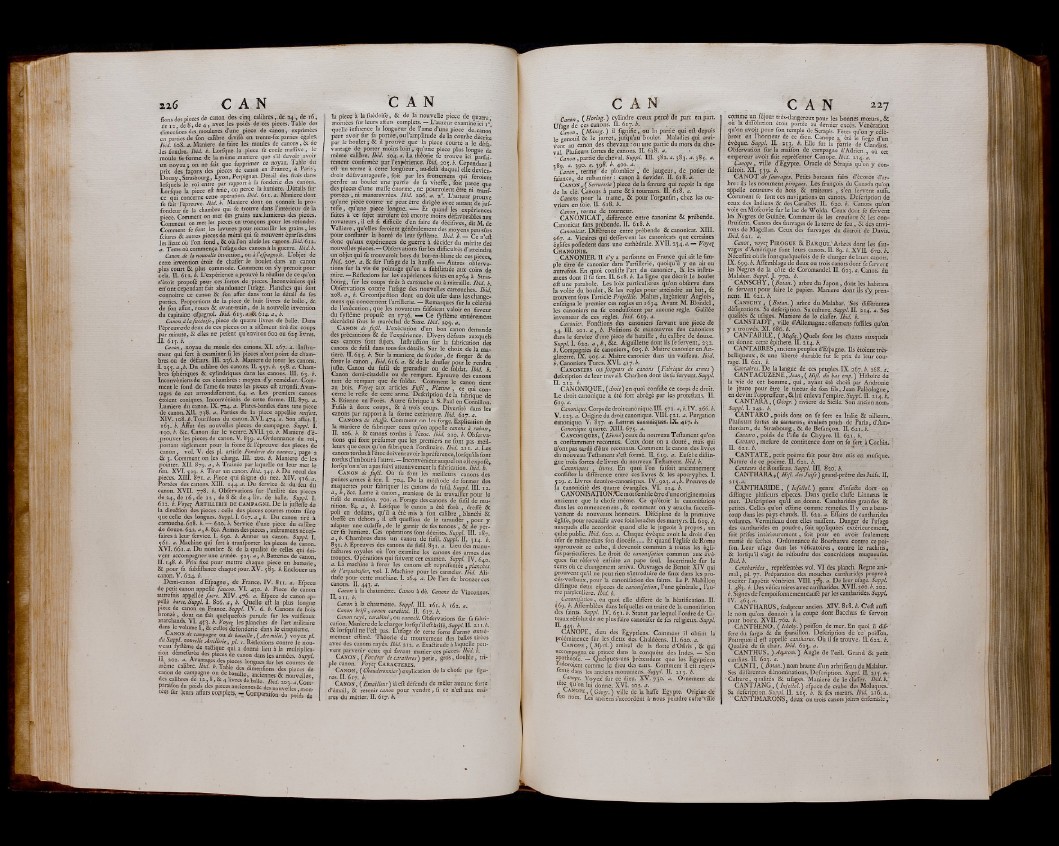
2 2 6 C A N 'C A N
fions des pièces de canon des cinq calibres, .de 14 , de 16,
de 12 de 8, de 4 , avec les poids de ces pièces. Table des
dimenfions.des moulures d’une piece de canon, exprimées
en parties de fon calibre divifè en trente-fix parties égales.
Ibid. 608. a. Maniere de faire les moules de canons, & de
•les fondre* Ibid. b. Lorfque la piece fe coule maifive, le
moule fe-forme de la même maniere que s’il devcwt^avoir
un noyau ; on ne fait que fupprimer ce noyau, iable du
prix des façons des pièces de canon en1 France, a rans,
Douay,Strasbourg, Lyon, Perpignan. Détail des frais dans
lefquels le roi entre par rapport a la fonderie des canons.
Lorfque la piece eli finie, on perce la ltumere. Détails fur
ce qui concerne cette opération, lhd. fin. a. Maniere dont
fe fait l’épreuve. Ibid. b. Maniere dont on connoit la profondeur
1
de la chambre qui fe trouve dans l’intérieur de la
piece. Comment on met des grains auxjuraieres des pièces.
Comment on met les pièces, en tronçons .pour les refondre.
Comment fe font les lavures .pour recueillir les grains, les
fciures & autres pièces de métal qui fe trouvent éparfes dans
-les lieux où Ton fond, & où-l’on alefeles canons. Ibid. 612.
a. Tems où commença l’ufagedes canons à la guerre. Ibid. b.
Canon Je la nouvelle invention., ou à l’efpagnole. L’objet de
cette invention étoit de chafferie boulet, dans un canon
plus court & plus commode. Comment on s’y prenoit pour
!çela. II. 612. b. L’êxpérience a prouvé la réuilite de ce qu’on
s’étoit propofépeur ces fortes de pièces. Inconvéniens qui
eri'ont cependant fait abandonner l’ufage. Planches qui font
■çonnoître ce canon 8c fon affût dans tout le détail de fes
parties. Proportions de la piece de huit livres de balle-, 8c
de fon affût, roues 8c avant-train, dela nouvelle invention
du capitaine èfpagnoL Ibid. 613. a.Sc 614.0, b.
. Canon à lafuidoifc, piece de quatre livres de balle. Dans
Tépreuve-de deux de ces pièces on a aifément tiré dix coups
r minute, 8c elles ne pefenfqu’environ 600 ou 625 livres.
. 615. b.
Canon, noyau du moule des. canons. XI. 267. ¿^Infiniment
qui fert à examiner fi les-pièces n’ont point de chambres
ou de défauts. III. 236.6. Maniere de forer les canons.
•L 255. 4,6. Du calibre des canons. II..537. b. 558. a. Chambres
fphériques 8c cylindriques dans les canons. III. 63. b.
Inconvéniens de ces chambres : moyen d’y remédier. Comment
le fond de l’ame de toutes les pièces eft arrondi. Avantages
de cet arrondiffement. 64. a. Les premiers -canons
étoient coniques. Inconvéniens de cette forme. III. 879. a.
Lumiere du canon. IX. 724. a. Plates-bandes dans ime piece
de canon. XII. 738. a. Parties de la piece appellée renfort.
XIV. 108. b. Tourillons du canon. XVL 474. 0. Son affût. I.
163. b. Affût des nouvelles pièces de .campagne. Suppl. I.
-190. k. 8cc. Canon fur le ventre. XVII. 30. b. Maniere d’é—;
.prouver les pièces de canon. V. 839. a. Ordonnance du roi,
portant règlement pour. la fonte 8c l’épreuve des pièces de
canon , vol. V. des pl. article Fonderie des canons, page 2
& 3. Comment on les charge. III. 200. b. Maniere de les
pointer. XII. 879. a, b. Traînée par laquelle on leur met le
feu. XVI. <29. b. Tirer un canon. Ibid. 345. b. Du recul des
fieces. XII1. 871.0. Piece qui feigne du nez. XIV. 516. a.
ortées des canons. XIII. 144.0. Du fervice 8c dufou du
canon. XVII. 778. b. Obfervations fur l’utilité des pièces
de.24, de 16, de 12 , de 8 8c de 4 liv. de balle. Suppl. I.
612. b. Voye^ A r t i l l e r i e DE campagne. De la jufteffe de
la direâion des pièces ; celle des pièces courtes moins fure
que celle des longues. SuppL I. 617.0,6. Du canon tiré à
cartouche. 618. b. — 620. b. Service d’une piece du calibre «
de douze. 622. a , b. 8cc. Armes des pièces, inftrumens nécef-
faires à leur fervice. I. 690. b. Armer un canon. Suppl. I.
561. o. Machine qui fert à tranfporter les pièces de canon.
XVI. 661. o. Du nombre 8c de la qualité de celles qùi doivent
accompagner une armée. 525.0,6. Batteries de canon.
II. 148. 6. Prix fixé pour mettre chaque piece en batterie
8c pour fa fubfiitance chaque jour.XV. 583. b. Enclouer un
canon. V. 624. 6. .
Demi-canon d’Efpagne, de France. IV. 811. o. Efpece
de petit canon appellé faucon. VI. 430. 6. Piece de canon
autrefois appellée facre. XIV. 476. o. Efpece de canon appellé
barce.Suppl. I. 806. 0 ,6 . Quelle eft la plus longue
piece de canon en France. Suppl. IV. 6. 6. Canons de bois
bronzé, dont on fait quelquefois parade fur les vaiffeaux
marchands. VL 453. 6. Voyez ^es planches de l’art militaire
dans le volume 1 , 8ç pelles de fonderie dans le cinquième.
CANON Je campagne o» de bataille, (Artmilit. ) voyez pl.
du Sappi, nouvelle Artillerie, pl. t. Réflexions contre le nouveau
M ime de taflique qui a donné lieu àia multiplication
démefurée des pièces de canon dans les armées. Suppl.
H p ■ H l i pièces longues fur les courtes de
meme cafibre. Ibid. t. Table des dùSenfions des pièces de
canon de campagne ou de bataille, anciennes & nouvelles,
des calibres de tp , 8, & 4 livres de balle. Ibid. aot. a. Coir.-
paraifou du poub des pièces anciennes & des nouvelles montées
fut leurs affûts complets. - Compataifon du poids de
la piece à la fuédoife, & de la nouvelle piece de quatre '
montées fur leurs affûts complets. — L’auteur examine ici i°.
•quelle influence la longueur de l’ame d’une piece de.canon
peut avoir fur fa portée , ou l’amplitude de la courbe décrite
par le boulet ; 8c il prouve que la piece courte a le désavantage
de porter moins loin,'qu’une piece plus longue de
même calibre. Ibid. 204. a. La tnéorie fe trouve ici parfaitement
confirmée par l’expérience. Ibid. 205.6. Cependant il
eft un terme à cette lohgùéur, au-delà duquel elle deviendrait
défavantageufe, foit par les frottemens qui feraient
perdre au boulet une‘partie de fa vîteffe,’ foit parce que
des pièces d’une maffe énorme, ne pourraient être ni transportées,
ni manoeuvrées. Ibid. 206. a. 20. L’auteur prouve
qu’une piece courte ne peut être dirigée avec autant de jufteffe,
qu’une piece longue..— Et quand les expériences
faites à 'Ce fujet auraient été encore moins défavorables aux
novateurs, il eft fi difficile d’en feire de décifives, dit M. de
Valliere, qu’elles feraient généralement des moyens peu sûrs
pour conftater la bonté de leur fyftême.' Ibid. B.— Ce n’eû
donc qu’aux expériences de guerre à décider 'du mérite des
nouvelles pièces. — Obfervations fur les difficultés d’atteindre
un objet qui fe trouverait hors du but-eri-blanc de ces pièces*
Ibid. 207. a. 8c fur l’ufage dé la hauffe. — Autres obferva-
tiôns fur la vis de pointage qu’on a fubftitüée aux coins de
mire. — Réflexions fur les expériences faites en 1764 à Strasbourg,
fiir les coups tirés à cartouche ou à mitraille. Ibid. 6.
Obfervations contre l’ufage des nouvelles cartouches. Ibid.
'208. a, b. Circonfpeétion dont on doit ufer dans leschange-
mens qui concernent l’artillerie. — Remarques fur la célérité
de l’exécution, que les novateurs feifoient valoir en feveur
du fyftême propofé en 1736. —- Ce fyftême entièrement
décrédité fous le maréchal de Saxe. Ibid. 209. a.
C a n o n de fußl. L’exécution d’un bon canon demande
des précautions 8c de l’expérience. Divers défauts auxquels
ces canons font fujets. Inftruétion fur la fabrication des
canons de fufil dans tous fes détails. ’Sur le choix de la matière.
II.615. 6. Sur la maniéré, de foùder, de forger 8c de
forer le canon , Ibid. 616. a. 8c* de le dreffer pour le rendre
jufte.. Canon du fùfil de grenadier ou de foldat. Ibid. b.
Canon demi-citadelle ou de rempart. Epreuve des canons
tant de rempart que dé foldat. Comment le canon tient
au bois. Voyez aux articles Fuß , Platine , ce qui concerne
le refte de cette arme. Defcription de la fabrique de
S. Etienne eri Forés. Autre fabrique à S. Paul en Cornillon.
Fufils à deux coups, 8c à trois coups. Diverfité dans les
canons par rapport à la forme extérieure. Ibid. 617. a.
C an on s de ckajfe. Comment on les forge. Explication de
la maniéré de fabriquer ceux qu’on appelle canons à ruban,
IT. 206.' 6. 8c canons tordus à l’étoc. Ibid. 210. 6. Obfervations
qui font préfumer que les premiers ne font pas meilleurs
que ceux qu’on fabrique à l’ordinaire. Ibid. 211. a. Les
canonstordus à l’étoc doiventavoir la préférence, lorfqu’ils font
tordus d’un bout à l’autre.— Inconvénient auquel on eft expofé*
lorfqu’on n’en apasfuivi attentivement la fabrication. Ibid. b.
C a n o n de fuß . Où fe font les meilleurs canons des
petites armes à fou: I. 704. De la méthode de former des
maquettes pour fabriquer les canons de fufil. Suppl. III. 12.
a, ¿,8cc. Lame à canon, manière de la travailler pour le
fufil de munition. 701. a. Forage des canons de fufil de munition.
84. a , 6. Lorfque le canon a été foré , dreffé 8c
poli en dedans, qu’il a été mis à Ton calibre /blanchi &
dreffé en dehors, il eft queftion de le tarauder , pour y
adapter une culaffe, de le garnir de fes tenons, 8c de percer
fa lumière. Ces opérations font décrites. Suppl. III. 187.
a , 6. Chambres dans un canon de fufil. Suppl. ïl. 314. b.
831. 6. Épreuves des canons de fùfil. 831. a. Lieu des manu-
feéhires royales où l’on examine les canons des armes dès
troupes. Opérations qui fuivent cet examen. Suppl. IV. 640.
a. Lz machine à forer les canons eft repréfentè e , planches
de Varquebufier, vol. I. Machine pour les canneler. Ibid. Alidade
pour cette machine. I. 264. a. De l’art de bronzer ces
canons. U. 443. a.
Canon à la chaumette. Canon à dé. Canons de Vinccnnes.
IL 211. 6.
Canon à la chaumette. Suppl. DI. 161. 6. 162. a.
Canon brifé, canon carabiné. H. 617. 6.
Canon rayé, carabiné , ou cannelé. Obfervations für fa fabrication.
Maniéré de le charger lorfqu’il eft brifé, Suppl. II. 211.6..
8c lorfqu’il ne l’eftpas. L’ufage de cette forte aarme extrêmement
eftimé. Théorie du mouvement des balles tirées
avec des canons rayés. Ibid. 212. a. Exactitude à laquelle peuvent
parvenir- ceux qui favent manier ces pièces. Ibid. b.
C a n o n , ( Fondeur de carafleres) petit, gros, double, tri- ;
pie canon. Voyez C a r a c t è r e s .
C a n o n , ( Chauderonnier) explication de la chofe par figu- J
res. II.’617. 6.
C a n o n , ( Emailleur) il eft défendu de mêler aucune forte
d’émail, 8c retenir canon pour vendre, fi ce n’eftaux mai- ‘
très du métier, n, 617.6.
C A N
Canon, ( Horlog. ) cylindre creux percé de part en part.
Ufage de ces canons. II. 617. 6. . . .
Canon, (Maneg.) il figmfie,,ou la partië qui eft depuis
le genouil 8c le jarret, jufqu’au boulet. Maladies qui arrivent
au canon des chevaux : ou une partie du mors du cheval.
Plufieurs fortes de, carions. IL 618. a.
■ Canon, partie dù chéval. Suppl. III. 382. a. 383. a. 385. a.
389. a. 390. a. 398. 6. 40o. a. ^ ^ -
' Canon, terme' de plombier , de jaugeur, de potier de
feïance, de rubannier : canon à devider. II. 618. a.
C a n o n , ( Serrurerie ) piece de la ferrure qui reçoit la tige
de la clé. Çancms à patte 8c à tournans. II. 618, a.
Canons pour la trame, 8c pour l’organfin, chez les ouvriers
en foie. II. 618. 6.
Canon, terme de tourneur.
■ CANONICAT, différence entre canonicat 8c prébende.
Canonicat fans, prébende. II. 618. 6.
Canonicat. Différence entre prébende 8c canonicat. XIII.
267. a. Vicaires qui deffervent les çanonicats que certaines
églifes poffedent clans une cathédrale.XVII. 234.a.— Voyez
C h an o in ie .
CANONIER. Il n’y a perfonrie en France qui ait le fim-
ple titre’de canoriier dans l’artillerie, quoiqu’il y en ait eu
autrefois. En quoi confifte l’art du canonier, 8c les iqftru-
mens dont il fe fert. II. 618.6. La ligne que décrit le boulet
éft une parabole. Les loix particulières qu’on obferve dans
la volée du boulet, 8c les réglés pour atteindre au but, fe
trouvent fous l’article Projeflile. Maltus, ingénieur Anglois,
ênfeigna le premier ces réglés en 1634. Avant M. Blondel,
les canoniers ne fe Condüifoient par aucune réglé. Galilée
inventèur de ces réglés. Ibid. 619. a.
Canonier. Fondions des canonieri fervant une piece de
24. III. 201. a , b. Pofitions 8c manoeuvres des canoniers
dans le fervice d’une riiéce de bataille, du calibre de! douze.
Suppl. I. 622. a , b t « c. Aiguillette dont ils fe fervent,' 232.
6. Compagnies de canoniers, 605.6. Maître' canonier en Angleterre.
IX. 905 . a. Maître canonier dans fin vaiffeau. Ibid.
b. Canoniers Turcs. XVL 4.17.6.
CANONÏERS ou forgeurs de canons {Fabrique des armes )
defcription de leur travail. Charbon dont ils fe fervent. Suppl.
n . 212. 6. H I
CANONIQUE, {droit) en quoi confifte ce corps de droit.
Le droit canonique a été fort abrégé par les proteftans. II.
619.4.
Canonique. Corps de droit canonique. III. 571.4,6.1V. 266.6.
y . 123. a. Origine du droit canonique. VIII. 521. a. Purgation
canonique. V. 837. a. Lettres canoniques. IX. 417. 6.
Canonique quarte. XIII. 675. a.
C an o n iq u e s , ( Livrés) ceux du nouveau Teftament qu’on
a conftamment reconnus. Ceux dont on a douté, mais qui
n’ont pas tardé d’être reconnus. Comment le canon des livres
du nouveau Teftamerit s’eft formé. H. 610. a. Eufebedifiin-
gue trois fortes dé livrés du nouveau Teftament. Ibid. b.
Canoniques , livres. En quoi l’on faifoit anciennement
confifter la différence entre ces livres 8c les apocryphes. I.
529. a. Livres deutéro-canoniques. IV. 923. a,b. Preuves de
la canonicité des quatre évangiles. VI. 114. 6.
CANONISATION.^ mot fomble être d’une origine moins
ancienne que la chofe même. Ce qu’étoit' la cauonifation
dans les commencemeris, 8c comment on y attacha fucceffi-
yement de nouveaux honneurs. Difcipline de la primitive
églife, pour recueillir avec foin les ailes des martyrs. II. 619.
auxquels elle accordôit quand elle le jugeoit à propos, un
culte public. Ibid. 620. a. Chaque évêque avoit le droit d’en
ùfer de même dans fon diocèfe Et quand l’églife de Rome
approuvoit ce culte, il devenoit commun à toutes les églifes
particulières. Le droit de canohifation commun aux évêques
fut réfervé en fuite au pape foui. Incertitude fur le
tems où ce changement arriva. Ouvrages de Benoît XIV qui
prouvent qu’il ne peut rien s’introduire de faux dans les procès
verbaux, pour la canohifation des feints. Le P. Mabillon
diftingue deux efpeces de cahonifation, l’une générale, l’autre
particulière. Ibid. 6.
. Canohifation, en quoi elle différé de la béatification. II.
169. 6. Affembléés dans lefquelles on traite de la canonifetion.
des feints. Suppl. IV. 651.6. Statut par lequel l’ordre de Ci-
teaux réfolut de ne plus faire canonifer de fes religieux. Suppl.
H. 445. 6..
CÀNOPE, dieu des Egyptiens! Comment il obtint la
prééminence fur les.dieux des Chaldéens. II. 620.. <z.
CaNope , ( Myth. ) amiral dé la flotte d’Ofiris'Î 8c qui
accompagna ce prince dans la conquête des Indes. — Son
apothéoie. Quelques-uris prétendent que les Egyptiens,
fadproient comme le dieu dès eaux. Comment il eft repré-
fonté dans les anciens monuniens. 5^/>p/. II. 213. 6.’
Canope. Voyez fur ce dieu. XV. 73'0! a. Ornement de
. 1 qu’o'ùlui donne. XVI. 202. .
Lanope , {.Géogr.) Ville de la baffe Egypte. Origine dé!
fori nom. Les anciens s’accorilèrif à-nous péindre ceftè’VÎÎÎë
C A N 227
j.’iî1 ,féi.our riès-dangereux pour les bonnes moeurs, 8c
ou là ailfolution étoit portée au dernier excès. Vénération
quon avoit pour fon temple de. Serapis. Fêtes qu’on y célébrait
en l’honneur de ce dieü. Canope a été le fiege d’un
évêque. Suppl. H. 213. 6. Elle fut la patrie de Claudius.
Obforvatidn fur la maifon de campagne d’Adrien , où cet
empereUr"avoit feit repréfenter Canope. Ibid. 214. a.
Çanope, ville d’Egypte. Oracle de Sérapis qu’on y con-
fultoit. XI. 539; 6.
CANOT de fauvages. Petits bateaux feits d’écorce d’arbre
: ils les nomment pirogues. Les françois du Canada qu’on
appelle coureurs de bois & traiteurs , s’én fervent auffi.
Comment fe font ces navigations en canots. Defcription de
ceux des Indiens ;& des Caraïbes. II. 620. 6. Canots qu’on
voit énMofcovie fur le lac de Wolda. Ceux dont fe fervent
lés Negres de Guinée. Commént ils les creufent 8c les con-
ftruifent. Canots des fauvages de la terre de feu, 8c des environs
de Magellan. Ceux des feuvages du détroit de Davis.
Ibid. 62i. a.
Canot, voyez P i r o g u e 8c B a r q u e .lArbres dont les fauvages'
d’Amérique font leurs canots. H. 89.6. XVII. 670..6.
Nécèffité où ils font quelquefois de fe charger de leurs canots.
IX. 699.6. Affemblage de deux ou trois canots dont fe fervent
les Negres de la côte de Coromandel. II. 623. 4. Canots du
Malabar. Suppl. J. 770. 6. •
CANSCHY, {Botan. ) arbre du Japon, dont les habitans
fe fervent pour faire le papier. Maniéré dont Us s’y prennent.
II. 621. 6.
C a n s c h y , {Botan.) arbre du Malabar. ‘Sés différentes
défignatioris. Sa defcription. Sa culture. Suppl. II. 214. a. Ses
qualités & ufages. Manière de le claffer. Ibid. b.
CANSTADT, vUle d’Allemagne: offemens foffiles qu’on
y a trouvés. XI. 686. 6. '
CANTABÏLE, ( Mufiq.) Quels font les chants auxquels
on donne cette épithete. il. 214. 6.
CANTABRES, anciens peuples d’Efpagne. Ils étoient très-
belliqueux , & une liberté durable fut le prix de leur courage.
II. 621. 6.
Cantabres. D e la langüe dé ces peuples. IX. 267.6. 268. a.
CANTACUZENE, Jean, ( Hijl. du bits emp.) Hiftoire de.
là vie de cet homme, qui, ayant été choifi par Andronic
le jêune pour être le tuteur,de fon fils, Jean Paléologue,
en devint i’opprcffeur,&lui ênlevaT’empire.Tapp/. II! 214.6,
CANTARA, ( Géogr. ) rivièrë de Sicüe. Sori ancien nom.
>/. I.142. 6. ,
ANTARO, poids dont on fe fert en Italie 8c ailleurs.
Plufieurs fortes de cantaros, évalués poids de Paris, d’Am-
fterdam, de Strasbourg, 8c de Befançon. II. 621.6.
Cantaro, poids de l’i fie de. Chypre. U. 621. 6.
Cantaro, mefure de continence dont ori fe fort àCochîn.
IL 621. 6.
CANTATE, petit poëmè feit pour être mis en mUfique.
Nature de ce .poème. II. 621. 6.
Cantates de Rouffeau. Suppl. III. 820.' 6.
CANTHARA * ( Hifl. des Juifs) grand-prêtre .des Juifs. IL
21 k. a.
CANTHARIDE, ( Infedol. ) genre d’infeéle dont' • on
diftingue plufieurs efpeces. .Dans quelle daffe Linnæus le
met. Defcription qu il en .donne. Cantharides grandes 8c
petites. Celles qu’on éftime comme remedes. Il y en a beaucoup
dans les pays chauds. II. 622. a. Effeins de cantharides
volantes. Vermiffeau dont elles naiffent. Danger de l’ufage
des cantharides eri poudre, foit appliquées extérieurement,
foit prifes intérieurement, foit pour en avoir feulement
manié de' fcches. Ordonnance de Boerhaave contre ce poi-
fon. Leur ufage dans les véficatoires, contre le rachitis,
8c lorfqu’il s’agit de réfoudre des concrétions muqueufes.
Ibid. b.
Cantharides, rèpréfentées vol. VI dès plâneh. Regne animal
, pl. 77. Préparation des mouches cantharides propre à
exciter l’àppétit vériérien. VIII. 3^9. a. De leur ufage. Suppl.
I. 483. 6. Des véficatoires avec cantharides. XVII. 200.6. 20.2.
6. Signes de l’empoifonnementcaùfé par les cantharides. Suppl.
IV. 464. a.
CANTHARUS,fculpteur ancien. XIV. 818. B. C’eft aûfli
le nom qu’on ! donnoit a la coupe dont Bacchus fe fervoit
pour boire. XVII. 760. 6.
CANTHENO, ( Ichthy. ) poiffon de mer. En quoi il dif- '
fore du fargo 8c du fparaillon. Defcription dè'cè‘, poiffon.
Pourquoi il eft appellé canthàrus. Où il fe trouve, IL 622. 6.
Qualité de fa chair. Ibid. 623. a.
CANTHUS, ).Atyitom.) Angle de l’oeil. Grarid'8c petit-
cànttius. II.'623. a.
CANTI, ( Botan.) nom brame-d’un arbriffeau du Malabar.
Ses différentes dénominations. Defcription. Suppl. IL'215. a.-
•GultUre, qualités 8c ufages. Maniéré' de le claffer. Ibid.b.\
CANTJANG, {Injcflàl.) efpece de crabe dès. Moluques. .
Sa defcription. Suppl. II. 215. 6.‘ 8c fes moeurs. Ibid. 216.4...
CAN 1 IMARONS, deux ou trois canots joints énfemblc