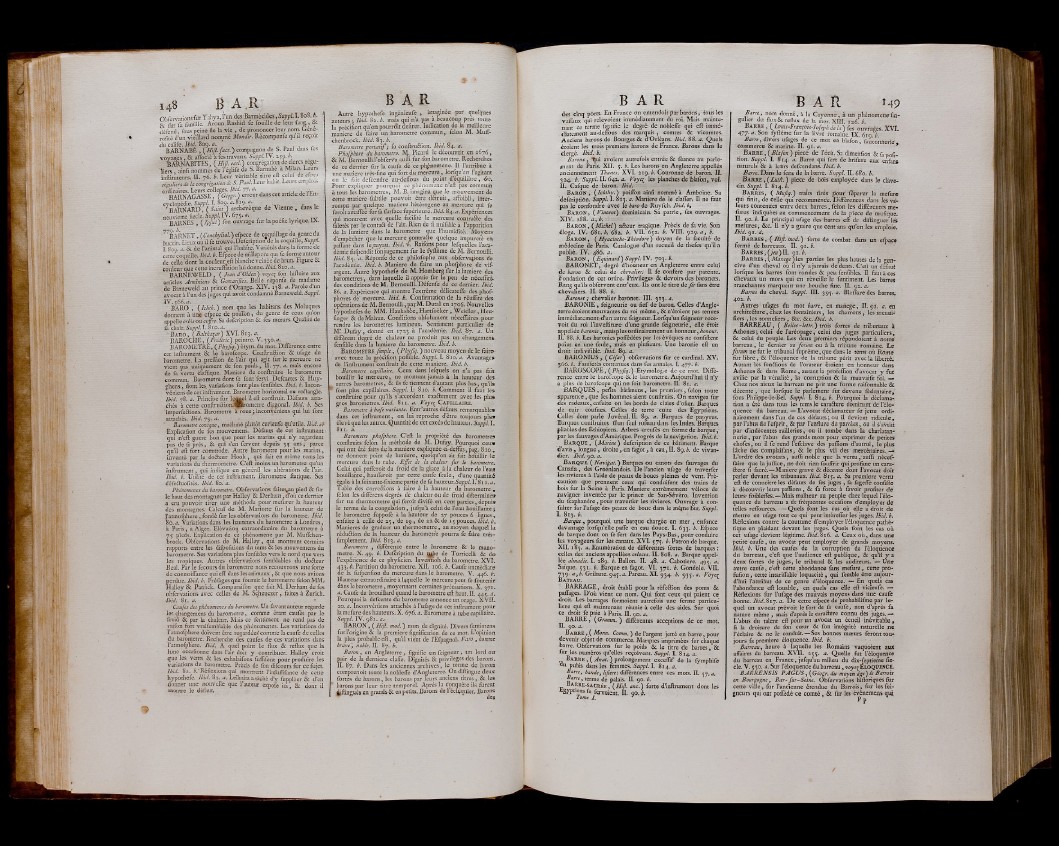
148 B A.R
ObftrvationsiurY3l.y»,l’un¿ ^ m è à i c S ,S ù p Pl . ï .9oS.t. S
& fur fa famille. Aroun.Rashid fe fouille de leur fane, oc
défend, fous peine de la vie , de prononcer leur nom. Géné-
rofité d’un vieillard nommé Mondir. Rêcompenfe qu’il reçoit
du calife. lbid.'809. a.
BARNABÊ , ( Hifi. facr. ) compagnon de S. Paul dans les
voyages I 8c affociè a fes travaux. Suppl. IV. 250. b.
BAkNABITES, ( Hifi . ceci.) congrégation (leclercs réguliers
! ainfi nommés de l’églife de S. Barnabe a Milan. Leurs
inftituteurs-. U. 76. b. Leur véritable titre eft celui de clercs
réguliers de la congrégation de S. Paul. Leur habit. Leurs emplois
ordinaires. Leurs collèges, lbid. 77. a. ,
BARNAGASSE, CGéogr.) erreur dans cet arncle de 1 Encyclopédie.
Suppl. I. 809. A 819. .
BARNARD, (¿Saint ) arebeveque de Vienne , dans le
neuvièmefiecle.Suppl.IV .675.a.
BARNÈS , (Jpfuè) f°n ouvrage fur lapoéfie lyrique. IX.
77|aRNET , ( Conchyliol.) efpece de coquillage du genre du
buccin. Lieux où il fe trouve.Defcription de la coquille, Supjri.
I 809. a. 8c de l’animal qui l’habite. Variétés dans la forme de
cette coquille, lbid. b. Efpece de millepore qui fe forme autour
de celle dont la couleurfceft blanche veinée de brun. Figure &
couleur que cette incruftation lui donne. lbid. 810. a.
BARNEV/ELD , ( Jean d’Olden } voye[ fon hiftoire aux
articles Arminiens 8c Gomarifles. Belle reponfe. de madame
de Barneweld au prince d’Orange. XIV. 128. a. Parole d’un
avocat | l’un des juges qui avoit condamné Barneweld. Suppl.
^ Bj\RO , ( Ichth.) nom, que les habitans des Moluques
donnent à line efpece de poiffon, du genre de ceux qu’on
appelle orbis ou coffre. Sa defeription Sc fes moeurs. Qualité de
f i chair. Suppl. I. 810. a.
BarO, (Balthaçar) XVI. 813. a.
BAROCHE, (Frédéric) peintre. V . 330.a.
BAROMETRE, ( Phyfiq.) étym. du mot. Différence entre
cet inilrument & le barofeope. Conftruétion & ufage du
baromètre. La preffion de l’air qui agit fur le mercure ne
vient pas uniquement de fon poids, II. 77. a. mais encore
de fa vertu èlaftique. Maniéré de conftrüire le baromètre
commun. Baromètre dont fe font-fervi Defcartes & Huy-
ghens, dont les. variations font plus-fenfibles. lbid. b. Ineon-
véniensde cet inilrument. Baromètre horizontal ou reâangle.
lbid. 78. a. Principe fur lçtmel il eft conftruit. Défauts attachés
à cette conflruélionj^prometre diagonal, lbid. b. Ses
imperfeélionsi Baromètre à roue^ inconvéniens qui lui font
attachés, lbid. 79. a. •
‘ Baromètre conique, machine plutôt curieufe qu’utile, lbid. ai
Explication de fes mouvemens. Défauts de cet inilrument 1
qui n’eft guere bon que pour les marins qui n’y regardent
pas de fi près, 8c qui s’en fervent depuis 3.5 ans, parce
qu’il eil fort commode. Autre baromètre pour les marins,
inventé, par le doéteur Hook, qui fait en même tems les
variations du thermo'metre. C’eft moins un baromètre qu’un
infiniment, qui indique en générjfl les altérations de l’air..
lbid. b. Utilité de cet inilrument. Baromètre fiatique. Ses
défeéluofités. lbid. 80.' a.
Phénomènes du baromètre. Obfervations faiteyiu pied 8c fur
le haut des montagnes par Halleÿ & Derham | d’où ce dernier
a cru pouvoir tiref; une méthode pour mefurer la hauteur
des montagnes. Calcul' de M. Mariotte fur la hauteur de
Tatmofiïhere, fondé fur les obfervations du baromètre. lbid.
86. a. Variations dans les hauteurs du baromètre à Londres,
à Paris I à Alger. Elévation extraordinaire du baromètre a
75 pieds. Explication de ce phénomène par M. Muffchen-
bvock. Obfervations de M. Halley, qui montrent certains
rapports entre les difpofitions 'du tems 8c les mouvemens du
baromètre. Ses variations plus fenfibles vers le nord que vers
les tropiques. Autres obfervations femblables du doéleur
Beal. Par le fecours du baromètre nous recouvrons une forte
de connoilfancc quieff dans les animaux, & quë nous avions
perdue. lbid. b. Préfages que fournit le baromètre félon MM.-
Halley & Patrick. Comparaifon que fait M. Derham de fes
obfervations avec celles de M. Scheuczer, faites à Zurich.
■lbid. 81. a. '
Caufes des phénomènes du barometre.XJn favant auteur regarde
les çhangemens du baromètre, comme étant caufés par le
froid & par la chaleur. Mais ce fonriment ne rend pas de
raifon fort vraifemblable des phénomènes. Les variations de
Tatmofphere doivent être regardée? comme lacaufe de celles
du baromètre. Recherche des caufes de ces variations dans
l’atmofphere. lbid. A quel point le flux & reflux que la
lune occafionne dans l’air doit y contribuer. Halley croit
que les vents & les exhalaifons fuffifent pour produire les
variations du baromètre. Précis de fon diieours fur ce fujet.
lbid. 8 j . b. Réflexions qui montrent l’infuffifance de cette
hypothefe. lbid. 82. a. Leibnitz a tâché d’y fupplécr & d’en
donner une nouvelle que l’auteur expofe ici, & dont il
montre le défaut.
BAR Autre hypothefe ingénieufe , imaginée par quelques
a u t e u r s V 82. b. mais qui n’a pas à beaucoup près toute
la précifion qu’on pourrait aefirer. Indication de la meilleure
manière de faire un baromètre commun, félon M. Muff-
chenbrock. lbid. 83. b.
Baromètre portatif i fil conftruélion. lbid, 84. a.
Phofphore du baromètre. AL Picard le découvrit, en 1676,
& M. Bernoulli .Î’obferVa aufii fur fon baromètre. Recherches
de ce dernier fur la caufe dé ce pl^nomene. Il l’attribue à
une matière très-fine qui fort du mercure, lorfqu’cn 1 agitant
on le fait defeendre au-deflous du point d’équilibre, &c.
Pour expliquer pourquoi cé phénomène n’efi pas commun
à tous les baromètres, M. B. imagina.que le mouvement de
cette matière fubtile pouvoir être détruit, aftoibli, interrompu
par quelque matière hétérogène au mercure qui fe
feroit amaffée fur fa furface fupérieurc. lbid. 84. a. Expériences
qui montrent avec quelle facilité le mercure contrafte des
laletés par le contaél de l’air. Rien de fi nuifible à l’apparition
de la lumière dans le baromètre que. l’humidité. Moyen»
d’empêcher que le mercure çontrafte quelque impureté eh
paffanr dans îe.tuyau. lbid. "b. Raifons pour lefquelles l’académie
fufpendit fon jugement fur le fyftême de M. Bernoulli.
lbid. 85. a. Réponfe de ce philofophe. aux obfervations de
l’académie, lbid. b. Maniéré de faire un phofphore de vif-
argent. Autre hypothefe de M. Homberg fur la lumière des
baromètres, dans laquelle il appuie fur le peu de néceffité.
des conditions de M. Bernoulli. Défenfe de ce dernier. lbid.
86. a. Expérience qui montre l’extrême délicateffc des phof-
phores de‘ mercure, lbid. b. Confirmation de la réuifite des
opérations de M. Bernoulli, par M. Dutal en 1706. Nouvelles
hypothefes de MM. Hauksbée, Hartfoëker, Ve id lc r , Heu-
finger &deMairan. Conditions abfolument néceffaires pour
rendre les baromètres lumineux. Sentiment particulier de
M! Dufby, donné en 1723 à l’académie, lbid. 87. a. Un
différent degré de chaleur ne. produit pas un çhangemens
fenfible dans la lumière du baromètre, lbid. b.
Baromètre fimple, ( 'Phyfiq. ) nouveau moyen de le faire
. avec toute la nrécifion pornble. Suppl. I. 810. a. Avantages
de l’inftrumént confirait de cette maniéré, lbid. b. .
Baromètre capillaire. .Ceux dans lefquels on n’a pas fait
bouillir le mercure, ne montent jamais à la hauteur des
autres baromètres, 8c ils fe tiennent d’autant plus bas, qu’ils
P font plus capillaires. Suppl. I: 810. b. Comment il faut les
conflruire pour qu’ils s’accordent exactement avec les plus
gros baromètres, lbid. 811. a. Voye{ C apillaire.
Baromctre à bafe variante. Entr’autres défauts, remarquables
dans cet infiniment, on lui reproche d’être toujours plu»
élevé que les autres. Quantité de cet excès de hauteur. Suppl. I.
811. t.
Baromètre phofphore. C’eft la propriété des baromètres
confiruits' félon la méthode de M. Dufay. Pourquoi ceux
qui ont été faits de la maniéré expliquée ci-deflus, pag. 810,
ne donnent point de lumière, quoiqu’on ait fait bouillir le
mercure dans le tube. Effet de la chaleur fur le baromètre.
Celui qui pafferoit du froid de la glace à la chaleur de l’eau
bouillante, haufferoit par cette caufe feule, d’une quantité
égale, à la foixante-fixieme partie de fa hauteur. Suppl. 1. 811. a.
Table des corrections à faire à la hauteur du baromètre ,
félon les différens degrés de chaleur ou de froid déterminé»
fur- un thermomètre qui feroit divifé en cent parties, depuis
le terme de la congélation, jufqu’à celui de l’eau bouillante ;
le baromètre fuppofe à la hauteur de 27 pouces 6 lignes,
enfiiite à celle de 25, de 19, de 22 8c de 15 pouces, lbid. b.
Maniérés de graduer un thermomètre, au moyen duquel la
réduClion de la hauteur du . baromètre pourra fe faire très-
fimplement. lbid. 813. a.
Baromètre , différence entre le baromètre & le manomètre.
X. 49. b". Defeription du tube de Torricelli 8c de-
, l’expérience de ce phyficien. Inveiraoh du baromètre. XVI.
433. b. Partition du baromètre. XII. 106. b. Caufe immédiate
de la fufpenfion du mercure dans le baromètre. V. 446. %
Hauteur extraordinaire à laquelle le mercure peut fe foutenir
dans le baromètre, moyennant certaines précautions. X. 371.
a. Caufe du brouillard quand le baromètre eft haut. II. 44e. a.
Pourquoi la defeente du baromètre annonce un orage. XVIL
20. a. Inconvéniens attachés à l’ufage de cet inilrument pour
lamefure des hauteurs. X. 676. a. Baromètre à tube capillaire.
Suppl. IV. 081. ¡g.
BARON, ( Hifi. mod. ) nom de dignité. Divers fentimens
fur l’origine 8c la première fignification de ce mot. L’opinion
la plus probable eft, qu’il vient de l’Efpagnol. Varo | homme
brave j, noble. II. 87. b.
Baron, en Angleterre, fignifie un feigneur, un lord oir
pair de la derniere claffe. Dignités 8c privilèges des barons.
II. 87. b. Dans les anciennes archives, le terme de baron
comprenoit toute la nobleffe d’Angleterre. _On diftingue deux
fortes de barons, les barons par leurs anciens titres, 8c les
* barons par leur titre temporel. Après la Conquête ils furent
¿ftingués en grands 8c en petits. Barons de 1 échiquier. Barons
BAR des cinq ports. En France On eiitendoit par barôns, fous les
vaffiiux qui relevoicnt immédiatement dü roi. Mais maintenant
ce terme fignifie le degré de nobleffe qui eft immédiatement
au-deffous des marquis » comtes 8c vicomtes.
-Anciens barons de Bourges 8c d’Orléans. lbid. 88. a. Quels
¿toient les trois premiers barons de France. Barons dans le
clergé. lbid. b.
Barons, t[ui avoient autrefois entree 8c féance au parlement
de Paris. XII. ç. b. Les barons en Angleterre appellés
anciennement Thanes. XVI. 219. b. Couronne de baron. II.
324. b. Suppl.li. 642. a. Voyeç les planches de blaion, vol.
H. Cafque de baron.- lbid,
Ba r o n , ( Ichthy. ) poiffon ainfi nommé à Amboine. Sa
defeription. Suppl, I. 813. a. Maniéré de le claflen II ne faut
pas le confondre avec le baro de Ruyfch. lbid. b.
Ba r o n , ( Vincent) dominicain. Sa patrie, fes ouvrages.
XIV. 288. at b. .
B a r o n , ( Michel) aéleur tragique. Précis de fa vie. Son
¿loge. IV. 681. b. 682. b. VIL 632, b. VIII. 929. a, b.
B a r o n , (Hyacinthe-Théodore) doyen de la faculté de
médecine de Paris. Catalogue d’un recueil de thefes qu’il a
publié. IV. 486. a.
Ba r o n , (Equinard) Suppl, IV. 703. b.
BARONET, degré d’honneur en Angleterre entre celui
de baron 8c celui ue chevalier, Il fe conféré par patente.
Fondation de cet ordre. Privilèges 8c devoirs des baronets.
Rang qu’ils obfervent entr’eux. Ils ont le titre de fir fans être
chevaliers. II. 88. b.
Baronet ; chevalier baronet. III. 313 .a.
BARONIE, feigneurie ou fief de baron. Celles d’Angle-*
terre étoient mouvantes du roi même, 8c n’étoient pas tenues
immédiatement-'d’un autre feigneur. Lorfqu’un feigneur rece-
voit du roi l’inveiliture d’une grande feigneurie, elle étoit
appeliée baronie, mais plus ordinairement un honneur, honour.
II. 88. b. Les baronies poffédées par les évêques ne confiftent
point en une feule, mais en plufieurs. Une baronie eft un
droit indivifible. lbid. 89. a.
BARONIUS , ( Céfar) obfervations fur ce cardinal. XV.
366. b. Faufiètés contenues dans fes annales. I. 477. b.
BAROSCOPE, (Phyfiq.) Étymologie de ce mot. Différence
entre le barôlcope 8c le- baromètre. Aujourd’hui il n’y
a plus de barofeope qui ne foit baromètre. II. 81. a.
BARQUES , petits bâtimens, les premiers, félon toute
apparence, que les hommes aient confiruits. On navigea fur
des radeaux, enfuite on les borda de claies d’ofier. Barques
de.-cuir coufues. Celles de terre cuite des Egyptiens.
Celles dont parle Juvénal. II. 89. a. Barques de papyrus.
Barques confinâtes d’un feul rofeau dans les Indes. Barques
pliables des Étliiopiens. Arbres creufés en forme de barque ,-
par les fauvages d’Amérique. Progrès de la navigation, lbid.b.
Ba rqu e , (Marine ) defeription de ce bâtiment. Barque
d’avis, longue , droite, en fagot, à eau,H. 89.b. de vivandier.
lbid. 90. a.
B arqu e. ( Navigat. ) Barques ou canots des fauvages du
Canada, des Groënlandois. De l’ancien ufage de traverfer
les rivieres à l’aide de peaux de boucs pleines de vent. Précaution
que prennent ceux qui conauifent des trains de
bois fur la Seine à Paris. Maniéré extrêmement véloce de
naviguer inventée par le prince de San-Sévéro. Invention
du feaphandre, pour traverfer les rivieres. Ouvrage à con-
fulter fur l’ufage des peaux de bouc dans le même but. Suppl.
I. 813. b.
Barque, pourquoi une barque chargée en mer , enfonce
davantage lorfqu’elle paffe en eau douce. I. 633. b. Efpece
de barque dont on fe fert dans les Pays-Bas, pour conduire
les voyageurs fur les canaux. XVI. 575. b, Patron de barque.
XII. 185. a. Enumération de différentes fortes de barques :
celles des anciens appellées celoces. II. 808. a. Barque appel-
lée almadie. I. 289. b. Ballon. II. 48. a. Cabotiere. 493. a.
Saïque. 331. b. Barque en fagot. VI. 371. b. Gondole. VII.
739. a, b. Gribane. 943. a. Pareau. XI. 934. b. 93 3. a. Voyez
B ateau.
BARRAGE, droit établi pour la réfection des ponts 8c
paffages. D’où vient ce nom. Qui font ceux qui paient ce
droit. Les barrages formoient autrefois une ferme particulière
qui eft maintenant réunie à celle des aides. Sur quoi
ce droit fe paie à Paris. II. 90. a.
BARRE, ( Gramm. ) différentes acceptions de ce mot.
H. 90. a.
B arre , ( Monn. Comm. ) de l’argent jetté en barre, pour
devenir objet de commerce. Marques imprimées fur chaque
barre. Obfervations fur le poids 8c le titre de barres, 8c
]es numéros qu’elles reçoivent. Suppl. I. 814. a.
Barre , ( Anat. ) prolongement cxcefïif de la fymphife
du pubis dans les femmes. Suppl. I. 814. a.
Barre y bande, lifiere: différences entre ces mots. II. 37. a.
■ ~?arre » terme de palais. II. 90. b.
carre-sacrée , ( Hifi. anc. ) forte d’inftrument dont les
Egyptiens fe fervoient. II. 90. b.
Tome. 1, * '
BAR M9 Barré, nom donné, à la Gayenne, à un pfiénomcne fin-
guher du flux 8c reflux de la mer. XIII. 126. b.
B a rre , (Louis-François-Jofephdelà) fes ouvfaêes. XVL
477-a- Sun fyftême fur la livre romaine. IX. 6ia b
Barre, divers ufages de ce mot en blafon, faucoiifieriê,
commerce 8c marine. II. 9i.a.
B a r r e , (Blafon) piece de l’édi. Sa diiheiifion 8cfapofi-
tion. Suppl. I. 814. a. Barre qui fert de brifure aux enfans
naturels 8c à lcürs defeendans. lbid. b.
Barre. Dans le fens de la barre. Suppl. H. 680. b,
B a rre , (Luth, ) pièce de bôis employée dans le clavecin.
Suppl. I. 814. b.
Ba rres, ( Mufiq.) traits tirés pour feparer la mefure
qui finit, de celle qui recommence. Différences dans les y«f-
leufs contenues entre deux barres, félon les différentes me-
fures indiquées au commencement de la piece de mufique.
II. 90. b. Le principal ufage des‘barres eft de diftinguer les
meiures, 8cc. Il n’y a guere que cent ans qu’on les emploie.
lbid. 91. d.
Ba r r e s , (tiifi.mod.) forte de combat dans un eipace
fermé de barreaux. II. 91. b.
B arres , (jeu ) II. 01. b.
B arres , Mar.ege ) les parties les plus hautes delà gencive
d’un cheval ou il n’y a jamais de dents. C’eft un défaut
lorfque les barres font rondes 8c peu fenfibles. Il fiiut à ces
Chevaux un mors qui en réveille le fentiment. Les barres
tranchantes marquent une bouche fine. II. 92. a.
Barres du cheval. Suppl. III. 393. a. Ble-ffure des barres,
402. b.
Autres ufages du mot barre, en maiiege, II. 95. a. en
architecture, chez les fontainiers, les charrons, les menui-
fiers, les tonneliers * 8cc. 8cc. lbid. b.
BARREAU, ( Belles-lettr.) trois fortes de tribunaux à
AtheneS; celui de l’aréopage, celui des juges particuliers,
8c celui du peuple. Les deux premiers répondoient à notrO
barreau, le dernier au forum ou à la tribune romaine. Le
forum ne fut le tribunal fuprème,que dans le tems où Rome
fut libre, 8c l’éloquence de la tribune périt avec la liberté.
Autant les fondions de l’orateur ètoient en honneur dans
Athènes 8c dans Rome, autant la profefiion d’avocat y fut
avilie par la vénalité, la corruption 8c la mauvaife foi. —
Chez nos aïeux le barreau ne prit une forme raifonnable 8c
décente, que lorfque le parlement fut devenu fédentaire,
fous Philippe-le-Bel. Suppl. I. 814. b. Pourquoi la déclamation
a été dans tous les tems le caraélere dominant de l’éloquence
du barreau. — L’avocat déclamateur fe jette ordinairement
dans l’un de ces défauts ; ou il devient ridicule,
par-l’abus de l’efprit, 8c par l’enflure de paroles, ou il s’avilit
par d’indécentes railleries, ou il tombe dans la charlatan-
ncrie, par l’abus des grands mots pour exprimer de petites
chofes,ou il fe rend l’efclave des paflions d’autrui, le plus
lâche des Complaifans, 8c le plus vil des mercénaires., —
L’ordre des avocats, aufli noble que la vertu,-aufli nécefi-
faire que la juftice, ne doit rien fouffrir qui profane un cara-
élere fi facré.— Maniéré grave 8c décente dont l’avocat doit
parler devant les tribunaux, lbid. 813. a. Sa première verru
eft de connoître les défauts de fes juges, fa fageffe confifte
à découvrir leurs paflions, 8c fa force à favoir profiter de
leurs* foibleffes.— Mais malheur au peuple chez lequel l’éloquence
du barreau a de fréquentes occafions d’employer de
telles reffources. — Quels font les cas où elle a droit de
mettre en ufage tout ce qui peut intéreffer les juges, lbid. b.
Réflexions contre la coutume d’employer l’éloquence pathétique
en plaidant devant les juges. Quels font les cas où
cet ufage devient légitime.lbid.816. a. Ceux où, dans une
petite caufe, un avocat peut employer de grands moyens.
lbid. b. Une des caufes de la corruption de l’éloquence
du barreau, c’eft que l’audience eft publique, 8c qu’il y a
deux fortes de juges, le tribunal 8c les auditeurs. — Une
autre caufe, c’eft cette.aboildance fans mefure, cette pro-
fùfion, cette intariffable loquacité, qui femble être aujourd’hui
l’attribut de ce genre d’éloquence. — En quels cas
l’abondance eft louable, en quels cas elle eft vicieufè. —
Réflexions fur l’ufage des mauvais moyens dans une caufè
bonne, lbid. 817. a. De cette efpece de probabilifme par lequel
un avocat prévoit le fort de fa caufe, non d’après fa
nature même, mais d’après le caraétere connu des juges. —
L’abus du talent eft pour un avocat un écueil inévitable ,
fi la droiture de fon coeur 8c fon intégrité naturelle ne
l’éclaire 8c ne le conduit.— Ses bonnes moeurs feront toujours
fa première éloquence. lbid. b.
Barreau, heure à laquelle les Romains vaquoient aux
affaires du barreau» XVII. 233. a. Quelle fut l’éloquence
du barreau en France, jufqu au milieu du dix-feptieme fiecle.
V. 330. a. Sur l’éloquènce du barreau, voyez Éloquence.
BARRENS1S PÂGUS, (Géogr. du moyen âge) fe Barrois
en Bourgogne, Bar- fur-Seine. Obfervations hiftoriques fur
cette ville, fur l’ancienne étendue du Barrois, fur lesfei-
gneurs qui ont poffédé ce comté, 8c fur les événemens qui