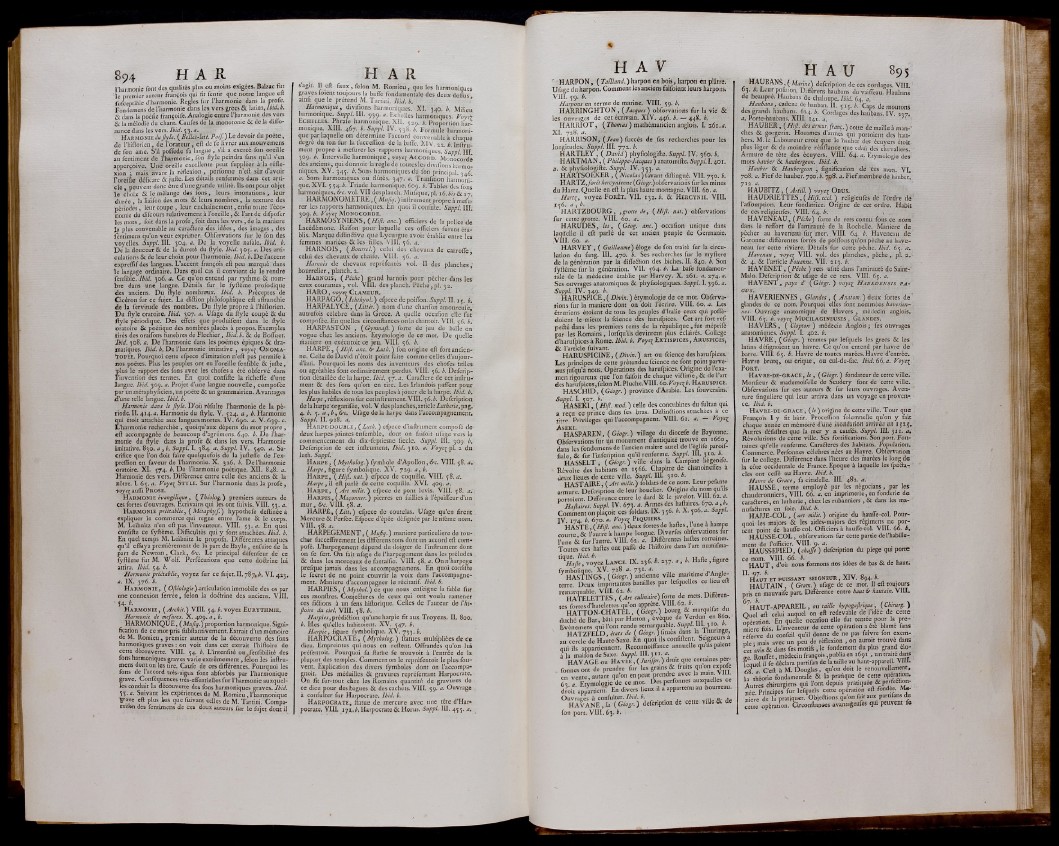
894 H A R
l'harmonie font des qualitis plus ou moins exigées. Balzzc fut
le premier auteur françois qui fit fcntir que notre langue eit
fiifceptible d’harmonie. Regles fur l’harmonie dans la profe.
Fondcmens de l’itarmonie dans les v e r s grecs & latins, Ibid. b.
& dans la poéfie françoife. Analogie entre l’harmonie des vers
& la mélodie du chant. Caufes de la.monoionic & de la diffo-
nance dans les vers. Ibid. 53. a . ■•
Harm o n ie du fly le . ( Belles-lett. P o é f.) Le devoir du p o e te ,
de l’hiftoricn, de l’o rateu r, efl de fe livrer aux mouvemens
de fon ame. S’il poffede fa langue, s’il a exerc¿ ion oreille
au fentimenr de l'harmonie, Ton fly le peindra fans qu’ il s’en
apperçoive. Une oreille excellente peut fuppléer à-la réflexion
• mais avant la réflexion , perfonne n’eft sûr d’avoir
ro réilie dêücate & ju ñ e . Les détails renfermés dans cet article
, peuvent donc être d’une grande utilité: Ils ont pour objet
le choix & le mélange des io n s , leurs intonations , leur
durée la liaiibn des mots & leurs nombres, la texture des
périodes, leur coupe , leur enchaînement, enfin toute l’économie
du difeours relativement à l ’o çe ille, & l’art de difpofer
les mots, (oit dans la p ro fe, foit dans les v e r s , de la maniere
ja plus convenable au caraûcre des idées, des imagos , des
jèntimens qu’on v eu t exprimer. Obfervations fur le fon des
voyelles. Suppl. III. 304. a. D e la v o y e lle nafale. Ibid. b.
D e la douceur & de la dureté du flyle. Ibid. 305. a. Des articulations
& de leur choix pour l’harmonie. Ibid. b. D e l’accent
expreflif des langues. L ’accent françois eit peu marqué, dans
le langage ordinaire. Dans quel cas il convient de le rendre
fenfible. Ibid. 306 . a. C e qu’on entend par rythme & nombre
dans une langue. Détails fur le fyitéme profodique
des anciens. D u fly le nombreux. Ibid. b. Préceptes de
Cicéron fur ce fuiet. La diétion philofophique efl affranchie
de la fervitude des nombres. D u fly le propre à l’hiflorien.
D u flyle oratoire. Ibid. 307. a. Ufage du f ly le coupé & du
fly le périodique. Des effets que produifent dans le fly le
oratoire & poétique des nombres placés à propos. Exemples
tirés des oraifons fúnebres de F lechier, Ibid. b. & de Bofluet.
Ibid. 308. a. D e l'harmonie dans les poèmes épiques & dramatiques.
Ibid. b. D e l’harmonie imitative , voyeç O n o m a -
*topee. Pourquoi cette efoece d’imitation n’efl pas permife à
nos poètes. Plus les peuples ont eu l’oreille fenlible & ju f le ,
plus le rapport des fons avec les chofes a été obfervé dans
Î’invention des termes. En quoi confifle la richefle d’une
langue. Ibid. 309. a. Projet d’une langue n ou ve lle, compofée
par un métaphyficien, un poète & un grammairien. Avantages
d ’une telle langue. Ibid. b.
Harmonie dans le fly le . D ’où réfulte l’harmonie de la période.
II. 4 14 .a. Harmonie du fly le. V . 524. a , b. Harmonie
Îui étoit attachée aux langues mortes. IV . 690. a . V . 639. c.
.’harmonie recherchée, quoiqu’aux dépens du mqgptôpre ,
efl accompagnée de beaucoup d’agrémens. 640. b. D e l’harmonie
du fly le dans la profe & dans les vers. Harmonie
imitative. 830. a , b. Suppl. I. 384. a., Suppl. IV . 540. a. Sacrifice
que l’on doit faire quelquefois de la jufteffe de l’ex-
preflion en faveur de l’harmonie. X . 326. b. D e l’harmonie
oratoire. X I . 574. b. D e l’harmonie poétique. XII. 848. a.
Harmonie des vers. Différence entre celle des anciens & la
nôtre. I. 63. a. Voye^ St y l e . Sur l’harmonie dans la p ro fe ,
voyc^ aufli P rose.
H a rm o n ie évangélique, ( Théolog. ) premiers auteurs de
ces fortes d’ouvrages. Ecrivains qui les ont fuivis. VIII. 53. a.
H a rm o n ie préétablie, ( Mé ta phy f.) hypothefe deflinée à
expliquer le commerce qui regne entre l’ame & le corps.
M. Leibnitz n’en efl pas l’inventeur. VIII. 33 .a . En quoi
confifle ce fyflême. Difficultés qui y font attachées. Ibid. b.
En quel temps M. Leibnitz le propofa. Différentes attaques
qu’il efluya premièrement de la part de B a y le , enfuite de la
part de N ew to n , Cla rk , & c . L e principal défenfeur de ce
fyflême fut M. W o lf. Pcrfécutions que cette doétrine lui
attira. Ibid. 54. b.
Harmonie préétablie, v o y e z fur c e fujet.II. 787* é. V I . 423.
a. IX . 376. b.
H a rm o n ie , ( Oftéologie)-articulation immobile des os par
une connexion fe r ré e , félon la doétrine des anciens. VIII.
1 54. b.
H a rm o n ie , ( Ar chit. ) VIII. 54. b. v o y e z E u r y thm ie .
Harmonie de mefurcs. X . 409. a , b.
H A RM O N IQ U E , ( Mufiq.') proportion harmonique. Signification
de ce mot pris fubflantivement. Extrait d’un mémoire
de M. Romieu, premier auteur de la découverte des fons
harmoniques graves : on vo it dans cet extrait l’hifloire de
cette découverte. V I I I . 54. b. L’intenfité ou .fenflbilité des
fons harmoniques graves varie extrêmement, félon les inftru-
mens dont on les tire. Caufe de ces différences. Pourquoi les
fons de 1 accord três-aigus font abforbés par l’harmonique
grave. Conféqueüces tres-effentielles fur l’harmonie auxquelles
conduit la découverte des fons harmoniques graves. Ib id.
p Suivant les expériences de M. Romieu, l’harmonique
ferave efl plus bas que fuivant celles de M. Tartini. Compararon
des fentimens de ces deux auteurs fur le fujet dont il
H A R
s agit. Il cft fa u x , félon M. Romieu , que les harmoniques
graves foient toujours la baffe fondamentale des deux deffus
ainft que le prétend M. Tartini. Ibid. b.
Harmonique, divifions harmoniques. XI. 340. b. Milieu
harmonique. Suppl. III. 939. Echelles harmoniques. Voye*
Echelles. Phrafe harmonique. XII. 529. b. Proportion harmonique.
XIII. 467. b. Suppl. IV . 538. b. Formule harmonique
j)ar laquelle on détermine l’accord convenable à chaque
degré du ton fur la fucceflion de la baffe. X IV . 22. b. Infiniment
propre à mefurer les rapports harmoniques. Suppl. III.
309. b. Intervalle harmonique, yoye[ A c c o r d . Monocorde
des anciens, qui donnoit la regie de toutes les divifions harmoniques.
X V . 345. b. Sons harmoniques du fon principal. 34C.
a. Sons harmoniques ou flûtés. 347. a. Tranfition harmonique.
X V I . Ç54.b . Triade harmonique. 600. b. Tables des fons
harmoniques, ¿»c. v o l. V I I desplanch. Muuque,pl. i6 .b i s 3 c 17
H A RM Q N OM E T R E | ( Mufiq. ) infiniment propre à mefurer
les rapports harmoniques. En quoi il confine. Suppl. III.
309. b. Voyez M o n o c o r d e .
H A RM O S YN IE N S , ( H ift. anc. ) officiers de la police de
Lacédémone. Raifon pour laquelle ces officiers furent établis.
Marque diflinélive que Lycurgue avoit établie entre les
femmes mariées & les filles. VIII. 56. a.
H A R N O IS , | Bourrel. ) celui des chevaux de carroffe,
celui des chevaux de chaifc. Y I I I . 56 . a.
Harnais de chevaux représentés vo l. II des planches,’
bourrelier, planch. 2.
H a r n o is , (P ê c h e ) grand harnois pour pêcher dans les
eaux courantes, vo l. V Î IL des planch. P ê c h e ,p l. 32.
H A R O , voyer C lam eu r .
H A R P A G O , ( Ichthyol. ) cfpece de poiffon. Suppl. II. 1 5. b.
H A R P A L Y C Ë , ( Littér. ) nom d’une chanfon amoureufe,
autrefois cèlebre dans la Grece. A quelle occafion elle fut
compofée. En quelles circonflances on la chantoit. VIII. 56. b.
H A R P A S T O N , ( Gymnafl. ) forte de jeu de balle en
vogu e chez les anciens. Etymologie de ce mot. D e quelle
maniere on exécutoit ce jeu. V I I I . 56. b.
H A R P E , (H i f t . anc. 6* L u th .) fon origine efl fort ancien-,
ne. C e lle de D avid n’étoit point faite comme celles d’aujourd’hui.
Pourquoi les noms des inventeurs des chofes Utiles
ou agréables font ordinairement perdus. V I I I . 56. b. Defcrip-
tion détaillée de la harpe. Ibid. 57. a. Cara&ere de cet inftru-
ment & des fons qu’on en tire. Les Irlandois paflent pour
les plus habiles de tous les peuples à jouer de la harpe. Ibid. b.
H a rp e, réflexions fur cetinflrumcnt. V I I I . 56.b. Defcription
de la harpe'organifée, vo l. V des planches, article Lutherie, pag.
4. b. 5. a , b 9 ore. Ufage de la harpe dans l’accompagnement.
Suppl. II. 928. a.
H a r p e -d o u b l e , (L u th . ) cfpece d’inftrument compofé de
deux harpes-jointes cnfemble, dont on faifoit ufage vers le
commencement du dix-feptieme fiecle. Suppl. 111. 309. b.
Defcription de cet inflrumcnt, Ibid. 310. a. Voy e{ pl. 2 du
luth. Suppl.
H a r p e , ( Mytholog. ) fymbple d’A p o llo n , 6*c. V I I I . 58. a ,
Harpe, figure fymbolique. X V . 729. a , b.
H a r p e , (H i f t . n a t .) efpece de coquille. V I I I . 58. a.
H a rp e, il efl parlé de ce tte coquille. X V I . 409. a.
. H a r p e , ( A r t m i l it .) efpece de pont levis. V i l i . 58. a i
H a r p e s , ( Maçonner. ) pierres en faillies à l’épaifleur d’un
m u r , 6*c. V I I I . 58. a.
H A R P É , (£ / « .) efpece de coutelas. Ufage qu’en firent
Mercure & Pcrfée. Efpece d’épéc défignée par le nfême nom.
V I I I . 58. ¡g
H A R P EG EM EN T , ( Mufiq. ) maniere particulière de toucher
fucceffivement les différons tons dont un accord efl compofé.
L’harpegement dépend du doigter de l’inflrumcnt dont
on fe fert. On fait ufage de l’harpegement dans les préludes
& dans les morceaux de fantaific. V I I I . 58. a. O n n ’harpcge
prefque jamais dans les accompagnemens. En quoi confifle
le fecret de ne point couvrir la vo ix dans l’accompagnement.
Maniere d’accompagner le récitatif. Ibid. b.
H A R P IE S , (M y th o l. ) ce que nous enfeigne la fable fur
ces monflres. Conjcélures de ceux qui ont voulu ramener
ces fiâions à un lens hiftorique. Celles de l’auteur de l ’hi-,
flaire du ciel. VIII. 58. b.
Harpies,prédiétion qu’une harpie fit aux Troyens . II. 800.
b. Ifles qu’elles habitoient. X V . 547. b.
H a rpie, figure fymbolique. X V . 733. b.
H A R P O C R A T E , (M y th o lo g .) ftatues multipliées de c e
dieu. Empreintes qui nous en relient. Offrandes qu’on lui
préfentoit. Pourquoi fa flatlie fe trouvoit à l’entrée de la
plupart des temples. Comment on le repréfentoit le plus fou-
vent. Explication des divers fymboles dont on l’accompa-
gnoit. Des médailles & gravures repréfentant Harpocrate.
On fit fur-tout chez les Romains quantité de gravures de
ce dieu pour des bagues & des cachets. VIII. 59. a. Ouvrage
à confufter fur Harpocrate. Ibid. b.
H a r p o c r a t e , fiatue de mercure avec une tête d’Har-
pocrate. VIII. 1 7 1 . b. Harpocrate & Horus. Suppl. III. 435. a.
H A V
' H A R P O N , ( T atllan d .) harpon en b ois, harpon en plâtre.
Ufage du harpon. Comment les anciens faifoient leurs harpons.
VIII. 59. b.
Harpons en terme de marine. VIII. 59. b.
H A R R IN G H T O N , (J a c q u e s ) obfervations fur la v ie &
les ouvrages de cet écrivain. X IV . 446. b. — 448. b.
H A R R IO T , ( T hom as ) mathématicien anglois. I. 2 6 1 .a.
X I. 728. a. * s <
H A R R ISO N , ( J e a n ) fuccès de fes recherches pour les
longitudes.' Suppl. III. 7 72 . b.
H A R T L E ï , ( D a v id ) phyfiologifle. Suppl. IV . 360. b.
H A R T M A N , ( Philippe-Jacques) anatomifle. S u p p l.1. 401.
ü . & phyfiologifle. Suppl. IV . 353. a.
H A R T S O E K E R , (N i c o la s ) favan t diftingué. V II. 750. b.
H A R T Z ,fo re t hercynienne (Giogr.)obfervations fur les mines
du Hartz. Q u e lle en e fl la plus haute montagne. VIII. 60. a.
H a r t i , v o y e z F o r ê t . V IL 132. b. & H e r c yn ie . VIII.
15 6. a , b.
H A R T Z B O U R G , , grotte d e , (H i f t . n a t .) obfervations
fur cette grotte. V I I I . 60. a.
H A R U D E S , le s , (G é o g . a n c .) occafion unique dans
l?qlfelle il efl parlé de cet ancien peuple de Germanie.
V I I I . 60. a.
H A R V E Y , ( Guillaume) éloge de fon traité fur la circulation
du fang. III. 470. b. Ses recherches fur le myftere
de la génération par la difleâion des biches. II. 840. b. Son
fyflême fur la génération. V IL 564. b. La bafe fondamentale
de la médecine établie par Harvey. X. 261. a. 274. a.
Ses ouvrages anatomiques & phyfiologiques. Suppl. I. 396. a.
Suppl. ,IV . 349. bi
H A R U S P IC E , ( D iv in . ) étymologie de ce mot. Obfervations
fur la maniéré dont on doit l’écrire. VIII. 60. a. Les
étruriens étoient de tous les peuples d’Italie ceux quipoffé-
doient le mieux la fcience des harufpices. C e t art fort ref-
peélé dans les premiers tems de la république, fut méprifé
par les Romains, lorfqu’ils devinrent plus éclairés. College
d’harufpices à Rome. Ibid, b. Voye{ E x t i s p ic e s , A ru spiCES,
& l’article fuivant.
H A RU SP IC IN E , (D i v in . ) art ou feience des harufpices.
Le s principes de cette prétendue fcience ne font point parvenus
jufqu’à nous. Opérations des harufpices. Origine de l’examen
rigoureux que l’on faifoit de chaque viétime, & de l’art
des harufpices,félon M. Pluche.VlII. 6 o .V o y e [b . H a r u s p ic e .
H A S C H ID , (G é o g r .) province d’A rabie. Les fouverains.
Suppl. I. 507. b.
H A S E K I , (H i ft . m od .) celle des concubines du fultan qui
a reçu ce prince dans fes bras. Diftinélions attachées a ce
titre. Privileges qui l’accompagnent. VIII. 6 1 . a. — Voye[
^ SR A S P A R E N , ( Géogr.) village du diocefe de Bayonne.
Obfervations fur qn monument d’antiquité trouvé en 16 60 ,
dans les fondemens de l’ancien maître autel de l’églife paroif-
fiale, & fur l’infcription qu’ il renferme. Suppl. III. 310. é.
H A S SE L T , (-Géogr .) v ille dans la Campine liégeoife.
Ré volte des habitans en 1566. Chapitre de chanoinefles à
lieux lieues de cette ville. Suppl. 1IL 310. b. _
H A S T A IR E , ( A r t m ilit.) ioldats de ce nom. Leur pefante
armure. Defcription de leur bouclier. Origine du nom qu ils
portoient. Différence entre le dard & le javelot. VIII. 62. a.
H a flaires. Suppl. IV . 673. 1 Armes des haftaires. 6 7 0 .a , b.
Comment on plaçoit ces Îoldats. IX. 356. b. X. 506. a . Suppl.
IV . 174. b. 6 70 . a. V o y e i PiQUIERS.
H A S T E , ( Hift. anc. ) deux fortes de haftes, 1 une à hampe
cou rte , & l’autre à hampe longue. Diverfes obfervations fur
l’une & fur l’autre. V I I I . 62. a. Différentes haftes romaines.
Toutes ces haftes ont paffé de l’hiftoire dans 1 art numifma-
A f f a l é , v o y e z L a n c e . IX. 23 6. b. 137. b. H a lle,figu re
fymbolique. X V . 728 a . y y i . a. ,,A 1
H A S T IN G S . (G éo g r .) ancienne v ille maritime d Angleterre.
D eu x importantes batailles par lfcfquclles ce lieu efl
remarquable. V I I I . 62. b. . rv .aW n
H A T F I E T T E S . (A r t culinaire) forte de mets. Uitterente
s fo r te s dïatelett^s au’on ap prêteVIII. 62 b.
H A T T O N -C H A T E L , (G éo g r .) bourg & marquifat du
duché de B a r , bâti par Hatton , évêque de Verdun en 86o.
Evénemens qui l’ont rendu remarquable. S u p p L U L y * *-
H A T Z F E L D , états de ( Géogr.) fitués dans la Thuringe,
au cercle de Haute-Saxe. En quoi ils confiftent. Seigneurs à
qui ils appartiennent. Reconnoiffance annuelle qu ils paient
à la maikrn deSaxe. Suppl. III. 3 1 1 ;
H A V A G E ou H a v e e , ( Jurifpr. ) droit.que certaines per-
Tonnes ont (le prendre fur les grains & fruits qu on expofe
en vente autant qu’on en peut prendre avec la main. VIII.
6% a Etymologie de ce mot. Des perfonnes auxquelles ce
droit* appardenn En divers lie u x i l a appartenu au bourreau.
Ouvrages à confulter. Ibid. b. , , .h o . 1-
H A V A N E , la (G é o g r .) defcnpuon de cette ville & de
fon port. V I I I . 63. h ,
HAU 8 9 5
HAUBANS , (M a r in e ) defcription de ces cordages. VIII.
63. b. Leur pofiuon. Dillérens haubans du vaiffeau. Haubans
de beaupré. Haubans de. chaloupe. Ibid. 64. a.
Ha u b a n s , c i t e n t de hauban. II. s , 5. i . Caps démoulons
des grands haubans. 614. b. Cordages des haubans. IV. 237,
a. Porte-haubans. XIII. 141. a. - •
H A U B E R , (H ift . des armur.franç.) cotte de maille à man-'
ches & gorgerin. Hommes d’armes qui portoient des hau-
bers. M. le Laboureur croit que le hauber des écuyers étoit
plus léger & de moindre réiîftancc que celui des chevaliers.
Armure de tète des écuyers. VIII. 6 4 . a. Etymologie des
mots hauber & haubergton. Ibid. b.
Hauber & Haubergeon , lignification de Ces mots. V I ,
708. a. F ie f de hauber. 700. b. ypS. a. F ie f membre de hauber,
7 12 . a.
H A U B IT Z , ( A r till. ) voyez Obu s.
H A U D R IE T T E S , ( H i f . eccl. ) religieufes de l’Ordre de
l’affomption. Leur fondatrice. Origine de cet ordre. Habit
de ces religieufes. VIII. 64. b. .
H A V E N E A U , (P ê c h e ) forte de rets connu fous ce nom
dans le reffort de l’amirauté de la Rochelle. Maniere de
pêcher au haveneaü fur mer. VIII. 64. b. Haveneau de
Garonne : différentes fortes de poiffons qu’on pêche au haveneau
fur cette riviere. Détails fur cette pêche. Ibid. 65. a.
Ha v en a u , voyez VIII. vol. des planches, pèche, pl., 2 .'
& 4. & l’article rouanne. V II. 213. b.
H A V E N E T , (P êch e ) rets aifite dans l’amirauté de Saint-'
Malo. Defcription & ufage de ce rets. VIII. 65. a.
H A V E N T , pa ys d ‘ (Géogr . ) voye[ H a b e d e n s i s p a -
G V S .
HAVERIENNES , Glandes , ( Anatom. ) deux fortes de
glandes de ce nom. Pourquoi elles font nommées haverien-
nes. Ouvrage anatomique de Havcrs , médecin anglois.
VIII. 65. b. voye{ M u cilagin euses , G landes.
H A V ER S , ( Clopton ) médecin Anglois ; fes ouvrages
anatomiques. Suppl. I. 402. b.
H A V R E , (G é o g r .) termes par lefquels les grecs & les
latins défignoient un havre. Ce qu’on entend par havre de ‘
barre. VIII. 65. b. Havre de toutes marées. H avre d’entrée.
Havre brutç, ou crique, ou cul-dc-fac. Ibid. 6 6 ,a. Voyeç
Po r t .
Ha V re-û E-GRACE , le , ( Géogr. ) fondateur de cette ville.-
Monfieur & mademoifelle de Scudery font de cette ville.
Obfervations fur ces auteurs & fur leurs ouvrages. A v en ture
finguliere qui leur arriva dans un vo yag e en proven-
ce. Ibid. b.
Ha vre-de-GRACE , ( l e ) origine de cette v ille. T o u r que
François I y fit bâtir. Proceflion folcmnclle qu’on y fait
chaque année en mémoire d’une inondation arrivée en 1523.
Autres défaftresque la mer y a caufés. Suppl. I II. 311. a .
Révolutions de cette ville. Ses fortifications. Son port. Fontaines
qu’elle renferme. Caraéteres des habitans. Population.
Commerce. Perfonnes célebres nées au Havre. Observation
fur le collège. Différence dans l’heure des marées le long de
la côte occidentale de France. Epoque à laquelle les fpefta- *
d e s ont ceffé au Havre. Ibid. b.
Havre de Grâce, fa citadelle. III. 482. a.
H A U S SE , terme employé par les nègocians, par les
chauderonniers, VIII. 60. a. en imprimerie,en fonderie de
caraéleres,en lutherie, chez les rubanniers , & dans les ma- '
nufaéhires en foie. Ibid. b. „ _
H A J JE -CO L , ( art milit. ) origine du hauffe-col. Pourquoi
les majors & les aides-majors des fégimens ne por-
tent point de hauffe-col. Officiers à hauffe-col. VIII. 66. b.
H A U S SE -CO L , obfervations fur cette partie de l’habiller
ment de l’offidér. VIII. o . a.
HAUSSE PIED , ( c h a f e ) defcription du piege qui porte
ce nom. VIII. 66. b. .
H A U T d’où nous formons nos idées de bas oc de naur.
IL H a u t e t p u is s a n t s e ig n e u r , X IV . 894. b.
H A U T A IN ( Gram.) ufage de ce mot. Il efl toujours
pris en mauvaiie part. Différence entre haut b hautain. V 1IL
67H AUT -A P PAR E IL , ou taille hypogaftrique, ( Chirurg. )
O u e l efl celui auquel on efl redevable de l’idée de cette
opération. En quelle occafion elle fut tentée pour la première
fois. L ’inventeur de cette opérauon a été blâmé ians
réferve du confeil qu’il donne de ne pas fuivre fon e x em - .
nie - mais avec un peu de réflexion , on auroit trouvé dans
cet avis & dans fes motifs, le fondement du plus grand éloee
Rouffet, médecin françois, publia en 1691 , un traité dans
îeâuel il fe déclara partifan de la taille au haut-appareil. V in .
68 a C ’eft à M. Douglas, qu’on doit le renouvellement,
la 'théorie fondamentale & la pratique de cette opération.
Autres chirurgiens qui l’ont depuis pratiquée « perfectionnée.
Principes fur lefquels cette opération efl fondée. Maniere
de la pratiquer. Obje&ions qu’on fait aux partifans de
cette opération. Circonftanoes avantageufes qui peuvent f®