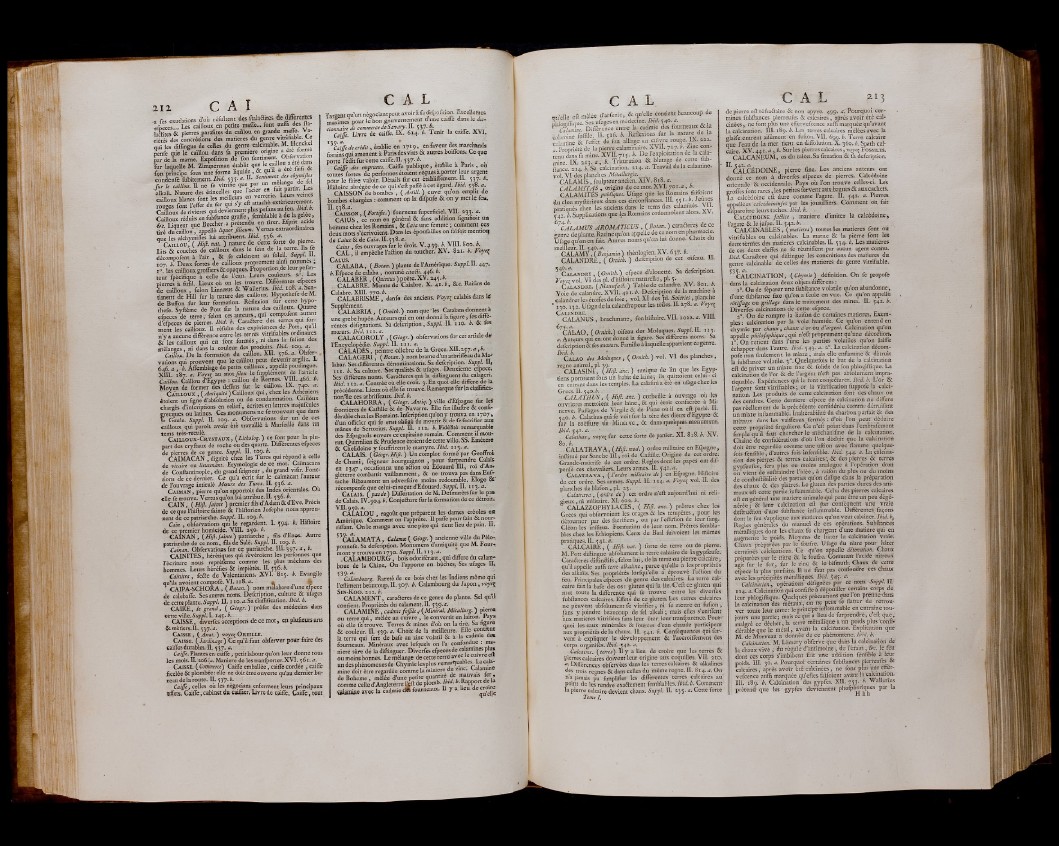
212 C A I CAL
-a fcs oetudarions d'où ré<ent des f a i t e s É g g M f
efueces..«. Les cailloux en petite mafle... font auffi des fta-
laclites & pierres parafites ou caillou en grande malle. Va-
riétés des concrétions des matières du genre vitnfiab^. Ce
mû les diitingue de celles du genre •calcmable. M. «encKei
penfe mie le caillou dans fa première origine a été forne
par delà marne. Expofition de fon fennmem.
ïur laquelle M. Zimmermtm établit
fçn principe fous une forme liquide , & qud
condenfe uibitemem. Ibid. 53s-u.II. j ‘t " ' „ I g g
fur U caillou. Il ne fe vitrifle que par un
ilkalL Nature des étincelles que
«moux blMc^on^les mei eum e atuché extèrieurement.
Cailloux réduits en fubftance graffe,femblable à de la gelée,
&c Lianèur que Beccher a prétendu en tirer. Efpnt acide
tiré du caillou, appellé liquor Jilicum. Vertus extraordinaires
<me les alchymiiles lui attribuent. lbid.y 536. 4.
C a i l l o u , ( Hifi. nat. ) nature de cette forte de pierre,
lits & couches de cailloux dans le fein de la terre. Ils fe
décompofent à l’air , & fe calcinent au foleil. Suppl. il.
107. b. Deux fortes de cailloux proprement ainfi nommés ;
ï». les cailloux greffiers 8c opaques. Proportion.de leur pefan-
teur fpécifique à celle de l’eau. Leurs codeurs, a . Les
pierres à fofil. Lieux où on les trouve. Différentes efpeces
Se cailloux , félon Linnæus & Wallerius. Ibid. 108:4.Sentiment
de Hill fur la nature des caUloux. Hypothefe de M.
de Buffon fur leur formation. Réflexion for cette hypothefe.
Syftême de Pottfor la nature des cailloux. Quatre
efpeces de terre,’ félon ces auteurs, qui compofent autant
d’efpeces de pierres. Ibid. b. Caraftere des terres, qui forment
les cailloux. U réfulte des expériences de Pott, qu il
n’y a aucune différence entre les terrés vitrifiables ordinaires
& les cailloux qui en font formés, ni dans¡la fufion des
mélanges, ni dans la couleur des produits. Ibid. 109-* :
CaÜlou. De la formation du caillou. XII. 576. a. Dbfer- ■
vations qui prouvent que le caillou peut devenir aralle. 1.
¿46.4 Affemblage de petits cailloux, appellé poudingue.
XIII. 187. a. Voyei au mot filex le fimplément de 1 article
Caillou. Caillou d’Egypte : caillou de Rennes. VIII. 466. b.
Moyen de former des devins fur le caillou. IX. 740. a.
C a il l o u x , f Antiquité ) Cailloux qui, chez les Athéniens
étoient un figne d’abfolution ou de condamnation. Çailldux
chargés d’inlcriptions en relief, écrites en lettres majufcules
grecques ou latines. Ces monumens ne fe trouvent que dans
fa Gaule. Suppl. II. 109. 4. Obfervations fur un de ces
cailloux qui paroît avoir été travaillé à Marfeule dans un
tems très-reculé. . , , . . , ,
C a il l o u x -C r y s t à u x , (Litholog. ) ce font pour la plupart
des cryftaux de roche ou des quartz. Différentes efpeces
de pierres de ce genre. Suppl. II. 109. b.
CAIMACAN, dignité chez les Turcs qui répond à celle
de vicaire ou lieute/umt. Etymologie de ce mot. Caimacans
de Conftantinople, du grand feigneur, du grand vifir. Fonctions
de ce dernier. Ce qu’a écrit fur le caimacan 1 auteur
de l’ouvrage intitulé Moeurs des Turcs. H. 530. a.
C a ïm a n , pierre qu’on apportoit des Indes orientales. O u
elle fe trouve. Vertus qu’on lui attribue. II. 536. §
CAIN, ( Hifi. fainte ) premier fils d’Adam & d Eve. Précis
de ce que l’hiftoire fainte & l’hiftorien Jofephe nous apprennent
de ce patriarche. Suppl. II. 109. b. .
Cdin , obfervations qui le regardent. I, 594. b. Wiltoire
de ce premier homicide. VIII. ¿<50. b.
CAIN A N , ( Hifi. Jointe') patriarche , fils d’Enos. Autre
patriarche de ce nom, fils de Salé. Suppl. II. 109. b.
Cainan. Obfervations fur ce patriarche. III. 397. a , b.
CAINITES, hérétiques qui révéroient les perfonnes que
l’écriture nous reprélente comme les - plus méchans des
hommes. Leurs héréfies & impiétés. H. 536. A
Cainites, feôe de .Valentiniens. XVI. 815. b. Evangile
qu’ils avoient compofé. VI. 118. 4. • * „ &
CAIPA-SCHORA, ( Botan. ) nom malabare d une elpece
de calebaffe. Ses autres noms. Defcription, culture & ufages
de cette plante. Suppl. II. 110.4.Sa clarification. Ibid. b.
CAIRE, U grand, ( Géogr. ) préfet des médecins dans
cette ville.Supvl’.\. 145. b.
CAISSE, diverfes acceptions de ce mot, en pluüeurs arts
& métiers, fi. 537. a.
C a isse, f Anat.) voye^O reille.
C aisse. ( Jardinage) Ce qu’il faut obferver pour faire des
caiffes durables. ÜL 537. a. r
Coiffe. Plantes en came, petit labour qu’on leur donne tous
les mois. II. 2o6.lo. Maniéré de lestranfporter.XVI. 561. a.
C aisse. ( Commerce) Caille emballée, caiffe cordée , caiffe
ficelée & plombée: elle ne doit être ouverte qu’au dernier bureau
de la route. IL 537. b.
Caiffe, celles où les négocians enferment leurs principaux
Effets. Caiffe, cabinet du caiffier. Livre de caiffe. Caiffe, tout
Yatgeht qu'un négociant peut avoir à fa difppfition. Excellentes
maximes pour le bon gouvernement d une caiffe dans le du-
•tionnaire de commerce de Savant. U. 537. A
Caiffe. Livre de caiffe. IX. 614. b. Tenir la caiffe. XVI.
de crédit, établie en 1719, en faveurdesmarchmds
forains qui amènent à Paris des vins & autres bmftons, Ce que
porte l’èdit fur cette caiire.Il. 537-t. . .
Caijfe des emprunts. Caiffe publique, établie a Pans , ou
toutes fortes de p e r fo n n e s étoient reçues ùporter leur argent
pour le faire valoir. Détails fur cet établiflement. IL 5 37. b.
Hiftoire abrégée de ce quis’eft paffé à cet égard. Ibid. 538.4.
CAISSON de bombes , ( Arttll. ) cuve qu on. emplit de
bombes chargées : comment on la difpofe & on y met le feu.
'¿JUSSON,.( Fortifie.) fourneau fuperficiel. VII. nj». a.
CA1US ce nom en général & fans addition fignifioit un
homme chez les Romains, & Caïa une femme ; comment ces
deux mots s’écrivoient. Dans les époufailles on faifoit mentioif
de Caïus & de Caïa. II. <38. a. g
Cdius, fes ouvrages lur le droit. V . Jf3ÿ. A VHI- 800. b.
CAL , il empêchel’aftion du toucher. XV. 821. b. Voye^
CACALABA , ( Botan. ) plante de l’Amérique. Suppl. II. 447.
b. Efpece de calaba, nommé citoBi. 446. b.
CALABER, (Qttinrui ) poëte. XV. 245. b. | |
CALABRE. Manne de Calabre. X. 41. b, &c. Raifinsde
Calabre. XIII. 770. b. . . S
CALABRISME, danfe des anciens. Voye^ calabis dans ltf
Supplément. 8 _ , , .
CALABRIA, ( Omith. ) nom que 'les Catalans donnent *
une grebe hupée. Auteurs qui en ont donné la figure, ¡es différentes
défignarions. Sa defcription , Suppl. II. 110. b. & les
moeurs. Ibid. 111.4. .
CALACOROLY , (Géogr. ) obfervauons fur cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. II. m . a.
CALADÈS, peintre célébré de la Grece.XII.257.a yb.
CALAGERI, (Botan.) nom brame d’un arbrifleau du Ma-'
labar. Ses différentes dénominations. Sa defcription. Suppl. IIj
m . b. Sa culture. Ses qualités & ufages. Deuxième efpece.
Ses différens noms. CaraSeresqui la diftinguent du calaeeri.
Ibid. 112.4. Contrée où elle croît. 3. En quoi elle différé de la
précédente. Lieux où elle fe trouve. Remarque fur la dafüfica-
tion'ïLe ces arbriffeaux. Ibid. b. • :
CALAHORRA, ( Géogr. Antiq.)\ ille dEfpagne fur le?
frontières de Caftille & de Navarre. Elle fut illultre & conli-
dérable chezles Romains. Infcription qu’on y trouva en_i707 ,
d’un officier qui fe crut obligé de mourir &de fefacrifier aux
mânes de Sertorius. Suppl. IL n a . b. Fidélité remarquable
des Efpagnols envers ce capitaine romain. Comment il mourut
Quintilien & Prudence étoient de cette ville. SS. Emétere
& Chelidoine y fouffrirent le martyre. Ibid. 113. 4. ^
CALAIS. ( Géogr. Ki(l. ) Un complot formé par Geoffroi
de Chami -, feigneur bourguignon , pour furprendre Calais
en 1347, occafionna une aôion où Edouard III, roi d’An»
gleterre combattit vaillamment, & ne trouva pas dansEufe
tache Ribaumont un adverfaire moins redoutable. Eloge 8c
récompenfe que celui-ci reçut d’Edouard. Suppl. II. 113. a.
Calais, (pasde) Differtation de M.Delmarêtsfur le pas
de Calais. IV. 904. b. Conjeôure fur la formation de ce détroit
C aC lLO U , ragoût que préparent les dames créoles ett
Amérique. Comment on l’apprête. Il paffe pour fain & nour>
iiffant. On le mange avec une pâte qui tient heu de pain. 11.
n &U,AMATA, Calamre ( Géogr. ) ancienne ville du Pélo-,
ponnefe. S» deferiprion. Monumens d’antiquité que M. Fours
mont y trouva en 1730. Suppl. II. 113.4.
.CÀLAMBOURG , bois odoriférant, qui différé du calam-
bouc de la Chine. On l’apporte en bûches^ Ses ufages IL
55 Calambourg. Rareté de ce bois chez les Indiens môme qui
l’eftiment beaucoup. 11.307. b. Calambourg du Japon, voyei
SlN-KOO. 212.
CALAMENT, caraâeres de ce genre déplanté. Sel qu n
contient. Propriétés du calament.II. 539.4. v
CALAMINE, cadmie foffle ,• ( Minéral. Métallurg. ) pierre
ou terre qui, mêlée au cuivre , le Convertit en laiton. Pays,
où elle fe trouve. Terres 8c mines d’où on la tiré. Sa figure
8c couleur. IL 539. a. Choix de la meilleure. Elle contient
la terre qui fert de bafe au zinc volatil 8c à la cadmie des
fourneaux. Minéraux avec lefquels on l’a confondue : maniéré
sûre dé ladiftinguer. Diverfes efpeces de ca aminés plus
ou moins bonnes. Le mélange d e cette terre avec le cuivre eit
un des phénomenesde Chymie lesplus remarfiuanies. La cal -
mine doit être regardée comme la minière du zinc. am
de Boheme, mêlée d'une petite quanmé de mauvais fe r ,
comme celle d’Angleterre ljeft de p lomb .fr . PF. ■ e
Çjlaoeine avec la cadmie d i fourneaux. Il y a. lieu decro.r^
CAL CAL
qu'elle eft mêlée d’arfenic, & qu’cUe contient beaucoup de •
uhlociflique. Ses ufageseit medecmo.Ibtd. 540. a.
Ca/amne. Différence entre la cadmie des fourneaux & la
calamine foffile. U. 516. b Réflexions fur la nature de a
calamine & l’effet de fon alliage au cuivre rouge. Di. aaa.
Propriété do la pierre calammatre. XVII. 717. b- Zmc contenu
/ans fa mine. XVII. 715. b. De l’exploitation de la calamine.
IX. a it. a , b. Trituration & blutage de cette fub-
fiance. 214 b. Sa calcination. 214. 4. Travail de la calamine,
vol. VI des planches Métallurgie.
CALAMlS, fculpteur ancien. XIV .818.4.
CALAMÎTÀS, origine de ce mot. XVI. 701.4, A
CALAMITÉS publiques. Ufagé que les Romains failoient
du clou myftérieux dans ces circonftances. III. 551. A Jeunes
pratiqués chez les anciens dans le tems des calamités. Vil.
542. b. Supplicatiqns.que les Romains ordonnoieut alors. XV .
6?CALAMt7S AROMATICUS , (Botan. ) caraftereç de ce
genre de plante. Racine qu’on appelle de ce nom en pharmacie,
t/fage qu’on en fait. Autres noms qu’en lui donne. Choix du
meiiieur.11.540.1t.
CALAMY, ( Benjamin) théologien.XV. 637. b.
CALANDRE, ( Omith. ) deferipuon de cet otfeau. U.
54Calandre , (Ornith.) efpece .d’tdouette. Su defcription.
roytr vol. VI des pl. d’hiftoire naturelle, pl. 5.
: Calandre. (A fW e ff. ) Table de calandre. XV. 801. b.
Voie de calandre. XVII. 4x1- Deferiprion de la machine à
calandrer les étoffes defoie, voLXI des pl. Soidncs, phmche
* 130.132. Ufagedelacalandrepourlestoües.U.i78.u. Voye^
CALENDRE. . . . -rrrr "l/TTT
CALANUS , brachmane, fon hiftoire. V i l . 1022.4. vm.
Î7CALAO, ( Omith.) oifeau des Moluques. Suppl. II. 113.
a. Auteurs qui en.ont donné la figure. Ses différens noms. Sa
defcription &fes moeurs. Famille h laquelle appartient ce genre.
U‘c a UlO des Moluques , ( Omith. ) vol. VÏ des planches,
reeme animal, pl. 39. ■’ . . -,
CALASIN1 , ( Hift. ahc. ) tunique de lin que les égyptiens
portoient fous un habit de laine; ils quittoient celui - ci
en entrant dans les temples. La calafini a été en ufage chez les
Grecs.U..540.é.; r ' : • » «
CALATBUS, ( Hifi. anc. ) corbeille à ouvrage ou les
ouvrières mettoieht .leur laine, 8c qui étoit confacrée à Minerve.
Paffages de Virgile 8c de Püne où il en eft parlé. II.
<40. b. Calathusquife voit fur la tête des dieux d’Egypte 8c
fur la coëffure dé Minerve, 8c dans quelques.monumensa
l Calathus, voye| fur cette forte de panier. XI. 818. b. XV.
°CALATRAVA, (HifiJmod. ) ordre militaire en Efpagne,
inftitué par Sanche III ; roi de Caftüle. Origine de cet ordre.
Grande-maîtrife de cet ordre. Réglés dont les papes ont dil-
penfé ces chevaliers. Leurs armes. II. 541.4. '
C a l a t r a v a , ( Tordre militaire de) en Efpagne. Hiftoire
de cet ordre. Ses armes. Suppl. II. 114.4. Voye^ vol. II. des
planches deblafon, pl. 23. ■ .
Calatrava, (ordre de) cet ordre n’eit aujourdliui m religieux
, ni militaire. XI. 602. b. ■
CALAZZOPHYLACES, ( Hifi. anc.) prêtres chez les
Grecs qui obfervoient les orages 8c les tempêtes, pour les
détourner par des facrifices, ou par l’effiifion de leur fang.
Cléon les inititua. Formation de leur nom. Prêtres fembla-
blcs chez les Ethiopiens. Ceux de Baal iùivoient les mêmes
pratiques. II. 541.4. . . .
. CALCAIRE, ( Hifi. nat. ) forte de terre ou de pierre.
M. Pott diitingue abfolumentla terre calcaire de lagypfeufe.
Caraéleres diftinétifs, félon lui, de la terre ou pierre calcaire*
qu’il appelle auffi terre alkaline, parce qu’elle a les propriétés
des alkalis. Ses propriétés lorlqu’elle a éprouvé l’action du
feu. Principales eipeces du genre des calcaires: La terre Calcaire
fait la bafe des os : gluten qui la lie. G’eft ce gluten qui
met toute la différence qui fe trouve entre les diverfes
fubftances calcaires. Effets de ce gluten. Les terres calcaires
ne peuvent abfolument fe vitrifier , ni fe mettre en fufion,
fans y joindre beaucoup de fel alkali ; mais elles s’unifient
aux matières vitrifiées fans leur ôter leur tranfparence. PouV-'
quoi les eaux minérales 8c fources d’eau chaude participent
aux propriétés de la chaux. II. 541. b. Conféquences qui fervent
à expliquer le développement 8c l’accroiffement des
• corps organifés. Ibid. 542. a.
Calcaires, (terres) 11 y a lieu de croire que les terres 8c
pierres calcaires doivent leur origine aux coquilles. VII. 210.
4: Différences obfervées dans les terres calcaires 8c alkalines
des trois régnés & dans celles du même regne. II. 814.4. On
«•’a jamais pu Amplifier les différentes terres calcaires au
point de les rendre exaftément femblables. Ibid. b. Comment
la pierre calcaire devient chaux. Suppl. II. 235. a. Cette forte
Tome I,
de pierre eft réfraftaire 8c non apyre. 499: 4. Pourquoi certaines
fubftances pierreufes 8c calcaires, après avoir été calcinées,
ne font plus une effervefcence aufli marquée qu’avant
la calcination-. UL 189. b. Les terres calcaires mêlées avec la
glaife.entrent aifément en fufion. VII. 699. b. Terre calcaire
que l’eau de la mer tient en diffolution. X. 360. b. Spath calcaire.
XV. 441.4 , . b. Sur les pierres calcaires, voyer F ossiles.
CÀLCÀNEUM, os du talon. Sa fituation 8c fa defcription.
¿ALCÉDOINE, pierre fine. Les anciens auteurs ont
donné ce nom | diverfes efpeces de pierres. Calcédoine
orientale 8c occidentale. Pays où l’on trouve celles-ci. Les
groffes font rares, les petites fervent aux bagues 8c aux cachets.
Là calcédoine eft dure comme l’agate. II. 542- u. Pierres
appellées calccdoineufcs par les jôuàillièrs. Comment oh. fait
dimaroître leurs taches. Ibid. b. . ; # y . ’
C a l c é d o in e faBice , maniéré d’imiter la calcédoine,
l’agate 8c le jafpe. II. 542. b.
CALCINABLES, (matières) toutes les matières font ou
vitrifiables ou calcinables. La marne 8c la pierre font les
deux ternies des matières calcinables. U. 534. b. Les matières
dé ces deux claffes ne fe réunifient par aucun agent connm
Ibid. Caraftere qui diitingue les concrétions des matières du
genre calcinable de celles des matières du genre vitrifiable.
55C a l c i n a t i o n , ( chymie ) définition. On fe propofe
dans la calcination deux objets différens :
i°. Ou de féparer une fubftance volatile qu’on abandonne,
d’une fubftance fixe qu’on a feule en vue. Ce qu’on appelle
rôtiffage ou grillage dans le traitement des mines. II. 542. b.
Diverfes calcinations de cette efpece.
à0. Ou de rompre la liaifon de certaines matières. Exemples
: calcination par la voie humide. Ce qu’on ehtend en
chymie par chaux, chaux d’or ou d'krgeni. Calcination qu’on
appelle philofophique, qui n’eft proprement qu’une décoction*
i°. On retient dans l’une les parties volatiles qu’on laifle
échapper dans l’autre. Ibid. 543. a. 20. La calcination décompose
non feulement le mixte, mais elle enflamme 8c détruit
la fubftance volatile. 30. Quelquefois le but de la calcination
eft de priver un mixte fixe 8c folide de fon phlogiitique. La
calcination de l’or 8c de l’argent n’eft pas ablolumènt impra-
tiquable. Expériences qui le font conjeéhirer. Ibid. b. L’or 8c
l’argent font vitrifiables ; or la vitrification fuppofe la calcination.
Les produits.de cette calcination font de? chaux ou
des cendres. Cette derniere efpece de calcination ne différé
pas réellement de la précédente confidérée comme détruifant
un mixte inflammable. Inaltérabilité du charbon parfait 8c des
métaux dans les vaiffeaux fermés : d’où l’on .peut déduire
cette propriété Singulière. Ce n’eft point dans l’embrafement
fimple qu’il faut chercher le méchanifme de la calcination.
Chaîne de confidérations d’où l’on déduit que la calcination
doit être regardée comme une uftion avec flamme quelquefois
fenfible, d’autrés fois infenfible. Ibid. 544. 4. La calcination
des pierres & terres calcaires', 8c des pierres 8c terres
gypfeufes, fera plus ou moins analogue à l’opération dont
on vient de reftraindré l’idée, à raifon du plus ou du moins
de combuitibilité des parties qu’on difiîpe dans la préparation
des chaux 8c des plâtres. Le gluten des parties dures des animaux
èft cette parüe.inflammable. Celui dés pierres calcaires
eft en général uné matière animale qui peut être un peu dégénérée;
& leur calcination eft pat conféqûeht une Vraie
deftrüàion d’une fubftance inflammable. Différentes, façons
dont le feu s’applique aux matières qu’on veut calciner:Ibid.b;
Réglés générales du manuel dè ces opérations Subftances
métalliques dont les chaux fe chargent d’une matière qui en
augmenté le pouls. Moyens de hâter la calcination vraie.
Gliaux préparées par le fohfre. Ufage du nitre pour hâter
certaines calcinations. Ce qu’on appelle détonation. Chaux
préparées par le nitre & le foufre. Comment l’acide nitreux
agit fur le fer, for le zinc 8c le bifmuth. Chaux de cette
elpece la plus parfaite» II 11e faut pàs corifondre ces chaux
avec les précipités métalliques. Ibid. 545. a. c . 7T
Calcination, opérations défignées par ce nom. Suppl. II.
114. 4. Calcination qui confifte à dépouiller certains corps de
leur phlogiftique. Quelques précautions que Ion prenne dans
la calcinànon dés métaux, on ne peut fe flatter de retrou-
ver toute lettr terre : le principe inflammable en entraîne toujours
une partie; mais ce qui a ben de furprendre, c eft que,
malgré ce déchet, la terre métallique a un poids plus conlf-
dérable que le métal, avant la calciriation. Explication que
M. de Morveau a donnée dé ce phénomène. Ibid. b.
Calcination. M.Lémèry obfetVe que dàhs la calcination de
la chanx vive ; du régule d’antimoine, de l’éfaih, &c. le féu
dont ces corps s’imbibent fait ufte addition fenfible à leur
poids. III. 30. 4. Pourquoi’ certaines fubftances pierreufes 8c
calcaires, après avoir été calcinées, ne font plus une effer-
vefcence auffi marquée qu’elles faifoient avant là calcination.
III. 189. b. Calcination des gypfes. XII. 7W-. Walleni?s
prétena que les gypfes deviennent phofphortques par la