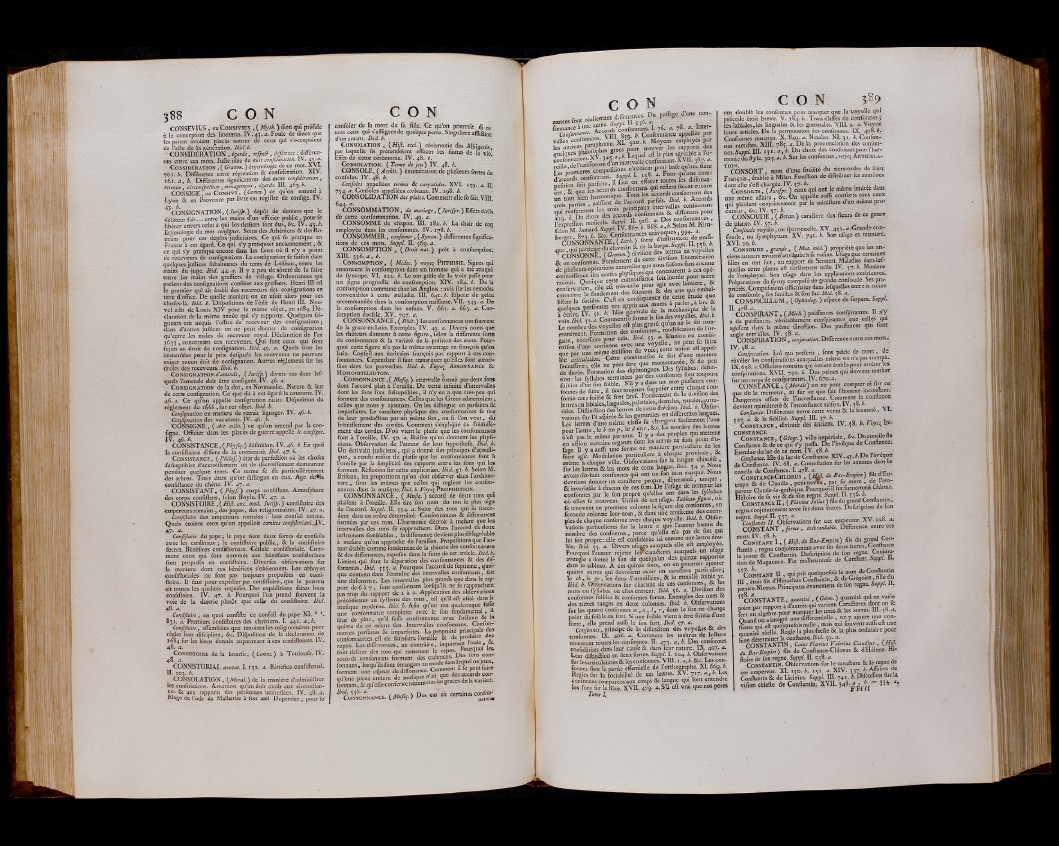
388 C O N
CONSEVIUS, « t C o n s ivh js , ( M y th . ) dieu qui préfide
è la conception des hommes. IV. 43. ¿.Foule de dieux que
les païens avoient placés autour de ceux qui 's’occupoient
de l’aéte de la génération, lbid: b.
• CONSIDÉRATION , égards, refpeff, déférence ^différences
entre ces mots. Jufte idée du mot confédération. IV. 4).a.
C o n s id é r a t io n , ( Gramm. ) étymologie de ce mot. AVI.
■701 :b. Différence entre réputation 8c confidération. XIV.
•161. a , b. -Différentes lignifications des mots considération,
retenue, circonfpcSion , ménagement , égards. 111. 463. .
CONSIGE, ou CONSIVE, { Comm. ) ce qu on entend a
•Lyon & en Provence par livre ou regiftre de confige.iV.
^CONSIGNATION, ( Jurifp. ) dépôt de deniers que le
débiteur fait. .. entre les mains d’un officier public, pour fe
libérer envers celui à qui les deniers font dus,6*c. IV. 43. b.
Etymologie du mot confiner. Soins des Athéniens & des Romains
pour ces dépôts judiciaires. Ce qui fe pratique en
France à cet égard. C e qui s’y pratiquoit anciennement., 8c
ce qui s’y pratique encore dans les fieux où il riy a point
de receveurs de confignations. La confignation fe faifoit dans
quelques .juftices fubaltemes du tems de -Loifeau, entre Jes
mains du juge. Jbid. 44. a. Il y a peu de sûreté de la faire
entre Jes mains des greffiers de village. Ordonnances qui
parlent des confignations confiées aux greffiers. Henri III eft
le premier qui ait établi des-receveurs des confignations en
titre d’office. De quelle maniéré on en ufoit alors pour ces
chofes-là. lbid. b. Dijpofidons de l’édit de Henri III. Nouvel
édit de Louis XIV pour le même objeten 1689. Déclaration
de la même année qui s’y rapporte. Quelques fei-
gneurs ont acquis l’office de receveur des confignations ;
dans d’autres juftices on ne peut donner de confignation
qu’eptre les mains du receveur royal. Déclaration de l’an
.1633 »concernant ces receveurs. Qui font ceux qui font
fujets au droit de confignation. lbid. 45. a. Quels font les
immeubles pour le prix defquels les receveurs ne peuvent
exiger aucun doit de confignation. Autres réglemens fur les
•droits des receveurs. lbid. b.
C o n s ig n a t io n d'amende, ( Jurifp.') divers cas dans lef-
quels l’amende doit être confignée.IV. 46. a.
C o n s ig n a t io n de la dot, en Normandie. Nature 8c but
de cette confignation. Ce que dit à cet égard la coutume. IV.
46. a. Ce qiron appelle confignation tacite. Difpofition du
■règlement de 1666, fur cet objet. lbid. b.
■ Confignation en matière de retrait fignager. IV. 46. b>
Confignation des vacations. IV. 46. b.
CONSIGNE, (Art milit.) ce qu’on entend par la con-
figne. Officier dans les places de guerre appellé le configne.
IV. 46.b.
CONSISTANCE,(Phyfiq.) définition. IV. 46. b. En quoi
la confiftance différé de la continuité, lbid. 47. b.
C o n s is ta n c e , ( Phïlof. ) état de perfection où les chofes
fufceptibles d’accroiflement ou de décroiflèment demeurent
pendant quelque tems. Ce terme fe dit particulièrement
des arbres. Trois états qu’on diftingue en eux. Age de*la
confiftance du chêne. TV. 47. a.
CONSISTANT, ( Pbyf) corps confiftans. Atmofphere
des corps confiftans, félon Boyle. IV. 47. a.
CONSISTOIRE, ( Hifi. anc. mod. Jurifp. ) confiftoire des
•empereursromams, des papes, des religionnaires. IV. 47. a.
Confiftoire des empereurs romains : leur confeil intime.
•Quels étoient ceux qu’on appelloit comités confiftoriani. JV.
47* a- . . .
Confiftoire du pape; le pape tient deux fortes de confeils
avec les cardinaux ; le confiftoire public, & le confiftoire
fecret. Bénéfices confiftoriaux. Céaule confiftoriale. Comment
ceux qui font nommés aux bénéfices confiftoriaux
font propofes en confiftoire. Diverfes obfervations fur
la maniéré dont ces bénéfices s’obtiennent. Les abbayes
confiftoriales ne font pas toujours propofées en confiftoire.
Il faut pour expédier par confiftoire, que le pourvu
ait toutes les qualités requifes. Des expéditions faites hors
confiftoire. lv . 47. A Pourquoi l’on prend fouvent la
voie de la daterie plutôt que celle du confiftoire. lbid.
■48. a.' jj . •
Confiftoire, en quoi confifte ce confeil du pape XI. * *.
831. a. Premiers confiftoires des chrétiens. I. 441. a,b.
Confiftoire, affemblées que renoient les religionnaires pour
régler leur difeipline, &c. Difpofition de la déclaration de
1684 fur les biens donnés auparavant à ces confiftoires. IV.
48. a.
C o n s i s t o ir e d e l à b o u r f e , (Comm.) à T o u l o u f e . I V .
48.*.
• -CONSISTORIAL avocat. 1. 152. a. Bénéfice confiftorial.
H. 203. b.
CONSOLATION, {Moral. ) de la maniéré d’adminiftrer
les .confolations. Attention qu’on doit avoir aux circonftan-
ces & aux rapports des- perfonnes intéreffées. IV. 48. a.
Eloge de l’ode .de Malherbe a fon ami Duperrier , pour le
C O N
confoler de la mort de fa fille. Ce qu’on pourrolt di re
tous ceüx qui s’affligent de quelque perte. Singulière affli&ion
d’un amant, lbid. b.
C o n s o la t io n , (Hifi. ceci.) cérémonie des Albigeois '
par laquelle ils prétendoient effacer les fautes de la vie!
Effet de cette cérémonie. IV. 48. b.
C o n s o la t io n . ( Terme de jeu) IV. 48. b.
CONSOLE, ( Archit. ) énumération de plufieurs fortes de
confoles. IV. 48. b.
Confoles appellées ternes & caryatides. XVI. 139. a. H.
734. a. Confoles appellées corbeaux. IV. 198. b.
CONSOLIDATION des plaies. Comment elle fé fait. VIII.
644. a.
CONSOMMATION, du mariage, ( Jurifpr. ) Effets civils
de cette confommation. IV. 49. a.
CONSOMMÉ de chapon. III. 182. b. La chair de coq
employée dans les confommés. IV. 178. b.
CONSOMMER, confumer, (Synon. ) différentes fignifica-,
• tions de ces mots. Suppl. II. 569. a.
CONSOMPTION , ( Droit nat. ) prêt à confomption.'
XIH. 336.*, b.
C on som p tion , ( Médec. ) voye[ P h th is ie . Signes qui
annoncent la confomption dans un homme qui a été attaqué
de fyncope. VI. 122. b. Le ton grêle de la voix paffe pour
un ligne prognoitic de confomption. XIV. 184. b. De la
confomption commune chez les Anglois : avis fur les remedes
convenables à cette maladie. III. 641. b. Efbece de geléeL
recommandée dans la confomption naiffante. Vil. 543. a. De
la confomption dans les enfans. V. 661. a. 663. a. Confomption
dorfale. XV. 797. a.
CONSONNANCE, ( Rhét. ) les confonnances ont fouvent
de la grâce en latin. Exemples. IV. 49. a. Divers noms que
les rhéteurs donnent à cette figure, félon la différente forte
de confonnance & la variété de la pofition des mots. Pourquoi
cette figure n’a pas le même avantage en françois qu’en
latin. Confeil aux écrivains françois par rapport à ces confonnances.
Cependant il faut remarquer qu’elles font autori-
fées dans les proverbes, lbid. b. Voyeç Assonnance 8c
H om o ïo te leu to n . *
C o n so n n a n c e , ( Mufiq.) intervalle formé par deux font
dont l’accord plaît à l’orèille. De cette infinité d’intervalles
dont les fons font fufceptibles, il n’y en a que très-peu qui
forment des confonnances. Celles que les Grecs admettoient,
celles que nous y . ajoutons. On les diftingue en parfaites &
imparfaites. Le caraclere phyfique des confonnances fe tire
de leur production par un même fon, ou fi. l’on veut, du
frémiffement des cordes. Comment s’explique ce frémiffe-
ment des cordes. D’où vient le plaifir que les confonnances
font à l’oreille. IV. 30. a. Raifon qu’en donnent les phyfi-
ciens. Obfervation de l’auteur fur leur hypotliefe. lbid. b.
Un écrivain judicieux, qui a donné des principes d’acoufti-
que, a rendu raifon du plaifir que les confonnances font à
1 oreille par la fimplicité des rapports entre les fons qui les
forment. Réflexion fur cette explication. lbid. 51. b. Selon M.
Brifeux, les proportions qu’on doit obferver dans l’architecture
, font les mêmes que celles qui règlent les confonnances.
dans la mufique. lbid. b. Voye^ P r o p o r t io n .
CONSONNANCE,. ( Mufiq. ) accord de deux tons qui
plaifent à l’oreille. Elle tire, fon nom du ton le plus aigu
de l’accord. SuppL II. 334. a. Suite des tons qui fe fucce-
dent dans un ordre déterminé. Confonnances 8c diffonances
formées par ces tons. L’harmonie décroit à mefure que les
intervalles des tons fe rapprochent. Dans l’accord de deux
inftrumens femblables, la mflbnance devient plus défagréable
à mefure qu’on approche de l’uniffon. Propofitions que 1 auteur
établit comme fondement de la théorie des confonnances
& des diffonances, expofée dans la fuite de cet article. Jbid. b.
Limites qui font la féparation des confonnances^ 8c des dif-
fonances. lbid. 333. a. Pourquoi l’accord de feprieme, quoi*
que contenu dans l’étendue des intervalles confonnans, fait
une diffonance. Les intervalles plus grands que dans le rapport
de 6 à 7 , font confonnans lorfqu’ils ne fe rapprochent
pas trop du. rapport de 1 à 2. Application des obfervations
précédentes au fyftême des tons, tel quileft ufité dansla
mufique moderne, lbid. b. Afin qu’un ton quelconque fafle
une confonnance complette avec le fon fondamental, u
faut de plus, qu’il fàffe confonnance avec l’oélave & la
quinte de ce même fon. Intervalles confonnans. Confonnances
parfaites & imparfaites. La propriété principale des
confonnances eft de fatisfitire l’oreille & de produire des
repos. Les diffonances, au contraire, inquiètent 1 orne,
font defirer des tons qui ramènent le repos.
accords confonnans forment ' des cadences. D e s “
fonn'ans,| lorqu'ils font étrangers au mode dans eq“el O"Jouj
forment une’ efpece
?imnansf&Cqu^cllèCconfM^néwmoinsles grâces de la variété.
^ C onsonnance. ( iW«A-) Des eas'où certaines confo£
C o N
n . réellement diflonances; Du Paflage ri’une con-
aances font r Suppl. II. $ $6. a- 0 T
fonnance à un confonnans. I. 76. a. 78. a. Inter-
. Confonnance. Accorg. | Confonnance appellee par
valles confonnans. XI 020. b. Moyens employés par
les anciens parapho ■ ' | „ „ „ « r rapports des
quelques W B fM Sm jBH g . el eft le plus agriable à ^
W H tfcw S Ë È S m sm ™(oÀnm. x v h . mm a.
reille, de 1! ?” n’avoient pour bafe qu'unefuite
Les premières compo „ g . ^ p0ur qu’une comd’T
-0n ^ r p a S , ‘ il faut en effacer toutes les diffonan-
P & les accords confonnans qui «fient feent encore
ces, & qu« les . T ous les accords un toutllen ^ om q u e Toirs t e aeoe ^con fosn, nans des
“ °.S PS e n t l i l lois ptlnclpauï lmervaUes confonnans
qnt « " fg “ “ ‘ j‘eSde‘ accoPds confonnans 8c dtffonans pour
119. Du CHOIX ucs a Des confonnances,
l’exprcffion muficale. Supp. -9 ¿^g a y. Selon M. Kirnque,
quipartwiueduclaveci . d lettres en voyelles
CONSONNÉ, ( cette ffivffion. Enuméîation
& en confonnes. lles que nous faifons faiis aucirne
de plufieurs opératiQnsn - ^ • concourent à ces opéconnoiffance
des caufes phy r0:t inutile pour notre
‘•uelques^rfonnes f â g M
à W i V ! ; a Commentée fonne le fon des voyelles, lbid. é.
munément. Formanon des conionnes^ ^ comb._
d“r vS r « n e
T K e S ^ C e t t e combinalfon
fucceffive; elle ne peut: te e <1 De fyll^ es: déhniton,
toujours
t t o n . le s fy lla b e s P p lu fie u r s c o n -
e f - L i - g , f o r t b r e f. F o n d em e n t d e l a d iv u io n d e s
en aâon cenalns organes dont les autres ne
face. Il y a aufli une forme ou manière particulière de 1«
faire agir. Modulation particulière à chaque provtnc* , &
même à chaque vifte. Ôbfervadons fur la
fur ies lettres & les mots de cette langue, lbid. 54- “■
avons dix-huit confonnes qui ont un fon bien marqué. Nous
devrions donner un cara&ere propre » déterminé, umqu ,
& invariable à chacun de ces fons.De lufage de nommer les
confonnes par le fon propre qu’elles ont dans les iyllabes
où elles fe trouvent. Utilité de cetufage. Tableau figure, ou
fe trouvent en première colonne la figure des conlonnes, en
fécondé colonne leur nom ,& dans une troifieme des exemples
de chaque confonne avec chaque voyelle, lbid.b. UDier-
vations particulières fur la lettre x que 1 auteur bannit du
nombre des confonnes, parce qu’elle n’a pas de Ion qui
lui foit propre: elle eft confidérée ici comme une lettre double.
lbid. 33 .a . Divers ufages auxquels elle eft employée.
Pourquoi l’auteur rejette lePcarafteres auxquels un uiage
aveugle a donné le Ion de quelqu’un des quinze rapportes
dans le tableau. A ces quinze fons, on en pourroit ajouter
quatre autres qui devroient avoir Un cara&ere particulier ;
le ch, le gn, les deux II mouillées,' & le mouillé foible ye.
Jbid. b. Obfervations fur chacune de ces confonnes, oc les
mots ou fyllabes où elles entrent. lbid. 36. a. Divifion des
confonnes foiblcs & confonnes fortes. Exemples des unes oc
des autres rangés en deux colonnes, lbid. b. Obfervations
fur les quatre confonnes m, n , /, r , dont le fon ne change
point du foible au fort. Si une foible vient à être fuivie d’une
forte, elle prend aufli le fon fort. lbid. 37. a.
Confonnes, principe de la diftinétion des voyelles & des
confonnes. IX. 406. a. Comment les maîtres de leôure
nomment toutes les confonnes. II. 473. a, b. Des confonnes
confidérées dans leur caufe & dans leur nature. IX. 407. a.
Leur diftinétion en deux fortes. Suppl. I. 604. b. Obfervations
fur lesarticulations&les confonnes. VIII. i.a^.&c. Les confonnes
font la partie effentielle de 1 orthographe. XI. 669. b.
Réglés fur la fociabilitè de ces lettres. XV. 717. a,b . Les,
confonnes comparées aux coups de langue qui font entendre
les fons fur la flûte. XVII, 479. a. S’il eft vrai que nos peres
Tome /,
CON ||g ont doublé les confonnes pour marquer que la voyelle qui
précédé étoit breve. V. 184. b. Troisclaflès de conlonnes;'
les labiales,les linguales 8c les gutturales. VIII. 2. a. Voyez-
leurs articles. De la permutation des confonnes. IX. 408. b.
Confonnes muettes. X. 849. a. Nazales. XI. 31. b. Confonnes
ramifies. XIII. 783. a. De la prononciation des confonnes
Suppl IIL 131. a, b. Du choix des confonnes pour Vhar-
monis du flyle. 305. a. b. Sur les confonnes, vW A r t ic u la -
T1CONSORT, nom d’une fociété du tiers-ordre de faint.
François, établie à Milan. Fonflion de diftribuer les aumônes
dont elle s’eft chargée. IV. Ç7- é.
C o n s o r t s , ( Jurifpr. ) ceux qui ont le même intérêt dans
une même affaire , L . On appeUe auffi conforts tous ceux
qui plaident conjointement par le miniftere d un même pro-,
cureur, &c. IV. 37. b. „ ,
CONSOUDE, ( Botan.) caraôere des fleurs de ce genre
de plante. IV. 37. b.
Confoude royale, ou fpéronnelle. XV. 431. a .Grande con-
foude, ou fymphytum. XV. 741. b. Son ufage en teinture.
XVI. 20.b. | <
Con sou d e , grande, ( Mat. mid. ) propriété que les anciens
auteurs avoient attribuée à fa racine. Ufage que certaines
filles en ont fait, au rapport de Sennert. Maladies danslel-
quelles cette plante eft réellement utile. IV. 37. b. Manier®
de l’employer. Son ufage dans les applications extérieures.
Préparations du fyrop compofé de grande confoude. Ses propriétés.
Compofitions officinales dans lefquelles entre la racine
de confoude, fes feuilles 8c fon fuc. lbid. 38. a. ■
CONSPICILLUM, ( Ophiolog. ) efpece de ferpenx^SuppU
II. 478. a. -, , .
CONSPIRANT, ( Méch.) puiffances confpirantes. 11 ny
a de puiffances .véritablement confpirantes que celles qui
agiffent dans la même direétion. Des puiffances qui font
angle entr’elles. IV. 38. a. M a i
CONSPIRATION , conjuration. Différence entre ces mots.
IV. 38.^. J . , m
Confpiration. Loi qui prefcrit , fous peine de mort, cie
révéler les confpirations auxquelles même on n a pas trempe.
IX 638. a. Officiers romains qui étoient établis pour arrêter les
confpirations. XVII. 79°- b- Des Peines T “ doivent tomber
fur un corps de confpirateurs. IV. 670. a.
CONSTANCE, (Morale) on ne peut compter ni iur ce
que dit le menteur, ni fur ce que fait l’homme inconftant.
Dangereux effets de l’inconftance. Comment la confiance
devient opiniâtreté 8c l’inconftance raifon. IV. 58. .
Confiance. Différence entre cette verni 8c la fermeté, v i.
327. a. 8c la fidélité. Suppl. III. 37. b.
C o n s ta n c e , divinité des anciens. IV. 38. b. Voye[ Inco
n s ta n c e . . . Æ , . , - *| J»
C o n s ta n c e , (Géogr.) ville impériale, 6*c.Du concile de
Confiance 6c de ce qui s’y oafla. De 1 évêque de Confiance.
Etendue du lac de ce nom. IV. 38. b.
Confiance. Ifle du lac de Confiance. XIV. 43. b. De 1 éyêque
de Confiance. IV. 68. *. Conteftation fur les annates dans le
concile de Confiance. 1. 47^* . \ ni «p
CoNSTANOE-CHtORUS , (1M. du Bas-Empirt) filsdEu-
trope 8c de Claudia, pctit-nevTu, par fa mere , de 1 empereur
Claude-le-gotliique. Pourquoi il fin furnommè Chloms.
Hiftoire de fa vie 8c de fon regne. Suppl. II. 5 56.
C o n s t a n C e I I , ( FUy-m* A i t o ) f i t du g r a n d C o p f tm tm
régna conjointement avec fes diux freres. Defcnpnon de fon
rtlConpnc!n' Obfervations fur cet empereur. XV. aa8.a,
CONSTANT , ferme, inébranlable. Différence entre ces
m C o to tÀ o t Î , ( Hifi. du Bas-Empire.) fils
ftantin régna conjointement avec fes deux freres, Conftance
Ui^eune s f Conftantin. Defcription de fon reguc C^ure-
tion de Magnence. Fin malheureufe de Confiant. Suppl.
^CotsTANT n , quipmquelquefoislenom deConftjmtin
m étoit fils d’Héracüus Conftanun, 8c de Grégoire, nue au
patrice Nicetas. Principaux événemens de fon regne. Suppl. .
^CONSTANTE, ouonùtl, (G/«m.) quannté qui ne varie
point par rapport à d'autres qui varient. Carafteres dont on fe
?ert en algèbre pour marquer les unes 8c les autres. ÜI. 3 8. a.
Q u a n d o ia intégré une différentiel e { on y a|Oute une cqn-
S e q u i eft quelquefois nulle, mais; qui fouvent auffi eft une
réeUe. Réglé la plus facile 8c la plus ordinaire pour
bien déierminerla confiante.lbid. 39. 0.
1 CONSTANTIN, CaïusFlavius Valertas Claudius , f*
du Sas-Empire ) fils de Conftance-Chlorus 8c d’Hélene. Hiftoire
de fon regne. Suppl. II. 3 38. a. -
C on s tan t in . Obfervations fur le caraôere 8c le regne de
cet empereur. XI. 130. i. f ç i e. XIV. 337, i- d=
Conftantin 6c de licinius. Suppl. III. 741. b. Difcuffion ferla
vifion cèlefte de ConftandR. XYII. *