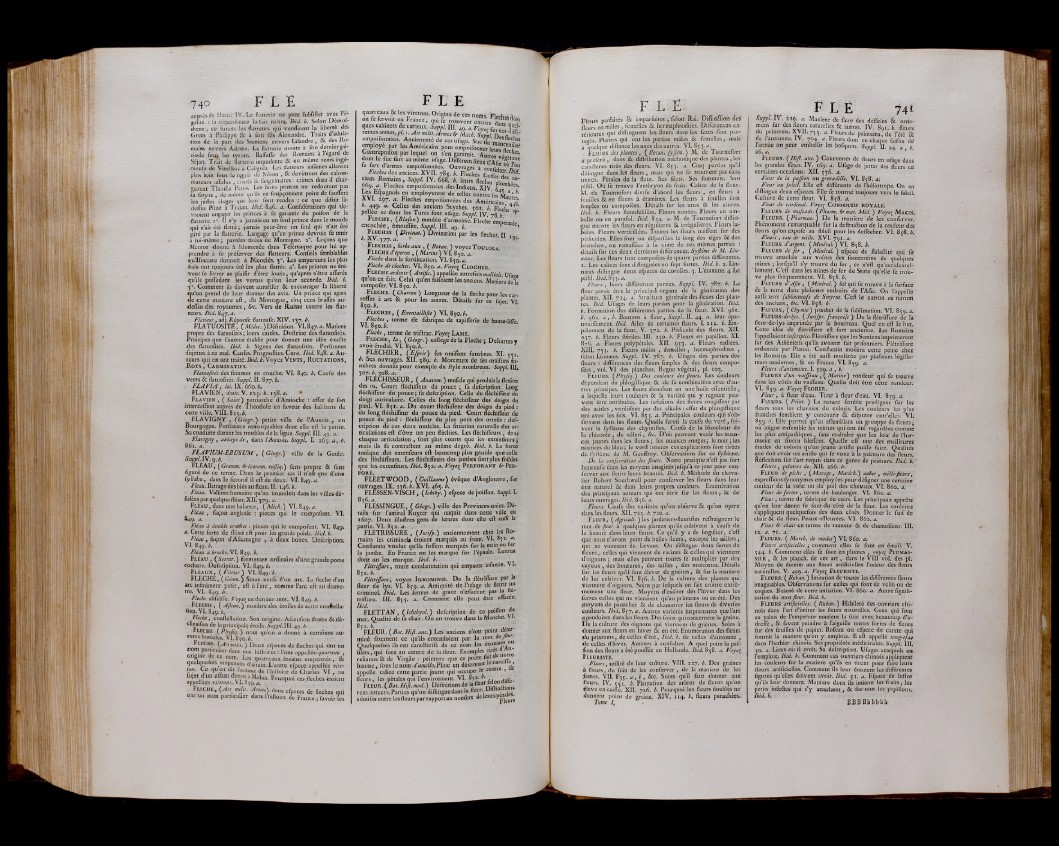
740 F L E
auprès de Henri IV, La flatterie ne peut fublifté»' avec Îé -
.galité : la dépendance la t’ait naitrç. Ibid. b. Selon Démof-
ihcnc-, cc furent les flatteurs qui vendirent la liberté des
•Grecs h Philippe & à fon fils Alexandre. Traits d’adula-
<tion de là part des Sanyicns envers Lifandrc, & des Roumains
envers Adrien. La flatterie monte à fon dernier période
fous, les tyrans. Baflcflc des Romains à l ’égard de
Séjan. Trait de flatterie impudente & en môme tems mgé»
■nicule de Vitellius à Calignla. Les flatteurs infâmes allèrent
plus loin fous le njgnl* de Néron , & devinrent des calomniateurs
aflidus, cruels & iànguinaires : crimes dont il chargèrent
Thraféa Pétu*. Les bons princes ne redoutent jia s
4a faty rc, de même qu’ils ne foupçonnent point de fauffeté
les juflcs éloges qui leur font rendus : ce que difoit là-
deflus Pline à Trajan. IDid. 846 . a. Confidérations qui de-
vroient engager les princes à fc garantir du poifon de la
flatterie. i°. fi n’y a jamais eu unieul prince dans le monde
qui n’ait été flatté ; jamais peut-être un fcul qui n’ait été
gâté par la flatterie. Langage qu’un prince devroit fc tenir
■à lui-même ; paroles tirées de Montagne. a°. Leçons que
Mentor donne à ïdomenée dans Télemaque pour lui apprendre
à le préferver des flatteurs. Confcils fcmblables
qu’Ifocrate dounoit à Nicoclôs. 30. Les empereurs les plus
hais ont toujours été les plus flattés. 4*. Les princes ne doivent
fc livrer au plaifir d être loués, qu’après s’étre aflurés
qu’ils poffedent les vertus qu'on leur accorde. Ibid, b.
5°. Comment ils doivent autorifer & encourager la liberté
lu’on prend de leur donner des avis. Un prince qui agira
le cette maniéré c i l , dit Montagne, cinq cens braffes au-
idefTus des royaumes, b c . Vers de Racine contre les flatteurs.
Ibid. 847. a.
Flatteur-, ad/. Réponfe flatteufe. XIV. 137. b.
FLATUOSITÉ, (|M Mééddeec*. ) Défini-t-ion. V I .847. a. Maticre
.propre des flatuofités; leurs caufes. Doélrinc des flatuofttés.
Principes que l’auteur établit pour donner une idée cxail:c
des flàruoiités. Ibid. b. Signes des flatuofités. Perfonncs
rfujettes. à ce mal. Caufes. Prognoftics. Cure. Ibid. 848. a. A uteurs
qui en ont traité. Ibid. b. Voyez V en t s , R u c t a t io n s ,
R o t s , C a rm in a t i fs.
Flatuofités des femme s en couche. V I. 840. b. Caufe des
vents & flatuofités. Suppl. II. 877. b.
F L A V I A I loi. IX. 6 6 0 .6
F LA V IEN , droit.V . 1 l y b . 138.a .
F la v ie n , ( Saint ) patriarche d’Antiochc : effet de fon
Jnterceflion auprès de Théodofe en faveur des habitans de
cette ville. V IÎI. 813. A.
F LA V IGN Y , ( Géogr. ) petite ville de PAuxois,, en
Bourgogne. Perfonncs remarquables dont elle cil la patrie.
Sa conduite durant les troubles de la lieue. Suppl. III. 49. a.
Flavigny, abbaye de , dans l’Auxois. Suppl. I. 263. a 9 b.
861. a.
F L A V IU M -E B U SU M , ( Géogr.) ville de la Gaule.
Suppl. IV. 9. A.
F LÉAU, (Gramm. béconom. ruft'uj.) fens propre 8c fens
figuré de cc terme. Dans le premier cas il n’eu qne d’une
fyJlabc, dans le fécond il cil de deux. V I. 849. 4.
Fléau. Battage des blés au fléau. II. 146. A.
Fléau. Viâime humaine qu’on immoloit dans les villes dé-
folécs par quelque fléau. X IL 379. a.
F lé a u , dans une balance, ( Méch. ) VI. 849. a.
Fléau , façon angloife : pièces qui le compofcnt. VI.
«49. a.
Fléau à double crochet : pièces qui le compofent. VI. 849,
*. Cette forte de fléau cil pour les grands poids. Ibid. A.
Fléau, façon d’Allemagne ,< à- Jeux boites. Defcription»
VI. 849. A.
Fléau à broché. V î . 849. A.
F lé a u , ( Serrur. ) fermeture ordinaire d’une grande porte
cochcrc. Defcription. VI. 849. A.
F l é a u x , ( Vitrier ) VI. 849. A.
FLECHE, (Géom .) Sinus verfe d’un arc. La flcchc d’un
arc infiniment petit, cft à l’a rc, comme l’arc cil au diamètre.
VI. 849. A.
Ifiche abfciffe. V cy tz ce dernier mot. V t 849. A.
F le c h e , ( Aflron. ) nombre des étoiles de cette conftclla-
tton.VI. 849. A.
f le c h e , conilcllation. Son origine. Afcenfion droite 8c dé-
chnaiion de la principal^ étoile. Suppl. III. 49. A.
r le ch e ( Vhyfiq. ) nom qu’on a donné à certaines, aurores
boréales. VI. 8 50. A.
„^mLECH?* { fir t milu. ) Deux cfpeces de fléchés qui ont un
nom particulier dans nos hiiloires : l’une appcllée.quarrcau ,
,10m* Lc* quarrtaux étoient empennés, &
fuckmefim empeaÿ. tfai.nm. L'auire cfpece nppullùu
u n . C e qu.cn dit £ g l’hittoire de Charles VI , au
a , e t d m affaut donné!. Mclu,,. Pourquoi ces fleol.es M e u t
appel lues y Vêtons. VI. 8 5 0 .a.
( A n . cfpeces de flccl.es qui
om un nom particulier dans M o i r e Je France ; lavoir les
F L E
ques cabinets de curieux. Suppl. III. 49.4. V o y ' A ? W 1
ren.csnm.es. p l . , . A n m il,. A m a fi. Mach.
empoifonnées. Ancienneté de cetufaee. S u c ï . . “
employé par les Américains pour empoifonber J e S Ï Ï
Contrepoifon par lequel on s’en garantit. Autr« z ’
dont le lue fert au même ufage. Différons lieux d’Afil £ • 1™*
fc fert d armes empoifonnées. Ouvrages à cnnr!\ ¿,?n
Flcchc, des anciens. XVII. 785. b. Flf'hes KI ' ,h,d-
Ciens Romains, SuppU IV . 668. b. leurs flechï, i / " '
669. a. Floches empoifonnées des Indiens XIV ? *^cs-
Les Efpagnols en employèrent de telles contre 1« lîi * ’ ’
XVI. 197. p Fléchés empoifonné« des S S S & S
b, 449. a. Celles des anciens Scythes, to i . b. Fleeh.'
pellée oc dont les Turcs font ufage. Suppl. IV 78 A ^
V l x c m A B l a f o n ) meuble d'armoiric. Fleche empennée
encochée, émouflée. Suppl. III. 49. 4. mpennee,
, Z ^ HtS {D iv in u c .) Divination par les flèches II
b. A V . 3 77. a, •
F léchés , herbe a u x , ( Bot an. ) voyez T oulola
Fleche <üéperon, ( Marine ) VÎ. 830. a.
Fleche dans la fortification. VI, 8ço.a.
Fleche de clocher. V I. 830. a. Voyeç CLOCHER.
F leche ardente ( Artiûc. ) appelléc autrefois malléole. Ufage
qu on en fait. Celui qu en faifoient les anciens. Manière de la
compofer. V I. 8ço. A.
Fleche. ( Charron ) Longueur de la fleche pour les car-
8 0 A C ^ t>0ur lcs autrcs* ^¿tails fur ce fujet. VI.
Flé ch és, ( Eventaillifie') VI. 830. A.
* terme de -fabrique de upifferie de haute-lifle
VI. 830. A.
F leche, terme de triélrac. Voye{ Lame.
F le c h e , la , ( Géogr. ) collège de la Fleche ; Dcfcartes y
avoit étudié. V I. 850. A. . -
FLECHIER, (F / p r i t ) Ces oraifons funèbres. XI. 331.
A. -Ses ouvrages. XII. 389. A. Morceaux de fes oraifons funèbres
donnés pour exemple du itylc nombreux. Suppl. IIL
307. A. 308. *. n
FLÉCHISSEUR, ( Anatom. ) mufcle qui produit la flexion
des os. Court fléchiffeur dü pouce ; fa defcription. Long
fléchiffeur du pouce} fa defcription. Celle du fléchiffeur du
doigt auriculaire. Celles du long fléchiffeur des doigts dit
pied. V I. 831. a. Du court fléchiffeur des doiets du pied :
du long fléchiffeur du pouce, du pied. Court fléchiffeur du
pouce du pied : fléchiffeur du plus petit des orteils : defcription
de ces deux mufcles. La fituation naturelle des articulations
efl d’être un peu fléchies. Lcs fléchiffeurs, dans
chaque articulation, font plus courts que les extenfeurs y
mais ils fc contraâent au même degré. Ibid. A. La force
tonique des extenfeurs èfl beaucoup plus grande que celle
des fléchiffeurs. Les fléchiffeurs des jambes font plus foibles
que les extenfeurs. Ibid. 832.1 a. Voyc^ Perforant b Perforé.
F L E E TW O O D , ( Guillaume) évêque d’Angleterre, fes
ouvrages. IX. 236. A. XVI. 463. A.
FLÊSSEN-VÎSCH , ( Ichthy. ) efpecc de poiffon. Suppl. I.
83 <5. u. ’
FLESSINGUE, ( Géogr. ) ville des Provinces-unies. Détails
fur l’amiral Ruytcr oui naquit dans cette ville en
1607. Deux illuflrcs gens ae lettres dont clic efl aufli la
patrie. VI. 832. a. .
FLÉTRISSURE , ( Jurifp.) anciennement chez les Romains
les criminels étoient marqués au front. VI. 832.
Conftantin voulut qu’ils fuffent marqués fur la main ou fur
la jambe. En France on les marque fur l’épaule. Lettres
donje on les marque. Ibid. b. ■ ■
Flétrijfure, toute condamnation qui emporte infamie. VI.
83a. A ., ’ pi- t
Plétriffurc y voyez Ignominie. Do la flétriffurc par la
fleur de lys. V L 839. a. Antiquité de l'ufage de flétrir un
crimincL Ibid. Les lettres de grâce n’effacent pas la flê-
triffure. III. 833. a. Comment elle peut être effacée.
Ibid. b , .te a
F L E T T A N , (Ich th y o l.) defcription de ce ooiffon de
mer. Qualité de fa chair. On en trouve dans la Manche. VI.
832. A. .
FLEUR. ( Bot. f fljl. anc. ) Les anciens n 'o n t p o in r déterminé
fixement ce qil’ils entendoient par- le mot. de jM -
Quelquefois ils ont caraélérifé de cc nom les a u_
filets, qui font au centre de la fleur. Excmplcs^tir^ n. tre
relianus & de Virgile ; peinture que ce poète fai* ¡a-
baume, fous le nom-d’amcllo. Pline en décrivant *
pelle calice cette partie jaune qui occupe le e >
urs, les pétales qui l’environnent. VI. 832« A.
F le u r . ( Bot. I lij l. mod. ) Définitions de la flcurr):ftin£lions
ns auteurs. Parties qu’on diftioguedansla fcur.V , ,
mifes entre les fleurs par rapport au nombre de F ^T?Icürs
F L E
Fleurs parfaites & imparfaites ’, feloil Rai. Diftirtélîoh i)eS
fleurs en mâles, femelles & hermaphrodites. Différences extérieures
qui diflinguent les fleurs dont les fexes font partagés.
Platitcs qui ont les parties mâles & femelles, mais
à quelque diflance les unes des autres. VI. 833. a.
F l e u r s des plantes 4 ( Botanc fyfiént¿ 5) M. de Tournefort
a- préféré, dans fa diflribution méthodique des plantes, les
caraéleres tirés des fleurs. VI. 833. a. Cinq parties qu’il
diftingue dans les fleurs, mais qui lie fc trouvent pas dans
toutes. Pétales de la fleur. Ses filets. Ses fomincts. Son
piflil. Oïl fc trouve l’embryon du fruit. Calice de la fleur.
M. .de Tournefort divife d’abord les fleurs , en fleurs à
feuilles & en fleurs à étamines. Lcs fleurs à feuilles font
Amples ou compofées. Détails fur les unes & les autres.
Ibid. A. Fleurs flcurdelifées. Fleurs nouées. Fleurs en um-
belle ou en parafol. Ibid. 834. a. M. de Tournefort diflin-
ue encore les fleurs en régulières 8c irrégulières. Fleurs la-
iées. Fleurs verticillées. Toutes les fleurs naiffent fur des
pédicules. Elles font ou difperfées le long des tiges 8c des
branches, ou ramaffées à la cime de ces mêmes parties :
détails fur ces deux dernicres différences. Syjléme de M. Lin-
naus. Les fleurs font compofées de quatre parties différentes.
1. Les calices font diflinguécs en fept fortes. Ibid. A. 2. Lin-
næus diftingue deux cfpeces de corolles. 3. L’étamine. 4. Le
piflil. Ibid. 8 h . a.
Fleurs H leurs différentes parties. Suppl. IV. 787. A. La
fleur paroit être le principal organe de la génération des
plantes. XII. 714. a. Structure générale des fleurs des plantes.
Ibid. Ufages de leurs parties pour la génération. Ibid.
A. Formation des différentes parties de la ncur. XVI. 961.
A. 962. a y b. Boutons à fleur, Suppl. II. 44. a. leur epa-
nouiffement. Ibid. Ailes de certaines fleurs. I. 212. A. Empalement
de la fleur., V. 372. A. Pédicule des fleurs. XII.
237. A. Fleurs flériles. III. 230.. A. Fleurs en papillon. XI.
876. a. Flcurspolypétales. XII. 9J3. a. Fleurs radiées.
X l l l . 733. A. Fleurs mâles , femelles, hermaphrodites ,
félon Linnæus. Suppl. IV. 787. A. Ufages des parties des
fleurs : différences des fleurs Amples 8c des fleurs compo-
fé e s , vol. V I des planches. Règne végétal, pl. 103.
Fleurs. ( Phyfiq. ) Des couleurs des fleurs. Les couleurs
dépendent du phlogifliquc 8c de fa combinaifon avec d’autres
principes. Les fleurs abondent en une huile cffcnticlle,
à laquelle leurs couleurs 8c la variété qui y régnent peuvent
être attribuées. Les infufions des fleurs rougiffent par
des acides, verdiffenr par des alkalis : effet du phlogifliquc
uni avec les fels. VI. 833. a. Principales couleurs quis’ob-
lervent dans les fleurs. Quelle feroit la câufe du verd, fui-*
vaut le fyflême d.es chymifles. Caufe de la blancheur de
lu chicorée, du céleri, b c . D ’où peuvent venir les nuances
jaunes dans les fleurs ; les nuances rouges j le noir; les
nuances du bleu ; le verd : toutes ces explications font tirées
du fyflême de M. Geoffroy. Obfervations fur ce fyflême.
De la confervation des fleurs. Notre pratique n’efl pas fort
heureufe dans les moyens imaginés jufqu’à ce jour pour con-
ferver aux fleurs leurs beautés. Ibid. A. Méthode du chevalier
Robert Southwell pour conferver les fleurs dans leur
état naturel 8c dans leurs propres couleurs. Enumération
des principaux auteurs qui ont écrit fur les fleurs, 8c do
leurs ouvrages. Ibid. 83 6. a.
Fleurs. Caufe des variétés qu’on obferve'8c qu’on opere
dans les fleurs. XII. 713. A. 720. a.
Fleur, ( Agricult. ) les jardiniers-fleurifles reflraignent le
mot.de fleur à quelques plantes qu’ils cultivent à caufe de
la beauté dans leurs fleurs. Ce qu’il y a de fingulici', c’eft
que nous n’avons point de belles fleurs, excepté les oeillets,
qui ne viennent du Levant. On diftingue deux fortes do
fleurs, celles qui viennent de racines 8c celles qui viennent
d’oignons ; mais elles peuvent toutes fc multiplier par des
cayeux, des boutures, des tailles , des marcottes. Détails
fur les fleurs qu’il faut élever de graines, 8c fur la maniéré
de les cultiver. VI. 836. A. De la culture des plantes qui
viennent d’oignons. Soins par lefqucls on fait croître extrêmement
une fleur. Moyens d’exciter dés l’hiver dans les
ferres celles qui ne viennent qu’au printems ou en été. Des
/moyens de panacher 8c de chamarrer les fleurs de diverfes
couleurs. Ibid. 857. a. Autres variétés furprenantes que l’art
^produites dans les fleurs. Des foins qui concernent la graine.
De la culture des oignons qui viennent de graines. Soins à
donner aux fleurs en hiver oc en été. Enumération des fleurs
du printems, de celles d’é té, Ibid. A. de celles d’automne ,
de celles d'hiver. Auteurs à confultcr. A quel point la paf-
fion des fleurs a étépoufféc en Hollande. Ibid. 838. a. Voyeç.
F leuriste.
Fleursy utilité de leur culture. VIII. 227. A. Des graines
à fleurs, du foin de les conferver, de la manière de les
femer. VII. 833. a y b y 8cc. Soins qu’il faut donner aux
fleurs. IV. 331, A. Plantation des arbres de fleurs qu’on
élevé en caiffc. XII. 726. A. Pourquoi les fleurs doubles ne
donnent point de graine. XIV. 114. A. fleurs panachées.
Tome I .
F L É 74*
S ü p p l.tV . i i à . a. Maniéré dé faire des déffeiris & orne-
mens fur des fleurs naturelles 6c autres. IV. 801. A. fleurs
du printems. X V I I .733. * .F lcursdu printems, de l’été &
de 1 automne. IV . 704. g| Fleurs dont en chaque faifon dd
1 année bn peut embellir les bofquets. Suppl. U. 14. a b,
2 6. a. 9
FleurSî (FUJI, anci ) Couronnes de fleurs en ufage dans
les grandes fêtes. IV. 169. a. Ufage de jetter de* fleurs cri
certaines occafidns. XII. 53 6 . à.
Fleur de la pajflon ou grenadille. VI. 838; a:
Fleur au Joleil. Elle efl différente de l'héliotrope. On en
diftingue deux cfpeces. Elle f c tourné toujours vers le foleil.
Culture de cette fleuh VI. 838. a.
Fleur de cardinal. Vôye{ CONSOUÜE ROYALE.
F leurs de mufeade. ( Pharm. b mat. Méd. ) Voye{ MàCIS.
F leurs. (Pharmacia De la manière de les conferver.
Phénomène remarquable fur la deftruélion de la couleur des
fleurs qu’on expofe au foleil pour les deffécher. VI. 858. A.
Fleurs , eau de mille. XVI. 79 t. a-.
F leurs d ’argent. (Minéral’.') VL 838. b.
Fleurs de J'er , ( Minéral. ) cfpece de flalaélite qui fc
trouve attachée aux voûtes des fouterreins de quelques
mines ; lorfqu’il s’y trouve du fer , ce n’e'ft qu’accidentcl-
' lement. C ’cft dans les mines de fer de Stirie qu’elle fc trouv
e plus fréquemment. VI. 838. A.
Fleurs d ’A fle t ( Minéral. ) fcl qui fë trouve à la furface
de la terre dans pluflctirs endroits de l’Afie. On l’appelle
aufli terre fablonneufe de Smyrne. C ’eft le natron ou nitruiri
des anciens, b c . V l. 838. Ai
F leurs, (Chymie) produit dé la fublîmatiôn; VI. 839. a.
FLEVRS-de-lys. ( Jurifpr. françoife ) D e la flétriffure de la
fleur-dc-lys imprimée par le bourreau. Quel en cft le but.
Cette idée dé flétriffure efl fort ancienne. Les Romains
l’appelloient infcriplio.Flétriffure que les Samiens imprimèrent
fur des Athéniens qu’ils avoient fait prifonniers. Flétriffure
ordonnée par Platon. Conftantin modéra cette peine chez
les Romaiqs. Elle a été aufli modérée par plufieurs législateurs
modernes, 8c en France. VI. 839. at
Fleurs & antimoine. I. 309. a , A.
Fleurs d'un vaijfeau , ( Marine ) rondttié qui fc trouve
dans les côtés du vaiffeau. Quelle doit être cette rondeur;
VI. 839. a. Voye{ F lorER.
Fleur y à fleur d’eau. Tiret à fleur d’eau. V I. 839. a.
F leurs. ( Peint. ) La nature femble prodiguer fur les
fleurs tous les charmes du coloris. Les couleurs les plus
franches femblcnt y concourir 8c difputer cntr’elles. VI;
839. a. Elle permet qu’en affcmblant un grouppe de fleurs;
on joigne enfcmble les teintes qui ont été regardées comme
les plus antipathiques, fans craindre que les loix de l'harmonie
en ioicnt bleffées. Quelle cft une des meilleures
études de coloris qu’un jeune artifte puiffe faire. Qualités
que doit avoir un artifte qui fe voue à ta peinture des fleurs;
Réflexions fut l’art requis dans ce genre de peinture) Ibid. Ai
Fleurs y peintres de. XII. 266. Ai
FLEUR de pêche , (Manège, Maréch.) auber, mille-fleurs,
expreflions fynonymes employées pour aéfigner une certaine
couleur de la robe ou du poil des chevaux. VI. 860. a.
Fleur de farine, terme de boulanger. VI. 860. a.
Fleur y terme de fabrique de cuirs. Les principaux apprêts
qu’on leur donne fe font du côté de la fleur. Les couleurs
s appliquent quelquefois des deux côtés. Donner le fuif de
chair Oc de ncur. Peaux effleurées. VI. 860. a. .
Fleur b chair en terme de tanneur 8c de chamoifeur. III.
12. a. 71. a.
F leurs. ( March. de modes) V I. 860. at
Fleurs artificielles ; comment elles fc font eri émail. V.
344. A. Comment elles fc font en plumes , voyc^ Plumas-
s ie r , 8c les planch. de cet a r t ,- dans le V IlL vo l. des pl.
Moyen de donner aux fleurs artificielles l’odeur- des fleurs
naturelles. V . 499. a. Voye{ F leu r is te .
Fleurs. ( Ruban.) Imitation de toutos les différentes fleurs
imaginables. Obfervations fur celles qui font de velin ou de
coques. Beauté de cette imitation. VI. 860. a. Autre fignifi-
cation du mot fleur. Ibid. b.
Fleurs artificielles. (Ruban.) Habileté des ouvriers chinois
dans l’art d'imiter les fleurs naturelles. Ceux qui font
au palais de l’empereur manient la foie avec beaucoup d’a-
dreffe, 8c favent peindre à l’aiguille toutes fortes de fleurs
fur des feuilles de papier. Rofcau ou cfpece de canne qui
fournir la matière qu’on y emploie. Il eil appcllé tong-tjao
dans l’herbier chinois. Ses propriétés médicinales. Suppl. IIL
30. a. Lieux où il croît. Sa defcription. Ufages auxquels on
remploie. Ibid. A. Comment ces ouvriers chinois appliquent
les couleurs fur la maticre qu’ils en tirent pour faire leurs
fleurs artificielles. Comment ils leur donnent les différentes
figures qu’elles doivent avoir. Ibid. 31 . a . Efpecc de luftre
qu’ils leur donnent. Manière dont ils imitent les fruits, les
petits infc&es qui s’y attachent, 8c fur-tout les papillons.
Ibid, b,
E B B B b b b b b