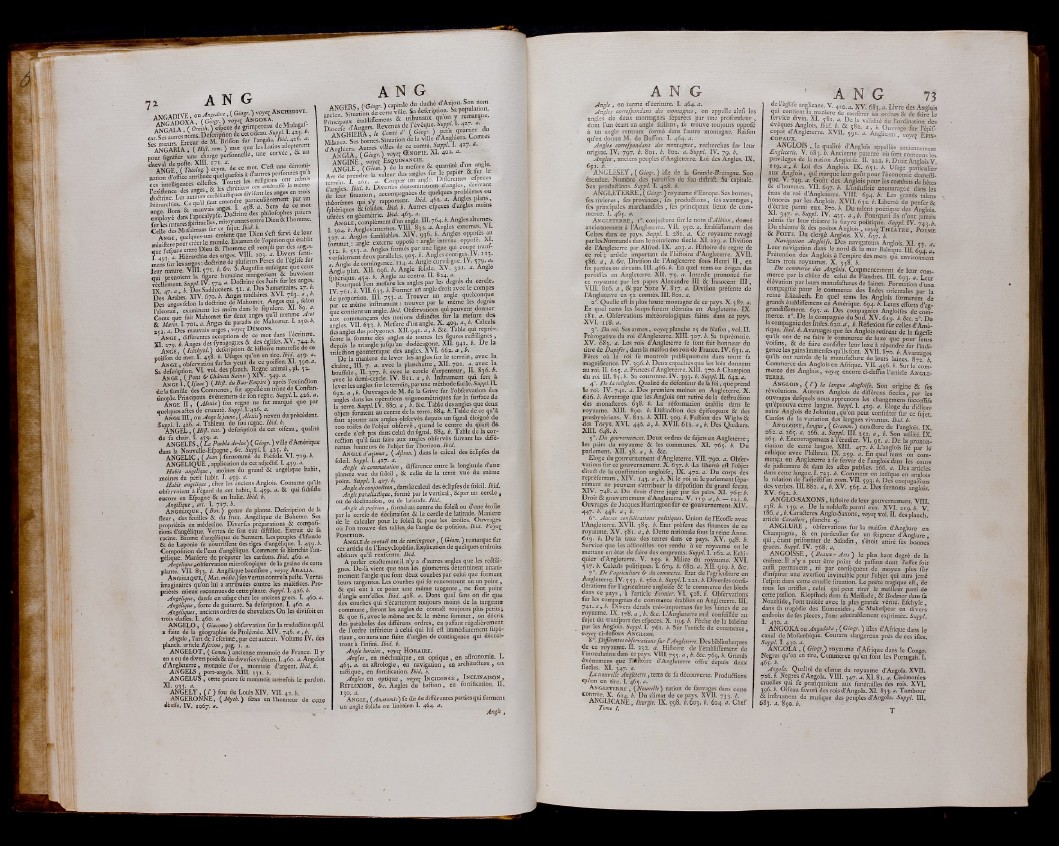
«72 A N G
ANGADIVE, ouMs«£ve,(Giosr.) voyi{.Anchedive.
r » = S « - S S " ’Éts '* ANGAR1A., (Hift. rom.) mot que le s Latins adoptèrent
pour fignifier une churge perfonneïle, une co rv ée ,
ch ANGE T(°rliôfog1) B R I ce mot. Ceft une dénonù-
6 5 a - i c e j J M W R a a S g R i
doârine. P« ®
hiérarchies, t e quu ;aui t r _ ¿e ce mot
S | § BH aS lC c I l y Sp S ^ n e des phüofophes païens
t e g s ’eft fervi de R
miniflme p o u r créer le monde. Examen de l’opuuon qui établit
T e ta e entre Dieu & l’homme eft rempli par des anges.
n ^ H é r a r c h i e des anges. VIII. ao3. n. 4 * » t a
mens fur les anges : doûrine de plufieurs Peres de 1 éghfe fur
lenr nature. Vin. 571. ». «■»• S. Augufttn enfeigne que ceux
„ " prenoient la f o r e humaine mangeotent & huvoient
réellement. Suppl. IV. 574-n. Ddarine des Jmfs f o ie anges.
IX 47 » , ». Des Sadducéens. 51. a. Des Samantains. 27. ».
Des Arabes. XIV. 670. ». Anges tutélaires. XVI. 763. n , i.
Des anges félon la doftrine de Mahomet Anges qui, félon
l’alcoran, examinent les morts dans le fepulcre. XI. 89. ».
Conte que fait Mahomet fur deux anges ou il nomme Arot
& Marc!. 1. 701. a. Anges du paradis de Mahomet. I. a;o. ».
a tt. a. Des mauvais anges, voycç Démons.
A nge , différentes acceptions de ce mot dans lécnture.
XL 770. b. Anges des fynagognes & des éghfes. XV. 744. ».
A n g e ( lihthyol. ) defcription & hiffoire natureUe de ce
poiffon de mer. § 4 » l f c | qu’on en tire, lbri 4J 9- »•
A n g e , obfervanon fur les yeux de c e poiffon. X I 390.4.
Sa defcription. VI. vol. des planch. Regne anuuàl, pL 5*.
A n g e , ( Pont & Château Saint-) XLV. 349* f - „ .
m m m w m après lexunÉhon
de la famille des Comnenes, fut appellé au trône de Conftan-
tinople. Principaux événemens de fon regne. Suppl. 1. 426. a.
A nge I I , (Alexis) fon regne ne fut marqué que par
«melquesaftes de cruauté. Suppl.l.'4*6. a.
A nge m , ou Ange le jeune, (Alexis) neveu du précédent.
Suppl. I. 426. di. Tableau de fon regne. Ibid. b.
ANGEL, ( Hijî. nat. ) defcription de cet oifeau, qualité
de fa chair. I. 459. a. g
ANGELES, ( La Puebla de-los) ( Geogr. ) ville d Amérique
dans la Nouvelle-Efpagne, &c. Suppl. I. 4* 5- b-
ANGELIC, (Jean ) furnommé de Fiéfolê. VI. 719. b.
ANGÉLIQUE, application de cet adjeâif. 1. 459. a.
Habit angélique, moines du grand & angélique habit,
moines du petit habit. I. 459. a.
■ Habit angélique, chez les anciens Anglois. Coutume qu tis
obfervoient à l’égard de cet habit, I. 459. a. & qui fubfifte
encore en Eipagne 8c en Italie. Ibid. b.
Angélique , art. I. 717. b.
A ngélique , (Bot.) genre de plante. Defcription de la
fleur j des feuilles 8c du fruit. Angélique de Boheme. Ses
propriétés en médecine. Diverfes préparations 8c compofi-
tions d’angélique. Vertus de fon eau diftillée. Extrait de fa
racine. Baume d’angèlique de Sennert. Les peuples'd’Iilande
8c de Laponie fe nourriffent des tiges d’angélique. I. 459.b.
Compofition de l’eau d’angélique. Comment fe blanchit l’an-
gélique. Maniéré de préparer les cardons. Ibid. 460. a.
Angélique „obfervation microfcopique de la graine de cette
plante. Vil. 833. b. Angéücrue baccifere, voye^ A r a u a .
A ngélique, (Mat. médic!) fes Vertus contre la pefte. Vertus
imaginaires qu’on lui a attribuées contre les maléfices. Propriétés
mieux reconnues de cette plante. Suppl. 1. 426. b.
Angélique, danfe en ufage chez les anciens grecs. I. 460. a.
Angélique, forte de guitarre. Sa defcription. I. 460. a.
Angéliques, anciens ordres de chevaliers. On les divifoit en
trois claffes. I. 460. a.
ANGELO, ( Giacomo ) obfervatiOn fur la tradu&ion qu’il
a faite dé la géographie de Ptolémée. XIV. 746. a ,b.
Angelo, l’art de l’efcrime, par cet auteur. Volume IV. des
planch. article Efcrime, pag. 1. a.
ANGELOT, ( Comm.) ancienne monnoie de France. Il y
en a eu de divers poids & de diverfes valeurs.! 460. a. Angelot
d’Angleterre, monnoie d’o r , monnoie d’argent. Ibid. b.
ANGELS , port-angels. XIII. 131. b.
ANGELUS , cette priere fe nommoit autrefois le pardon.
À^HeLY , ( / ') fou de Louis XTV. VIL 42. i.
ANGERONNE, (Myth.) fêtes en l’honneur de cette
déefie. IV. 1067. a. |
A N G
ANGERS, (•Gioff. ) capitale ' sÛpopuhriô”
iss'“’<35.fnr*.s i-»p*-u,* tmïefn u Æ g ^ D ÎÆ m s efpeces isaaRÉi^MRÉBÉiiAi théorèmes qui s’y rapportent. Ibid. 462. a. Angles plans,
fphèriques SfoUdes. Ibid. ». Autres efpeces d angles moins
UfÎ ^ , t f o t c " d t n1 ^ e : i n . 764.».Ang1eSahet„et
I Ï04 b Angles interhes. VIII. 832. a. Angles externes. VI.
,27 1 Angles femblables. XIV. 936. b Angles oppofés au
fommet : â g le externe oppofé : angle interne oppofé. XI.
, i 2 ». ',13. 4. Angles formés par une.ligne qui coupe trailfvcrfalement
deux parallèles. 905. »• Angles conngus IV . . 3.
4 Angle de contingence/114.4. Angle curviligne. IV. s |9- “■
AndTplau. XII. 696. ». Angle fol.de. XV. 3*1. ». Angle
fDherique. 4S4. b. Angle au centre. II. 824. a.
Pourquoi l’on mefure les angles par les degrés du cercle.
I IV 761 b. VII. 633 .b. Former urî angle droit avec le compas
de proportion. I I ! 753- B Trouver un, Æ par ce même inftrument : trouver par le meme les degrés
que contient un angle. Ibid. Obfervations qui peuvent donner
aux commençans des notions diihnftes fur la mefure des
angles. V I ! 633. b. Mefure d’un angle. X. 40^. a, b. Calculs
des angles des polygones. X I ! 941. a , b. &c. Table qm repre-
(enteïa fomme des angles de toutes les figures reélilignes,
depuis le triangle jufqu’au dodécagone. XII. 941. b. De la
trife&ion géométrique des angles. XVI. 662. a , b.
De la maniéré de lever les angles fur le terrein, avec la
chaîne, I I ! 7. a. avec la planchette , X I ! 701. a avec la
bouffole, II. 377. b. avec le cercle d arpenteur, IL 826. b.
avec le demi-cercle. IV. 811. a f b. Inftrument qui fert à
lever les angles fur le terrein, par une méthode facile. Suppl. IL
692. a y b. Ouvrages de M. de la Grive fur l’obfervation des
angles dans les opérations trigonométriques fur la furface de
la terre. Suppl.IV. 880. a , b. &c. Table des angles que deux
objets forment au centre de la terre. 884. b. Table de ce (m il
faut ajouter aux angles obfervés depuis un fignal éloigne de
100 toifes de l’objet obfervé, quand le centre du quart de
cercle n’eft pas dans celui du fignal. 884. b. Table de la correction
qu’il faut faire aux angles obfervés fuivant les différentes
hauteurs de l’objet fur l’horizon. Ibid.
A ngle d'azimut, (Afiron.) dans le calcul des éclipfes du
foleil. Suppl. ! 427. a.
Angle de commutation y différence entre la longitude d une
planete vue du foleil, & celle de la terre vue du même
point. Suppl. ! 427. b. '
Angle de conjonélion, dans le calcul des éclipfes de foleil. Ibid.
Angleparallaüique, formé par le Vertical, &par un cercle a
ou de déclinaifon, ou de latitude. Ibid.
Angle depofition , formé au centre du foleil ou d’une étoile
par le cercle de déclinaifon & le cercle de latitude. Manier©
de le calculer pour le foleil &. pour les étoiles. Ouvrages
où l’on trouve des tables.de l’angle de pofition. Ibid. Voyeç
Position. •
A ngle de contait ou de contingence, ( Geom. ) remarque fur
cet article de l’Encyclopédie. Explication de quelques endroits
obfcurs qu’il renferme. Ibid.
A parler exactement il n’y a d’autres angles que les reCtili-
gnes. De-là vient que tous les géomètres déterminent unanimement
l’angle que font dèux courbes par celui que forment
leurs tangentes. Les courbes qui fe rencontrent en un point,
& qui ont à ce point une même tangente, ne font point
d’angle entr’elles. Ibid. 428. a. Dans quel iêns on dit que
des courbes qui s’écarteront toujours moins de la tangente
commune, feront les angles de contaft toujours plus petits;
& que fi, avec le même arc & le même fommet, on décrit
des pahiboles des différens ordres, en paffant régulièrement
de l’ordre inférieur à celui qui lui eft immédiatement fupé-
rieur, on aura une fuite d’angles de contingence qui décroîtront
à l’infini. Ibid. b.
Angle horaire , voycç HORAIRE.
Angles y en méchanique, en optique, en aftronomié. !
463. a. en aftrologie, en navigation, en architeClure , en
taCuque, en fortification. Ibid. b.
Angles en optique , voye[ In c id e n c e , In c l in a is o n ,
R é f l e x io n , &c. Angles du baftion, en fortification. I !
130 .a . H H I
A ngle, (Anatomie) fe dit de différentes paruesqui forment
un angle folide ou linéaire» ! 464. a.
Angle,
A N G
Angle y en terme d’écriture. ! 464. a.
Angles correfpondans des montagnes, on appelle ainfi les
angles de deux montagnes féparées par une profondeur ,
dont l’un étant un angle faillant, fe trouve toujours oppofé
à un angle rentrant formé dans l’autre montagne. Raifon
qu’en donne M. de Buffon. ! 464. a.
Angles correfpondans des montagnes, recherches fur leur
origine. IV. 797. b. 801. b. 802. a. Suppl. IV. 79. b.
Angles 3 anciens peuples d’Angleterre. Loi des Angles. IX.
651. b.
ANGLhSEY, ( Géogr. ) ifle de la Grande-Bretagne. Son
étendue. Nombre des paroifies de fon diftriCt. Sa capitale.
Ses productions. Suppl. I. 428. b.
ANGLETERRE, ( Géogr. ) royaume d’Europe. Ses bornes,
fes rivieres , fes provinces, fes productions, fes avantages,
fes principales marchandifes, fes principaux lieux de commerce.
1. 463. a.
A ngleterre , i°. conjeChire fur le nom d’Albion, donné
anciennement à l’Angleterre. V I ! 950. a. Etabliffement des
Celtes dans ce pays. Suppl. ! 281. a. Ce royaume ravagé
par les Normands dans le neuvième fiecle. X ! 229. a. Divifion
de l’Angleterre par Alfred. IX. 403. a. Hiftoire du regne de
ce roi ; article important de l’hiftoire d’Angleterre. X V I !
<86. a 3 b. &c. Divifion de l’Angleterre fous Henri I I , en
fix parties ou circuits. I I ! 466. b. En quel tems on érigea des
paroifies en Angleterre. X I ! 73. a. Interdit prononcé fur
ce royaume par les papes Alexandre III & Innocent I I I ,
V I I ! 816. a , &par Sixte V. 817. a. Divifion préfente de
l’Angleterre en <2 comtés.II!801 .a.
20. Quelle eft la plus haute montagne de ce pays. X. 387. a.
En quel tems les loups furent détruits en Angleterre. IX.
181. a. Obfervations météorologiques frites dans ce pays.
XVI. 118. i
30. Du roi. Ses armes, voye^ planche 1 1 du blafon, vol. ü
Prérogative du roi d’Angleterre. X I I ! 307. b. Sa iuprématie.
XV. 683. a. Les rois d’Angleterre fe font frit honneur du
titre de Dapifer, dans la mailon des rois de France. IV. 631. a.
Fêtes où le roi fe montroit publiquement dans toute fa
magnificence. IV. 396.b. Deux capacités que les loix donnent
au ro i.I ! 625. a. Princes d’Angleterre. X I Î ! 370. ¿.Champion
du roi I I ! 85. b. Sa couronne. IV. 393. b. Suppl. I ! 642. a.
4°. De la religion. Qualité de défendeur de la foi, que prend
le roi. IV. 741. a. Des premiers moines en Angleterre. X.
616. ¿.Avantage que lesAnglois ont retiré delà deftruétion
des monafteres. 038. b. La réformation établie dans le
royaume. XIII. 890. b. Diftinétion des épifeopaux 8c des j
presbytériens. V. 812. b. X I I ! 309. b. Faétion des Wighs 8c
des Torys. XVI. 440. a , b. X v lï . 6x2. a, b. Des Quakers.
X I I ! 648. ¿I .
50. Du gouvernement. Deux ordres de fujets en Angleterre;
les pairs du royaume 8c les communes. XI. 763. b. Du
parlement. XII. 38. a , b. 8cc.
Eloge du gouvernement d’Angleterre. VII. 790. a. Obfervations
fur ce gouvernement. X. 637. b. La liberté eft l’objet
direft de la conftitution angloife, IX. 472. a. Du corps des
repréfentans, XIV. 143. a , b. Ni le roi ni le parlement fépa-
rément ne peuvent s’attribuer la difpofition du grand fceau.
XIV. 748. a. Du droit d’être jugé par fes pairs. XI. 763: b.
Droit 8c gouvernement d’Angleterre. V. 119. a ,b . 121. ¿.
Ouvrages de Jacques Harrington fur ce gouvernement. XIV.
447. b. 448. a 3 b.
6°. Autres confédérations politiques. Union de l’Ecofle avec
l’Angleterre. XVII. 383. b. Etat préfent des finances de ce
royaume. XV. 381. a , b. Dette nationale fous la reine Anne.
619. b. De la taxe des terres dans ce pays. XV. 948. b.
Service que les aélioniftes ont rendu à ce royaume en le
mettant en état de faire des emprunts. Suppl. ! 162. a. Echiquier
d’Angleterre. V. 239; b. Milice du royaume. XVI.
52?.Jb. Calculs politiques. ! 679. b. 680. a. X I ! 919. ¿. &c.
70. De 1“agriculture & du commerce. Etat de l’agriculture en
Angleterre. IV. 353. ¿. 360. b. Suppl. ! 221. b. Diverfes confédérations
fur l’agriculture angloife 8c le commerce des bleds
dans ce pays, a l’article Fermier. VI. 528. ¿". Obfervations
fur les compagnies de commerce établies en Angleterre. H !
741. a 3 b. Divers détails très-importans fur les laines de ce
royaume. IX. 178. a , b. 8cc. L’Angleterre mal confeillée au
fujet du tranfport des efpeces. X. 194. b. Pèche de la baleine
par les Anglois. Suppl. ! 761. b. Sur l’article du commerce, I
voye^ ci-deffous A ng lo is .
8°. Différentes obfervations fur VAngleterre. Des bibliothèques
de ce royaume. I ! 232. a. Hiftoire de l’établiflement de
l’inoculation dans ce pays. V I I ! 7 j 3. a , b. 8cc. 769. b. Grands
événemens que l’itàoire d’Angleterre offre depuis deux
flecles. XI. 347. a.
La nouvelle Angleterre, tems de fa découverte. Productions
qu’on en tire. ! 463. a.
A ngleterre , (Nouvelle) nation de fauvages dans cette
contrée. X. 614. b. Du climat de ce pays. X v lï. 733. b.-
ANGLICANE, liturgie. IX. 398. b. 603. b. 604. a. Chef
Tome I,
A N G 73
É É É f e anlU(:M'e- S 4 » . ». XV. 683. 1 Livre des Anglois
qui contient la maniere de conftrer les ordres & de fiire le
ÎévlêfqouLes A4n'g"lio is. ,2Il8,,dV. »'. P&i h5.8 ev.Æ ad,i té4. dOeu lv’orradgien aftuior nl ’édneisf.
cXuxg e-xm w,‘ I ¡¡ÉpPR ifl;
ANGLOIS , la qualité d'Anglois appellée anciennement
r.ngiecent. V. 683. b. Ancienne patente où font contenus les
privilèges de la nation Angloife. II. 222. b. Droit Anglois V.
119. a s ¿. Loi des Anglois. IX. 631. b. Ufage particulier
aux Anglois, qui marque leur goût pour l’économie domefti-
9ue;,/ • 749* a- Goût des Anglois pour les combats de bêtes
oc d hommes. VII. 697. b. L’induftrie encouragée dans les
états du roi d’Angleterre. V I I ! 694. b. Les grands talens
honores par les Anglois. X V I ! 632. b. Liberté de penfer&
d écrire parmi eux. 870. b. Du talent poétique des Anelois.
j .347- a- Süppl IV. 433. a 3 b. Pourquoi ils n’ont jamais
admis fur leur théâtre la frtyre politique. Suppl. IV. 7An.b.
Du théâtre 8c des poètes Anglois , voye^T h é â t r e , PoemE
8c P o e te . Du clergé Anglois. XV. 637. b.
Navigation Angloife. Des navigateurs Anelois. XI. <2 a
Leur navigation dans le nord 8c la mer Baltique. I I ! ¿ 4 . 1
Prétention des Anglois à l’empire des mers qui environnent
leurs trois royaumes. X. 338. b.
Du commerce des Anglois. Coqimencement de leur commerce
par la chute de celui de Flandres. I I ! 693. a. Leur
élévation par leurs manufaftures de laines. Formation d’une
compagnie pour le commerce des Indes orientales par là
reine Elizabeth. En quel tems les Anglois formèrent de
grands étabiiflemens en Amérique. 694. b. Leurs efforts d’ae-
grandiflement. 693. a. Des compagnies Angloifes de commerce.
1 . De la compagnie du Sud. XV. 619. ¿.8cc. 20. De
la compagnie des Indes. 620. b. Réflexion fur celles d’Àmé-
nque. Ibid. b. Avantages que les Anglois retirent de la faeefle
qu ds ont de ne frire le commerce de luxe que pour fours
voifins, 8c de frire confifter leur luxe à répandre for l’indigence
les gains immenfes qu’ils font. X V I ! 870. b. Avantages
qu’ils ont retirés de la manufacture de leurs laines. 872 b
Commerce des Anglois en Afrique. V I ! 436. b. Sur le commerce
des Anglois, voye\ encore ci-deffus l’article A ngleterre.
A n g l o is , ( / ’ ) la langue Angloife. Son origine 8c fes
révolutions. Auteurs Anglois de différens fiecles, par les
ouvrages defquels nous apprenons les changemens fucceflifs
qu éprouva cette langue. Suppl. ! 429. a. Eloge du dictionnaire
Anglois de Johnfon, qu’on peut confulter fur ce fujet.
Caufes de la variation des langues vivantes. Ibid. b.
A N g lô ïS e 3 langue3 ( Gramm.) caraCtere de l’anglois. IX.
262. a. 263. a. 266. a. Suppl. I I ! 232. a , b. Son utilité. IX.
263. i Encouragemens à l’étudier. VI. | | a. De la proiion-
ciation de cette langue. X I I ! 437. b. L’anglois lié par lé
celtique avec l’hébreu. IX. 239. a. En quel tems on commença
en Angleterre à fe fervir de l’anglois dans les cours
de judicature & dans les aCtes publics. 266. a. Des articles
dans cette langue. !. 723. b. Comment oh indique en anglois
la relation dé l’adjeCtifau nom. VII. 393. b. Des conjuguions
des verbes. III. 882. a, b. XV. 365. a. Des furnoms anglois.
XV. 692. b.
ANGLO-SAXONS, hiftoire de four gouvernement. V I I !
b. 139. a. De la nobleftè parmi eux. X V ! 219. b. V.
136. a 3 b. CaraCleres Anglo-Saxons, voye^ vol. H. des planch.*
article Cdraftere, planche 9;
ANGLURE , obfervations fur la maifon d’Anglure en
Champagne, 8c en particulier fur un feigneur d’Anglure ,
qui, étant prifonnier de Saladin, s’étoit attiré fes bonnes
grâces. Suppl. IV. 768. a.
ANGOISSE, (Beaux-Arts) le plus haut degré de la
crainte. Il n’y a peut être point de paflion dont l’effet foir
ùtiffi, permanent, ni par conféquent de moyen plus for
d’infpirer une averfion invincible pour l ’objet qui aura jetté
l’efprit dans cette cruelle fituation. Le poè’te tragique eft, de
tous les artiftes, celui qui peut tirer le meilleur parti de
cette paflion. Klopftock dans fa Meifiade, 8c Bodmer daiisia
Noachide, l’ont traitée avec la plus grande vérité. Efchyle,
dans fa tragédie des Eumenides, & Shakefpear en divers
endroits de fes pièces, l’ont admirablement exprimée. Suppl.
! 430. a.
ANGOKA ou Angadoka, ( Géogr. ) ifles d’Afrique dans le
canal de Mofambique. Courans dangereux près ae ces ifles.
Suppl. ! 430. a.
ANGOLA, | G é o g r royaume d’Afrique dans le Congo.
Negres qu’on en tire. Commerce qu’en font les Portugais. !
4<>Ç- b.
Angola. Qualité du climat du royaume d’Angola. XVII.
726. b. Negres d’Angola. V I I ! 347. a. XI. 81. a. Cérémonies
cruelles qui fe pratiquoient aux funérailles des rois. XVI.
396. b. Oifeau favori des rois d’Angola. XI. 833. a. Tambour
8c inftrument de mufique des peuples d’Angola.- Suppl. I ü
683. a. 850. b.
T