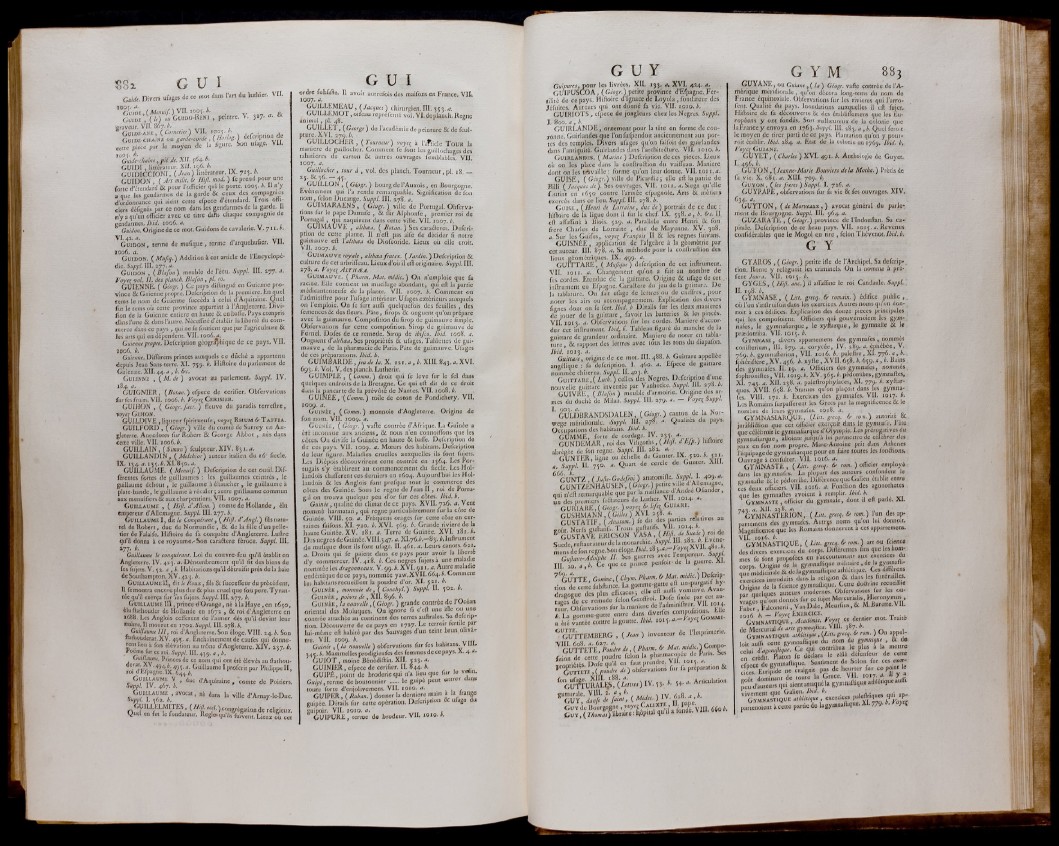
"O o 2. G U I
Coi*. Divers ufages de ce mot dans l'art du luthier. VII.
* G u i d e , (M c n u if.) V I I . 1 0 0 5 .b. .
G u id e , (/<) 0« G u i o o - K e n i , peintre. V. 317. a. at
^Guide'ane! \curnc i’n r ) V II. toor. A , . ..
C . C » « ou gardt-cordt, ( /¿ r% . ) dcfcrtpt.on de
ccneplece par le moÿen de la ligure, ion ufage. VU.
Guide-chaîne, »/V d e .X J l. 304. é.
G U ID I, littérateur. X l l .u jO .b .
G m Ù l G C t O m , ( t o n ) Iiuérateur. IX. 713. f.
GUIDON ( milit. b Hifl. mod. ) fe prend pour une
forte d’étendard & pour l’officier qui le porte. 1005. b. Il n y
a que les gendarmes de la garde 8c ceux des compagnies
d’ordonnance qui aient cette efpece d étendard. Trois officiers
défignés par ce nom dans les gendarmes de la garde. 11
n’y a qu’un officier avec ce titre dans chaque compagnie de
gendarmes. Ibid. 1006. a. , ,
Guidon. Origine de ce mot. Guidons de cavalerie. \ . 7 1 1 .0 .
G u id o n , terme de mufique, terme d’arquebufier. V II.
G u id o n . ( M uj iq.) Addition à cet article de l’Encyclopédie.
Suppl.III. 2 77* a ' . .. . „ Tyr
G u id o n , ( B la fo n ) meuble delécu. Suppl. III. 277. a.
Voyez vol. II . de/ planch. B la fon, pl. 10.
GUIENNE. ( Géogr. ) Ce pays diftingué en Guienne province
& Guienne propre. Description de la première. En quel
tems le nom de Guienne fuccéda à celui d’Aquitaine, Quel
fut le tems où cette province appartint à l’Angleterre. Dm *
fion de la Guienne entiere en haute & en baiîe. Pays compris
d'ans l’une & dans l’autre. Néceffité d’établir la liberté du commerce
dans ce pays, qui ne fe foutient que par l’agriculture 8c
les arts qui en dépendent. V II. 1006. a.
Guienne propre. Defeription géographique de ce pays. V II.
ïffoô. b, . -
Guienne. DifTérens princes auxquels ce duché a appartenu
depuis Jean Sans-terre. XI. 759. b. Hiftoire du parlement de
Guienne.XII.44 . a , b.& c .
G u ie n n e , (M , d e ) avocat au parlement. Suppl. IV ,
184, a.
GUIGNIER, ( Bûtan. ) efpece de cerifier. Obfervations
fur fes fruits, V II. 1006. b. Voyez C e r i s i e r .
GUIHON , ( Géogr. facr. ) fleuve du paradis terreftre,
Voyez GeHON»
GUJLDIVE , liqueur fpiritueufe, v oy e zR h u m 6 * T a f p i a .
GUILFORD, (G éo g r.) ville du comte de Surrey en Angleterre,
Anecdotes fur Robert 8c George Abbot, nés dans
cette ville. V II. 1006. b.
GU1L LA IN , ( Simon ) fculpteur. X IV . 831.4.
GUILLANDIN , ( Melchior) auteur italien du iG" fiecle.
IX. 134. a. 135.b .X I.850, a.
GUILLAUME, ( Menutfl ) Defeription de cet outil. D ifférentes
fortes de guillaumes : les guillauines ceintrés, le
guillaume debout, le guillaume à ébaucher, le guillaume à
plate-bande, le guillaume à récaler ; autre guillaume commun
aux menuifiers & aux charpentiers. V II. 1007, a.
G u i l l a u m e , ( Hifl. d'Allcm, ) comte de Hollande, élu
empereur d’Allemagne, Suppl. III . 277. b.
G u i l l a u m e I , dit le Conquérant, (H i f l . d ’A n g l .) fils naturel
de Robert, duc de Normandie, 8c de la fille d’un pelletier
de Falaife, Hiftoire de fa conquête d’Angleterre. Luftre
qu’il donna à ce royaumes Son caraClcre féroce. Suppl. 111.
* 77* bt .
Guillaume le conquérant. Loi du couvre-feu qu’il établit en
Angleterre. IV. 423. a. Dénombrement qu’il fit des biens de
fes fiijets, V. 5 2. a ,b . Habitations qu’il détruifit prés de la baie
deSouthampton.XV.423, b.
G u i l l a u m e 11, dît U R o u x , fils 8c fuccefleur du précédent.
Il fe montra encore plus dur 8cplus cruel que fou pere. Tyrannie
qu’il exerça fur fes fujets, Suppl. III. 277, b.
G u i l l a u m e 111, prince d’Orauge, né à la Haye, en 1630,
éluftathouder de Hollande en 1672 , 8c roi d’Angleterre en
1688. Les Anglois cefferent de l’aimer dés qu’il devint leur
maître. Il mourut en 1702, Suppl. III. 278. b,
. Guillaume ¡ 1 1 , roi (l'Angleterre. Son éloge. V III, 24, b. Son
ftathouderat.XV. 495, a. Enchaînement de caufes qui donnèrent
lieu à fon élévation au trône d’Angleterre. X IV . 227. b,
Poemefur ce roi, Suppl. III, 439, a ,b .
Guillaume, Princes de ce nom qui ont été élevés au ftathou
- / ï i r r 495'n. Guillaume I roi d Efpagne, IX, 644, b. proferit 1p ar Philipupe II
* r C M V W# T * ^Aquitaine * comte de Poitiers,
S u p l lLl AlG i £b ,a V 0 Ç i i t * * h * d’Arnay-le-Duc,
oQuefl een ifuTt le* fo?nda t*e Cur.# R^é'g:l^é*) q;cup’inUg fruéigvactniotn, L diee urexl i¿gJieux,
G U I
ordre fubfifle. Il avoit autrefois des maifons en France. V IL
1007. a.
r r r i ' r r î î n T ’17 Jacques) /.c ,liru r&ien. I I I . 3 3 3 .4 .
GUILLEMOT, oileau représenté vol. V I. de planch. Regne
animal, pl. 48.
GU1LLE T, ( George ) de l’académie de peinture 8c de fculu
r e .X V I , 279.L
GUILLOCHER I ( Tourneur) voyez à i’àfticle T o u r la
maniere de guillocher. Comment fe font les guillochages des
tabatières de carton 8c autres ouvrages femblables, V II.
X007. 4 ,
G uillocher, tour à , vol. des planch. Tourneur, pl. 18 —
^3 6 . — 43.
GU1LLON , ( Gépgr. ) bourg de l’Auxois , en Bourgogne.
Evénement qui l’a rendu remarquable. Signification de ion
nom, félon Ducange, Suppl. III. 278. a.
GUIMARAENS , ( Géogr. ) ville de Portugal. Obfervations
fur le pape Damafe , 8c fur Alphonfe, premier roi de
Portugal, qui naquirent dans cette ville. V II. 1007. b.
G UIMAUVE , althaa, ( Botan. ) Scs caraéleres. Defeription
de cette plante. Il neft pas aife de décider fi notre
guimauve eft 1 althaa de Diofcoride. Lieux où elle croit.
VII. 1007. b.
G u im a u v e royale, althaa frutex. ( Jardin. ) Defeription 8c
culture de cet arbrifleau. Lieux d’où il eft originaire. Suppl. III.
278. 4 . Voyez A l t i iæ a .
G u im a u v e . ( Pharm. Mat. rtiédic.) On n’emploie que fa
cine. Elle contient un mucilage abondant, qui eft la partie
médicamemeufe de la plante. V II. 1007. b. Comment 011
l’adminiftre pour l’ufage intérieur. Ufages extérieurs auxquels
on l’emploie. On fe icrt auffi quelquefois des feuilles , des
femenccsôc des fleurs. Pâte, firops 8c onguent qu’on prépare
avec la guimauve. Compofition du ftrop de guimauve fimple.
Obfervations fur cette compofition. Sirop de guimauve de
Fernel, Dofes de ce remede. Sirop de ibtfco. Ibid. 1008. a.
Onguent à'althaa. Ses propriétés 8c ufages. Tablettes de guimauve
, de la pharmacie de Paris, Pâte de guimauve. Ufages
de ces préparations. Ibid. b.
G UIMBARDE, jeu de la. X. 121.4, b. X III. 843.4. X V I.
693, b. Vol. V . des planch. Lutherie.
G UIMP LE, ( Corn/n, ) droit qui fe leve fur le fel dans
quelques endroits de la Bretagne. Ce qui eft dit de ce droit
dans la pancarte de la prévôté de Nantes, V II. 1008. b.
G U I N É E , ( Comm. ) toile de coton de Pcuidichery. V II.
1009. 4.
G u i n é e , (C om m .) monnaie d’Angleterre. Origine de
fon nom. V II. 1009. a.
Guinée, (Géogr. ) vafte contrée d’Afrique. La Guinée a
été inconnue aux anciens, 8c nous n’en connoiflbns que les
côtes. Ou divife la Guinée en haute 8c baffe. Defeription de
de ces pays, V II. 1009. a. Moeurs des habitans, Defeription
de leur figure. Maladies cruelles auxquelles ils font fujets.
Les Diépois découvrirent cette contrée en 1364. Les Portugais
s’y établirent au commencement du fiecle, Les Hol-
hndois chafferent ces derniers en 1604. Aujourd’hui les Hol-
landois 8c les Anglois font prefque tout le commerce des
côtes des Guinée. Sous le regne de Jean I I , roi de Portugal
on trouva quelque peu d’or fur ces côtes. Ibid. b.
Guinée, qualité du climat de ce pays. X V II, 72G. a. Vent
nommé harmataii, qui regne particulièrement fur la côte de
Guinée. V III. 50. 4. Fréquens orages fur cette côte en certaines
faífons. X I. 7,1 o . b. X V I. 569, b. Grande rivieré de la
haute Guinée. XV , 181, 4. Terre de Guinée. X V I. 18 1 . b.
Des negres deGuinée.VIII.347. a. XX.yG.b.—83, b. Inftrument
du mufique dont ils font uíagé. II. 461. a. Leurs canots, G%i,
a. Droits« ..q.1u iC af e n.p'iAaiHe.n t dans c en opva.cy sn ApIoIu, rn \arrvt\oY ir1 3 lal ibliebretrété
d’y commercer, IV. 418, b. Ces negres fujets à une maladie
nommée les dragonneaux. V . 99. b. X V I . 1 1 . a. A utr e maladie
endémique de ce pays, nommée yaw.X VII. G64. b. Comment
les habitans recueillent la poudre d’or. XI. 321. b.
G u i n é e , monnoie d e A C o n c h y l . ) Suppl. IL 302. b.
G u in é e , poivre (te ,X Ü . 896. b.
G u in é e , la nouvelle, (Géogr. ) grande contrée de 1 Océan
oriental des Moluques. On ignore fi c’eft une ifie ou une
contrée attachée au continent des terres auftrales. Sa delcrip-
tion. Découverte de ce pays en *727. Le terroir fertile par
lui-même eft habité par des Sauvages d’un teint brun, olivâtre.
V IL 1009, b. _/m
G uinée , ( la nouvelle) obfervations fur fes habitans, V 111-
343. b. Mammeiles prodigieufes des femmes de ce pays. X. 4.4.
G UIO T , moine Bénédiéli 11. X II. *323. a.
G UIN1ER, efpece de cerifier, II. 044. b.
GUIPÉ, point de broderie qui 11’a lieu que fur 1« venu.
G uipé, terme de boutonnier ...... le guipé peut entrer ans
toute forte d’enjolivemens. V II. toio. a.
GUIPER, (R u b a n .) donner la dernierc main a la trange
guipée. Détails fur cette opération. Defeription « ufage du
guipoir. V II, loi©, 4. ' ,
GUIPURE, terme de brodeur. V II. 19 10 . b.
G U Y
Guipures, pour les livrées, X II. *33, 4, X V I, 424. 4,
GUIPUSCOA, (G é o g r .) petite province d’Efpagne, Fertilité
de ce pays. Hiftoire d’Ignace de Loyola, fondateur des
Jéfuites. Auteurs qui ont donné fa vie. VIL 1010 . b.
G U IR IO TS , efpece de jongleurs chez les Negres. Suppl.
I. 800, 4 , b.
G U IR L A N D E , ornement pour la tête en forme de couronne.
Guirlandes que l’on fufpendoit anciennement aux portes
des temples. Divers ufages qu’on faifoit des guirlandes
dans l’antiquité. Guirlandes dans l’architeélure. V il, 1010. b.
G u i r l a n d e s . ( Marine ) Defeription de ces pièces. Lieux
où on les place dans la conftru&ion du vaifleau. Maniéré
dont on les trtivaille ; forme qu’on leur donne. V II. t o i i . a .
GUISE, ( Géogr.) ville de Picardie; elle eft la patrie de
Billi (Jacques d e ) . Ses ouvrages, V II. io n . 4,Siege qu’elle
f jutint en 1630 contre l'année efpagnole. Arts oc métiers
exercés dans çe lieu, Suppl. III. 278. b.
G u i s e , (Hen ri de Lorraine, duc d e ) portrait de ce duc :
hiftoire de la ligue dont il fut le chef. IX. 338. a , b. &c. Il
eft aflaffiné a Blois, 529. a. Parallèle entre Henri 8c fon
frere Charles de Lorraine , duc de Mayenne. XV. 308,
4, Sur les Guifes, voyez François I I 8c les règnes fui vans.
GUISNÉE, application de l’algebrc à la géométrie par
cet auteur III. 878. a. Sa méthode pour la conftruftion des
lieux géométriques. IX . 499. 4. . .
G U IT TA R E , ( Mufufue ) defeription de cet inftrument.
V II. io n . u. Changement qu’on a fait au nombre de
fes cordes. Etendue de la guittare. Origine 8c ufage de cet,
inftrument en Efpagne. Caraélere du jeu de la guittare. De
la tablature. On fait ufage de lettres ou de chiffres, pour
noter les airs ou accompagnemens. Explication des divers
fignes dont 011 fe fert. Ibid. b Détails fur les deux maniérés
de jouer de la guittare, favoir les batteries 8c les pincés.
V il. XQ13. a. Obfervations fur les cordes. Maniéré d’accorder
cet inftrument, lbi<L b. Tableau figuré du manche de la
guittare de grandeur ordinaire. Maniéré de noter en tablature
, 8c rapport des lettres avec tous les tons du diapafon.
ib id. l o i î . 4, . .. .
Guittare, origine de ce mot. HI. 4^8. b. Guittare appellée
angélique : fa defeription. L 4^0- a > Efpcce guittare
nommée chiterna, &/W . IL A fiy b . , ,
G u i t t a r e , celles des Negres. Defeription dune
nouvelle guittare inventée par Vanhecke. Suppl. III. 278, b*
GUIVRE, (B la fo n ) meuble d’armoirie. Origine des armes
du duché de Milan. Suppl. III. 279. a. — Voyez Suppl.
■■ ¿Î?LDüRANDSOALEN, {G é o g r .) canton de h Nor-
wege méridionale. Suppl. I& a7S. a. Qualité« du pays.
Occupations des habitans. Ibid. b.
G UMME, forte de cordage. IV. 233. a.
GUNDEMAR, roi des Viligoths, ( rhfl> d E fp . ) hiftoire
abrégée de fon regne. Suppl. Ul. 28». 4,
GUNTER, ligne ou échelle de Gunter. IX. .320.
a. Suppl. II. 730. a. Quart de cercle de Gunter. X III.
6<GUNTZ , ( M c G o J t f r o i ) anatomifte. Suppl- I. 409^-
GUNTZENHAUSMN, ( Géogr. ) petite vdle d Allenuene,
qui n’eft remarquable que par la nmlfauce-d André Ofiander,
un des premier» fcâateurtt de Luther. ,, ' 4'
GÜRIARE, ( Gtogr. ) 0 0 m S l i f é . g u i a m .
g1 lus4 tÆ '^ R Î c S N ^ A S A f ( X L . Jr f dr) roi de
G u l la v i -AM p In I I Se« guerres avec I empereur. Suppl.
I II . lq , a , t- Ce que ce prtuce penfoii de la guerre, XI.
7 f c v r T E Gorn'm, ( Chym. Pharm. «• H médk.) Defcriptjon
de zzTliz il il teur Obfervations fur la maniéré de l admmiftrer. V I. 1014.
L La gomme-gutte entre dans diverfes compoiinons. Die
a été vantée cutitre lagonttc. Ihid. lo l ^ . o . - P o y i i
W m m m » ( Je,m \ invcnKur de l’Imprimerie.
^ ^ U T T E T E J k u d r t d e , (Pharm. b Mar. méd ic .)C omp o -
I M i s i noudre félon la pharmacopée de (arts, bes
G Y M 8 8 3
fnion de cette poudre félon la pbarmaconce de l .,n
»/inriArés D o fe qu’il en faut prendre. V u . 101<. a.
P ¿UTTETE, ( r n J~ J ' s - ur-'*/ar!nnfi fur p a r lm a
fon ufage. XIII._
P r é p a r a t io n &
U R A L ¿ !8( ¿ « « r ) 1V’ Í 3 ’ | Articulation
GUYANE, ou G u ia n e , ( la ) Géogr. vafte contrée de l’Amérique
méridionale, qu’on décora long-tems du nom de
France équinoxiale. Obfervations fur les rivières qui l’arro-
fent. Qualité du pays. Inondations auxquelles il eft fujer.
Hiftoire de fa découverte 8c des établinemens que les Européens
y ont fondés. Sort malheureux de la colonie que
la France y envoya en 1 7 6 3. Suppl. Ul. |g|J a , b. Quel fero.t
le moyen de tirer parti de ce pays. Plantation qu’on y pourrait
établir, Ibid. 284. a. Etat de la colonie en 1769. Ibid. b,
Voyez G u i a n e .
G u Y E T , ( Charles ) X V I. 491. b. Anthologie de Guyet.
I. 496, b,
G U Y O N A Jeanne-Marie Bouviers d e là Mot/te.) Précis de
fa vie. X. 68t. 4. X III. 709. b,
G u y o n , ( les freres ) Suppl. 1. 726 . a.
GUYPAPE, obfervatiops fur fa vie 8c fes ouvrages. X IV .
634. 4.
G U Y TO N , ( de Mo rveaux , ) avocat général du parlement
de Bourgogne. Suppl. III. 964. a.
GUZARATE , (Géo g r.) province de l’Indouftan. Sa capitale.
Defeription de ce beau pays, V II, 1013. a. Revenus
confidérables que le Mogol en tire , félon Thévenot. Ibid. b,
G Y
GYAROS, (G éo g r ,) petite ifle de l’Archipel, Sa deferip-,
tion, Rome y reléguoic les criminels, On la nomme à pré-
lent Joura. V II. 1013, b.
GYGES, ( Hifl. anc. ) il affaffine le roi Candaulc, Suppl.
IL 108 .b . , . . . . ..
GYMNASE, ( L in . grccq.,fr romain.) édifice public,,
où l’on s’inftruifoit dans les exercices. Autres noms qu’on don-,
noit à ces édifices. Explication des doiuoe pièces principales .
qui les çompolbient. Officiers oui gouyernoient Jes gym-
nafes, le gymnafiarque, le xyuarque, le gymnaite tk 1*
prædotriba. V il. 1013. b. ,
G ym n a s e , divers appartemens des gymnafes, nommés
conifterium, III. 879, a, corycée, LV. 209. a. éphébée, V.
769. b. gymnafterion, V IL 1016. b. paleftrc, XI. 7 7 6 .a , b.
fphérifterc, XV. 436, b. xyfte, X V II. 638. b. ¿50.a , b. Bains
u.1e s g. .y.m__na.'iicls. . sIli . ». ay . am , ,I.ïc bmj/.m...n. .aO«. norïiiilés
fopbroniftes, VU. 1019. È x v * W b‘ pédotribes, gymnaftes,
Xi, 743. 4. XII. 238. 4, paleftrophylaces, XI. 770, b. xyftar-
ques. X V II. 638. b. Statues quon plaçoit dans les gymnafes.
VUE 171. b. Exercices des gymnafes. V II. 10 17 . b.
Les Romains furpafferent les Grecs par la magnificence 8c le
nombre de leurs gymnafes. 1018, 4. ; , .
GYMNAMARQUE, (Xi«, grecq. 0 rom.) autorité 8c
jurifdiâion «qnu«e cet o/»fffliïceiWer ee^xeerrcçooiitr ddaannss llee gsyvmmnnaa..çc.. FFêettee
que céîébroit le gymnafiarque d 'O lym p ic. Les prérogatives du
gymnafiarque, alloient juiqu’à lui permettre de célébrer des
jeux fon nom propre. Marc-Anroine prit dans Athènes
t . , , 1 ................ __/?__ r<Aiiv dn r t i .o li*fi rWnrri/lflfi. en ton y ...
l’équipage de gymnafiarque pour en faire toutes les touchons,
Ouvrage à confulter, VIL 101G. a. ,
GYMNASTE , ( L in . grecq. & rom. ) officier employé
dans les gymnafes. La plupart des auteurs confondent le
evmnafte 8cle pédorribe. DiftérencequeGalien établit entre
ces deux officiers. V II. xot6. 4. Fonction des agonothetes
que les gymnaftes avoient à remplir.Ib td . b.
G ym n a s te , officier du gymnale, dont il eft parlé. XL
743, 4, XII. i%8., a, \ 1» j
GYMNASTERION, ( L in . grecq. b rom. ) I un des appartenons
des gymnafes. Autres noms mt’on lui donnoir.
Magnificence que ,les Romains donnèrent à ces appartemens.
V IL 101 G., b. . r .
GYMNASTIQUE, ( L iu . grecq. b rom.) art ou fcience
des divers exercices du corps. Différentes lins que les hommes
fe font proposées en s'accoutumant aux exercices du
corps. Origine de la gymnaftique militaire, de la gymnafti-
que médlcimle & de lagymnaflique »thletique. Çw jM irw »
exercices introduits dan» U religion Sc dans les funérailles.
Orieine de la fcience gymnaftique. Cette doârine recueilli«
nar nuclques auteur» moderne». Obfervations fur les ou-
S I S donnés fur ce lujet Mercurtalt» Hteronytmts,
F a b e r , Falconerii, Van-Dale, Meurftus.Sc M.iiureiee.VIl.
1016 b. — Voyez Exercice, _ . .
Gymnastique, Académii Voy.r « dernier mot.Tratté
de Mercurial de arte gyrnnafltca. VU». 387. u.
Gymnastique afhUtiqta A L i tn grecq. 6* rom.) On appel-
loit auffi cette gymnaftique du nom de gymnique , oc de
I l B i l Ce qui conrribu» le Plus i la meme
en crédit. Plaion fe déclara le zélé défenfeur de cerm
peu’d'^ieurs’qu^alcmanaqué^a’ gymnaftique athlétiqueauift
pancnoictit it cette partie de lagytnnafttque, A». 779 7 1