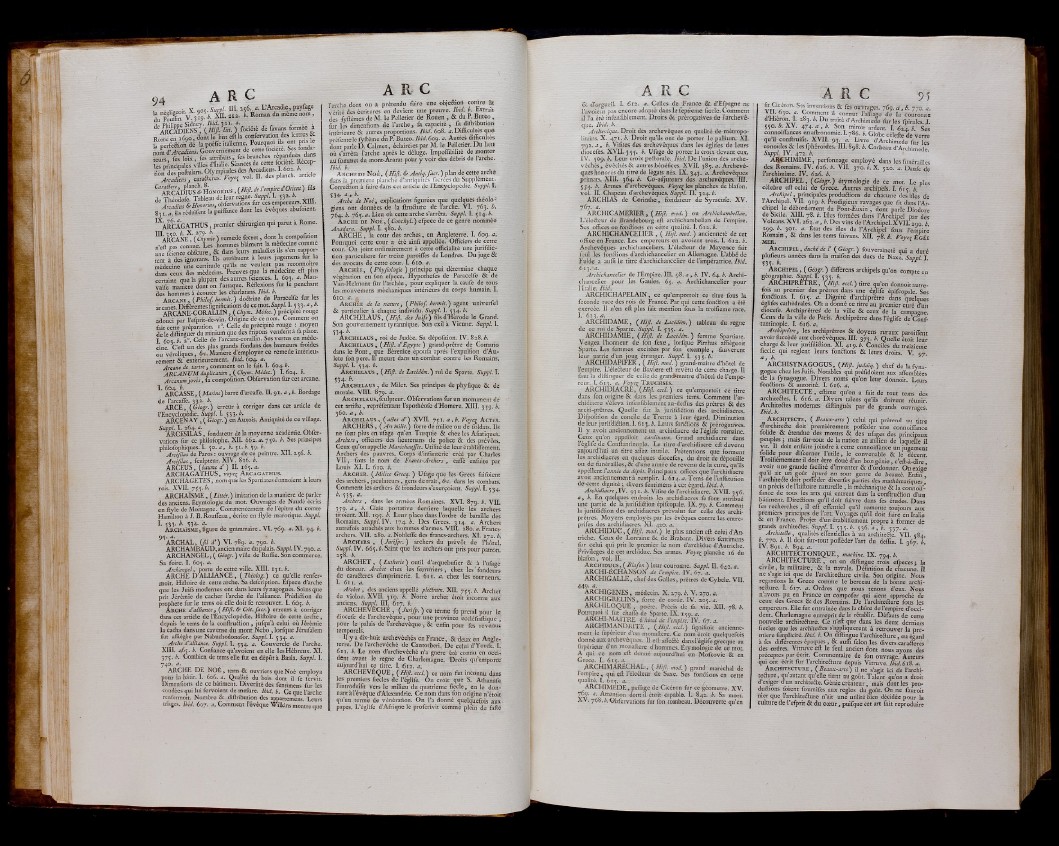
M
9 4 9
W Ê IÊ Ë Sù
R c
HI. 2<6.,,ä. L’Arcadie, payiage
n i . L Roman du même nom,
A R C
i s c S b lE N S , (tSfi. tilt.) fociétè Je forais formée a
Roroèén 1690, dont lé but eftla confervanon des lettres &
la perfeétion. de la pftétfe italienne. Pourquoi ils ont mis le
nom SArcaJüns. Gouvernement de cette focieté. Ses t0®"
Hosô éws , (Hijl.S l ’emP?ef ° riebnt') fils
de Théodofe. Tableau de leur regne.Suppl. I. 332. b.
ArZdius 6* Honorius, obfervations fur ces empereurs. XHL
83V.Tlls réduifent la puiffance dont les évêques abufoient.
ÀRCAGATHUS, premier chirurgien qui parut à Rome.
^aI^CANE (Chymie) remede fecret, dont la compétition
n’eft pas connue. Les .hommes blâment la médecine comme
une fcience obfcure, & dans leurs maladies ils s en rapportent
à des icnorans. Ils attribuent à leurs jugemens fur la
médecine une certitude qu’ils ne veulent pas reconnoitre
dans ceux des médecins. Preuves que la médecine eft plus
certaine que la plupart des autres iciences. I. 693. a. Mau-
vaife manière dont on l’attaque. Réflexions fur le penchant
des hommes à écouter les charlatans. Ibid. b.
A rc ad e , ( Philof. hermét. ) doftnne de Paracelfe furies
arcanes.Différentesfignifiçationsde c em o t .% / .I . 533.a,b.
ARCANE-CORALLltt ,,( Chym. Médec. ) précipité rouge
adouci par l’efprit-de-vin. Origine de ce nom. Comment on
fait cette préparation. i°. ÇeUe du précipité rouge : moyen
de le diftinguer du minium que des fripons vendent a fa place.
I 601 b. 20. Celle de l’arcane-corallin. Ses vertus en médecine
C’ell un des plus grands fondans des humeurs froides
ou véroliques, &c. Maniéré d’employer ce remede intérieurement
8c extérieurement. Ibid. 604. a.
Àrcanc de tartre, comment on le fait. I. 604. b.
ARCANUM duplicatum , ( Chym. Médec. ) I. 604. b.
Arcanumjovis, la compofido’n. Obfervation fur cet arcane.
ARCASSE, ( Marine) barre d’arcaffe. II.91. a,b. Bordage
de l’arcaffe. 332. b. . , . , j
ARCE, ( Géogr. ) erreur à corriger dans cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. 1- 533* A- ...
ARCENAY, ( Géogr.) en Auxois. Anuqmtéde ce village.
5U^RCksILÀS , fondateur de la moyenne académie. Obfervations
fur ce philofophe. XII. 662. a. 750. b. Ses principes
philofophiques. ï. 50. a, b. 51. b. 59. b.
Arcéfilas de Paros : ouvrage de ce peintre. XII. 25(t. b.
Arcéfilas, fculpteur. XIV. 8x6. b.
ARCEUS, ( baume d ') II. 165. a.
ARCHAGATHUS, voyei A r c ag a th u s .
ARCHÀGETES, nom que les Spartiates donnoient à leurs
rois. XVII. 755. b.
ARCHAÏSME, ( Littér.) imitation de la maniéré de parlei
des anciens. Étymologi,e du mot. Ouvrages de Naudé écrits
en ftyle de Montagne. Commencement de l’épître du comte
Hamilton a J. B. Rouffeau | écrite en flylè marotique. Suppl.
I. 533. b. $3^ d.
A r c h a ïsm e , figure de grâmmaire. VI. 769. a. XI. 94. b.
ÀRCHAL, (fil <r ) VI. 789. a. 790. 4.
ARCHAMBAUD, ancien maire du palais. Suppl. IV. 790. a.
ARCHANGEL, ( Géogr. ) ville de Ruflie. Son commerce.
Sa foire. ï. 605. a.
Archangel, porte de cette ville. XIII. 131. A
ARCHE D’ALLIANCE, ( Théolog: ) ce qu’elle renfer-
moit. Hiftoire dé cette arche. Sa defeription. Efpece d’arche
que lès Juifs modernes ont dans leurs lynagogues. Soins que
prit Jérémie de cacher l’arche de l’alliance. Prédiction du
prophète fur lé tems où elle doit fe retrouver. L 603. b.
ÂRCHE d’alliance, (Hijl. 6» Crit.facr.) erreurs à corriger
dans cet article de l’Encyclopédie. Hiftoire de cette, arche,
depuis le tems de là conftruftion, jufqu’à celui où Jérémie
la cacha dans une caverne du mont Nebo, lorfque Jérufalem
fut afliégée par Nabuchodonofor. Suppl. I. 534. a.
arche dont on a prétendu faire une objeftiori contre la
vérité des écritures en devient une preuve. Ibid: b. Extrait
des fyftêmes de M. le Pelletier de Rouen , 8c du R B ute o,
fur les dimenfions de l’arche, fa capacité, fa diftribution .
intérieure & autres proportions. Ibid. 608. a. Difficultés que
préfente le fyftême du P. Buteo. Ibid. 609. a. Autreà difficultés
dont parle D. Calmet, éclaircies par M. le Pelletier. Du lieu
où s’arrêta l’arche après le déluge. Impoflïbilité de monter
aii fommet du mont-Ararat pour y voir des débris de l’arche.
Ibid. b . S , S
Arche d'alliance. Suppl. I. 334. a. Couvercle de l’arche.
XIII. 463. b. Confiance qu’avoient en elle les Hébreux. XI.
373. b. Combien de tems elle fut en dépôt à Baala. Suppl. I.
740. a.
ARCHE^ DE NOÉ, tems & ouvriers que Noé employa
pour la bâtir. 1. 606. a. Qualité du bois dont il fe fervit.
Dimenfions de ce bâtiment. Diverfité dés fentimens fur les
coudées qui lui ferVoient de mefure. Ibid. b. Ce que l’arche
renfermoit. Nombre & diftribution des appartemens. Leurs
ufages. Ibid. 607. a. Comment l’évêque Wilkins montre que
A r c h e d e N o é , {Hiß- 6* Antiq. facr.) plan de cette arche
dans la première planche d’antiqîtités fncrées dù Supplément.
Correction à faire dans cet article de l’Encyclopédie. Suppl. I;
334. a , b.
Arche de Noé, explications figurées que quelques théologiens
ont données de la ftruftute de l ’arcne. v l. 763. b.
764. b. 763. a. Lieu Où cette arche s’arrêta. Suppl. I. 314. b.
A rche de N o é , (Conchyl.) efpece de ce genre nommée
Anadara.. Suppl. I. 380. b.
ARCHE, la cour des arches, en Angleterre. I. 609. <t;
Pourquoi cette cour a été ainfi appellée. Officiers de cette
cour. On joint ordinairement à cette officialité une jurifdic-
tiort particulière fur treize paroiffes de Londres. Du juge 8c
des avocats de cette cour. 1. 610. a.
ArCHÉe , ( Phyfiologie ) principe qui détermine chaque
végétation en ion efpece. Hypotnefes de Paracelfe 8c de
Van-Helmont für l’archée, pour expliquer lacaufe de tous
les.mouvemens méchaniques intérieurs du corps humain. I.
610. a. m
A r ch Ée de la nature, ( Philof. hermét.) agent univerfel
8c particulier à chaque individu. Suppl. I. 334. b.
ÀRCHELAUS, (Hiß. des Juifs) fils d’Hérode le Grand.
Son gouvernement tyrannique. Son exil à Vienne. Suppl. I.
534- b.
A r ch e l a u s , roi de Judée. Sa dépofition. IV. 828.b.
A rchelaus , {Hiß. d’Egypte ) grand-prêtre de Comano.
dans le Pont, que Bérénice époufa après l’expulfion d’Au-
lete fon pere. Il meurt dans un combat contre les Romains.
Suppl. I. 334. b.
ÂRchelaus , {Hiß. de Lacédém.) roi de Sparte. Suppl. I.
534- b.
A rchelaus , de Milet. Ses principes de phyfique 8c de
morale. VIII. 879. a.
A rchelaus, fculpteur. Obfervations fur un monument de'
cet artifte , repréfentant l’apothéofe d’Homere. XIII. 33 q.b.
360. a , b.
A r ch e l a u s , (afles d"\ XVII. 731. a s b. Voyeç A ctes.
ARCHERS, ( Art milit. ) forte de milice ou de foldats. Ils
ne font plus en ufaee qu’en Turquie 8c chez les AfiatiqueS.
Archers, officiers des lieutenans de police 8c des prévôts.
Ceux qu’on appelle Maréchauffée. Utilité de leur établiffement.
Archers des pauvres. Corps d’infanterie créé par Charles
V I I , fous le nom de Francs-Archers , caflé enfuite par
Louis XI. I. 610. b.
A r ch er . ( Milice Grecq. ) Ufâge que les Grecs faifoient
des archers, jaculateurs, gens de trait, &c. dans les combats.
Comment les archers 8c frondeurs s’exerçoient. Suppl. I. 334.
4. 535. a.
Archers , dans les armées Romaines. XVI. 879. b. VII.
339. a , b. Claie portative derrière laquelle les archers
tiroient. XII. 193. b. Leur place dans l’ordre de bataille des
Romains. Suppl. IV. 174. b. Des G r e c s^ 14. a. Archers
autrefois attachés aux hommes d’armes. VUL 280. a. Francs-
archers. VII. 280. a. NobleiTe des francs-archers. XI. ly i.b l
A rchers , ( Jurifpr. ) archers du prévôt de l’hôtel.
Suppl. IV. 663. b. Saint que lès archers ont pris pour patron.
238. b.
ARCHET, {Lutherie) outil d’arquebufier 8c à l’ufage
du doreur. Archet chez les ferruriers, chez les fondeurs
de caraôeres d’imprimerie. I. 6x1. a. chez lès tourneurs.
L 611. a.
Archet, des anciens appellé pléflrum. XII. 733. b. Archet
de violon. XVIL319. b. Notre archet étoit inconnu aux
, anciens. Suppl. lu . '617. b.
ARCHEVÊCHÉ , {Jurifp. ) ce terme fe prend pour le
diocefe de l’archevêque, pour urte province eedéfiaftique f
pour le palais de l’archevêque-, 8c enfin pour fes revenus
temporels.
U y a dix-huit archevêchés en France, 8c deux èn Angleterre.
De l’archevêché de Cantorberi, De cèliii d’Yorclc. ï.
61 x. b. Le nom d’arèhtevêché n’a guère été connu en oéci-V
dent avant le regne de Charlemàgne. Droits qu’emporte'
aujourd’hui ce titre. I. 6x2. a.
ARCHEVÊQUE, ( Hiß. eccl. ) ce noin fut incOnnu dans
les premiers fiecles de l’églife. On crôit que S. Athanafe
l’intrôduifit vers le milieu du quatrième fiecle, en le donnant
à l’évêque d’Alexandrie. Ce nom dans fon origine n’étoit-
qu’un terme de vénération. On l’a donné quelquefois aux
l papes. L’églife d’Afrique le proferivit comme plein de fâfte
r
A R C
©c d’orgueil. I. 6r2. a. Celles- de France Sc d’Efpagne ne
l’avoiênt pas encore adopté1 dans le ièptieme fiecle; Comment
il l’a été infenfiblement. Droits &. prérogatives de l’archevêque.
Ib id. b.
Archevêque. Droit des archevêques en qualité de-métropolitains.
X. 471. b. Droit qu’ils ont de porter le pallium. XI.
792.4*, b. Vifites des archevêques dans les égliles de leurs
diocefes. XVIIv 333. b. Ufage de porter la croix devant eux.
IV. 309. b. Leur croix peélorale. Ibid. De l’union des archevêchés,
évêclxés8c autres bénéfices. XVII. 383. a. Archevêques
honorés du titre de légats nés. IX. 343. a.. Archevêques
primats. XIII. 364. b. Co-adjuteurs des archevêques. III.
334. b. Armes d’archevêques. Voyelles planches aeblafon.
vol. ÌI. Chapeau d’archevêques. Suppl. II. 324. b.
ARCHI AS de Corinthe, fondateur de Syracufe. XV.
767. a.
ARCHICAMERIER , ( Nijh mod. ) ou Archichambelldn.
L’éleétcur de Brandebourg eft archichambellan de l’empire.
Scs offices ou fondions en cette qualité. I. 612. b.
ARCHICHANCELIER, ( Hijl. mod. ) ancienneté de cet
office en France. Les empereurs en avoient trois. I. 612. b.
Archevêques ârchichanceliers. L’éle&eur de Mayence fait
fcul les fon&ions d’arcliichancelier en Allemagne. L’abbé de
Fulde. a auffi le titre d’archichancelier de l’impératrice. Ibid.
613 ¿a.'
Archichancelier de l’Empire. III. 98. a , b. TV. 64. b. Archi-
chancelier pour les Gaules. 63. a. Archichancelier pour
ìltalie. Ibid.
ARGHICHAPELAIN, ce qu’emportoit ce titre fous la
feconde race des rois de France. Par qui cette fonâion a été
exercée. Il n’en eft plus fait mention fous la troifieme race.
I. 613. a.
ARCHIDAME, ( Hijl. de Lacédém. ) tableau du regne
de Ge roi de Sparte. Suppl. I. 333. a.
ARCHIDAMIE, ( Hijl. de Lacedétn. ) femme Spartiate.
Vengea l’honneur de fon fexe, lorfque Pirrhus affiégeoit
Sparte. Les femmes excitées par fon exemple , fauverent
leur patrie d’un joug étranger. Suppl. I. 333. b:
ARCHIDAPIFER, {Hijl. mod.) grand-maître d’hôtel de
l’empire. L’éleéleur de Baviere eft revêtu de cette charge. Il
faut la diftinguer de celle de granchmaître d’hôtel de l’empereur.
I. 613. a. Voye[ T r UCHSES.
ARCHIDIACRE, {Hijl. eccl. ) ce qu’emportoit ce titre
dans fon origine 8t dans les. premiers tems. Comment l’archidiacre
s’éleva infenfiblement au-defliis des prêtres & des
archi-jjrêtres. Quelle fut la jùrifdiôion des archidiacres.
Pifpoiition du concile de Trente à leur égard. Diminution
de leur jurifdiôion. 1. 613. b. Leurs fondions 8c prérogatives.
Il y avoit anciennement un archidiacre de l’églife romaine.
Ceux qu’on appelloit cardinaux. Grand archidiacre dans
l’églife de Conffantinople. Le titre d’archidiacre eft devenu
aujourd’hui un titre aflez inutile. Prétentions que forment
les archidiacres en quelques diocefes, du droit de dépouille
ou de funérailles, 8c d’une année de revenu de la cure, qu’ils
appellent l'année du dépôt. Principaux offices que l’archidiacre
avoit anciennement à remplir. 1. 614. a. Tems de l’inftitution
de-cette dignité ; divers fentimens à cet égard. Ibid. b.
Archidiacre, 1V.^931. b. Vifitede l’archidiacre. XVII. 336.
a, b. En quelques endroits les archidiacres fe font attribué
une partie de la jurifdifrion épifcopale. IX. 79. b. Comment
la jurifdiâion des archidiacres prévalut fur celle des archi- j
prêtres. Moyens employés par les évêques contre les entre-
prifes des archidiacres. XI. 420. a.
ARCHIDUC, {Hijl. mod.) le plus ancien eft celui d’Autriche.
Ceux de Lorraine 8c de Brabant. Divers fentimens
fur celui qui prit le premier le nom d’archiduc d’Autriche.
Privilèges de cet archiduc. Ses armes. Voye^ planche 16 du
blalon, vol. II.
A r ch id u c s , ( Blafon ) leur couronne. Suppl. II. 642. a.
ARCHI-ÉCHANSON de l ’empire. IV. 67. a.
ARCHIGALLE, chef des Galles, prêtres de Cybele. VII.
449. a.
ARCHIGENES, médecin. X. 279. b. V. 270. a.
ARCHIGRELINS, forte de corde. IV. ’203. a.
ARCHILOQUE, poëte. Précis de fa- vie. XII. 78. b.
Pourquoi il fut chaffé de Sparte. IX. 139. a.
ARCHI-MAITRE d'hôtel de l ’empire. IV. 67. a.
ARCHIMANDRITE , {Hijl. eccl.) fignifioit anciennement.
le fuperieur d’un monaftere. Ce nom étoit quelquefois
donné aux archevêques. Il eft affeélé dans l’églife grecque au
fupérieUr d’un monaftere d’hommes. Étymologie de ce mot. ;
A qui ce nom eft donné aujourd’hui en Mofcovie 8c en
Grece. I. 613. a.
) ARCHIMARÉCHALi, {Hijl. mod.) grand' maréchal de
l’empire, qui eft l’éle&eur de Saxe. Ses fondions en cette
qualité.!. 613. a.
ARCHIMEDE, paflage de Cicéron fur ce-géomètre. XV.
769; a. Attention dont il étoit capable. I. 842. b. Sa mort.
XV. 768. b. Obfervations fur fon tombeau. Découverte qu’en
A R C 95
Ses inventions & fes ouvrages. 769, a , b. 770. a.
° ' r ' o0m,m^vnt il connut l’alliage de la couronne
dHiéfon. 1. 283. b. Du traité d’Archimede furies fpîrales.J.
33°. b. XV. 474. a , b. Son miroir ardent. I. 624. b. Ses
connoiffances en aftronomte!. 786. b. Globe célefte de verre
quil conftruifit. XVII. 93. a Livre d’Archimede fur les
conoides 8c les fphéroides. III. 898. b. Corbeau d’Archimede.
Suppl. IV. 472. b.
AIJEHIMIME, perfonnage employé dans les funérailles
des Romains. IV. 626. b. VII. 370. b. X . 320. a. Danfe de
l ’archimime. IV. 626. b.
ARCHIPEL, (Géogr.) étymologie de ce mot. Le plus
célébré eft celui de Grece. Autres archipels. I. 613. b.
Archipel, principales productions de chacune des ifles de
l’Archipel. VII. 919. b. Prodigieux ravages que fit dans l’Ar*
chipel le débordement du Pont-Euxin , dont parle Diodore
de Sicile. X1H. 78. b. Ifles formées dans l’Archipel par des
Volcans. XVI. 262. a, b. Des vins de l’Archipel. XVII. 290. b.
299. b. 301. a. État des ifles de l’Archipel fous l’empire
Romain , 8c dans les tems fuivans. XII. 78. b. Voyez Égée
MER. 1
A r c h ip e l , duché de l’ ( Géogr. ) fouveraineté qui a duré
plufieurs années dans la maifon des ducs de Naxe. Suppl I
535* b'
A r c h ïp e l , ( Géogr. ) difFérens archipels qu’on compte en
géographie. Suppl. L 333. b.
ARCHIPRÊTRE, (Hijl. eccl.) titre qu’on donnoitautrefois
au premier des prêtres dans une églife épifcopale. Ses
fonctions. I. 613. a. Dignité d’archiprêtre dans quelques
églifes cathédrales. Qft a donné ce titre au premier curé d’un
diocefe. Archiprêtre^ de la ville 8c ceux de la campagne.
Cerne de la ville de Paris. Archiprêtre dans l’églife de Conf-
tanrinople. L 616. a.
Archiprêtre, les archiprêtres 8c doyens ruraux paroiffent
avoir fuccédé aux chorévêques. III. 373. b. Quelle étoit leur
charge 8c leur jurifdiaion. XI. 419. b. Conciles du treizième
fiecle qui règlent leurs fondions 8c leurs droits. V. 07.
a , b.
ARCHISYNAGOGUS, (Hijl. juda'iq.) chef de lafyna- '
gogue chez les Juifs. Notables qui préfidoient aux affemblées
de la fynagogue. Divers noms qu’on leur donnoit. Leurs
fonctions oc autorité. I. 616. a.
ARCHITECTE, eftime qu’on a frit de tout tems des
architedes. I. 616. a. Divers talens qu’ils doivent réunir.
Architeftes modernes diftingués par de grands ouvrages!
Ibid. b.
Î A r ch it e c t e , ( Beaux-arts ) celui qui prétend au titre
d’architede doit premièrement pofféder une connoiffance
folide 8c étendue des moeurs 8c des ufaees des principaux
peuples ; mais fur-tout de la nation au milieu de laquelle il
vit. Il doit enfuite joindre à cette connoiffance un jugement
folide pour difeerner l’utile, le convenable 8c le décent.
Troifiémementil doit être doué d’un bon génie, c’eft-à-dire
avoir une grande facilité d’inventer 8c d’ordonner. On exige
qu’il ait un goût épuré en tout genre de beauté. Enfin ,
l’architede doit pofféder diverfes parties des mathématiques,
un précis de l’hiftoire naturelle, la méchanique 8c la connoif-
fance de tous les arts qui entrent dans la conftniCtion d’un
bâtiment. Directions qu’il doit fuivre dans fes études. Dans
fes recherches , il eft effentiel qu’il remonte toujours aux
premiers principes de l’art. Voyages qu’il doit frire en Italie
8c en France. Projet d’un établiflement propre à former de
grands architeftes. Suppl. I. 333. b. 336. a , b. 337. a.
Architeêle, qualités effentielles à un architefte. VII. 384.
b. 770. b. U doit fur-tout pofféder l’art du deflin. I. 267. b.
IV. 891. b. % 4. *. i 7
ARCHITECTONIQUE, machine. IX. 794. b.
ARCHITECTURE , on en diftingue trois efpeces j la
civile, la militaire, 8c la navale. Définition de chacune. Il
ne s’agit ici que de l’architefture civile. Son origine. Nous
regardons la Grece comme le berceau de la bonne architecture.
I. 617. a. Ordres que nous tenons d’eux. Nous
n’avons pu en France en compofer qui aient approché de
ceux des Grecs 8c des Romains. De l ’architeCiure fous les
empereurs. Elle fut entraînée dans la chute de l’empire d’occident.
Charlemagne entreprit de la rétablir. Défauts de cette
nouvelle architecture. Ce n’eft que dans les deux derniers
fiecles que les architeftes s’appliquèrent à retrouver la première
fimplicité. Ibid. b. On diftingue l’architefture, eu égard
à fes différentes époques, 8c aufli félon les divers carafterés 1
des ordres. Vitruve eft le feul ancien dont nous ayons des
préceptes par écrit. Commentaire de fon ouvrage. Auteurs
qui ont écrit fur l’architefture depuis Vitruve. Ibid.,618. a.
A rchite cture , ( Beaux-arts ) il ne s’agit ici de l’architefture,
qu autant qu’elle tient au goût. Talent qu’on a droit
d exiger d un architefte. Génie créateur, mais dont les productions
foient foumifes aux réglés du goût. On ne fauroit
nier que l’architefture n’ait une utilité bien décidée pour la
"culture de l’efprit 8c du coeur, puifque cet art fait reproduire