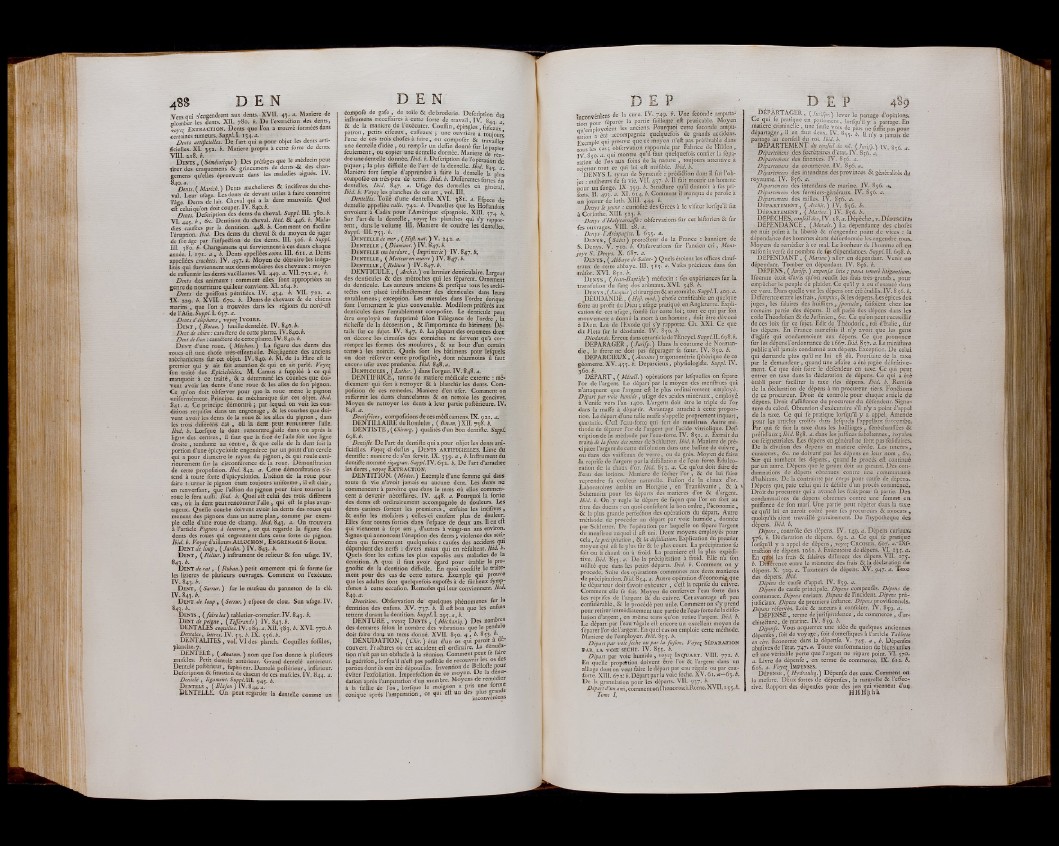
488 D E N
Vers qui s’engendrent aux dents. XVII. 43. a. Maniéré de
plomber les dents. XIL 780. b. De l'extraâion des dents,
voyci E x t r a c t i o n . Dents q u e l’on a trouvé formées dans
certaines tumeurs. SuppL 1. 134. a.
Dents artificielles. De l’art qid a pour objet les dents artificielles.
XI. 35 a. b. Madere propre à cette forte de dents.
V in . ai8.é. , .
D en t s , ( Sèmèiotïque) Des préfages que le medecm peut
tirer des craquemens 8c grincemens de dents -ofc des enaps
gemens qu’elles éprouvent dans les maladies aiguës. IV .
4Dents.(Maréch.) Dents machelieres & incifives du cheval
Leur ufage. Les dents de devant utiles à faire connoitre
l’âge. Dents de lait. Clieval qui a la dent mauvaife. Quel
«il celui qu’on doit couper. IV. 840. b.
Dents. Defcription des dents du cheval. Suppl. 111. 300. b.
VI. 445. b , &c. Dentition du cheval. Ibid. & 446. b. Maladies
eaiifées par la dentition. 448. b. Comment on facilite
l’éruption. Ibid. Des dents du cheval & du moyen de juger
de fon âge par l’infpeâtion de fes dents. IIL 306. b. Suppl.
III. 380. b. Changemens qui furviennent à ces dents chaque
année. I. 171. a , b. Dents appellées coins. III. 611. a. Dents
appellées crochets. IV. 497. b. Moyen de détruire les inégalités
qui furviennent aux dents molaires des chevaux : moyen
de raffermir les dents vacillantes. VI. 449. a. VII. 752.4, b.
Dents des animaux : comment elles font appropriées au
genre de nourriture qui leur convient. XL 264.'¿.
Dents de poiffons pétrifiées. IV. 434. b. VII. 722. a.
IX. 229. b. aVU. 670. b. Dents de chevaux & de chiens
marins, que l’on a trouvées dans les régions du nord-eft
de l’Afie. Suppl. L 637. a.
Dents d'èléphans , voye[ IVOIRE.
D e n t , ( Bot an. ) feuille dentelée. IV. 840. b.
JDent de chien : caraétere de cette plante. IV. 840. b.
Dent de lion : caraélere de cette plante. IV. 840. b.
D e n t d’une roue. ( Michan. ) La figure des dents des
roues eft une chofe très-effentiellc. Négligence des anciens
méchaniciens fur cet objet. IV. 840. b. M. de la Hire eil le
premier qui y ait fait attention & qui en ait parlé. Voye^
fon traité des Epickloides. M. Camus a fuppléé à ce qui
manquoit à ce traité, & a déterminé les courbes que doivent
avoir les dents d’une roue & les ailes de fon pignon.
Ce qu’on doit obferver pour que la roue mene le pignon
uniformément. Principe- de méchanique fur cet objet. Ibid.
841. a. Ce principe démontré ; par lequel on voit les conditions
requifes dans un engrenage , & les courbes que doivent
avoir les dents de la roue 8c les ailes du pignon, dans
les trois différens cas , où la dent peut rencontrer l’aile.
Ibid. b. Lorfque la dent rencontre^’aile dans ou après la
ligne des centres, il faut que la face de l’aile foit une ligne
droite , tendante au centre, & que celle de la dent foit la
portion d’une épicycloïde engendrée par un point d’un cercle
qui a pour diametre le rayon du pignon, 8c qui roule extérieurement
fur la circonférence de la roue. Démonfiration
de cette propofition. Ibid. 842. a. Cette démonfiration s’étend
à toute forte d’épicydoïdes. L’aâion de la roue pour
faire tourner le pignon étant toujours uniforme, il eft clair,
en renverfant, que l’aftion du pignon pour faire tourner la
roue le fera aufii. Ibid. b. Quel eft celui des trois différens
cas, où la dent peut rencontrer l’aile , qui eft le plus avantageux.
Quelle courbe doivent avoir les dents des roues qui
mènent des pignons dans un autre plan, comme par exemple
celle d’une roue de champ. Ibid. 843. a. On trouvera
à l’article Pignon à lanterne, ce qui regarde la figure des
dents des roues qui engrennent dans cette forte de pignon.
Ibid. b. Voye[ d'ailleurs A l l u c h o n , E n g r e n a g e 6* R o u e .
DENT de loup, (Jardin.) IV. 843. b.
D e n t , ( Reliur. ) infiniment de relieur & fon ufage. IV.
843. b.
D'art de rat, ( Ruban.) petit ornement qui le forme fur
les lizieres de plufieurs ouvrages. Comment on l’exécute.
IV. 843. b.
D e n t , ( Serrur. ) fur le mufeau du panneton de la clé.
IV. 843. b.
D ent de loup, (Serrur.) efpece de clou. Son ufage.IV.
843-b.
D ents , (faire les) tabletier-cornetier. IV. 843. b.
D ent de peigne , (Tiffèrands) IV. 843. b.
DENTALES coquilles. IV. 189. a. XII. 583. b. XVI. 770. b.
Dentales, lettres. IV. 53. b. IX. 556. b.
DENTALTTES, vol. VI des planch. Coquilles foifiles,
planche. 7.
DENTELÉ, £ Anatom. ) nom que l’on donne à plufieurs
mufcles. Petit dentelé antérieur. Grand dentelé antérieur.
Dentcle pofténeur, fupérieur. Dentelé poftérieur, inférieur.
Defcription 8c fituation de chacun de ces mufcles. IV. 844. a.
Dentelé , ligament. Suppl.Ul. 94«. b.
D entelé , ( Blafon ) IV.. 844. a.
PENTELLE. On peut regarder la dentelle comme un
D E N
compofé de gafe , de toile & de broderie. Defcription des
inftrumens néceffaires à cette forte de travail, i v f 844. a
8c de la maniéré de l’exécuter. Couffin, épingles ,'fufeaux*
patron, petits cifeaux, caffeaux ; une ouvrière a toujours
l’une de ces trois chofes à faire, ou compofer & travailler
une dentelle d’idée, ou remplir un deffin donné fur le papier
feulement, ou copier une dentelle donnée. Maniéré de rendre
unedentelle donnée. Ibid. b. Defcription de l’opération de
piquer.; la plus difficile de l’art de la dentelle. Ibid. 84e. a
Maniéré fort fimple d’apprendre à faire la dentelle la plus
compofôe en très-peu de tems. Ibid. b. Différentes fortes de
dentelles. Ibid. 847. a. Ufage des dentelles en général.
Ibid. b. Voye^les planches de Cet art, vol. III.
Dentelles. Toile d’une dentelle. XVI. 381. a. Efpece de
dentelle appellée tulle. 742. b. Dentelles que les Hollandois
envoient à Cadix pour l’Amérique efpagnole. XIII. |§|| b.
Sur l’art de la dentelle, voye{ les planches qui s’y rapportent
, dans le volume III. Maniéré de coudre les dentelles,
Suppl. III. 753.
D en telle de mer, (Hifi.nat. ) V. 242. a.
D entelle , (Diamant.) IV. 847. b.
D entelle ou bordure, ( Imprimerie) IV. 847. b.
D entelle , ( Metteur en oeuvre ) ÏV. 847. b.
D entelle , ( Reliure ) IV. 847. b.
DENTICULE, ( Archit.) ou larmier denticulaire. Largeur
des denticules & des métoches qui les féparent. Ornement
du denticule. Les auteurs anciens & prefque tous les archi-
teftes ont placé indiltinâement des denticules dans leurs
entablemens; exception. Les mutules dans l’ordre dorique
font l’ornement le plus convenable. Modillons préférés aux
denticules dans l’entablement compofite. Le denticule peut
être employé ou fupprimé félon l’élégance de l’ordre , la
richeffe de la décoration , & l’importance du bâtiment. Détails
fur ce fujet. IV. 847. b. La plupart des ornemens dont
on décore les cimaifes des corniches ne fervent qu’à corrompre
les formes des moulures, & au bout d’un, certain
tems» à les noircir. Quels font les bâtimens pour lefquels
on doit réferver cette prodigalité, dont néanmoins il faut
encore ufer avec prudence. Ibid. 848. a.
D e n t ic u l e s , (Luther.) dans l’orgue. IV. 848. a.
DENTIFRICE, terme de matière médicale externe : médicament
qui fert à nettoyer & à blanchir les dents. Com-
pofition de ces remedes. Maniéré d’en ufer. Comment on
raffermit les dents chancelantes Sc on nettoie les gencives.
Moyen de nettoyer les dents à leur partie poftérieure. IV.
848. a.
Dentifrices, compofitions de ces médicamens. IX. 921 .a.
DENTILLAIRE de Rondelet, ( Botan. ) XII. 798. b.
DENTISTE, (Chirurg. ) qualités d’un bon dentifte. SuppL
698. b.
Dentifie De l’art du dentifte qui a pour objet les dents artificielles.
Voye[ ci-deffus , D ents a r t if ic ie l l e s . Lime du
dentifte : maniéré de s’en fervir. IX. 539. a , b. Infiniment du
dentifte nommé ri^agran. Suppl. IV. 652. b. De l’art d’arracher,
les dents, voye[ E x t r a c t io n .
DENTITION. (Médec. ) Exemple d’une femme qui dans
toute fa vie n’avoit jamais eu aucune dent. Les aents ne
commencent à paroître que dans le tems où elles commencent
à devenir néceffaires. IV. 448. a. Pourquoi la fortie
des dents eft ordinairement accompagnée de douleurs. Les
dents canines fortent les premières, enfuite les incifives,
& enfin les molaires ; celles-ci caufent plus de douleur.
Elles font toutes forties dans l’efpace de deux ans. Il en eft
qui viennent à fept ans , d’autres à vingt-un ans environ.
Signes qui annoncent l’éruption des dents ; violence des acci-
dens' qui furviennent quelquefois : caufes des accidens qui
dépendent des nerfs : divers maux qui en réfultenr. Ibid. b.
Quels font les enfans les plus expofés aux maladies de la
dentition. A quoi il faut avoir égard pour établir le pii?~
gnoific de la dentition difficile. En quoi confifte le traitement
pour des cas de cette nature. Exemple qui prouve
que les adultes font quelquefois expofés à de fâcneux fymp-
tômes à cette occafion. Remedes qui leur conviennent. Ibid■
849- « • .. . .
Dentition. Obfervation de quelques phénomènes fur la
dentition des enfans. XV. 737. b. il eft bon que les enfàns
tettent durant la dentition. Suppl.1. 295.a,b.
DENTURE, voye{ D ents , (Méchaniq.) Des nombres
des dentures félon le nombre des vibrations que le pendule
doit faire dans un tems donné. XVII. 850. 4 , b. 853. b.
DÉNUDATION, ( ChJr. ) état d’un os qui paroît à découvert.
Fraâures où cet accident eft ordinaire. La dénudation
n’eft pas un obftacle à la réunion. Comment peut fe faire
la guérifon, lorfqu’il n’eft pas pofiible de recouvrir les os des
parties dont ils ont été dépouillés. Invention de Bellofte pour
éviter l’exfoliation. Imperfeétion de ce moyen. De Ja dénudation
après l'amputation d’un membre. Moyens de remédi
à la faillie de l’os , lorfque le moignon a pris une forme
conique après l'amputation, ce qui eft un
D E P
ïnconvèniens de la cure. IV, 749- Ë Une feconcle amputation
pour féparer la partie fallíante eft praticable. Moyen
ou’employoient les anciens. Pourquoi cette fécondé amputation
a été accompagnée quelquefois de grands accidèns.
Exemple qui prouve que ce moyen n’eft pas préférable dans
tous les cas j obfervation rapportée par Fabrice de Hilden,
IV. 850. a. qui montre qu’il faut quelquefois confier la fépa-
ration de l’os aux foins de la nature , toujours attentive a
rejetter tout ce qui lui eft nuifible. Ibid. b.
DENYS I. tyran de Syracufe : prédiftion dont il fut l’objet
: malheurs de fa vie. VII. 437. b. Il fait mourir un homme
pour un fonge. IX 399. b. Struéhire qu’il dorinoit à fes priions.
II. 493. a. XI. 614. b. Comment il manqua de parole à
un joueur de luth. XIII. 444. b. *
Denys le jeune : currofité des Grecs à le vifiter lorfqu’il fut
à Corinthe. XIII. 513. b.
Denys d'Halycarnaffe : obfervations fur cet hiftorien 8c fur
fes ouvrages. VIII. 28. a.
Denys■ TAréopagite. I. 635. a.
Denys, (Saint) protecteur de la France : banniere de
S. Denys. V. 710. ¿. Obfervations fur l’ancien cri, Mont-
joye S. Denys. X. 687. a.
Denys , (Abbaye de Saint- ) Quels étoient les offices clauf-
tritux de cette abbaye. III. 515- a- Vafes précieux dans fon
-tréfor. x v i . 851. b. : ■ ‘,Y
Denys, (Jean-Baptifle) médecin : fes expériences fur la
transfufion du fang des animaux. XVI. 548. b.
D e n y s , (Jacques) chirurgien & anatomifte. Suppl. 1. 409. a.
DÉODANDE, (Hiß. mod.) chofe confifcable en quelque
forte au profit de Dieu ; ufage pratiqué en Angleterre. Explication
de cet ufage, fondé tur cette loi; tout ce qui par fort
mouvement a donné la mort à un homme, doit être dévoué
à Dieu. Loi de l’Exode qui s’y rapporte. Ch. XXI. Ce que
dit Fleta fur le déodande. IV. 850. b.
Dèodande. Erreur dans cet article de FEncycl. Suppl. II. 698. é.
DEPARAGER, ( Jurifp. ) Dans la coutume de Normandie,
le frere ne doit pas deparager fa foeur. IV. 850. b.
DEPARCIEUX, ( Antoine§ trigonométrie fphérique de ce
géometre. XV. 455. b. Deparcieux, phyfiologifte. Suppl. IV.
360. H -
DÉPART, ( Metall. ) opérations par lefquclles on fépare
l’or de l’argent. Le départ par le moyen des menftrues qui
n’attaquent que l’argent eft le plus ordinairement employé.
Départ par voie humide, ufage des acides minéraux, employé
à Venile vers l’an 1400. L’argent doit être le triple de l’or
dans la maffe à départir. Avantage attaché à cette proportion.
Le départ d’une telle maffe s’appelle proprement inquart,
quartatio. Ceft l’eau-forte qui fert de menitrue. Autre méthode
de féparer l’or de l’argent par l’acide vitriolique. Def-
■cription-de la méthode par l’eau-forte. IV. 851. a. Extrait du
traité de la fonte des mines de Schlutter. Ibid. b. Maniere de précipiter
l’argent de cette diffolution dans une baffine de cuivre,
ou dans des vaiffeaux de verre, ou de grès. Moyen de faire
la reprife de l’argent par la diftillation de l’eau forte. Edulcoration
de la chaux d’or. Ibid. 852. a. Ce qu’on doit faire de
l ’eau des lotions.- Maniere de fécher l’or , & de lui faire
reprendre fa couleur naturelle. Fufion de la chaux d’or,
laboratoires établis en Hongrie , en Tranfilvanie , & à
Schemnitz pour les départs des matières d’or & d’argent.
Ibid. b. On y regle le départ de façon que l’or en fort au
titre des ducats : en quoi confiftent le bon ordre, l’économie,
& la plus grande perfeélion des opérations du départ. Autre
méthode de procéder au départ par voie humide , donnée
par Schlutter. De l’opération par laquelle on fépare l’argent
du menftrue auquel il eft uni. Deux moyens employés pour
cela, la précipitation, & la diftillation. Explication du premier
moyen qui eft le plus fur & le plus court. La précipitation fe
feit ou à chaud ou à froid. La première eft la plus expéditive.
Ibid. "853. a. De la précipitation à froid. Elle n’a fon
utilité que dans les petits départs. Ibid. b. Comment on y
procede. Suite des opérations communes aux deux manieres
de précipitation. Ibid. 854. a. Autre opération d’économiçque
le départeur doit favoir exécuter , c’eft la reprife du cuivre.
Comment elle fe fait. Moyen de conferver l’eau forte dans
■les reprifes de l ’argent & du cuivre. Cet avantage eft peu
confidérable, & le procédé peu utile. Comment on s’y prend
pour retirer immédiatement une partie de l’eau-fortede la diffo-
îution d’argent, en même tems qu’on retire l’argent. Ibid. b.
Le départ par l’eau régale eft encore un excellent moyen de
féparer l’or de l’argent. En quel cas on emploie cette méthode.
Maniere de l’employer. Ibid. 855. b.
Départ par voie feche ou par la fufion. V6ye[ SÉPARATION
PARt,LA VOIE SECHE. IV. 855. b.
Départ par voie humide, voyc{ I n q u a r t . VIII. 772. b.
En quelle proportion doivent être l’or & l’argent dans un
alliage dont on veut faire le départ par eau régale ou par eau-
fbrtc. XIII. 672: b. Départ par la voie feche. XV. 61..*—63. b.
De la granulation pour les départs. VII. 937. &•
Dipartd'un ami, comment on l’honorok à Rome. XVII. 255.9.
Tome îx
D E P 4S9
DÉPARTAGER., ( Jurifpr.) lever le partage d’opinions.
c e qui fe pramme en parlement, lorfquH y ! partage. En
mattere çrnnincUc, «ne feule voix tle pins ne fufe pas pour
départager, il en faut deux IV 4. 1, , jÜâiSdé
partage au confeti du roi. Ibid. b.
DEPARTEMENT du confeti du roi. (Jurïfp.) lv . 856. a.
Dèpartemens des fecrétaires d’état.lV. 856. a.
D ¿partemer, s des finances.' IV. 856. a.
Dèpartemens du commerce. IV. 856. a.
Dèpartemens des ititendans des provinces & généralités dja
royaume. IV. 856. a-.
Dèpartemens des iñtendans de marine. IV. 856; <h>
Dèpartemens des fermiets-généraux. IV. 856. a.
Dèpartemens des tailles. IV. 856. ai
DEPARTEMENT, f Archit.) IV. 856. b.
D é p a r t em e n t , (Marine.) IV. 856. b.
DÉPÊCHES, confeildes, IV. 18. a. Dépêche, v. DÉPESCHE»
• DÉPENDANCE, ( Morale. ) La dépendance des chofcs
ne. nuit point à la liberté 8c n’engendre point de vices : la
dépendance des hommes étant défordonnée les engendre tous.
Moyens de remédier à ce mal. Le bonheur de l’homme eft en
raifon inverfe du nombre de fes dépendances. Suppl. II. 698. b.
DÉPENDANT, (Marine) aller .en dépendant. Venir et*
dépendant. Tomber en dépendant. IV. 856. b.
DÉPENS j ( Jurifp. ) expenfoe litis ; pana temeré litigantium.
Ifocrate ¿toit d’avis qu’on rendît les frais très-grands, pouf
empêcher le peuple de plaider. Ce qu’il y a eu d’exaucé dans
ce voeu. Dans quellé vue les dépens ont été établis. IV. 856.b.
Différence entre les frais ,fumptus, & les dépens. Les épices des;
juges, les falaires des huifiiers, fportulee, feiioient chez les
romains partie des dépens. Il eft parlé des dépens dans les
code Théodofien & de Juftinien, &c. Ce qu’on peut recueillir
de ces loix fur ce fujet. Edit de Théodoric , roi d’Italie,, fur
les dépens. En France, autrefois il n’y avoit que les gens
d’églife qui cûndamnoient aux dépens. Ce que prononce
fur les dépens l’ordonnance de 1667. 8 5/'. u. Le minifteré
public n’eft jamais condamné aux dépens. Exception. De celui
qui demande plus qu’il ne lui eft dû. Pourfuite de la taxe
par le demandeur, quand une affaire a été jugée définitivement.
Ce que doit faire lé défendeur en taxe. Ce qui peut
entrer en taxe dans la déclaration de dépens. Ce qui a été
établi pour faciliter la taxe des dépens. Ibid. b. Remife
de la déclaration de dépens à un procureur tiers. Fondions
de ce procureur. Droit de controle pour chaque article de
dépens. Droit d’afftilance du procureur du défendeur. Signature
du calcul. Obtention d’exécutoire s’il n’y a point d’appel
de la taxe. Ce qui fe pratique lorfqu’il y a appel. Amende
tour les articles croifés dans lefquels l’appellant fuccombe.
\ar qui fe feit la taxe dans les bailliages , fénéchauffées &
préfiaiaux ; Ibid. 858. a. dans les jufticès fubalternes, foyales
ou feigneuriales. Les dépens en général 11e font pas folidaires*
De la divifion des dépens en matière civile. Les tuteurs,
curateurs, &c. ne doivent pas les dépens en leur nom , &c.
Sur qui tombent les dépens, quand le procès, eft continué
par un autre. Dépens que le garant doit au garanti. Des condamnations
de dépens obtenues contre une communauté
K
d’habitans. De la contrainte par corps pour caufe de dépens.
Dépens que, paie celui qui fe défifte d’un procès commencé.
Droit du procureur qui a avancé les frais pour fa partie. Des
condamnations de dépens obtenues contre une femme en
puiffance de fon mari. Une partie peut répéter dans la taxe
ce qu’il lui en auroit coûté pour fes procureurs & avocats ,
quoiqu’ils aient travaillé gratuitement. De l’hypotheque des
dépens. Ibid. b.
Dépens, contrôle des dépens. IV. 149. a. Dépens curiaux;
576. b. Déclaration de dépens. 6,92. a. Ce qui, fe pratique
lorfqu’il y a appel de dépens, ,voye[ C r o ise r . 607. aruiC»
traélion de dépens. 1061. b. Exécutoire de dépens. VI. 23 5. a.
En qifoi les frais & falaires différent des dépens. VII. 275.
b. Différence entre le mémoire des frais & la déclaration de
dépens. X. 329. a. Taxateurs de dépens. XV. 947. a. Taxe
des dépens. Ibid.
Dépens de caufe d’appel. IV. 859. a.
Dépens de caufe principale. Dépens compenies. Dépens de
contumace. Dépens curiaux. Dépens de l’incident. Dépens pré-
judiciaux. Dépens de première inftance. Dépens_provifionnels.
Dépens réfervés. Loix 8c auteurs à confulter. lv . 859. a.
DÉPENSE, terme de jurifprudence, de commerce , d’ar-
chitefture, de marine. IV. 859. b.
Dépenfe. Vous acquerrez une idée de quelques anciennes
dépenfes, foit de voyage, foit domeftiques à l’article Tablette
en cire. Economie dans la dépenfe. V. 745. a , b. Dépenfes
abufives de l’état. 747. a. Toute confomitiation de biens utiles
eft une véritable perte que l’argent ne répare point. VI. 570..
a. Livre de dépenfe , en terme de commerce. IX. 612. bt
616. a. Voyc{ IMPENSES.
D épense , (Hydrauliq.) Dépenfe des eaux. Comment on
la mefure. Deux fortes de dépenfes-, la naturelle & l’effec*
tive. Rapport des dépenfes pour des jets^ui viennent d’un