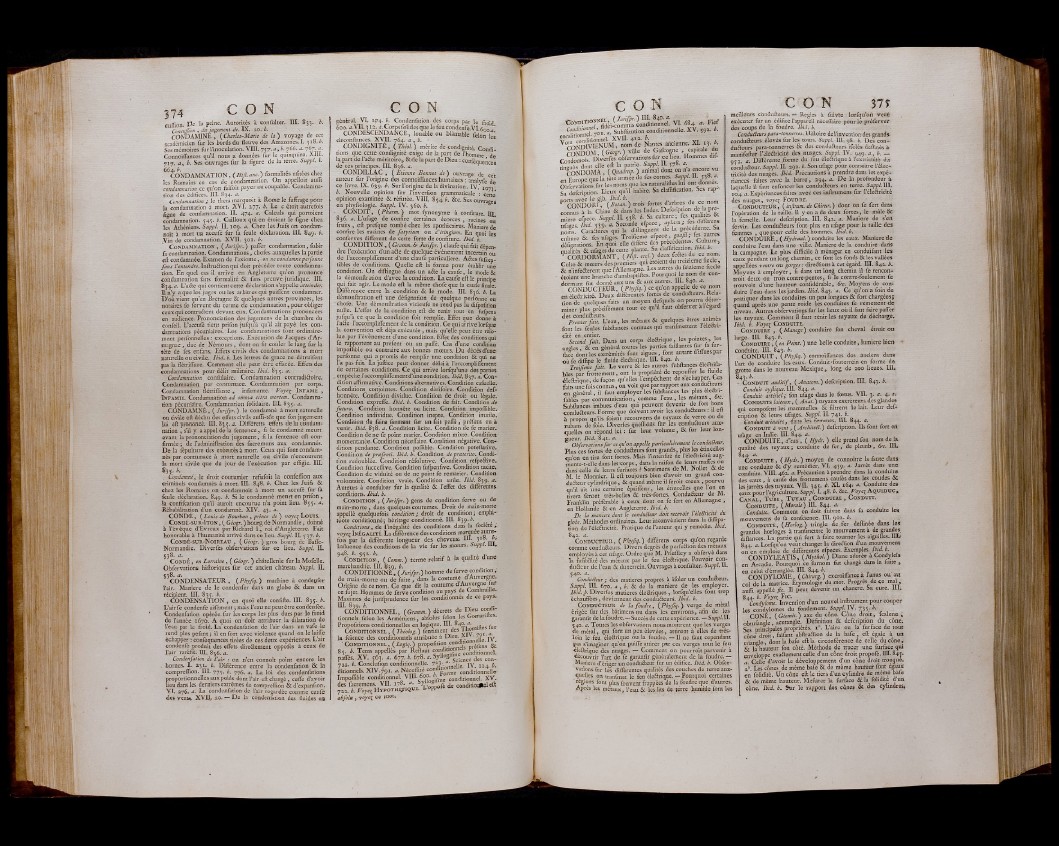
374 C O N
cuflîon. De la Pcine- Aatorités à confulter. HI. 833. h.
Concujfion , du jugement de. IX. 20. b. -
CONDAMINE , ( Charles-Marie de la) voyage de cet
académicien fur les bords du fleuve des Amazones. I. 318. b.
Ses mémoires fur l’inoculation. VIII. 757. a, b. 766. a. 767. a.
Connoiffances qu’il nous a données fur le quinquina. XIII.
717. <2, b. Ses'ouvrages fur la figure de la terre. Suppl. 1.
^CONDAMNATION, C Bit. ose.) formaliiés ufitéeschez
les Romains en cas de condamnation. On appelloit aufli
condamnation ce qu’on faffoir payer au coupable. Condamna-
tion des édifices. III. 834. a.
Condamnation ; le thêta marquoit à Rome le fuffrage pour
la condamnation à mort. XVl. 277. b. Le c étoit autrefois
figne de condamnation. II. 474. a. Calculs qui portoient
condamnation. 545. b. Cailloux qui en étoient le figne chez
les Athéniens. Suppl. II. 100. a. Chez les Juifs on condam-
noit à mort un accufé fur fa feule déclaration. III. 849. b.
Vin de condamnation. XVII. 301. b.
Condamnation, ( Jurifpr.) paffer condamnation, fubir
fa condamnation. Condamnations , chofes auxquelles la partie
eft condamnée. Examen de l’axiome, on ne condamne perfonne
fans Ventendre. Inftruélion qui doit précéder toute condamnation.
En quel cas il arrive en Angleterre qu’on prononce
condamnation fans formalité & fans preuve juridique. III.
834. a. L’aéte qui contient cette déclaration s’appelle atteinder.
Il n’y a que les juges ou les arbitres qui puiffent condamner.
D ’où vient qu’en Bretagne & quelques autres provinces, les
notaires fe fervent du terme de condamnation, pour obliger
ceux qui contraélent devant eux. Condamnations prononcées
en audience. Prononciation des jugemens de la chambre du
confeil. L’accufè tient prifon jufqu’à qu’il ait payé les condamnations
pécuniaires. Les condamnations font ordinairement
perfonnelles : exceptions. Exécution de Jacques d’Ar-
magnac, duc de Némours, dont 011 fit couler le lang fur la
tête de fes. enfons. Effets civils des condamnations à mort
naturelle ou civile, lbid. b. Les lettres de grâce ne détruifent
pas la flétriflùre. Comment elle peut être effacée. Effets des
condamnations pour délit militaire, lbid. 835. a.
Condamnation confulaire. Condamnation contradictoire.
Condamnation par contumace. Condamnation par corps.
Condamnation flétriffante , infamante. Voyeç Infâme ,
Infamie. Condamnation ad omhia citfa mortem. Condamnation
pécuniaire. Condamnation folidaire. III. 835. a.
CONDAMNÉ, ( Jurifpr. ) le condamné à mort naturelle
ou civile eft déchu des effets civils auifi-tôt que fon jugement
lui eft prononcé'. III. 835. ii. Différens effets de la condamnation
, s’il y a appel de la fentence, fi le condamné meurt
avant la prononciation du jugement, fi la fentence eft confirmée
| de l'adminiflration des facremens aux condamnés.
De la fépulture des exéeutés à mort. Ceux qui font condamnés
par contumace à mort naturelle ou civile n’encourent
la mort civile que du jour de l’exécution par effigie. ILL
835. b. ' # -
. Cojidamnè, le droit coutiunier refùfoit la confeffion aux
criminels condamnés à mort. III. 848. b. Chez les Juifs &
chez les Romains on condamnoit à mort un accufé fur fa
feule. déclaration. 849. b. Si le condamné meurt en prifon ,
la confifcation qu’il auroit encourue n’a point lieu. 855. a.
Réhabilitation d’un condamné. XIV. 43. a.
CONDÉ, | Louis de Bourbon , prince de | voyc^ LO U IS .
Condé-sur-Iton , | Geogr. ) bourg dè Normandie, donné
à l’èvêque d’Evreux par Richard I , roi d’Angleterre. Fait
honorable à l’humanité arrivé dans ce lieu. Suppl. II. 537. b.
CondÉ-SUR-Noireau , (Geogr.) gros bourg de Baffe-
Normandie. Diverfes observations fur ce lieu. Suppl. II.
¡ ¡p | a.
CondÉ , en Lorraine, ( Geogr. ) châtellenie fur la Mofelle.
Obfervations hiftoriques fur cet ancien château. Suppl. II.
<38. a.
CONDENSATEUR , ( Phyfiq. ) machine à condepfer
l’air. Maniéré de le condenfer dans un globe & dans un
récipient. III. 835. b.
CONDENSATION, en quoi elle confifte. III. 835. b.
L’air fe condenfe aifément ; mais l’eau ne peut être condenfée.
Condensation opérée- fur les corps les plus durs par le froid
de l’année 1670. A quoi on doit attribuer la dilatation de
l’eau par le froid. La condenfation de l’air dans un vafe le
rend1 plus pefant ; il en fort avec violence quand on le laiffe
échapper : conféquences tirées de ces deux expériences. L’air
contlenfé produit des effets directement oppofés à ceux de
Pair raréfié. III. Sy6: a.
Condenfation de l'air : on n’en connoît point encore les
• bornes. I. 2.31. b. Différence entre la condenfation & la
compreffion. III. 775. b. 776. a. La loi des condenfations
proportionnelles aux poids dont l’air eft chargé, ceffe d’avoir
lieu dans les derniers extrêmes de compreffion & d’expanfion.
VL 276. a. La condenfation de l’air regardée comme caufe
des vents. XVIL 20. — De la condenlation des fluides en
C O N
général. VI. 274. b. Condenfation des corps par le ftoid
600. ¿.VII. 312. -2. Corps fo'lides que le feu condenfe.Vl ’
CONDESCENDANCE, louable ou blâmable félon il*
circonftances. XVII. 764. a , b. ' leS
CONDIGNITÉ, ( Thiol. ) mérite de condignité* Conditions
que cette condignité exige de la part de l’homme de
la part de l’afte méritoire* &de la part de Dieu : conféquences
de ces principes. III.,836. <2.
CONDILLAC , ( Etienne Bonnot de ) ouvrage de cet
auteur fur l’origine des connoiffances humaines : analyfe de
ce livre. IX. 639. b. Sur l’origine de la divination. IV. 1071.
b. Nouvelle opinion fur l’inverfion grammaticale : cette*
opinion examinée & réfutée. VIII. 854. b. & c. Ses ouvrages
en phyfiolqgie. Suppl. IV. 360. b.
CONDIT, ( Pharm. ) mot fynonyme à confiture, ffi.
836. a. L’ufage de confire certaines écorces , racines ou
fruits , eft prefque tombé chez les apothicaires. Maniéré de
confire les racines de fatyrium ou d'éringium. En quoi les
conferves différent de cette forte déconfiture. Ibid.b.
CONDITION, ( Gramm.b Jurifpr. ) claufe qui foit dépendre
l’exécution d’un aéte de quelque événement incertain ou
de raccompliffement d’une claufe particulière. Aftes fufcep-
tibles de conditions. Quelle .eft la forme pour établir une
condition. On diftingue dans un aéte la caufe, le mode &
la démonftration d’avec la condition. La caufe eft le principe
qui fait agir. Le mode eft la même chofe que la caufe finale.
Différence entre la condition & le mode. III. 836. b. La
démonftration eft une défignation de quelque perfonne ou
"chofe. Une démonftration vicieufe ne rend pas la difoofition
nulle. L’effet de la condition eft de tenir tout en fufpens
jufqu’à ce que la condition foit remplie. Effet que donne à
l’aéte l’accompliffement de la condition. Ce qui arrivé lorfque
la convention eft déjà exécutée, mais qu’elle peut être réfo-
lue par l’événement d’une condition. Effet des conditions qui
fe rapportent au préfent ou au paffé. Cas d’une condition
impoflible ou contraire aux bonnes moeurs. Du décès d’une
perfonne qui a promis de remplir une condition & qui ne
l’a pas fai». La juftice peut donner délai à l’accompliffement
de certaines conditions. Ce qui arrive lorfquhme des parties
. empêche l’accompliffement d’une condition, lbid. 837.-2. Condition
affirmative. Conditions alternatives. Condition cafuclle.
Conditions conjointes. Condition dérifoire. Condition def-
honnête. Condition dividue. Condition de droit ou légale.
Condition expreffe. lbid. b. Condition de fait. Condition de
futuro. Condition honnête ou licite. Condition impoflible.
Condition individue. Condition inepte. Condition inutile, f
• Condition de faire ferment fur un fait paffé, préfent ou à
venir, lbid. 838. a. Condition licite. Condition de fe marier.'
Condition dene fe point marier. Condition mixte. Condition
momentanée. Condition néceffaire. Condition négative. Condition
pendante. Condition poflible. Condition poteftative.
Condition de prtefenti. lbid. b. Condition de praterito. Condition
redoublée. Condition réfolutive. Condition refpeétive.
Condition fucceffive. Condition fufpenfive. Condition tacite.
Condition de viduité ou de ne point fe remarier. Condition
volontaire. Condition vraie. Condition utile. lbid. 839. a.
Auteurs à confulter fur la qualité 8c l’effet des différentes.
conditions. lbid. b.
C o n d i t io n , (Jurifpr.) gens de condition ferve ou de
main-morte, dans quelques coutumes. Droit de main-morte
appellé quelquefois condition; droit de condition ; emplti-
téote conditionné; héritage conditionné. III. 839.b.
Conditions, de l’inégalité des conditions dans la fociété,
voyeç In é g a li té . La différehee des conditions marquée autrefois
par la différente longueur des chevepx. III- 3 ,
Influence des conditions de la vie fur les moeurs. Suppl. III.
C o n d it io n , ( Comm.) terme relatif à la qualité dune
marchandife. III. 839. b. „ .
CONDITIONNÉ, (Jurifpr.) homme dé ferve condition,
de main-morte ou de fuite, dans la coutume dAuvergne.
Origine de ce nom. Ce que dit la coutume d Auvergne f ur
ce iujct. Hommes de ferve condition au pays de Combrau .
Maximes de jurifprudence fur les conditionnés de ce pay •
IH. 839. b. & . 1.
CONDITIONNEL, ( Gramm. ) décrets de Dieu conditionnels
félon les Arméniens, abiolus félon les Gomari
Propofitions conditionnelles en logique. III. 840.
C o n d it io n n e l , | Théolog. ) fentiment des Thoiai ^
la fcience des conditionnels attribuée à Dieu. A i - 7J • •
'C o n d ition n e l, ( Logiq.) propofition condino • •
8 t. b. Tems appellés par Reftaut conditionnel p
paffés. XV. J f a. 677. b. 678. ^ ^ I scfence des con-
722. b. Conclufiqn condmonnelle. 7a.3\ .„ tu i v h a b
¡monnek. XIV f c . H P " !
Impoflible condmonnel VIII. Îc,o. .[.me g | g | g | g | XV.
P P j j P M B B a j M H * «n<üùo*deft 7a; . .
abfolu, voyei ce mot,
C O N
VI. 684. a. Fief
Co,^ ,tl0.e\ 7oi a. Subftitution conditionnel. 7 • . ,conditionnelle. XV. b.
V ? b S S Æ ü M , nom de Nantes ancienne. XL 13. i.
rONDOM, (Giogr.) ville de Gafcogne capitale dn
C ondom ois. Diverfes obfervariohs ftfcg B g , ' ^ omma dlf_
♦înpués dont elle eft la patrie. Suppl. II. 578. a
FoNDOMA, (Ouadnip.) animal dont, on n a encore vu
en Europe que la tète année de fes cornes. Suppl. H- H8- *
Obftrvanom fur les noms que les naturaliftes lut ont donnés
Sa defeription. Lieux qu’il habite. Sa daflificatton. Ses rapmÈÈglÊBÈW
trois fortes d'arbres de ce nom
connus à la Chine & dans les Indes. Defeription de la;prer
S e efpcce. Suppl. II. 338. b. Sa culture; fes qualités &
aliènes lbid. 3.3'oi a. Seconde efpece, oyLiru; fes différens
noms Caraileres qui la diflinguent de la précédente. Sa
culture 8c fesufages. Troifieme efpece , goafi; fes. autres
défignadons. En quoi elle diffère des précédentes. Culture,
qualités 8c nfages de cette plante. Sa claflification. lbid. b.
CORDORMANT, (Hijl. m l.) deux feftes de ce nom.
Culte 8t moeurs des premiers qui étoient du treizième ftecle,
8t n’infeélerent que l’Allemagne. Les autres jufeliaemeifedc
étoient une branche d’anabaptiftes. Pourquoi le nom de cou
dormant fut donné aux uns 8t aux autres. 111. 840. a.
CONDUCTEUR, (.Phyfiq.) ce qu’on appelle de ce nom
en éleélriclré. Deux différentes fortes de conduaeurs. Relation
de quelques faits au moyen defquels on pourra déterminer
plus précifément tout ce qud faut obferver à 1 égard
des comlu&eurs. g , . . . , ‘
Premier fait. L’eau, les métaux 8c quelques êtres animes
font les feules fubftances connues qui tranfmettent I électricité
en entier. „ , . . „
Second fait. Dans un corps éleftrique, les pointes, les
anales, 8c en général toutes les parties raillantes fur la lur-
face dont les extrémités font aiguës, font amant d mues par
où fe diflme le fluide éleftrique. III. 840■ b.
Troifieme fait. Le verre 8c les autres fubftances éleftrifa-
bles par frottement, ont la propriété de repouffer le fluide
élefWque, de façon qu’elles l’empèchent de s échapper. Ces
faits une fois connus, on volt que par rapport aux conduaeurs
en général, il faut employer les fubftances les plus élettri-
fables par communication, comme l’eau, les métaux, o*c.
Subftances imbues d’eau qui peuvent devenir de fort bons
•conduaeurs. Forme que doivent avoir les conduaeurs : il ett
à propos qu’ils foient recouverts de tuyaux de verre ou de
Tubans de foie. Diverfes queftions fur les conduaeurs auxquelles
on répond ici : fur leur volume, & fur leur longueur.
lbid. 841. a. , 1 j
Obfervations fur cequ on appelle particulièrement le conducteur.
Plus ces fortes de conduaeurs font grands, plus les étincelles
1 qu’on en tire font fortes. Mais l’intenfité de l’éfearicité augmente
t-elle dans les-corps, dans la raifon de leurs maffes ou
dans celle de leurs furfaces ? Sentimens de M. Nollet oc de
M. le Monnier. Il eft toujours bien d’avoir un grand con-
dufteur cylindrique, & quand même il feroit creux, pourvu
qu’il ait une certaine épîtiffeur., les étincelles que l’on en
tirera feront très-belles & très-fortes. Conduapur de M.
Franklin préférable à ceux, dont on fe fert en Allemagne ,
en Hollande & en Angleterre, lbid. b.
De la maniéré dont le conduSeur doit recevoir l elcuricitc du
globe. Méthodes ordinaires. Leur inconvénient dans la diflipa-
tion de l’élearicité. Pratique de l’auteur qui y remédie, lbid.
. 842. a. .
C o n d u c te u r , (Phyfiq.) différens corps quon regarde
Comme conduaeurs. Divers degrés de perfeaion des métaux
employés à cet ufage. Ordre que M. Prieftley a obfervé dans
la fufibilité des métaiLX par le feu éfearique. Pouvoir con-
duâcur .de l’eau & du terrein. Ouvrages à confulter. Suppl. II.
540. a. . . . . . _
ConduEteur j des matières propres à ifoler un conduaeur.
Suppl. III. 670. a , b. & de la maniéré de les employer.
lbid. Jj. Diverfes matières éleariques, lorfqu’elles font trop
échauffées, deviennent des conduaeur^. lbid. b.
C o n d u c te u r de la foudre, (Phyfiq.) verge de métal
érigée fur des bâtimens ou dans les environs, afin de les
garantir de la foudre.— Succès de cette expérience. —Suppl.W.
540. a. Toutes les obfervations nous montrent que les verges
de métal, qui font un peu élevées, attirent à elles de très-
loin le feu élèarique ou la foudre. — Il ne faut cependant
pas s’imaginer qu’on puifle attirer par ces verges tout le feu
«fearique des nuages. — Comment on pourroit parvenir à
découvrir l’art de fe garantir généralement de la foudre. —
Maniéré d’ériger un conduaeur fur un édifice. lbid. b. Obfervations
fur les différentes qualités des couches de terre auxquelles
,on tranfmet le feu éfearique. — Pourquoi certaines
régions font pluslbuvent frappées de la foudre que d’autres.
Apres les métaux, l’eau 6c les lits de terre humide font les
C O N 37 î
meilleurs c'onduaeurs. — Réglés à fuivte lorfqu’oil vetié
exécuter fur un édifice l’appareil néceffaire pour le préfer ver
des coups de là foudre, lbid. b.
Conducteurs para-tonnerres. Hiftoire de l’invention dès grands
conduaeurs élevés fur les tours. Suppl. III. 98. b. Des conduaeurs
para-tonnerres 8c des conduaeurs ifolés dèftinés à-
manifefter l’élearicité des nuages. Suopl. IV. 049. a , b. —
9 <2. a. Différente forme du feu éfearique à 1 extrémité du
conduaeur. SuppL II. 292. b. Son ufage pour connoitre l’êlec-
tricitè des nuages, lbid. Précautions à prendre dans fes expériences
faites avec la barre, 294. a. De la profondeur à
laquelle il faut enfoncer fes conduaeurs en terre. Suppl. III.
104. a. Expériences faites avec ces inftrumens fur l’élettriclté
des nuages, voyc{ F o u d r e . . ’
C o n d u c t e u r , ( inftrum. de Ckirur.) dônt bri fe fert daiis
l’opération de la taille. Il y en a de deux fortes, 1e màle &
la femelle. Leur defeription. III. 842. a. Maniéré de s’eri
fervir. Les conduaeurs font plus en ufage pour la taille des
femmes, que pour celle des hommes, lbid. b.
CONDUIRE, ( Hydraul. ) conduire fes eauX. Maniéré de
conduire l’eau dans une ville. Maniéré de la conduire dans
la campagnek Le plus difficile à ménager en conduifant fes
eaux pendant un long chemin, ce font Tes fonds & fes vallées
appellées ventre ou gorges : direaions à cet égard. III. 842. bt
Moyens à employer, fi dans un long chemin il fe rencon-
troit deux ou trois contre-pentes, fi fe contre-foulement fe
trouvoit d’une hauteur confidérable, &c. Moyens de conx
duire l’eau dans fes jardins, lbid. 842. a. Ce qu’on a foin de
pratiquer dans fes conduites un peu longues & fort chargées 5
quand après une pente roide fes conduites fe remettent de
niveau. Autres obfervatiops fur fes lieux où il fout foire paffer
fes tuyaux. Comment il fout tenir les tuyaux de décharge.
lbid. b. Voyc[ C o n d u i t e .
C o n d u i r e , (Manège) conduire fon cheval étroit ou
large. III. 843. b. # . '
C o n d u i r e , ( en Peint. ) une belle condiute, lumière bien *
conduite. III. 843. b. - .
CONDUIT, ( Phyfiq. ) connoiffances des anciens dans
l’art de conduire fes eaux. Conduit «fouterrein en forme de
grotte dans 1e nouveau Mexique, long de 200 lieues. III.
-^ C o n d u i t auditif, (Anatom.) defeription. III. 843. b.
Conduit cyfiique. III. 844. a. .
Conduit artériel ; fon ufage dans 1e foetus. VIL 3. a. 4.
C o n d u i t s laiteux, ( Anat.) tuyaux excréteurs des glandes
qui compofent fes mammelles & filtrent fe lait. Leur defeription
& leurs ufages. Suppl. H. 74t. b.
Conduit urinaire, dans les femmes, III. 844. a.
C o n d u i t à vent, ( ArchiteEl. ) defeription. Ils font fort eii
ufage en Ijtalie. III. 844. a.
CONDUITE, d'eau, ( Hydr. ) elle prend fon nom de la
qualité des tuyaux ; conduite de fer i de plomb, 6*e. IIL
844. a. . . r j
C o n d u i t e j (Hydr.) moyen de connoitre la foute dans
une conduite & d’y remédier. VI. 439. a. Jarret dans une
conduite. VIII. 462. a. Précaution à prendre dans la conduite
des eaux, à caufe des frottemens caufés dans fes coudes &
les jarrets des tuyaux. VII. 343- b. XL 164. a. Conduite des
eaux pour l’agriculture.£«/>;>/. I. 48. b. Scc.f'oyei A q u e d u c *
C a n a l , T u b e , T u y a u , C o n d u i r e , C o n d u i t .
C o n d u i t e , (Morale) III. 844. a. .
Conduite. Comment on doit fuivre dans fa conduite les
mouyemens de fa confcienee. HI. 002. b.
C o n d u i t e , (Horlog.) tringle de fer deftinée dans fes
grandes horloges à transmettre 1e mouvement à de grandes
diftances. La partie qui fert à faire tourner fes aiguilles. IILi
844. a. Lorfqu’on veut changer la dire&ion d’un mouvement
on en emploie de différentes efpeces. Exemples, lbid. b. _
CONDYLEATIS, (Mythol.) Diane adorée àCondyleis
en Arcadie. Pourquoi ce furnom fut changé dans la fuite »
en celui d’étranglée. III. 844. b. .
CONDYLOME, (Chirurg.) excroiffanceà 1 anus ou au
col delà matrice. Etymologie du mot. Progrès de ce mal,
auifi appellé fie. Il peut devenir un chancre, ba cure. III.
844. b. Voye{ Fie.
Condylome. Invention d’un nouvel inftrument pour couper
les condylomes du fondement. Suppl. IV. 73$.^.
CONÉ, (Géomét.) axe du cône. Cône droit -, feafene
obtufangle, acutangle. Définition & defeription du cônei
Ses principales propriétés. i°. L’aire ou la furface de tout
cône droit, foiiant abftrailion de la bafe. eft égale à un
triangle-, dont la bafe eft la circonférence de celle du cône,
& la hauteur fon côté. Méthode dè tracer une furfoce qui
enveloppe exaftement celle d’un cône droit propofô. III. 84«*
a. Celle d’avoir 1e développement d’un cône droit trongué*
2b. Les cônes de même baie & de même hauteur lont égaux
en folidité. Un cône eft 1e tiers d’un cylindre de nîêinè bàfe
& de même hauteur. Mefurer la furfoce 8f. la folidite d un
cône, lbid, b. Sur le rapport des cônes & des cylindres4