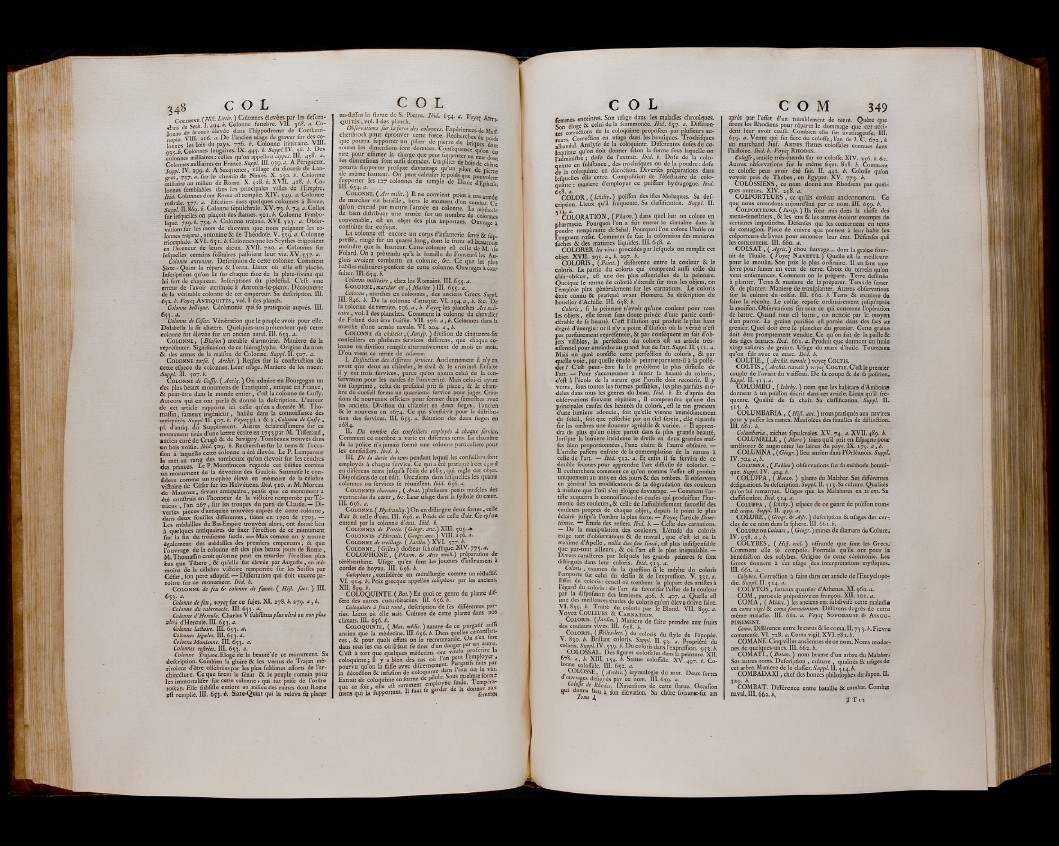
? 4 8 C O L
S r _r . W(.£ fHiß.Littcr. ) Colonnes élevées par lcsdéfcen-
J K b Colonne .funebre. V i f 368. * Co-
lônne Je bronze élevée dans 1 hippodrome de Comtann-
nople. VIII. 216. a. .De l’ancien ulage de graver fur des colonnes
les loix du pays. 776. A Colonne itinéraire. WIL
03 3.. A Colonnes leugaires. IX. 443. A Suppl. IV.. *6. A Des
colonnes milliaires: celles qu’on appelloit cippes. LIL 430. a.
Colonnes milliaires en France. Suppl. III. 919. a. A Péngueux.
Suppl. IV. 299. b. A Sacquener, village du diocele de Lan-
eres, -7Î7- a.lut le chemin de Nîmes. X. 230. A Colonne
znilliaire au milieu de-Rome. X. 518. A XVII. 418. A -Colonnes
iemblables dans les principales villes de l’Empire.
Ibid. Colonnes dont Rome eft remplie. X IV. 249. a. Colonne
roftrale. 277. Efcaliers dans quelques colonnes à Rome.
Suppl. IL 869. A Colonne fépulchrale. XV. 73. A 74. a. Celles
fur lesquelles on plaçoit des ftatues. 501. A Colonne fymbo-
liqué. 729. A 734. A Colonne trajane. XVI. 523. a. Obfer-
vationsfur les mors de chevaux que nous peignent les colonnes
trajane, antonine & de Théodofe. V. 3 39. a. Colonne
triomphale. XVI. 631. A Colonnes que les Scythes érigcoient
en l’honneur de leurs dieux. XVlî. 720. a. Colonnes fur
lesquelles certains folitaires pafloient leur vie. XV. 337. a.
Colonne antonine. Defcription de cette colonne. Comment
Sixte-Quint la répara & l'orna. Lieux où elle eft placée.
Infcriptions qu’on lit fur chaque face de la plate-forme qui
lui fert de chapiteau. Infcriptions du piedeftal. C’eft une
erreur de l’avoir attribuée a Antonin-le-pieux. Découverte
de la véritable colonne de cet empereur. Sa defcription. III.
5 j 2 . A Voyei A n t i q u i t é s , vol. I des planch.
Colonne bellique. Cérémonie qui fe pradquoit auprès. III.
653. a.
. Colonne de Céfar. Vénération que le peuple avoit pour elle.
Dolabella la fit .abattre. Quelques-uns prétendent qué cette
colonne fut élevée fur un ancien autel. III. 633. a.
C o l o n n e , (Blafon) meuble d’armoirie. Maniéré delà
repréfenter. Signification de ce hiéroglyphe. Origine du nom
& des armes de la maifon de Colonne. Suppl. II. 307. a.
. C o l o n n e torfè. ( Archit. ) Réglés fur la. conftruétion de
cette efpece de colonnes. Leur ulage. Maniéré de les tracer.
Suppl. II. 307. A
C o l o n n e de Cujfy. ( Antiq.) On admire en Bourgogne un
des plus beaux monumens de l’antiquité, unique en France,
& peut-être dans le monde entier, c’eft la colonne de Cufly.
Auteurs qui en ont parlé & donné la defcription. L’auteur
de cet article rapporte ici celle qu’en a donnée M. Tho-
tnaflin, fameux ingénieur, habile dans la connoilfance des
antiquités. Suppl. II. 307. A Voye^ pl. 1 & 2 , Colonne de Cuffy,
pl. d’antiq. du Supplément. Autres éclaircïflemens fur ce
monument tirés d’une lettre écrite en 1733 par M. Tifferand,
ancien curé de Crugé & de Savigny. Tombeaux trouvés dans
un bois voifin. Ibid. 309. A Recherches fur le tems 8c l’occa-
fion à laquelle cette colonne a été élevée. Le P. Lempereur
la met au rang des tombeaux qu’on élevoit fur les cendres
des princes. Le P. Montfoucon regarde cet édifice comme
un monument de la dévotion des Gaulois. Saumaife le con-
fidere comme un trophée élevé en mémoire de la célébré
viftoire de Céfar fur les Helvétiens. Ibid. 310. a. M. Moreau
d e M au tour, favant antiquaire, penfe que ce monument a
été conftruiten l’honneur de la viftoire remportée parTé-
tricus l’an 267, fur les troupes du parti de Claude.— Di-
verfes pièces d’antiquité trouvées auprès de cette colonne,
d?n<t deux fouilles différentes, fûtes en 1700 & 1703. —
Les médailles du Bas-Empire trouvées alors, ont donné lieu
à quelques antiquaires de fixer l’éreftion de ce monument
fur la hn du troifieme fiecle. — Mais comme on y trouve
également des médailles des premiers empereurs; & que
l’ouvrage de la colonne eft des plus beaux jours de Rome,
M.Thomaflin croit qu’on ne peut en retarder l’éreétion plus
fcas que Tibere , & qu’elle fut élevée par Augufte , en mé-
moire de la célébré viftoire remportée fur les SuifTes par
Céfar, fon pere adoptif. — Diflertation qui doit encore pa-
roître fur ce monument. Ibid. A
C o l o n n e de feu & colonne de fumée. ( Hiß. facr. ) III.
Î53. a.
Colonne de feu, voye{ fur ce fujet. XI. 278, A 279. a , A
Colonne du tabernacle. III. 653- a"
Colonne d'Hercule. Charles V fubftitua plus ultrâ au non plus
Mitra d’Hercule. III. 633. a.
Colonne la&aire. III. 633. a.
Colonnes légales. 111.633. a.
Colonne Manienne. III. 633. a.
Colonnes roflrées. III, 653. a.
Colonne Trajane. Eloge de la beauté'de ce monument. Sa
defcription. Combien la gloire 8c les vertus de Trajan mé-
ritoient d’être célébrées .par les plus fublimes efforts de l’ar-
chiteélure. Ce que firent le fénat & le peuple romain pour
les immortalifer fur cette colonne » qui fut prife de l’ordre
tofean. Elle fubfifte entière au milieu des ruines dont Rome
pft remplie. IIL 653. A Sixte-Quint qui la releva fit placer
COL au-déflùs la ftatue de S. Pierre. lbid. 634. a. Voyez A n t
q u i t é s , vol. I des planch. *
Obfervations fur la force des colonnes. Expériences deMiUT
chenbroek pour éprouver cette force. Recherchés du do d
que pourm fupporter un pilier de pierre de briques don!
toutes les dimenfions font données. Conféquence qu’on 7
tire pour eftimer la charge que peut iupporteriin mur don°t
les dimenfions font aufli données. Un pilier de bois de chè
pourra fupporter prcfque. davantage qu’un pifier de-pierre
de -meme hauteur. On peut calculer le poids que poùvoient
p o r t e r les 127 colonnes du temple de Diane d’Ephefe
C o l o n n e . {Art milit. ) Il ne convient point à unearmée
de marcher en bataille, hors le moment d’un combat Ce
aù’on entend par mettre l’armée en colonne. La méthode
de bien diftribuer une armée fur un nombre de colonnes
convenable, eft un objet des plus importans. Ouvrage à
confulter fur ce fujet. 6
La colonne eft encore un corps d’infanterie ferré 8c fon.
preffé, rangé fur un quarré long, dont le front eft beaucoup
moindre que la hauteur. Cette colonne eft celle de M. de
Folard. On a prétendu qu’à la bataille de Fontenoi les An-
glois avoient combattu en colonne, &c. Ce que les plus
habiles militaires penfent de cette colonne. Ouvraees à confulter.
IH. 634. A 6
Colonne militaire , chez les Romains. III. 653. a.
ÇOLONNE,marcher en,{Marine) III. 633. a.
Colonne » marches en colonnes, des anciens Grecs. Suppl;
III. 846. A De la colonne d’attaque. VI. 194. a , A &c. De
la colonne de retraite. 196. u, A Voye{ les planches An militaire
, vol. I des planches. Comment la colonne du chevalier
de Folard doit être fraifée. VII. 276. a , A Colonnes dans la
marché d’une armée navale. VI. 204. a , A
C o l o n n e du châtelet, ( Jurifp. ) divifion de cinquante-fix
confeillers en ptufieurs fervices différens, que chaque colonne
ou divifion remplit alternativement de mois en mois.
D’où vient ce terme de colonne.
L Dijlinflion des différens fervices. Anciennement il n’y en
avoit que deux au châtelet, le civil 8c le criminel. Enfuite
il y eut trois fervices, parce qu’on ajouta celui de la con-
fervation pour les caufes de l’univerfité. Mais celui-ci ayant
été fupprimé , celui du prêfidial prit fa place, & la chambre
du confeil forma un quatrième fervice pour juger. Créations
de nouveaux officiers po.ur former deux femeftres avec
les anciens. Divifion du châtelet en deux fieges, l’ancien
8c le nouveau en 1674. Ce qui s’enfuivit pour la diftribu-
tion des fervices. IIL 633. a. Réunion des deux fieges en
1684.
II. Du nombre des confeillers .employés à chaque fervice.
Comment ce nombre a varié en différens tems. La chambre
de la police n’a jamais formé une colonne particulière pour
les confeillers. lbid. b.
III. De la durée du tems pendant lequel les confeillers font
employés à chaque fervice. Ce qui a été pratiqué à cet égard
en différens tems jufqu’à l’édit de 1685, qui réglé cet objet.
Difpofitions de cet édit. Occafions dans lefquelles les quatre
colonnes ou fervices fe réunifient, lbid. 636. a.
C o l o n n e s charnues,, (^«<*r.)plufieurs petits mufcles des
ventricules du coenr , &c. Leur ufage dans la fyftole du cceur.
m . 636. *.
C o l o n n e . ( Hydrauliq. ) On en diftingue deux fortes, celle
d’air 8c celle d’eau. III. 636. a. Poids de celle d’au-..Ce qu’on
entend par la coloone d’eau. lbid. A
C o l o n n e s de Protée. {Géogr. anc.) XIII. 303.^*
C o l o n n e s d'Hercule. { Géogr. anc.) VIII. 130.m.
COLONNE de treillage. ( Jardin.) X v l. 377- A
C o l o n n e , {Gilles) doéfeur fcholaftique.XIV.773.a;
C O L O P H O n E , {Pharm. & Arts méch.) préparation de
térébenthine. Ufage qu’en font les joueurs d’inftrumens à
cordes de boyau. III. 636. A
Colophone, confidérée en métallurgie comme un réduétif.
VI. 914. A Poix grecque appellée colophone par les anciens.
XII. 899. A
COLOQUINTE. ( Bot. ) En quoi ce genre de plante dit-,
fere des autres cucurbitacees. QI. 636, b.
Coloquinte à fruit rond, defcription de fes différentes parties.
Deux où elle naît. Culture de cette plante dans nos
climats. IH. 636. A _.
C o l o q u i n t e , ( Mat. médic. ) nature de ce purgatif auiu
ancien que la médecine. III. 636. A Dans quelles circonltan-
ces, & pour quels effets on le recommande. On s en lert
dans tous les cas où il faut fe tirer d’un danger par un au ç.
C’eft à tort que quelques médecins ont voulu Pr° . * J
coloquinte; 3 y a bien des cas où
pourvu'qu’on la fàfle avec difeernement. n g I
| d é c o in & i„fUf,on f - f J S Î
Extrait de coloquinte en forme ne w , - .1 Temoéramens
qui fupportent. * femmes
COL C O M 349
femmes enceintes. Son ufage dans les maladies chroniques.
Son éloge & celui de la feammonée. lbid. 637. a. Différentes
correéfions de la coloquinte propofées par plufieurs auteurs.
Correftion en ulage dans les boutiques. Trochifques
alhandal. Analyfe de la coloquinte. Différentes dofesde coloquinte
qu’on doit donner félon la forme fous laquelle on
Î’aaminiftre ; dofe de l’extrait. lbid. b. Dofe de la coloquinte
en fubftance , des trochifques ou de la poudre : dofe
de la coloquinte en décoétion. Diverfes préparations dans
lefquelles c elle entre. Compofition de l’éleéfuaire de coloquinte
: manière d’employer ce puiffant hydragogue. lbid.
^CO LOR , {Iehthy.) poiffon des ifles Moluques. Sa def-
çription. Lieux qu’il fréquente. Sa clafiification. Suppl. II.
^1 C o l o r a t i o n , (Pharm.) dans quel but on colore en
pharmacie. Pourquoi l’on a fait entrer le cinnabre dans la
poudre tempérante de Sthal. Pourquoi l’on colore l’huile ou
l’onguent rofat. Comment fe fait la coloration des matières
feches 8c des matières liquides. III. 638. a.
COLORER Us vins: procédés par lefquels on remplit cet
objet. XVII. 295. a y A 297. A
COLORIS, {Peint. ) différence entre la couleur & le
coloris. La partie du coloris qui comprend auffi celle du
çlair-obfcur, eft une des plus .eflentieîles de la peinture.
Quoique le terme de colorié s’étende fur tous les objets, on
l’emploie plus généralement fur les carnations. Le coloris
¿toit connu & pratiqué avant Homere. Sa defcription du
bouclier d’Achiile. III. 638. A
Coloris, fi la peinture n’avoit qu’une couleur pour tous
les objets, elle feroit fans doute privée d’une partie confi-
dérable de fa beauté. C ’eft l’illufion qui produit le plus haut
degré d’énergie : or il n’y a point tTillufion où la vérité n’eft
pas parfaitement repréfentée, & par conféauent en fait d’objets
vifibles, la perfeâion du coloris eft un article très-
eiïentiel pour atteindre au grand but de l’art. Suppl. II. 311. a.
Mais en. quoi confifte cette perfection du coloris, & par
quelle voie, par quelle étude le peintre parvient-il à la poffé-
der? C’eft peut-être là le problème le plus difficile de
l’art. — Pour s’accoutumer à fentir la beauté du coloris,
c’eft à l’école de la nature que l’artifte doit -recourir. Il y
verra, fous toutes les formes poffibles, les plus parfaits modèles
dans tous les genres du beau. lbid. b. Et d’après des
obfervations fouvent répétées, il comprendra qu’une des
principales caufes des beautés du coloris, eft le ton gracieux
d’une lumière adoucie, foit qu’elle vienne immédiatement
du foleil , foit que réfléchie par un ciel ferein, elle répande
fur les ombres une douceur agréable & variée. - U apprendra
de plus qu’un objet paroît dans fa plus grande beauté,
lorfque la lumière incidente le divife en deux grandes maf-
fes bien proportionnées, l’une claire & l’autre obfcure. —
L’artifte pafiera enfuite de la contemplation de la nature à
celle de l’art. — lbid. 312. a. Et enfin il fe fervira de ce
double fecours pour apprendre l’art difficile de colorier. -
Il recherchera comment ce qu’on nomme l’effet eft produit
uniquement au moyen des jours & des ombres. Il obfervera
en général les modifications & la dégradation des couleurs
à mefure que l’oeil s’en éloigne davantage. — Comment l’ar-
tifie acquerra la connoifiance des caufes qui produifent l’harmonie
des couleurs,& celle de rafibibliiTement fucceflif des
couleurs propres de chaque objet, depuis le point le plus
éclairé jufqu’à l’ombre la plus forte. — Voyt{ l’article Demi-
teintes. Etude des reflets. lbid. b. — Celle des carnations.
— De la manipulation des couleurs. L’étude du coloris
exige tant d’obfervations & de travail, que c’eft ici où la
maxime d’Apelle, nulla dies fine lineâ, eft plus indifpenfable
que par-tout ailleurs, & où l’art eft le plus inépuifable. —
Divers carafteres par lefquels les grands peintres fe font
diftingués dans leur coloris. lbid. 313. a.
1f Coloris p examen de la queftion fi le mérite du coloris
lemporte fur celui du deflîn & de l’expreffion. V. 331.a.
i f i s ,“H. c°loris : écucil où tombent la plupart des artiftes à
1 égard du coloris : de l’art de favorifer l’effet de la couleur
par la dtlpofition des lumières. 406. A 407. a. Quelle eft
»inc des meilleures études de coloris qu’un éleve doive faire.
VI. 839. A Traité du coloris par le Blond. VII. 899. a.
Voyez C o u l e u r s & C a r n a t i o n .
C o l o r i s . {Jardin.) Maniéré de faire prendre aux fruits
des couleurs vives. III. 638. b.
CoLOHlsABilks-Un.) iu coloris du ftyle de l’épopée.
V 850. b. Brdlant colons. Su.pt. n. a. Propri/té du
Cr OLOSSnAL. Deis figureus ccooolorf,flsales da‘n«sI l-a peintui re. XII.
678. a, b. XIII. 154. A Statue coloffale. XV. 407. A Colonne
coloflale. IU. 632. «.
COLOSSE, {Archit.) étymologie du mot. Deux fortes
°“v.ra8es défignés par ce nom. fil. 639. a.
Coloffe de Rhodes. Dimenfions de cette ftatue. Occafion
qui donna lieu à fon élévation. Sa cbûte foixante-fix ans
H ome L
après par 1 effet d’un trémblemént de tèrrê. Quête qüe
firent les Rhodiens pour réparer le dommage que cet accident
leur avoit caufé. Combien elle fut avantageufe. III.
639. a. Vente qui fut faite du coloffe, l’an de J. C. 672 , à
un marchand Juif. Autres ftatues coloffales connues dans
l’itiftoire. lbid. A Voyer R h o d e s .
Coloffe, article très-étendu fur ce coloffe. XIV. 236. b. 6>c.
Autres obfervations fur le même fujet. 818. A Comment
ce colofie peut avoir été foit. II. 442. A Coloffe qu’on
voyoit près de Thebes, en Egypte. XV. 773. A
COLOSSIENS, ce nom donné aux Rhodiens par quel-!
ques auteurs. XIV. 238. a.
COLPORTEURS , ce qn’ilS étoient anciennement. Ce
que nous entendons aujourd’hui par ce nom. III. 639. A
C o l p o r t e u r s . {Jûrifp.) Ils font mis dans la clafie des
menu-feneftriers, 8c les uns 8c les autres étoient exempts de
certaines impofitidns. Défenfes qui les concernent en tems
de contagion. Piece de cuivre que portent à leur habit les
colporteurs de livres pour annoncer leur état. Défenfes qui
les concernent. III. 660. a.
COLSAT, ( Agric.) chou fauvage.... dont la graine fournit
de l’huile. ( Voye{ N a v e t t e . ) Quelle eft la meilleure
pour le moulin. Son prix le plus ordinaire. U en faut une
livre pour femer un cent de terre. Choix du terrein qu’on
veut .enfemencer. Comment on le prépare. Terre deitinée
à planter. Tems 8c maniéré de la préparer. Tems de femer.
8c de planter. Maniéré de tranfplanter. Autres obfervations
fur la culture du colfat; III. 660. b. Tems 8c maniéré de
foire la récolte. Le colfot repofe ordinairement jufqu’après
la moifion. Obfervations fur tout ce qui concerne l’opération
de battre. Quand tout eft battu, on nettoie par le moyen
d’un puroir. La graine purifiée eft portée dans des . focs au
grenier. Quel doit être le plancher au grenier. Cette graine
doit être promptement vendue. Ce qu’on -fait de la paille 8c
des tiges battues. lbid. 661. a. Produit que donnent en huile
vingt rafieres de graine. Ufage du marc d’huile. Tourteaux
qu’on foit avec ce marc. lbid. A
COLTIE, .( Archit. navale ) voyeç C o lT IS .
COLTIS, ( Archit. navale ) voyer C o l t i e . C’eft le premier
couple de l’avant du vaifleau. De la coupe 8c de fa pofition;
Suppl. II. 313. a.
. COLOMBO, {Jchthy. ) nom que les habitans d’Amboine
donnent à un poiffon décrit dans cet article. Lieux qu’il fréquente.
Qualité de fa chair. Sa clafiification. ’ Suppl. IL
I j f f j i
COLUMBARIA, {Hifi. anc.) trous pratiqués aux navires
pour y pafier les rames. Maufolées des familles de diftinétion.
III. 661. A
Columbaria, niches fépulcrales. XV. 74. a. XVII. 489. A
COLUMELLE , ( Marc ) foins qu’il prit en Eipagne pour
améliorer 8c augmenter les laines au pays. IX. 179. a , A
COLUMNA, ( Géogr. ) lieu ancien dans l’Orléanois. Suppl.
IV. 704. atb.
COLUMNA , ( Fabius ) obfervations fur fa méthode botanique.
Suppl. IV. 404. A
COLUPPA , ( Botan. ) plante du Malabar. Ses différentes
défignations. Sa defcription. Suppl. II. 313.'Sa culture. Qualités
qu’on lui remarque. Ufages que les Malabares en. tirent. Sa
clafiification. lbid. 314. a.
C o l u p p a , {Iehthy.) efpece de ce genre de poiffon nommé
coipa. Suppl. II. 499. a.
COLURE, {Géogr. 6» Afir.) defcription 8c ufages des cercles
de ce nom dans la fphere. lll. 661. A .
C o l u r e ou Coloure , ( Géogr. ) mines de diamans de Colure.
IV. 938. a , A
COLYBES, ( Hifi. eccl. ) offrande que font les Grecs.'
Comment elle fe compofe. Formule qu’ils ont pour la
bénédiction des colybes.. Origine de cette cérémonie. Les
Grecs donnent à cet ufage des interprétations myfiiques,
m. 662. a.
Colybes. Correction à foire dans. cet article de l’Encyclopé-,
die. Suppl. II. 314. a,
COL iTOS , fameux quartier d’Athenes. XI.960.a.
COM, particule prépofitive en françois. XII. 101. a.
COMA , ( Médec. ) les anciens ont fubdivifé cette maladi»
en coma yigil 8c coma fomnoUntum. Différens degrés de cette
même maladie. III. 662. a. Voye£ S o p o r e u s e & A s s o u p
i s s em e n t.
Coma. Différence entre le carus 8c le coma. II. 73 3. b. Fievre
comateufé. VI. 728. a. Coma vigil. XVI. 781. A
COMANE. Cinq villes anciennes de ce nom. Noms modernes
de quelques-unes. III. 662. A
COMATI, ( Botan. ) nom brame d’un arbre du Malabar.'
Ses autres noms. Defcription, culture , qualités 8c ufages de
cet arbre. Maniéré de le clafler. Suppl. II, 314. A
COMBADAXI, chef des bonzes philofophes du Japon. II.
329. A
COMBAT. Différence entre bataille 8c combat. Combat
naval, III, 662, A
îT T t t