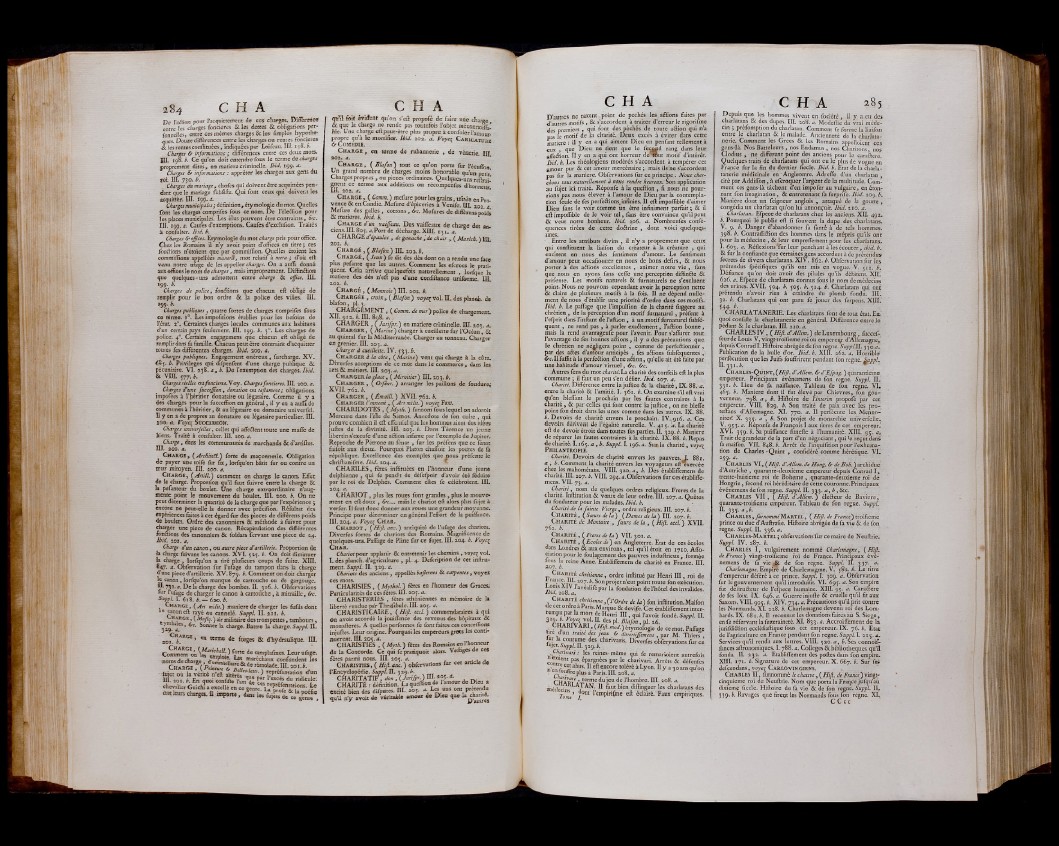
184 C H A
De faâion pour l'acquittement de ces charges; Différence
entre les charges foncières & les dettes & obligations per-
{onnelles, entre ces mêmes charges & les fimples hypothe*
eues. Douze différences entre les charges ou rentes foncières
à les rentes conftituées, indiquées pat JLoifean. III-198. b.
Charges & informations ; différences entre ces deux mots.
HI. 198. b. Ce qu’on doit entendre fous le terme de charges
proprement dites, en madère criminelle. Ibid. 199 .a.
Charges & informations : apprêter les charges aux gens du
toi. HL 750. b.
Charges du mariage, choies qui doivent être acquittées pendant
que le mariage fubfifle. Qui font ceux qui doivent les
acquitter. III. 199. a.
Charges municipales; défini don, étymologie du mot. Quelles
font les charges comprifes fous ce nom. De l’éleâion pour
les places municipales. Les élus peuvent être contraints, &c.
III. 190. a. Caufes d’exemptions. Caufes d’exclufion. Traités
a confulter. Ibid. b.
Charges & offices. Etymologie du mot charge pris pour office.
Chez les Romains il n’y avoir point d’offices en dtre ; ces
fondions n’etoient que par commiifion. Quelles étoient les
comntiffions appellées munera, mot relatif à mera ; d’où eft
venu notre nfage de les appeller charges. On a auffi donné
aux offices le nom de charges , mais improprement. DiftinHion
que quelques -iu» admettent entre charge & office. 1IL
199. b.
Charges de police, fondions que chacun eft obligé de
remplir pour le bon ordre & la police des villes. I1L
199. b.
Charges publiques, quatre fortes de charges comprifes fous
ce terme. i°. Les impofitions établies pour les befoins de
Pétat. t°. Certaines charges locales communes aux habitans
d’un certain pays feulement. III. 199. b. 30. Les charges de
police. 40. Certains engagemens que chacun eft obligé de
remplir dans fa famille. Chacun peut être contraint d’acquiuer
tomes fes différentes charges. Ibid. aoo. a.
Charges publiques. Engagement onéreux, furcharze. XV.
€.83. b. Privilèges qui difpenfent d’une charge publique &
pécuniaire. VI. 238. a , b. De l’exemption des charges.Ibid.
& VIIL g p b.
Charges réelles ou foncières. V oy. Charges foncières. III. aoo. a.
Charges d’une fucceffion, donation ou tejlament; obligations
impofées à l’héririer donataire ou légataire. Comme il y a
des chargés pour la fucceffion en général, il y en a aufli de
communes à l’héritier, & au légataire ou donataire univerfel.
Il y en a de propres au donataire ou légataire particulier. III.
aoo. a. Voyez SÜCCessiÔN.
. Charges univerfeües, celles qui affeâent toute une maffe de
biens. Traité à confulter. III. 200. a.
Charge, dans les communautés de marchands & d ’artiftes.
III. 200. a.
C h a rg e , ( Architetl.) forte de maçonnerie. Obligation
de payer une toile fur fut, lorfqu’on bâtit fur ou contre un
tniir mitoyen. III. 200. a.
C h a rg e , (Anill.) comment on charge le canon. Effet
de la charge. Proportion qu’il faut fuivre entre la charge 8c
la pefanteur du boulet. Une charge extraordinaire n’augmente
point le mouvement du boulet. HL 200. b. On ne
peut déterminer la quantité de la charge que par l’expérience ;
encore ne peut-elle la donner avec précifion. Réfultat des
expériences faites à cet égard fur des pièces de différens poids
de boulets. Ordre des canonniers & méthode à fuivre pour
niareer une piece de canon. Récapitulation des différentes
fonnions des canonniers & foldats fervant une piece de 24.
Ibid. 20Z. a.
Charge d’un canon , ou autre piece eTartillerie. Proportion de
la charge fuivant les canons. AVI. 525. b. On doit diminuer
la charge , lorfqu’on a tiré plufieurs coups de fuite. XIII.
847. a. Obfervation fur Image du tampon dans la charge
d'une piece d’artillerie. XV. 870. b. Comment on doit charger
le canon, lorfqu’on manque cie cartouche ou de gargouge.
■L 732. a. De la charge des bombes. II. 326. b. Obfcrvations
fur fufàge de charger le canon à cartouche, à mitraille, &c.
Suppl. I. 618. b. — 6ao. b.
C h a r g e , {An milit.) maniéré de charger les fofils dont
C?n°ne^ r*^ ou canne^- Suppl. II. 211. b.
(Mufiq.) air militaire des trompettes, tambours,
319 . ’ Som*'r g charge. Battre la charge. Suffi. H.
eoiC ” **°* I 8 dt forges & d’hydraulique. HL
C < 2 ^ V n \ ^ S lT P « ÿ a fm « . ieorufage.
C H A
qu’il foit évident qu’on s’eft propofé de faire une charge
8c que la charge ne rende pas toutefois l’objet méconnofflâ-
ble. Une charge eft peut-être plus propre à confoler l’amour-
propre qu’à le mortifier. Ibid. 202. a. Voyez C a r ic a t u r z
6* C o m e d ie .
C h a r g e , en terme de rubannerie , de vénerie. HT
202. a.
C h a r g e , ( Blafon ) tout ce qu’on porte for l’écuflon
Un grand nombre de charges moins honorable qu’un petit*
Charges propres , ou pièces ordinaires. Quelques-uns relirai
znent ce terme aux additions ou récompenfes d’honneur.
III. 202. a.
C h a r g e , ( Comm.'l mefure pour les grains, ufoée en Pro
vence & en Candie. Mefure d’épiceries a Vcnife. IIL 202 a
Mefure des galles , cottons, bc. Mefures de différens poids
& matières. Ibid. b.
C h a r g e d’un vaiffeau. Des vaiffeaux de charge des anciens.
III. 803. ¿.Port de décharge. XIII. 131. a.
CHARGE d’épaules , de ganache ÿdc chair ( Maréch. ) HL
202. h. 1
C h a r g é , ( Blafon') n i. 202.b.
C h a r g é , {Jeux) le dit des dés dont on a rendu une face
plus pelante que les autres. Comment les efcrocs le pratiquent.
Cela arrive quelquefois naturellement , lorfque la
matière des dés n’eft pas d’une confiftance uniforme. UJL
202. b.
C h a r g é , (Monnoie) III. 202. b.
C h a r g é e , croix, ( Blafon) voyt[ vol. IL des planch. de
blafon, pl. 3.
CHARGEMENT, ( Comm. de mer ) police de chargement.
XII. 912. b. IIL 898. a. ,
CHARGER, { Jurifpr. ) en matière criminelle. III. 203. a.
C h a r g e r , ( Marine) charger à cueillette fur l’Océan, &
au quintal fur la Méditerranée. Charger au tonneau. Charger
en grenier. III. 203. a.
Charger à cueillette. IV. 533. b.
C h a r g e r à la côte, (Marine) vent qui charge à la côre.
Diverfes acceptions de ce mot dans le commerce , dan< les
arts & métiers. IIL 203. a.
C h a r g e r la glace, { Miroitier | IIL 203. b.
C h a r g e r , { Orfévr. ) arranger les paillons de foudure,'
XVII. 762. b.
C h a r g e r , ( Émaill. ) XVIL 762. b.
CHARGER l’ennemi - ( Art milit. ) voyej Feu.
CHARIDOTES , ( Myth. ) fur nom fous lequel on adoroit
Mercure dans llfle de Samos. Anecdote de Ion culte , qui
prouve combien il eft effentiel que les hommes aient des idées
juftes de la divinité. III. 203. b. Dans Térence un jeune
libertin s’exeufe d’une aâion infame par l’exemple de Jupiter.
Reproche de Pétrone au fénat , fur les préfens que ce fénac
failpit aux dieux. Pourquoi Platon chaffoit les poëtes de (à
république. Excellence des exemples que nous préfente le
cbriftianifme. Ibid. 204. a.
CHAKILES, fêtes inftituées en l’honneur d’une jeune
delphienne , qui fe pcnd’t de défefpoir d’avoir été féduite
par le roi de Delphes. Comment elles fe célébraient. HL
204. a.
CHARIOT, plus les roues font grandes, plus le mouvement
en eft doux , bc.... mais le chariot eft alors plus fujet à
verfer. Il faut donc donner aux roues une grandeur moyenne.
Principe pour déterminer en général l’effort de la puiflânee.
III. 204. a. Voye{ C h a r .
C h a r io t , ( Hiß. anc. ) antiquité de l’ufage des chariots.
Diverfes fortes' de chariots des Romains. Magnificence de
quelques-uns. Paflàge de Pline fur ce fujet. III. 204. b. Voycç
C h a r .
Chariot pour applanir 8c entretenir les chemins , voycç vol.
I. des planch. d’agriculture , pl. 4. Deicription de cet infiniment.
Suppl. II. 329. a.
Chariots des anciens , appelles baflemes & caipentts, voyez
ces mots.
CHARISIES, ( Mythol.) fêtes en l’honneur des Grâces.'
Particularités de ces fêtes. Ifl. 20y a.
CHARISTERIES , fêtes athéniennes en mémoire de la
liberté rendue pa'r Thrafibule. IIL 205. a.
CHARISTICAIRE, ( Hiß. eccl. ) commendataires à qui
On avoir accordé la jouiuance des revenus des hôpitaux &
monafteres. A quelles perfonnes fe font faites ces concertions
in juftes. Leur origine. Pourquoi les empereurs grecs les continuèrent.
HI. 205. a.
CHARISTIES , {Myth.) fêtes des Romains en l’honneur
de la Concorde. Ce qui fepratiquoit alors. Vertiges de ces
fêtes parmi nous. III. 20e. a. . . .
C h a r is t i e s , ( Hiß. anc. ) obfbrvarions for cet article de
■l’Encyclopédie. Suppl.II. 329.é. jjr
CHARITATIF, don , ( jurifpr.) HL 205. a.
CHARIT^ : définition. La queftionde 1 amour de Dieu a
excité bien des difputes. III. 205. Les uns ont prétendu
qu’il n’y ayoh de VfataMe « nw . de D.eu
C H A C H A
D’autres ne taxent. point de pcchcs les allions faites par
d’autres motifs, & s’accordent à traiter d’erreur le rigoriime
des premiers , qui font des péchés de toute aélion qui n’a
pas le motif de la charité. Deux excès à éviter dans cette
matière : il y en a qui aiment Dieu en penfant tellement à
eux , que Dieu ne tient que le fecmid rang dans leur
affeélion. Il y en a qui ont horreur de*rout motif d’intérêt.
Ibid. b. Les théologiens modérés s’accordent à tempérer cet
amour pur & cet amour mercénaire ; mais ils ne s’accordent
pas fur la maniéré. Obfcrvations for ce principe. Nous cherchons
tous naturellement à nous rendre heureux. Son application
au fujet ici traité. Réponfe à la queftion , fi nous ne pourrions
pas nous élever à l’amour de Dieu par la contemplation
feule de fes perfeélionst infinies. Il eft impofiible d’aimer
Dien fans le vojr comme un être infiniment parfait ; & il
eft impofiible de le voir tel, fans être convaincu qu’il peut
& veut notre bonheur. Ibid. 206. a. Nombreufes confé-
quences tirées de cette doétrinc , dont voici quelque
unes.
- Entre les attributs divins , i l n’y a proprement que ceux
qui condiment la liaifon du créateur à la créature , qui
excitent en nous des fentimens d’amour. Le fentiment
d’amour peut occafionner en nous de bons defirs, 8c nous
porter à des allions excellentes , animer notre vie , fans
que nous en ayons fans -ceffe une perception diftinâe &
préfente. Les motifs naturels & furnaturels ne s’excluent
point. Nous ne pouvons cependant avoir la perception nette
& claire de plufieurs motifs à la fois. Il ne dépend nullement
de nous d’établir une priorité d’ordre dans ces motifs.
Ibid. b. Le partage que l’impulfion de la charité fuggere au.
chrétien , de la perception d’un motif furnaturel, préfent à
l’efprit dans l’inftant de l’aéiion , à un motif furnaturel fubféquent
, ne rend pas , à parler exaélement, l’allion bonne,
mais la rend avantageufe pour l’avenir. Pour s’affurer tout
l’avantage de fes bonnes allions, il y a des précautions que.
le chrétien ne nédigera point, comme de perfellionner,
par des ailes d’amour anticipés , fes allions fubféquentes,
bc. Il fuffit à la perfcllion d’une altion , qu’elle ait été faite par
une habitude d’amour virtuel, bc. bc.
Autres fens du mot charité, lia charité des confeils eft la plus
commune ; il faut un peu s’en défier. Ibid. 207. a.
Charité. Différence entre la juftice & la charité, IX. 88. a.
entre la charité & l’amitié. I. 361. b. On examine s’il eft vrai
qu’en bleffant le prochain par les fautes contraires à la
charité , & par celles qui font contré la juftice, on ne bleffe
point fon droit dans les unes comme dans les autres. IX. 88.
b. Devoirs de charité envers le prochain. IV. 916. a. Ces
devoirs dérivent de l’égalité naturelle. V. 413. a. La charité
eft de devoir étroit dans toutes fes parties. H. 3,29. b. Maniéré
de réparer les fautes contraires à la charité. IX. 88. b. Repas
de charités L 163. a , b. Suppl. 1. 196. a. Sur la charité, voyez
P h il a n t r o p ie .
Charité. Devoirs de charité envers les pauvres. J .
a , b. Comment la charité envers les voyageurs eftoxercée
chez les mahométahs. Vin. 320.0, b. Des établiffemens de
charité. III. 207. b. VIII. 294. a. Observations fur ces établiffe-
mens. VII. 73. a.
Charité, nom de quelques ordres religieux. Freres de la
charité. Inftimtion & voeux de leur ordre. III. 207. a. Quêtes
du fondateur pour les malades. Ibid. b.
Depuis que les hommes vivent en fociété , il y a.eu des
charlatans & des dupes. III. 208. ¿. Modcftie du vrai médecin
; préfomption du charlatan. Comment fe forme la liaifon
entre le charlatan & le malade. Ancienneté de la charlata-
nerie. Comment les Grecs 8c les Romains appelloient ces
gens-là. Nos Batteleùrs , nos Endamus, nos Chantons, nos
Clodius , ne different point des anciens pour le carallerc.
Quelques traits de charlatans qui ont eu le plus de vogue en
France fur la fin du dernier uecle. Ibid. b. Etat de la charla-
tanerie médicinale en 'Angleterre. Adreffe d’un charlatan ,
cité par Addiffon, à eferoquer l’argent de la multitude. Comment
ces gens-là tâchent d’en impofor au vulgaire, en étonnant
fon imagination, 8c entretenant fa forprue. Ibid. 209. b.
Maniéré dont un feigneur anglois , attaqué de la goutte,
congédia un charlatan qu’on lui annonçoit. Ibid. 210. a.
. Charlatan. Efpece de charlatans chez lés anciens. XII. 492.
b. Pourquoi lè public eft fi fou vent la dupe des charlatans.
V. 9. b. Danger d’abandonner fa fanté à de tels hommes.
398. b. Contradillion des hommes dans le mépris qu’ils ont
pour la médecine , 8c leur empreffement pour les charlatans.
I. 603. a. Réflexions *fur leur penchant à les écouter, ibid. b.
& fur la confiance que certaines gens accordent à de prétendu»
fecrets de divers charlatans. XIV. 862. b. Obfervation fur les
prétendus fpéciflques qu’ils ont mis en vogue. V. 311. b.
Défiance qu’on doit avoir des pilules qu’ils débitent. XIL
626. a. Efpece de charlatans connus fous le nom de médecins
des urines. XVII. 304. b. 303. b. 314. b. Charlatans qui ont
prétendu n’avoir rien à craindre du plomb fondu. III.
32. b. Charlatans qui ont paru fe jouer des ferpens. XIII.
U 4- b•
GHARLATANERIE. Les charlatans font de tout état.Ea
quoi confifte la charlatancrie en général. Différence entre le
pédant & le charlatan. IH. 210. a.
CHARLES I V , ( Hiß. d’Allem. ) de Luxembourg, fuccef-
feurde Louis V, vihèt-troifleme roi ou empereiy d’Allemagne,
depuis Conrad I. Hiuoiré abrégée de fon reene. Supplll. 3 30.*.
Publication de la bulle d’or. Ibid. b. XIU. 262. a, Horrible
Berfécution que les Juifs fouffrirent pendant fon régné. ¿uppL
1. 331. b.
C h a r l e s -Q u in t , {Hiß. d’Allem. & d’Efpag. ) quarantième
empereur. Principaux événeinens de fon regne. Suppl. II.
331. b. Lieu de fa naiffahee. Tableau de fon regne. VI.
403. b. Maniéré dont il fut élevé par Chievres, fon gouverneur.
798. a, b. Hiftoirc de l’intérim propofé par cet
empereur. VIII. 829. b. Son traité de paix avec les pro-
teflans d’Allemagne. XI. 770. a. Il perfécute les Mcnno-
nites! X. 333. a , b. Son projet de monarchie univerfelle..
V. 033. a. Réponfe de François I aux titres de cet empereuri
XVI. 3 39- b. Sa puiffance funefte à l’humanité. Xni. ,93. a.
Trait-de grandeur de la part d’un négociant, qui Je reçut dans
fa maifon. VII. 848. b. Arrêt de l’inquifition pour l’exhumation
de Charles-Quint , confidéré comme hérétique. VI.
239. a.
C h a r l e s VI, {Hiß. d’Allem, de Hong. & de Boh.) archiduc
d’Autriche , quarante-deuxieme empereur depuis Conrad I ,
trente-huitieme roi de Boheme , quarante-deuxieme roi de
Hongrie, fécond roi héréditaire de cette couronne. Principaux
événemens defon regne. Suppl. II. 333. a, b, & c.
C h a r l e s VII , ( Hiß. d’Allem. ) élelleur de Bavière,
Îuarante-troifieme empereur. Tableau de fon regne. Suppl.
1.335. a , j . „ , ,
C h a r l e s , fumomméM a r t e l , ( Hiß. de France) troifieme
prince ou duc d’Auftrafie. Hiftoirc abrégée de fa vie & de fon
regne. Suppl. II. 33 6. a.
C h a r l e s -Ma r t e l ; obfervuions fur ce maire de Neuftrie.
Suppl. IV. 287. b.
C h a r l e s I , vulgairement nommé Charlemagne, ( Hiß.
de France) vingt-troificme roi de France. Principaux événemens
ae fa vie$ c de fon regne. Suppl. II. 337. a.
Charlemagne. Empire de Charlemagme. V. 382. b. Le titré
d’empereur déféré à ce prince. Suppl. 1.' 309. à. Obfervation
fur le gouvernement qu’il introduiut. VI. 693. a. Son empire
fut deilruéleur de l’cfpece humaine. XIH. 93. a. Carallere
de fes loix. IX. 646. a. Guerre injufte & cruelle qu’il fit aux
Saxons. VIII. 903. b. XIV. 734. a. Précautions qu’il prit contre
les Normands. Ai. 228. b. Charlemagne devenu roi des Lombards.
IX. 681 .b. Il reconnut les donations faites aü S. Siege,
en fe réfervant la fuzeraincté. XL 833. a. AccroifTcment de la
jurifdiâion eccléfiaftique fous cet empereur.- IX. 76. b. Etat
de l’agriculture en France pendant fon regne. Suppl.1. 213. a.
Services-qu’il rendit aux lettres. VIII. 320. a , b. Ses connoiir
fances aftronomiques. 1. 788. a. Colleges & bibliothèques qu’il
fonda. II. 232. a. Etabliflement des portes dans fon empire.
XIII. 171. b. Signature de cet empereur. X. 667. b. Sur fes
defçendans , voyez C a r l o v in g ie n s .
C h a r l e s I I , fumommé le chauve, ( Hiß. de France) vingt-
cinquieme roi de Neuftrie. Nom que porta la Fraqcc jufqu’au
dixième ficcle. Hiftoire de fa vie & de fon regne. Suppl. 11.
339. b. Ravages que firent les Normands fous ion régne. XI.
C C c c