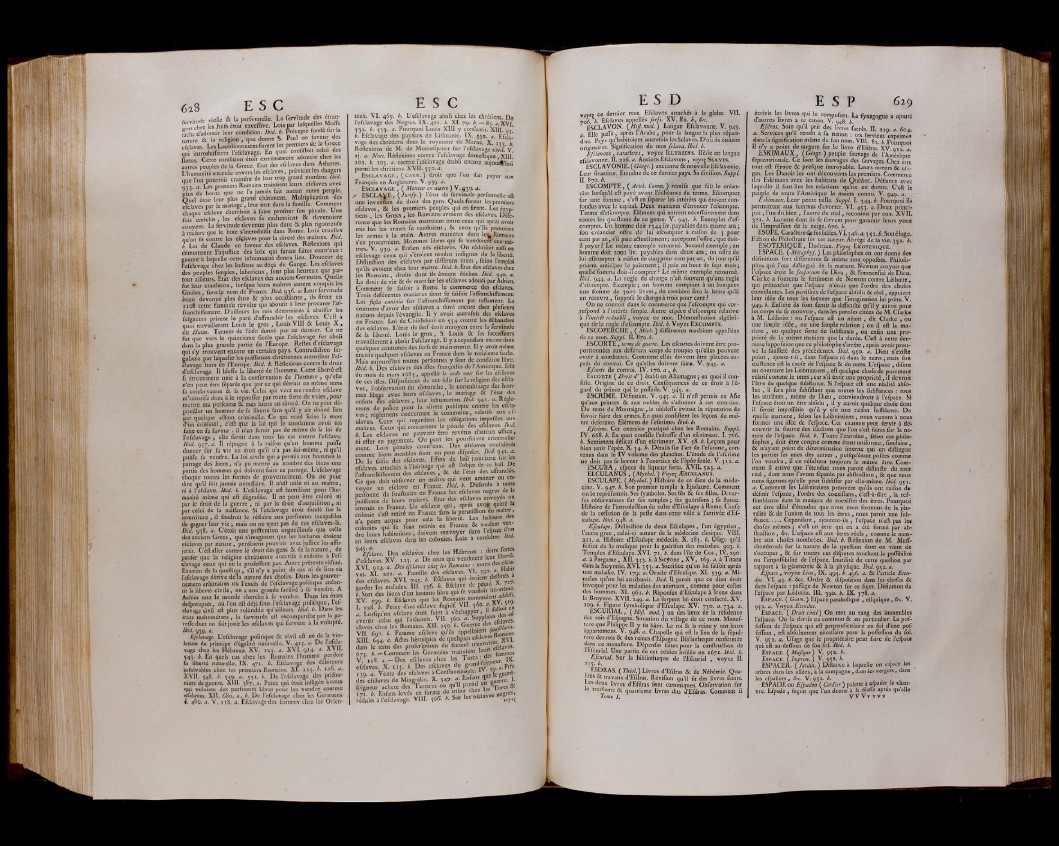
6a8 E S C E S C
firvittitlC réelle & S pcrfonndle. La fervitude des érran-
oers dira les Juifs étoit exceflivc. Loi* par lcfquelles MoïTe
ficha d'adoucir leur coudilion. IHd k- Précepte fondé fur la
nature & la religion, que donne S. Paul en jàveur des
cfdaves. Les Lacédémomens furent les premiers de la Grèce
qui imroduifircnt l'efclayage. En quoi confdloit celui des
fiotes. Cette condition étoit extrêmement adoucie chez les
autres peuples de la Grece. Etat des efeiaves dans Athènes.
L'humanité exercée envers les efeiaves, prévient les dangers
que l'on pourrait craindre de leur trop grand nombre. Ihd
otc a t e s premie rs Roma ins trairaient leurs efdaves avec
¿fus' de bonté que ne l'a jamais fait aucun autre peuple,
Duel étoit leur plus grantf châtiment. Multiplication des
efclavcs par le mariage, leur état dans la famille. Comment
chaque 'efclave chcrchoit à faire profiter ion pécule. Une
fois enrichis, les efclavcs fc rachetoicnt & devenoient
citoyens. La fervitude devenue plus dure & plus rigoureufe
à mcfurc que le luxe s’introdumt dans Rome. Loix cruelles
qu’on fit contre les efdaves pour la sûreté des maîtres. Ibid.
b. Loi de Claude en faveur des efclavcs. Réflexions qui
démontrent l’injuftice des loix qui furent faites contr eux :
guerre*à laquelle cette inhumanité donna lieu. Douceur de
Fefclavage chez les Indiens au déçà du Gange. Les efeiaves
des peuples fimplcs, laborieux, font plus heureux que partout
ailleurs. Etat des efclavcs des anciens Germains. Quelle
fut leur condition, lorfque leurs maîtres curent conquis les
Gaules, fous le nom de Francs. Ibid. 936. a. Leur fervitude
étant devenue plus dure & plus accablante, ils firent en
1108 cette fameufe révolte qui aboutit à leur procurer laf-
ftanchiflement. D’ailleurs les rois déterminés à abaiffer les
feigneurs prirent le parti d’affranchir les efclavcs. Ccft a
quoi travaillèrent Louis le gros , Louis VIII 6c Louis X ,
dit Hutin. Termes de l’édit donné par ce dernier. Ce ne
fut que vers le quinzième ficcle que l’efclavage fut aboli
dans la plus grande partie de l’Europe. Reftcs d’cfclavage
qui s’y trouvent encore en certains pays. Contradiction fin-
gulierc par laquelle les puiffances chrétiennes autorifent l’ef-
clavagc hors de l’Europe. Ibid. b. Réflexions contre le droit
d’cfclavagc. U bleffe la liberté de l’homme. Cette liberté cft
fi étroitement unie à la confervation de l’homme , qu'elle
n’en peut être féparée que" par ce qui détruit en même tems
fa confervation 6c fit vie. Celui qui veut me rendre efclave
m’autorife donc à le repouffer par toute forte de voies, pour
mettre ma perfonne 8c mes biens en sûreté. On ne peut dépouiller
un homme de fa liberté fans qu’il y ait donné lieu
par quelque a&ion criminelle. Ce qui rend licite la mort
d’un criminel, c’cft que la loi qui le condamne avoit été
faite en fa faveur : il n’en feroit pas de même de la loi de
l’cfclavagc ; elle feroit dans tous les cas contre l’efclavc.
Ibid. 937. a. Il répugne à la raifon qu’un homme puiffe
donner fur fa vie un droit qu’il n’a pas lui-même, ni qu’il
puiffe fe vendre. La loi civile qui,a permis aux hommes le
partage des biens, n’a pu mettre au nombre des biens une
partie des hommes qui doivent faire ce partage. L’efçlavagc
choque toutes les formes de gouvernement. On rie peut
dire qu’il foit jamais néceffairc. Il n’efi utile ni au maître,
ni à l’cfclave. Ibid. b. L’efclavage eft humiliant pour l’humanité
même qui cil dégradée. Il ne peut être coloré ni
par le droit de la guerre , ni par le droit d’acquifition, ni
par celui de la naiffance. Si l’cfclavage étoit fondé fur la
nourriture , il faudrait le réduire aux perfonnes incapables
de gagner leur vie ; mais on ne yeut pas de ces cfclaves-là.
Ibid. 938. a. C’étoit une prétention orgucillcufe que celle
des anciens Grecs, qui s’imaginant que les barbares étoient
efeiaves par nature, penfoient pouvoir avec juflicc les affu-
jettir. C’cft aller contre lé droit des gens 8c de la nature, &jè
penfer que la religion chrétienne autorife à réduire à l’ef-
qlavagc ceux qui ne la profeffent pas. Autre prétexte réfuté.
Examen de la queftion, s’il n’y a point de cas ni de lieu ou
l’efclavage dérive delà nature des chofcs. Dans les gouver-
nemens arbitraires où l’excès de l’efclayagc politique anéantit
la liberté civile, on a une grande facilité à fc vendre. A
Acliiin tout le monde cherche à fc vendre. Dans les états
defpotiques, où l’on cft déjà fous l’efclavagç politique, 1 cf-
clavagc civil cft plus tolérable qu’ailleurs. Ibid. b. Dans les
états mahométans , la fervitude cft récompcnfée par la pa-
reffe dont on fait jouir les efclavcs qui fervent à la volupté.
Ibid, 939, a. . . » • '
Efclavage. L’cfclavage politique 8c civil cft né de la violation
du principe d’égalité naturelle. V. 413. a. De Ycfch-
vage chez les Hébreux. XV. 123. a. XVI. 914« a- 3vV*L
943. b. En quels cas chez les Romains l’homme pcrdoit
m liberté naturelle. IX. 471. b. Efolavaee des débiteurs
itifolvables chez les premiers Romains. XL 12,5* b, 120. a.
XVII. 548. b. 349. a. 35 t. b. De l’cfclavagc des prifon-
niers de guerre. XIII. 387. a. Peine qui étoit infligée à ceux
qui voloicnt des perfonneq libres pour les vendre comme
efeiaves. XII. ¿80. a, b. De l'cfclavagc chez les Germains
f. 480. a. V. it8. a. Efclayage des femmes* chez les* Orientaux.
VI. 469. b. L’efclavage aboli chez les chrétiens. De
l’efclavage des Negres. IX. 471. b. XI. 79. b. — 83. «.XVL
<32. b. 533'. a. Pourquoi Louis XIII y confentit. XIII. 03.
b. Efclavage des payions de Lithuanie. IX. 592. a. Efcla-
vage des chrétiens dans le royaume de Maroc. X. 133. b.
Réflexions de M. de Monteiquicu fur l’cfclavage civil. V.
xj. a. Note. Réflexions contre l’cfclavagc domeftique, X1IL
102. b. 102. a. contre l’efclavage établi encore aujouit’huî
parmi les chrétiens. XVII. 5 50. a.
E s c l a v a g e , ( Comm. ) droit que l’on fait payer aux
François en Angleterre. V. 939. a.
E s c l a v a g e , (Metteur en auvre) V.fl.39. a.
v ESCLAVE, ( Jurifp. ) l’état de fervitude perfonnellc cft
une inveritton du droit des gens. Quels furent les premiers
efeiaves, 8c les premiers peuples qui en firent. Les éeyp.
tiens , les Grecs, les Romains avoient des efclavcs. Différence
que les Romains mettoient entre ceux qui après avoir
mis bas les armes fc rendoient, & ceux qu’ils prennent
les armes à la main. Autres manières dont lc^Romains
s’en procuroient. Hommes libres qui fe vendoient eux-mêmes.
V. 939. a. Enfans nés efclavcs. On réduifoit auiïi en
■efclavage ceux qui s’étoient rendus indignes de la liberté.
Diftinéfion des efeiaves par différens titres , félon l’emploi
qu’ils avoient chez leur maître. Ibid. b. Etat des efclavcs chez
les Romains, droits dont ils étoient déchus. Ibid. 940. a.
Le droit de vie 8c de mort fur les efdaves adouci par Adrien.
Comment fe faifoit à Rome le commerce des efeiaves.
Trois différentes maniérés dont fe faifoit l’affranchiffemcnt.
Loi fitfia caninia fur l’affranchiffement par teftament. La
coutume d’avoir des efclavcs a duré encore chez pluficurs
nations depuis l’évangile. Il y avoit autrefois des efclavcs
en France. Loi de Childebert en 554 contre les débauches
des efdaves. L’état de ferf étoit mitoyen entre la fervitude
8c la liberté. Louis le gros, S. Louis 8c fes fucceffeurs
travaillèrent à abolir l’cfclavagc. Il y a cependant encore dans
quelques coutumes des ferfs de main-morte. Il y avoit même
encore quelques cfdaves en France dans le treizième fiecle.
Mais aujourd’hui toutes perfonnes y font de condition libre.
Ibid. b. Des efdaves des ifles françoifes de l’Amérique. Edit
du mois de mars 1685, appellé le code noir fur les cfdaves
de ces ifles. Difpofuions de cet- édit fur la religion des efeiaves
l’obfervation du dimanche, le concubinage des hommes
libres avec leurs efdaves, le mariage 8c l’état des
enfans des cfdaves , leur inhumation. Ibid. 941. a. Kêgle-
mens de police pour la sûreté publique contre les efeiaves;
réelemens concernant le commerce, relatifs aux efdaves.
Ceux qui regardent les obligations impofées aux
maîtres. Ceux qui concernent le pécule des cfdaves. Ibid.
b. Les efdaves ne peuvenr être revêtus daucun office,
ni dira en jugement. On çeut les poiirfu.vre U
ment. Loix pénales contr eux. Ocs efclavM cmiMé'és .
comme biens meubles dont on peut difpofer.
De la faific des efclavcs. Effets du bail judiciaire fur les
efeiaves attachés à l’héritage qui cft l'objet de
l’affrancbiftemcnt des efclavcs , & de létat des affranchi
Ce que doit obferver un maître qm veut amener ou en
vover un efclave en France. Ibid. b. Défendu à toute
perfonne de fouftraire en France les efclavcs negres de la
f c de leurs maîtres Etat des cfc avcs c^voy oc
amenés en France. Un efclave qui, après avo* quuté la
colonie s’eft retiré en Franc,a fans 1i permiflion du maître,
n’a point acquis pour cela la liberté- Les habnan
colonies qui fe (but «étirés en
dre leurs habitations, doivent renvoyer dans l ; f g H
an leurs efclavcs dans les colontes. Loix à confulter.
liMiÙm ! Des cfdaves chez les Hébreux :
d’efelavcs. XV. S I e. De ceux qui vendotent leur Itbe^
XVI. 9 14 ... Des efeiaves c k l les Romanis : noms de ^
ves. XL 101. a. Famille des efeiaves. VI. 391.
des efdaves. XVI. 745. | Efdaves qu. ératem de
garder les malades. 111. 336. b. Efclave de pe ne. X
b. Sort des biens d’un homme libre qui fc voml<“ ' guM. '
XV. Ç99. b. EfcUvcs que les Romainsnommoicuta
L . M Peine «l'un efclave fugitif VU.
a. Lorfqu'un cfdave étoit futçt h s'échapper. 1U»»
avertir celui qui l’achetoit. VIL 360. <1. Supphc cfc|jvc)
daves chez les Romains. XII. « n b. Guetrw 0' c//arfa.
VII. 697. ! Femme cfdave qu ils dppclioient
XIII. 694. es. Ailes héroïques de quelques efttov» XVI.
dans le tems des proferiptions du fécond trium ci-claVCÎ,
6 7 5 . />. — Comment les Germains trajtoient femmes
V. 118. a. — Des efdaves chez les Turcs
efdaves. X. f e b. Des efeiaves du V fV ^ r .ç .. a. Prix
139. a. Vente des efdaves ¡1 Conftantmoplc. y • w a.
des cfdaves de Mingrélie. X. 347- «■ Enfan <1 rrc, I.
fcigneur acheté des T'artarcs ou O T jH W . , 6T „ rcs Sf
171. b. Enfans levés en forme de tribut chez rc5,
réduits â l'cfclavagc. VIII. 3<S«- l Slir Ici V î
E S D E S P 629
*over Ce dernier mot. Efeiaves attachés à la glebe. VII.
706. b. Efeiaves appellés ferfs. XV. 82. b, &c.
ESCLAVON. ( Hijl. mod. ) Langue Efclavonne. V. 943.
a. Elle paffe, après l’Arabe, pour la langue la plus répandue.
Pays qu’habitoient autrefois lcsSclavcs. D ’ou ils étoient
originaires. Signification du mot fclava. Ibid. b.
Efclavons, carafleres, voyez I l l y r i e n s . Bible en langue
efclavonne. II. 226. a. Anciens Efclavons, voyer S l a v e s .
ESCLAVONIE. ( Giogr. ) ancienne &'nouvclleEfclavonie.
Leur fituation. Etendue de ce dernier pays. Sa divifion. Suppl.
II. 870. b.
ESCOMPTE, ( Arith. Comm, ) remife que fait le créancier
lorfqu’il eft payé avant l’échéance du terme. Efcomptcr
fur une fomme, c’cft en féparer les intérêts qui étoient confondus
avec le capital. Deux maniérés d’énoncer i’efeompte.
Terme d’efeompre. Elémens qui entrent néceffairement dans
toutes les queftions de ce genre. V. 942. b. Exemples d’ef-
comptes. Un homme doit 1344 Üv. payables dans quatre ans ;
fon créancier offre de lut efcomptcr à raifon de 3 pour
cent par an, s’il paie aéhicllcment; acceptant l’offre, que doit-
il payer % Le même exemple retourné. Second exemple ; un
homme doit 2000 liv. payables dans deux ans ; on offre de
lui efcomptcr à raifon de cinq pour cent par, an, du jour qu’il
pourra anticiper le paiement; il paie au bout de fept mois;
Îuëllë fomme doit-il compter ? Le même exemple retourné.
bid. 944. a. La règle de change n’eft fouvent qu’une réglé
d’efeompte. Exemple ; un homme comptant à un banquier
une fomme de 3000 livres, de combien fera la lettre qu’il
en recevra, fuppofé le change à trois pour cent?
On ne connoît dans le commerce que l’efcompre qui cor-
,refpond à l’intérêt fimple. Autre efpece d’efeompte relative
à l'intérêt redoublé, voyez ce mor. Démonftration algébrique
de la réglé d’efeompte. Ibid. b. "Voyez E x c o m p t e .
ESCOPERCHE, ( Mcch. ) différentes machines appcllées
de ce nom. Suppl. II. 870. b.
ESCORTE, terme de guerre. Les efeortes doivent être proportionnées
aux différens corps de troupes qu’elles peuvent
avoir à combattre. Comment elles doivent être placées auprès
du convoi. Ce qu’elles doivent faire. V. 945. a.
Efcorte de convoi. IV. 170. a , b.
E s c o r t e ( Droit d’ ) établi en Allemagne ; en quoi il con-
fille. Origine de ce droit. Cenféquences de ce droit à l’égard
du prince qui le poffede. V. 945. a.
ESCRIME. Définition. V. 945. a. Il n’eft permis en Afie
Îu’aux princes 8c aux nobles de s’adonner a cet exercice.
>u tems de Montaigne , la nobleffe évitoit la réputation de
favoir faire des armes. En quoi confiftent les leçons du maître
defcrlme. Elémens de l’cfcrimc. Ibid. b.
Efcrime. Cet exercice pratiqué chez les Romains. Suppl.
IV. 668. b. En quoi confifte l’adrcffc d’un eferimeur. I. 766.
b. Sentiment délicat d’un eferimeur. XV. 58. b. Leçons pour
bien tenir l’épée. X. 34. b. Détails fur l’art de l’eferime, contenus
dans le IV volume des planches. L’étude de l’cfcrime
ne doit pas fe borner à l’exercice de 1 épée feule. V. 3 z 2. a.
ESC UBA , cfoece de liqueur forte. aVII. 523. a.
ELCULANUb , (Mythol:) Voye[ Æsculanus.
ESCULAPE. (Mythol. ) Hiftoire de ce dieu de la médecine.
V. 947. b. Son premier temple à Epidaure. Comment
on le repréientoit. Scs fymboles. Scs fils oc fes filles. Diver-
fes obfervations fur fes temples ; fes guérifons ; fa ftatue.
Hiftoire de l’introduélion du culte d’Efculape à Rome. Caufc
de la ceffation de la pefte dans cette ville à l’arrivée d’Ef-
culapc. Ibid. 948. a.
Efculape. Diftinâion de deux Efculapes, l’un égyptien,
. l’autre grec, celui-ci auteur de la médecine clinique. VIII.
211. a. Hiftoire d’Efculape médecin. X. 283. b. Ufagc qu’il
faifoit de la mufique pour la guérifon des maladies. 903. b.
Temples d’Efculapc. XVI. 71. b. dans l’île de Cos , IV. 290.
a. à Pergamc, XII. 353. b.k Sicyone, X V, 169. a. à Titana
dans laSicyonie. XVI. 355. a. Sacrifice qu’on lui faifoit après
une maladie. IV. 170. «.Oracle d’Efculape. XI. 539. a. Miracles
au’on lui attribuoit. Ibid. Il paroît que ce dieu étoit
invoqué pour les maladies des animaux, comme pour celles
des hommes. XI. 961. b. Réponfes d’Efculapc à Irene dans
la Bruyère. XVII. 249. a. Le ferpent lui étoit confacré. XV.
109v F ig u r e fymbolique d’Efculape. XV. 730. a. 734. a.
ESCURIAL, ( Hijl. mod. ) un des lieux de la réfidence
des rois d’Efpagnc. Situation du village de ce nom. Monaf-
tere que Philippe II y fit bâtir. Le roi 8c la reine y ont leurs
appartenions. V. 948. «. Chapelle qui cft le lieu de la fépul-
iiirc des rois 8c des reines d’Efpagne. Bibliothèque renfermée
i*rvS c? n1003^ 1,6, Dépcnfos faites pour la conftru&ion de
1 Efcurial. Une partie de cet édifice brûlée en 1671. Ibid. b.
Efcurial. Sur la bibliothèque de l’Efcurial , voyez II.
a3i* b. J
ESDRAS. ( Théol.) Livres d’Efdras 8c de Néhémie. Qualités
oc travaux d’Efdras. Révifion qu’il fit des livres faints.
Les deux livres d’Efdras font canoniques. Obfcrvation fur
le troifiemc 8c quatrième livres dits d’Efdras. Comment il
Tome /, . • ■
écrivit les livres qui le comp„fent. La fyoagogué a ajouté
dautres livres à ce canon. V. 048 y
Efdms. Soin qu'il prit des livre's facrês. IL « 9 , 1 604.
a. Sèmera qu il rendit à la nation t ces fervices exprimés
dans 1a lignification même de fon nom. VIII. 8a. 4 Pourquoi
il n’y a point de taraum fur le livre d’Efdras. XV 91a a
ESKIMAUX , (Giogr. Vpeuple fauvage de l’Amérique'
fcptcntrionale. Ce font lés fauvages des iauvages. Chez eux
tout eft féroce 8c prefqtie incroyable. Leurs moeurs 8c ufa-
cs. Les Danois les ont découverts les premiers. Commerce
es Eskimaux avec les habitans de Québec. Défiance avec
laquelle il faut lire les relations quV>n en donne. C’eft le
peuple de toute l’Amérique le moins connu. V. 949. a.
Eskimaux. Leur petite taille. Suppl. I. 344. b. Pourquoi ils
permettent aux femmes d’avorter. VI. 453. a. Deux principes
, l’un du bien, l’autre du mal, reconnus par eux. XVII.
371. b. Lunette dont ils fe fervent pour garanrir leurs yeux
de l’imprcflion de la neige. 670. b.
ESOPE. Caraélere dofes fables. VL 246. a. 3 52. b. Son éloge.
Fiftion de Philoftrate fur cet auteur. Abrégé de fa vie. 252. b.
ESOTERIQUE, Doétrùie. Vo\eç E x o t e r i q u e .
ESPACE. (çMètaphyf, ) Les phiiofophes en ont donné de*
définitions fort différentes 8c même tout oppofées. Phiiofophes
qui l’ont diftingué de la matière. Newton croyoit que
refpace étoit le fenjorium de Dieu, 8c l’immcnfité de Dieu.
Clarke a foutenu le fentiment de Newton contre Léibnitz,
qui prétendoit que l’efpacc n’étoit que l’ordre des chofes
cooxiftantcs. Les partifans de l’efpace abfolu 8c réel, appuient
leur idée de tous les fccours que l’imagination lui prête. V.
049. b. Enfuite ils font fentir la difficulté qu’il y auroit pouf
les corps de fe mouvoir, dans les paroles citées de M. Clarke
à M. Léibnitz : ou l’eljiace cft un néant, dit Clarke » ou
une funplc idée, ou une fimple relation ; ou il eft la matière
, ou quelque forte de fubftance , ou enfin une propriété
de la même maniéré que la durée. C’eft à cette dernière
fuppofition que ce philoiophe s’arrête, après avoir prouvé
la fauffeté des précédentes. Ibid. 950. a. Dieu n’exifte
point, ajoute-t-il, dans l’cfpace ni dans le tems ; mais fon
cxiftcnce eft la caufe de l’efpacc 8c du tems. L’cfpace, difent
au contraire les Léibnitziens, eft quelque chofe de purement
relatif comme le tems ; car s’il étoit une propriété, il devroit
l’être de quelque fubftance. Si l’efpace eft une réalité abfo-
lu e, il fera plus fubfiftant que toutes les fubftances : tous
les attributs, même de Dieu, conviendront à l’efpace. Si
l’cfpace étoit un être abfolu, il y auroit quelque chofe dont
il feroit impofliblc qu’il y eût une raiion fuffifante. De
quelle maniéré, félon les Léibnitziens, nous venons à nous
former une idée de l’efpace. Cet examen peut fervir à découvrir
la fource des illufions que l’on s’eft faites fur la nature
de l’elpace. Ibid. b. Toute l’éténduc, félon ces phiiofophes
, doit être conçue comme étant uniforme, fimilaire,
8c n’ayant point de détermination interne qui en diftingué
les parties les unes des autres , puifqu’étant pofées comme
l’on voudra , il en réfultera toujours le même être. Comment
il arrive que l’étendue nous paroît diftinéle du tout
réel, dont nous l’avons féparée par abftraélion , 8c que nous
nous figurons qu’elle peut fubfifter par elle-même. Ibid. 931.
a. Comment les Léibnitziens prouvent qu’ils ont raifon de
définir l’efpace, l’ordre des coexiftans, c’eft-à-dire , la ref-
femblance dans la maniéré de coexifter des êtres. Pourquoi
cet être idéal d’étendue que nous nous formons de la pluralité
8c de l'union de tous les êtres, nous paroît une fubftance
Cependant, ajoutent-ils , l’efpace n’eft pas les
chofcs mêmes ; c’eft un être qui en a été formé par ab-
ftraftion, &c. L’efpace eft aux êtres réels , comme le nombre
aux chofes nombrées. Ibid. b. Réflexion de M. Muff-
chembrock fur la nature de la queftion dont on vient de
s’occuper, 8c fur toutes ces difputes touchant la poffibilité
ou l’impoffibilité de l’efpace. Inutilité de cette queftion par
rapport à la géométrie 8c à la phyftqùc. Ibid. 952. a.
Efpace y voyez Lieu, IX. 495. b. 496. a. 8c l’article Etendue.
VI. 43. b. 8cc. Ordre 8c difpofition dans les chofes 8c
dans l’efpace : partage de Newton fur ce fujet. Définition de
l’elbace par Léibnitz. III. 390. b. IX. 378. a.
E s p a c e . ( Gc'om. ) Efpace parabolique, elliptique, Oc. V.
952. a. Voyez Etendue.
E s p a c e . (Droit civil) On met au rang des immeubles
l’efoace. On le divife en commun 8c.cn particulier. La pof-
feffion de l’cfoacc qui eft perpendiculaire au fol d’une pof-
feflion , eft abfolament nécefiaire pour la poffefiion du fol.
V. 952. a. Ufagc que le propriétaire peut faire de l’eipacc
qui eft au-deffous tic fon loi. Ibid. b.
E s p a c e . ( Mufique ) V. 95a. b.
E s p a c e , \lmprim. ) V . 952. b.
ESPACER. ( Jardin. ) Diftancc à laquelle on elpac* les
arbres dans les allées, à la campagne, dans les vergers, dans
les efpalièrs , Oc. V. 932. b.
ESPADE ou Efpadon ( Cordier ) palette à cfpader le chanvre.
r 9 y * y v V w v v
Efpade , façon que l’on donne à la fijaffe après qu elle