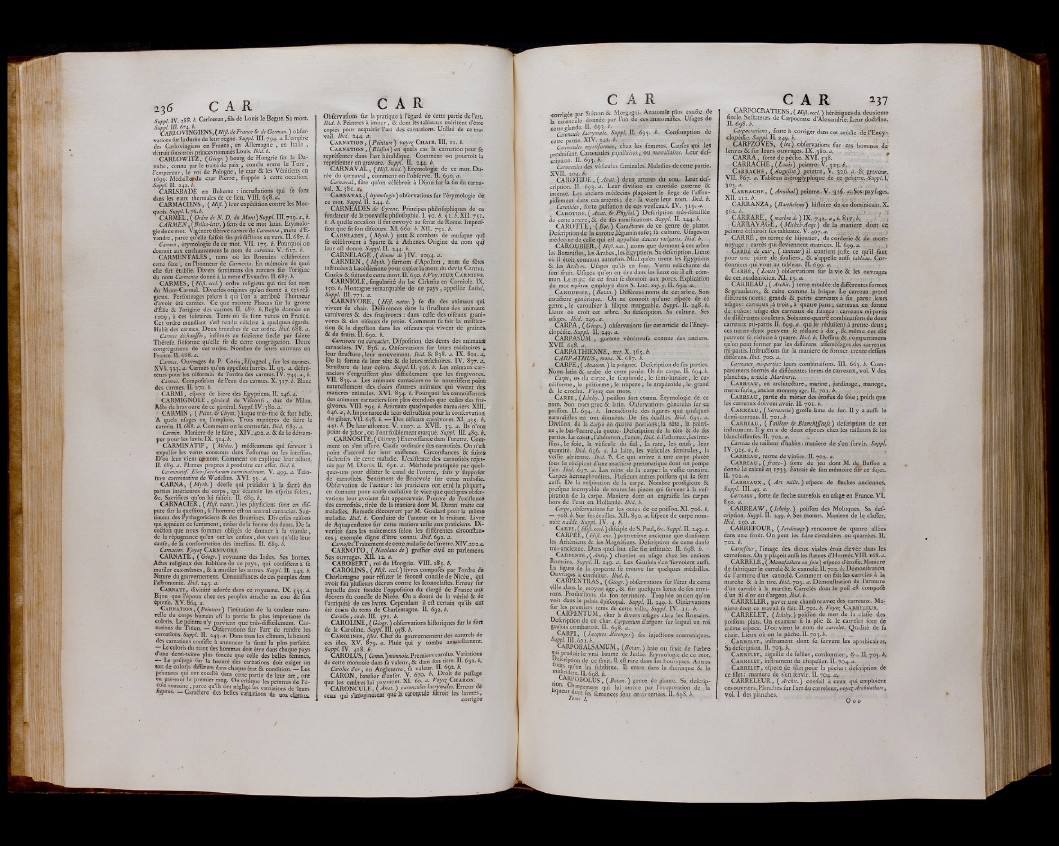
2.3 6 C A R .
Suppl. IV. 288. Éj Carloman,fils de Louis le Begue. Sa mort,
^TaRLÔVINGIENS , ( Hift. de France & de Gcrman.) obfer-
vations fur la durée de leur regne. Suppl. III. 794. a. L’empire
des Carlovirigiens en Frailce, en Allemagne , en Italie ,
détruit fous trois princes nommés Louis. Ibid. b.
CARLOW1TZ, (Géogr;) bourg de Hongrie fur le Danube
, connu par le traité de paix , conclu entre le Turc,
l ’empereur, le roi de Pologne, le czar & les Vénitiens en
1699. MédailleÉdu czar Pierre, frappée à cette occafion.
-Suppl. II. 242. b. . , . ' .
CARLSBADE en Boheme : incruftations qui fe font
dans les eaux thermales de ce liéù. VIII. 658.4.
CARMACIENS, ( Hift. ) leur expédition contre les Mec-
quois.Suppl. Lj6.b.
CARMEL,( Ordre de N .D. du Mont)Suppl. nr.719.ii, b.
CARMENi (Belles-lettr. ) fens de ce mot latin! Étymologie
de ce mot. Vigénere dérivé carmende Carmenta, mere d’E-
vandre, parce qu elle faifoit fes prédi&ions envers, n. 687.b.
Carmen, étymologie de ce mot. VII. 175. b. Pourquoi on
donnoit aux enchantemens le nom de cannina. V.- 617. b.
CARMENTALES, tems où les Romains célébroient
cette fête , en l’honneur de Carmenta. En mémoire de quoi
elle fut établie. Divers fentimens des auteurs fur l’origine
du nom Carmenta donné à la mere cPEvandre. II. 687. b.
CARMES, ( Hift.eccl.) ordre religieux qui tire fon nom
du Mont-Carmel. Diverfes origines qu’on donne à ces religieux.
Perfonnages païens à qui l’on a attribué l’honneur
d’avoir été carmes. Ce que raconte Phocas fur la grotte
d’Élie & l’origine des carmes. II. 687. b. Réglé donneè en
1209 , | ces lolitaires. Tems où ils font venus en France.
Cet ‘ordre mendiant s’eft rendu célébré à quelques égards.
Habit des carmes. Deux branches de cet ordre. Ibid. 688. a.
Carmes déchaujfés, inilitués au feizieme fiede par fainte
Thérefe. Réforme qu’elle fit de cette congrégation. Deux'
congrégations de cet ordre. Nombre de leurs couvens eh
France. II. 688. a.
Carmes. Ouvrages du P. Coria, Efpagnol, fur les carmes.
XVI. 323 . a. Carmes qu’on appelloit barrés. II. 93. a. défini-
teurs pour les réformés de l’ordre des carmes. IV. 745. a, b.
Carmes. Compofition de l’eau des carmes. X. 317. b. Blanc
des carmes. II. 270. b.
CARMI, efpece de biere des Egyptiens. II. 246.4.
CARMIGNOLE, général de Vifconti ,. duc de Milan.
Afte de bravoure de ce général. Suppl. IV.‘38o. a.
' CARMIN , I Peint. & Chym. ) laque très-fine & fort belle.
A quels ufages on l’emploie. Trois maniérés de faire le
carmin. II. 688. a. Comment on le contrefait. Ibid. 689. a.
Carmin. Manière de le faire, XIV. 402. a. &de le détremper
pour les lavis.-IX. 314. b.
CARMINATIF, ( Mèdec. ) médicamens qui fervent à
expulfer les vents contenus dans l’eiiomac ou les inteftins.
D’où leur vient cernom. Comment on explique leur aétiori.
II. 689. a. Plantes propres à produire cet effet. Ibid. b.
Carminatif. Eleo-faccharum carminativum. V. 499. a. Teinture
carminative de Wedëlius. XVI. 33. a.
CARNA, ( Myth. ) déefTe qui préfidoit à la farité des
parties intérieures du corps, qui écarroit les ëfjprits folets,
&c. Sacrifices qu’on lui faifeir. II. 689. b.
CARNACIER, (Hift. natur.) les plïyficiens font en dif-
pute fur la queftion, fi l’homme eftun animal carnacier. Sentiment
des Pythagoriciens & des Bramines. Diverfes raiforis
•qui appuient ce fentiment, tirées de la forme des dents. Dé la
coétion que nous fommes obligés de donner à la viande,
de la répugnance qu’en ont les enfans, des vers qu’elle leur
caufe,de la conformation des inteftins. II. 689. b. '
Carnacier. Fbye^ CARNIVORE.
CARNATE, (Géogr.) royaume des Indes. Ses bornes.
Aétcs religieux des habitans de ce pays, qui confiflent à fè
mutiler eux-mêmes, & à mutiler les autres. Suppl. II. 242. b.
Nature du gouvernement. Connoiffances de ces peuples dans
l ’aftronomie. Ibid. 243. a.
C arnate, divinité adorée dans ce royaume. IX. 555.à.
Bijou que l’époux chez ces peuples attache au cou de fon
époufe. XV. 864. a.
.* C arnation , ( Peinture ) l’imitation de la couleur naturelle
du corps humain eft la partie la plus importante du
coloris. Le peintre n’y parvient que très-difficilement. Carnations
du Titien. — Obfervations fur l’art de rendre les
carnatiohs. Suppl. II. 243. a. Dans tous les climats, la beauté
des carnations confifte à annoncer la fanté la plus parfaite.
—- Le coloris du teint des hommes doit être dans chaque pays
dune demi-teinte plus foncée que celle dès belles femmes.
Le préjugé fur la beauté des carnations doit exiger un
ton de colons différent dans chaque état & condition. — Les
peintures qui ont excellé dans cette partie de leur art, ont
eu par-tout le premier rang. On critique les peintres de l'é-
col. parce quels ont négligées carnations de leurs
fcgures. - Caraftcre des belles carnations de nos cEjaàts.
CAR Obfervatloûs fur la pratiqué à l’égard de cette partie de l’art.
Ibid. b. Peintres à imiter, & dont lés tableaux méritent d’être
copiés pour acquérir l’art des carnations. Utilité de ce travail.
Ibid. 244. a.
C a rn a t io n , (Peinture) voyc^ C h air . III. u . b.
C a rn a tion , (Blafori) en quels cas la carnation peut fe
repréfenter dans l’art héraldique. Gomment on pourroit la
rèpréfenter en gravure. Suppl. II. 244. b.
CARNAVAL, (Hiß. mod.) Etymologie de ce mot. Durée
du carnaval, comment on l’obferve. II. ’690. a.
Carnaval, fête qu’on célébroit à Dijon fur la fin du carnaval.
X. 381. a.
C a rn a v a l , ( étymologie) obfervations fur l’étymologie dé?
ce mot. Suppl. 11. 244. b.
CARNEADES de Cyrene. Principes philofophiques de ce
fondateur de la nouvelle philofophie. I. 50. b. 51. ¿.XII. 75 u
b. A quelle occafion il fut envoyé au fénat de Rome. Impref-
fiori que fit fon difcoujrs. XI. 660. b. XII. 751. b.
Carneades, (Myth.) jeux & combats de mufique qui
fe célébroient à Sparte 6c à Athènes. Origine du nom qu)
leur eft donné. Suppl. II. 244. b.
CARNELAGE, ( dixme de ) IV. 1094. a.
CARNIEN, ( Myth. ) fumom d’Apollon , nom de fêtes
inftituées à Lacédémone pour expier la mort du dévin Carnut.
Caufcs & fuites de cette mort. II. 690. b.Voy. jeux Carniens.
• CARNIOLE, Angularité du lac Cirknîtzén Carniole. IX.
150. bt Montagne remarquable de ce pays, appellée Loi bel.
Suppl. III. 771. a.
CARNIVORE, (Hiß. natur.) fe dit des animaux qui
vivent de chair. Différences dans la ftrufture des animaux
carnivores & des frugivores : dans celle des oifeaux granivores
& des oifeaux de proie. Comment fe fait la maftica-
tion & la digeftion dans les oifeaux'qui vivent de graines.
& de fruits, fi. 690. b.
Carnivore ou carnacier. Difpofition des dents des animau*
carnaciers. IV. 836. a. Obfervations fur leurs mâchoires ,
leur ftrufture, leur mouvement. Ibid. & 838. a. IX. 801. a.
De la forme de leur tête & de leurs mâchoires. IV. 837.4*
Structure de leur colon. Suppl. II. 506. b. Les animaux carnaciers
s’engraiffent plus difficilement que les frugivores.
VII. 839. a. Les animaux carnaciers ne le nourriffent point
naturellement des chairs d’autres animaux qui vivent des
matières animales. XVI. 834. b. Pourquoi les connoiffances
des animaux carnaciers font plus étendues que celles des frugivores.
Vni. 795. b. Animaux quadrupèdes carnaciers. XIII.
646. a, b. Importance de leur deftru^ion poür la confervatioii
du gibier. VU. 658. b. >— Des oifeaux carnivores. XI. 435. b.
441. b. De leur eftomac. V. 1007. a. XVU. 33. a. Ils n’ont
point de jabot, ou l’ont foiblément marqué. Suppl. IU. 489. b.
CARNOSITÉ, ( Chirurg. ) Excroiffance dans l’uretre. Conr*
ment on s’en affure. Caufe ordinaire des carnofités. On n’eft
point, d’accord fur leur exiftence. Circonftances & fuiteÿ
fâcheùfes de cette maladie. L’exiftence des carnofités rejet-
tée par M. Dionis. U. 691. a. Méthode pratiquée par quelques
uns pour dilater le canal de l’uretre , fans y fuppofer
de carnofités. Sentiment de Bénévole fur cette maladie.
Obfervation de l’auteur : les praticiens ont erré la plupart ,
en donnant pour caufe exclufiye ‘le vice qué quelques obfervations
leur avoient fait appercevoir. Preuve de l’exiftencé
des carnofités, tirée de la maniéré dont M. Daran traite ces
maladies. Rémede découvert par M. Goulard pour la même
maladie. Ibid. b. Conduite de l’auteur en la traitant. Livre
de Aqüapendente fur cette matière utile aux praticiens. Di-
verfité dans les traitemens félon les différentes circonftan«
ces, ; exemple digne d’être connu. Ibid. 692. a.
CamofitèVCraitement de cette maladie de l’uretre. XIV.202.Ä
CARNOTO, (Nicolaus de) greffier civil au parlement
Ses ouvrages. XII. 12. a.
CAROBERT, roi de Hongrie. VHI. 285. b.
CAROLINS, (Hiß. eccl.)livres compofes par l’ordre dé
Charlemagne pour réfuter le fécond concile de Nicée, qui
avoit fait plufieurs décrets contre les Iconoclaftes. Erreur fur
laquelle étoit fondée l’oppofition du clergé de France aux
décrets dü concile de Nicée. On a douté de la vérité & dé
l’antiquité de ces livres. Cependant il eft certain qu’ils ont
été écrits du tems de Charlemagne. II. 692. b.
Carolin , code. III. 571. b.
CAROLINE, ( Géogr. ) obfervations hiftoriques fur le fort
de la Caroline. Suppl. III. 958. b.
Carolines , iftts. Chef du gouvernement dés naturels de
ces ifles. XV. 879. a. "Pluie qui y tombe annuellement.
Suppl. IV. 418. b.
CAROLUS, ( Comm. ) monnoie. Premiers carolus. Variations
de cette mohnoie dans fa valeur, & dans fon titre, il. 692. ¿.
Carolus d'or, en Angleterre, fa valeur. U. 692. 4.
CARON, batelier J'enfer. V. 670. 4. Droit de paffage
que les ombres lui payoient. XI. 60. a. Foyer C haron.
CARONCULE, ( A n a t . ) caroncules lacrymales. Erreur dé
ceux qui s’imagmoient que la «voawe filtroit les larmes,
* ' corrigée
C A R C A R a 3 7
-corrigée par Stänpn& Morgagni.. Anatomie plus exafle dè
la caroncule donnée par l’un de. ces anatomiites. Ulages de
cette glande. II. Wffl l>- ■ ^ ,
Caroncule lacrymale. Suppl. II. • 695. b. Conlomption de
cette partie.XIV. 242.:é., : . ; . ;
Caroncules myrttformef-9 chez les femmes. Cailles qui les
produifent. Caroncules pupillaires,ou niamillaircs. Leur def-
cription. II. 693. b.
Caroncules des véficules fénnnales! Maladies de cette partie.
XVII. 204. A \ ■»J.
CAROTIDE-,i { Anat. ) deux-, arteres du cou. > Leur defr
cription. II. 693. a. Leur divifion en carotide externe &
interne.-Le.s anciens médecins plaçoient le fiege .de raifou-
piffement dans ces arteres; .de - là vient leur nom. Ibid. b.
. Carotides % forte pulfation de cés vaifteaux. IV. 319.-4.
j C a r o t id e . ( Anat. & Phyfiol.) Defcription très-détaillée
de cette artere, Sc de fes ramifications. Suppl. II. 244; b. s
CAROTTE, ( ¡¡9t. ) Çaraéferes de ce genre de planté.
Defcription-de la .carotte jégumineufe ; fa culture. Ufages en
médecine de. celle qui eft appellée daucus vulgaris. Ibid. b,.-.
CAROUBIER, (Hiß. nat.Ynoms que donnent à cet arbre
les BotanifteSj, les Arabes, les Egyptiens. Sa defcription. Lieux,
où il étoit commun autrefois. Miel qu’en tirent les Egyptiens
& les Arabes. Ufages qu’ils en font. Vertu relâchante de
fon* fruit. Ufages qu’on en tire dans les lieux où il eft commun.
Le marc de ce fruit fe donnoit aux porcs. Explication
du mot »ifctTia employé dans S. Luc. xvj.y. II. 694.-4._
C a r o u b i e r , (Botan.) Difiérens noms de cet arbre. Son
çaraâere générique. On ne connoît qu’une efpece de ce
genre , le çaroubier à filique mangeable. Suppl.. 11.-2:48. b.
Lieux où croit cet arbre.. Sa defcription. Sa .culture.. Ses
ufages. Ibid. 2 4 9 .4.
CARPA, ( Géogr. ) obferyations fur cet article de l'Encyclopédie.
Suppl. II. .249. 4.
CARPASuM , gomme vénéneufe connue -des anciens.
XVn.' 658. 4.
CARPATHIENNE, /wrr. X. 365. ¿.
CARPATHUS, mons. X. 687. b.
CARPE, ( Anatom. § le poignet Defcription de fes parties.
Noms latin oç-arabe de cette partie. Os du carpe. II. 694. b.
Carpe, os du carpe, le feaphoïde, le femi-lunaire, le eu-,
néiformç,.le .pififorme, le trapeze, le trapézoïde, le .grand
èc le crochu. Foyer ces mots.
. C a r p e , (Ichthy..) poiffon fort connu. Étymologie de: ce
liom. Son nom grec & latin. Obfervations générales for ce,
poifton.. II. -694. b. Inexactitude des figures que quelques
naturaliftes en ont donnéesi De fes écailles. Ibid. 695. a.
Divifion de la carpe en quatre portions;la tête, la poitrine
, le bas-centre, la queue* Defcription de la tête & de fes
parties.Le coeu»,l’abdomen, l ’anus, Ibid. b.l’eftomac,lâsinte-
ftins,le foie, la vêficule du -fiel, la rate, les oeufs, leur
quantité. Ibid. 696. a. La laite, les véficules féminalcs, la
veffie aérienne. Ibid. T>. Ce qui arrive à une carpe placée
fous le récipient d’une macliine pneumatique dont on pompe
l’air. Ibid. 697. 4. Les reiris de la carpe : la veffie urinaire.
Carpes hermaphrodites. Plufieurs autres poiffons qui le font
aum. De la reipiration de la carpe. Nombre prodigieux &
.prcfque incroyable de toutes les pièces qui fervent a la respiration
de la carpe. Maniéré dont on engraifte les carpes
hors de l’eau en Hollande. Ibid. b.
Carpe, obfervations fur les ouïes de ce poifton. XI. 706. b.
— 708. b. Sur fes écailles. XII. 890. a. Efpece de carpe nommée
nadde. Suppl. IV. 4. b.
C a rp e , (Hiß. eccl.) difciple de S. Paul,&c. Suppl. H. 249. a.
CARPÈL, (Hiß. anc. ) pantomime ancienne que danfoient
les Athéniens & les Magnéfiens. Defcription de cette danfe
très-ancienne. Dans quel but elle fut instituée. II.; 698. b. •
C a rp en te , (Antiq.) charriot en ufage chez les anciens
Romains. Suppl. II. 249. 4. Les Gaulois s’en 'fervoient auffi.
La figure de la carpente fe trouve fur quelques médailles.
Ouvrages à confulter. Ibid. b.
. CARPENTRAS, f Géogr. ) obfervations fur l'état de cette
ville dans le moyen âge, & fur quelques lieux de fes environs.
Productions, de fon territoire. Tropnée ancien qu’on
voit dans le palais épifcopal. Suppl. II. 249. b. Obfervations
fur les premiers tems de cette ville, Suppl. IV. 11. b.
OARPENTUM, char à divers ufages chez les Romains.
Defcription de ce char. Carpentum d’arcent fur lequel un roi
gaulois combattoit. II. 698. a.
(Jacques.Berenger) fes injeâion» anatomiques.
Suppl. III.6pi.b.
CARPOBALSAMUM, (Botan. ) baie ou fruit de l’arbre
produit le vrai baume de Judée. Etymologie,de, ce mot.
Defcription de ce fruit. Il eft rare dans les boutiques. Antres
nuts qu’on lui fubftitue. Il entre dans la tliériaque &. le
^ " t a e .n .6 0 8 .4 .
rio Ch (Botan.') genre de plante. Sa. defcripî
- , ’ Dnangement qui lui arrive par l’évaporation de la
¿ “ r/e ' ' fcmences f9at cnyii onnées.ll. 698. b.
ÇARPOCRATIENS, ( Hift.eccl. ) hérétiques du deuxième
iiecle. oeclateurs de Carpocrate d’Alexandrie; Leur doftrlne.
II. 698. b.
. Carpocratiens, faute à corriger dans cet. article dé l’Ency-.
clopédie. SuppL II. 249. b.
ÇARPZOVES, obfervations fur eps "hommes dff
lettres & fur leurs ouyrages.; IX.-380,4.
CARRA, forte de pêche. XVI. 538.
■ CARRACHE, (Louis) .peintre:^V. 3 2 5 ; - _
C a r r a c h e , (ÀuguJlin^ tÿQmpte, V. 326...4. graveur.
VU, 867. 4. Tableau Itiérqgjyphique de j:e,'peiinre,1itt/y/.L
303.a. " ‘ B ", .. ‘ ' 'J ’ • «
C a r r a c h e , ( A n n ib a lj peintre.. V . jjf a f 4àÿ_es;|^ayfages.
XII. 2Z2. b.
CARRANZA , (Barthelem) hiftoire de.ce dominicain,X.
562 ,.bi. ^ . . oy. ; : ; ■/, r. jy; y ., .»V / f ,*|
CARRARE, ( marbre de) IX. 742. 4, b. 8\j^b^
CARRAVAGÉ, ( Michcl-Angtr ) de la maniéré dont ce
peintre.,ëciairoit fes tableaux. V.'407.4. - " A :j
CARRÉ, en terme de bijoutier, .de corderie-& de mon^
nqÿage ; carrés qui .deviennent matrices. Ù.‘ 699! a. ■
• C a r r é de cuir,. ( tanneur) i l . contient- jufte. ce qu’il, faut;
pour une paire dé.fouliers,. &. s’appelle auffi tableau. C,or-
donniers.qui.vpnt au tableau. II. 699. a. . .
C a r r é , ( Louis ) obfervations fur la vie & les ouvrages
de. cet. académicien. XI. 13 . a.
CARREAU, ( Archit. ) terre,moulée de différentes formel
&•,grandeurs, & cuite comme, la' brique; Le carreau prend
difiérens noms : grands & petits carreaux à fix pans : .leurs
ufages : carreaux (à trois, à quatre pans ; carreaux ..en, forme
de,,cubes; ufage des çarreaux de faïançe .‘ carreaux mi-partis
de différentes couleurs. Soixante-quatre combiupifons de deux
Carreaux mi-partis II. 699. a. qui .fe réduifen^à ¡trente-deux i
ces trente-deux peuventÿfë réduire à dix , &-même ces dix
peuvent fe,réduire à quatre. Ibid. b. Deffins 8c pompartimens
qu’on peut former par les différens affemblagcs.des carreaux
mi-partis. Inftruélions fur la maniéré de former trente deffins
difiérens. Ibid. 700. a.
Carreaux mi-partis: leurs combinaifons. III. 663.^. Com--
partimens formés de différentes fortes de carreaux, vol. V des
planches.» article Marbrerie.- ■
C a r r e a u , en architeéture-, marine, jardinage,.nianege,
menuiferie.,,ancien monnoyage. \\.;joi;b.
C a r r e a u , partie du. métier des étoffes de foie ; poids que
les carreaux doivent avoir. II. 701 .b. : ,
C a r r e a u , (Serrurerie) groffe lime de fer; Il y a auffi le
demi-carreau.il. 701. b .
CARREAU , ( Tailleur. 6* Blanchijjeufe ) defcription de cet
inftrumenr. Il y en a de deux efpec.es chez les tailleurs & les
blahcliiffeufes. II. 702. a. «
Carreau de tailleur d’habits : maniéré de s’en fervir. Suppl,
IV. 925.4, b. . . . . . .
C a r r e a u , terme de vitrier. II. 702. a.
C a r r e a v , (/ranc-) forte de jeu {font M. d&Bufibn a
donne le calcul en 1733. Extrait de fon mémoire fur ce fujet.
II. 702.4.
C a r r e a u x , ( Art milit. ) efpece de fléchés anciennes.
Suppl. III. 49. 4.
Carreaux, forte de fleche autrefois en ufage en France. VL
850. 4.
CARREAW, (Ichthy.) poiffon des Moluques. Sa defcription.
Suppl. II. 249. b. Ses moeurs. Maniéré de le clafler,
Ibid. 25P. 4.
CARREFOUR, (Jardinage) rencontre.de quatre allées
dans une forêt. On peut les faire circulaires pu quarrées. II.
702. b.
Carrefour, l’image des dieux viales étoit élevée dans les
carrefours. On y plaçoitauffi les ftatues d’Hermès.VIII. 168.4.
CARRELÉ, ( Marmfailure en foie) efpece d’étoffe. Maniéré
de fabriquer le çarreié & le cannelé. II. 702. b: Démonftration
de l’armure d’un cannelé. Comment on fait les carrelés à la
marche & à la tire. Ibid.-703. a. Démonftration de l’armure
d’un carrelé à la marche. Carrelés dont le- poil eft compofé
d’un fil d’or ou d’argent. Ibid. b.
CARRÉLER, paver .une chambre aveç des carreaux. Maf
niere dont ce travail-fe fait. II. 702. b. ^bye^ ÇARRELEUR.
CARRELET, (Ichthy.) poiffon de mer de la claffe des
poiffons plats. On examine fi la plie & le carrelet font de
même efpece. D’où vient le nom de carrelet.Qualité de fa
chair.. Lieux où on le pêche. II. 703. b. - , ,
C a r r e l e t , inftrument. dont fe fervent les apothicaires;
Sa defcription. II. 703. b.
C a r r e l e t , aiguille de fellier, cordonnier, éyc. ÎI. 703. ¿.
C a r r e l e t , inftrument de chapelier. II. 704. 4.
C a r r e l e t , efpece de filet pour la pêche :. defcription de
ce filet : maniéré de s’en fervir. ÎI. 704. 4«.
CARRELEUR, (Archit.) cônfeil à ceux qui.emploient
ces ouvrie,«..Planches fur l’art du carreleur,.voye^Architeflure,
vol. I des. planches.