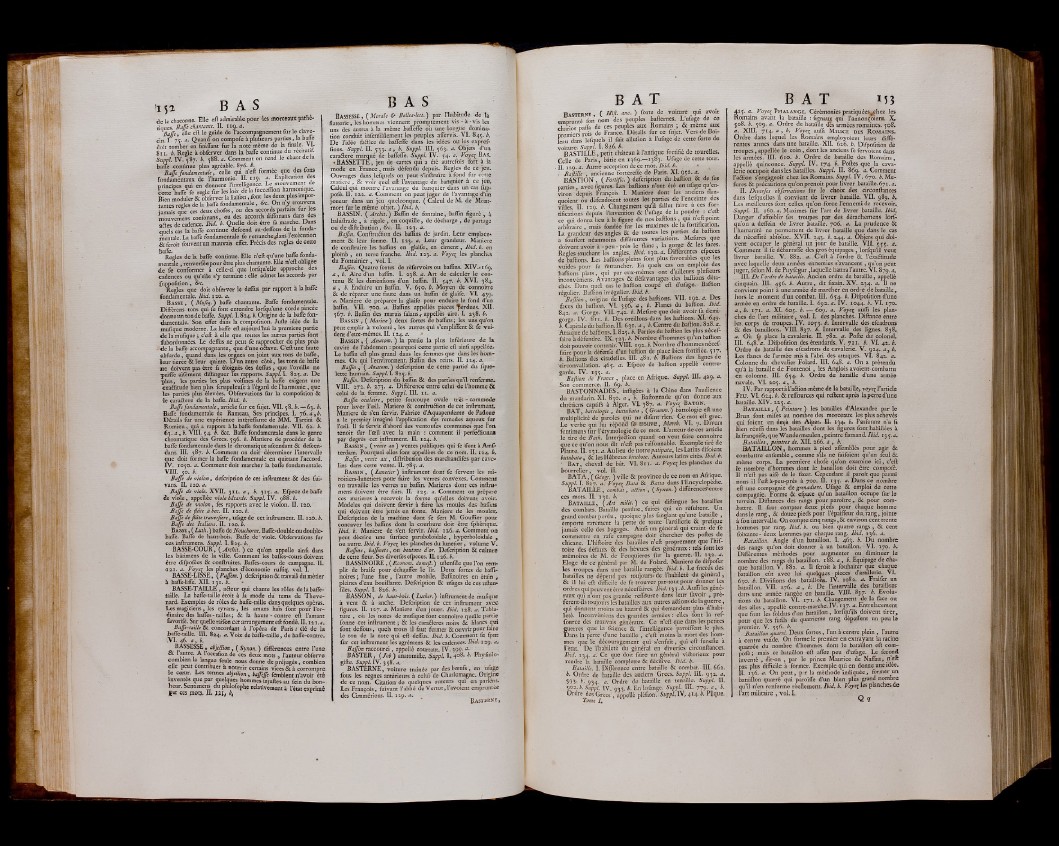
>i5* BAS de i chaconne. Elle eft admirable pour les morceaux pathétiques.
Baffi chantante. II. n o .e .
Baffe, elle eft le guide de l’accompagnement fur le clavecin.
I. 75- a- Quand on compofe à plufieurs parties, la balle
doit tomber en finiffant fur la note même de la finale. VI.
$ n , ¿. Regle à obferver dans la baffe continue du récitatif.
Suppl. IV. 587. b. 588. a. Comment on fend le chant de la
baffe contìnue plus agréable. 876. b.
Baffe fondamentale, celle qui n’eft formée que des fons
fondamentaux de l’harmonie. II. 119. Explication des
principes qui en donnent l’intelligence. L e mouvement de
cette baffe fe regle fur les loix de la fucceffion harmonique.
Bien moduler & obferver la liailbn font lesdeux plus importantes
réglés de la baffe fondamentale, bc. On ny trouvera
jamais que ces deux chofes, ou des accords parfois fur les
mouvemens confonans, ou des accords diffonans dans des
aSes de cadence. lbid. h. Quelle doit être fa marche. Dans
quels cas la baffe continue defeend au-deffous de. la fondamentale.
La baffe fondamentale fe retrancherons l’exécution
& feroit fou vent im mauvais effet. Précis des réglés de cette
Réglés de la baffe contìnue. Elle n’eft qu’une baffe fondamentale
, renverféepour être plus chantante. Elle n’eft obligée
de fe conformer à celle-ci que lorfqu’elle approche des
cadences ou qu’elle s’y termine : elle admet les accords par
^Kegles que doit obferver le deffus par rapport à la baffe
fondamentale, lbid. 120. a.
B a s s e , ( Mufiq. ) baffe chantante. Baffe fondamentale.
Différens tons qui fe font entendre lorfqu’une corde pincée
donne un ton de baffe. Suppl. 1. 8 24. b. Origine de la baffe fondamentale.
Son effet dans la compofition. Jufte idée de la
mufique moderne. La baffe eft aujourd’hui la premiere partie
de la mufique ; c’eft à elle que toutes les autres parties font
iiibordonnées. Le deffus ne peut fe rapprocher ae plus près
J de la baffe accompagnante, que d’une octave. C’eft une faute
abfurde, quand dans les orgues on joint aux tons de baffe,
leur tierce & leur quinte. D’un autre côté, les tons de baffe
aie doivent pas être ft éloignés des deffus , que l’oreille ne
-puiffe aifement diftinguer les rapports. Suppl. I. 825. a. De
plus, les parties les plus voifines de la baffe exigent une
exactitude bien plus fcrupuleufe à l’égard de l’harmonie, que
les parties plus élevées. Obfervations fur la compofition &
'le caraftere de la baffe, lbid. b.
Baffe fondamentale, article fur ce fujet. VII. 58. b. — 63. b.
Baffe fondamentalè de Rameauv Ses principes. I. 76. a,b.
Détails fur une expérience intéreffante de MM. Tarditi &
Romieu, qui a rapport à la baffe fondamentale. VU. 62. b.
63. a , b. V in. 54. b. &c. Baffe fondamentale dans le genre
chromatique des Grecs. 596. b. Maniere de procéder de la
baffe fondamentale dans le chromatique afeendant & defeen-
tlant. III. 387. b. Comment on doif-déterminer l’intervalle
Îue doit former la baffe fondamentale en quittant l’accord.
V. 1050. a. Comment doit marcher la baffe fondamentale.
VIU. j o . b.
Baffe de violon, defeription de cet infiniment & des fui-
yans. IL 120. a.
Baffe de viole. XVH. 311. a , b. 3x5. a. Efpece de baffe
de viole, appellée viole bâtarde. Suppl. IV. 988. b.
Baffe de violon, fes rapports avec le violon. U. 120.
Baffe de flûte à bec. n. 120. b.
Baffe de flûte traverfiere, ufage de cet infiniment. U. 120. b.
Baffe des Italiens. U. 120.0.
B as se , ( Luth. ) baffe de Nouchome. Baffe-double ou double-
baffe. Baffe de haut-bois. Baffe de'viole. Obfervations fur
ces inftrumens. Suppl. I. 825. b.
BASSE-COUR, ( Archit. ) ce qu’on appelle ainfi dans
les bâtimens de la ville. Comment les baffes-cours doivent
¿tre difpofees & confinâtes. Baffes-cours de campagne. II.
■121. a. Voyez les planches d’économie ruftiq. vol. I.
BASSE-LKSE, (Paffem.) defeription 8c travail du métiei
à baffe-liffe'. XII. 131. ¿. *
BASSE-TAILLE, aéteur qui chante lçs rôles de la baffe-
taille. La baffe-taille étoit à la mode du tems de Thévenard.
Exemples de rôles de baffe-taille dans quelques opéras.
Les magiciens, les tyrans , les amans haïs font pour l’ordinaire
des baffes-tailles; & la haute-contre eu l’amant
favorifé. Sur quelle raifon cet arrangement eft fondé. II. 121 .a.
Baffi-taille & concordant à l’opéra de Paris : clé de la
baffe-taille. HI. 824. a. Voix de baffe-taille, de baffe-contre.
tVL 46. a , b.
BASSESSE , abjeffion, ( Synon. ) différences entre l’une
ce l autre. A loccafion de ces deux mots , l’auteur obferve
combien la langue feule nous donne de préjugés, combien
elle peut contribuer à nourrir certains vices & à corrompre,
le coeur. Les termes abjeaion, baffeffe femblent n’avoir été
inventés que par quelques hommes injulles au fein du bon-
heur. Sennmens du phdofophe relativement à l’état exprimé
fa r ces jnots. U. 17-1, bt K
BAS Bassesse, ( Morale & Belles-lett.) par l’habitude de ta
flatterie, les hommes viennent promptement vis - à - vis les
uns des autres à la même baffeffe où une longue domination
conduit infenfiblement les peuples affervis. VI. 845.
De l’idée faélice de baffeffe dans les idées ou les expref-
fions. Suppl. II. 533. a , b. Suppl. III. 563. a. Objets d’un
caraâere marqué de baffeffe. Suppl. IV. 54. a. Voyeç Bas. •
• BASSETTE, jeu de cartes qui a été autrefois fort à la
mode en France, mais défendu depuis. Réglés de ce jeu.
Ouvrages dans lefquels on peut s’inftruire à fond fur cette
matière, & voir quel eft l’avantage du banquier à ce jeu.
Calcul qui montre l'avantage du banquier dans un cas fup-
pofé. U. 122. a. Comment on peut juger de l’avantage d’un
joueur dans un jeu quelconque. ( Calcul de M. de Mont-
mort fur le même objet. ) lbid. b.
BASSIN. ( Archit. ) Bafiin de fontaine, badin figuré , à
baliiftrade , à rigole, en coquille, de décharge, de partage
ou de diftribution, &c. II. 123. a.
Baffin. Conftruétion des bafnns de jardin. Leur emplacement
8c leur forme. H. 123. a. Leur grandeur. Maniéré
de conftruire les badins en glaife, en ciment, lbid. b. en
plomb, en terre franche. lbid. 123. a. Voyez les planches
du Fontainier, vol. I.
Baffin. Quatre fortes de réfervoirs ou badins. XIV.* 169.
a , b. Aire d’un badin. I. 238. a. Art de calculer le contenu
& les dimènfions d’un badin, n. 547. b. XVI. 384.
a , b. Enduire un badin. V. 650. b. Moyen de connoître
& de réparer une faute dans un badin de glaife. VI. 439.
a. Maniéré de préparer la glaife pour enduire le fond d un
badin. VU. 700. a. Badins appellés pièces perdues. XII
567. b. Badin des marais falans f appellés aire. I. 238. b.
B a s s in , ( Marine ) deux fortes ae badins ; les uns qu’on
peut emplir à volonté , les autres qui s’empliffent & fe vui-
dent d’eux-mêmes. IL 124. a.
B a s s in , ( Anatom. ) la partie la plus inférieure de la
cavité de l’abdomen : pourquoi cette partie eft ainfi appellée.
Le badin eft plus grand dans les femmes que dans les hommes.
Os qui l’environnent. Badin des reins. II. 124. a.
Baffin, ( Anatom.) defeription de cette partie* du fque-
lette humain. Suppl. 1. 825. b.
Baffin. Defeription du badin & des parties qu’il renferme.
V n i. 272. b. 273. a. Différence entre celui de l’homme &
celui de la femme. Suppl. Ul. 11. a.
Baffin oculaire, petite foucoupe ovale très - commode
pour laver l’oeil. Matière & conftruétion de cet infiniment.
Maniéré de s’en fervir. Fabrice d’Aquapendente de Padone
a le premier imaginé l’application des remedes aqueux fur
l’oeil. Il fe fervit d’abord des ventoufes communes que l’on
tenoit fur l’oeil avec la main : comment il perfectionna
par degrés cet infiniment. H. 124. b.
B as s in -, ( vente au ) ventes publiques qui fe ‘font à Amsterdam.
Pourquoi elles font appellées de ce nom. n. 124. b.
Baffin, vente au , diftribution des marchandifes par cave-
lins dans cette vente, n . 785. a.
B as s in , ( Lunetier ) infiniment dont fe fervent les mi-
roitiers-lunetiers pour faire les verres convexes. Comment
on travaille les verres au badin. Matières dont ces inftrumens
doivent être faits, n. 125. a. Comment on prépare
ces matières à recevoir la forme qu’elles doivent avoir.
Modèles qui doivent fervir à faire les moules des badins
qui doivent être jettés en fonte. Maniéré de les mouler.
Defeription de la machine dont fe fert M. Gouffier pour
concaver les badins dont la courbure doit être fphèrique.
lbid. b. Maniéré de s’en fervir. lbid. 126. a. Comment on
peut décrire une furface paraboloïdale., hyperboloïdale 9
ou autre, lbid. b. Voyez les planches du lunetier, volume V.
Baffins, baffinets, ou boutons d'or. Defeription & culture
de cette deur. Ses diverfes efpcces. II. 126. b.
BASSINOIRE, ( Econom. domeft.) uftcnfile que l’on remplit
de braife pour échguffer le lit. Deux fortes de baffi-
noires ; l’une fixe , l’autre mobile. Badinoires en étain ,
pleines d’eau bouillante. Defeription & ufages de ces uften-
files. Suppl. I. 826. b.
BASSON, de haut-bois. {Luther.) infiniment de mufique
à vent & à anche. Defeription de cet infiniment avec-
figures. II. 127. a. Maniéré d’en jouer. lbid. 128. a. Tablature
, où les notes de mufique font connoître quelle partie
fonne cet infiniment ; 8c les carafteres noirs 8c blancs qui
font deffous, quels trous il faut fermer & ouvrir pour faire
le ton de la note qui eft deffus. lbid. ¿. .Comment fe fpnt
fur cet infiniment les agrémens & les cadences. lbid. 129. a,
Baffon raccourci, appelle courtaut. IV. 399- a-
BASTER, ( Job ) anatomifte. Suppl. I* 4°^« Phyfiolo-
gifle. Suppl. IV. 358. a. ~
BASTÉRNE, voiture traînée par des boeufs, en ufage
fous les régnés antérieurs à celui de Charlemagne. .Origine
de ce nom. Citation' de quelques auteurs qui en parlént.
Les François, fuivant l’abbé de Ver tôt, l’avoient emprunte«
des Cimmériens. II. 129. a-.
Ba s t sr n e ,
BAT BAT 153 Basterne . ( W É ^ ) forte de voiture qui avoit !
emprunté fon nom des peuples bafternes. L’ufage de ce
chariot paffa de ces peuples aux Romains ; & meme aux
premiers rois de France. Détails fur ce fujet. VersdeBoi-
feau dans lefquels il fait allufion à 1 ufage de cette forte de
voiture. Suppl. 1. 816. b. . . . . , ..
BASTILLE, petit château a l’antique fortifie de tourelles. ;
Celle de Paris, bâtie en 1269.— 1383. Ufage de cette tour, j
• II. 129. a. Autre acception de Ce mot. lbid. b. •
. B affilie , ancienne fortereffe de Paris. XI. 951. a.
BASTION , ( Fortifie. ) defeription du baftion & de fes
parties, avec figures. Les baflions n’ont été en ufage qu’environ
depuis François I. Maniere dont les anciens flan-
quoient' ou défendoient toutes les parties de l’enceinte des
villes. H. 129. b. Changement qu’il fallut faire à ces fortifications
depuis l’invention & l’ufage de la poudre : cefi
ce qui donna lieu à la figure de nos baillons , qui n eft point
arbitraire , mais fondée fur les maximes de la fortification.
La grandeur des angles & de toutes les parties du bafhon
a fouffert néanmoins différentes variations. Mefures que
doivent avoir à-peu-près le flanc, la gorge & les faces. •
Réglés touchant les angles. lbid. 130. a. Différentes efpeces
déballions. Les baflions pleins font plus favorables que les
vuides pour fe Retrancher. En quels cas on emploie des
•baflions plats, qui par eux-mêmes ont d’ailleurs plufieurs
inconvéniens. Avantages & défavantages des baflions détachés.
Dans quel cas le baftion coupé eft d’ufage. Baftion
régulier. Baition irrégulier, lbid. b.
Baftion, origine de l’ufàge des baflions. VII. 192. a. Des
faces du baftion. VI. 356. a , b. Flancs du baftion. lbid.
842. a. Gorge. VU. 742. b. Mefure que doit avoir fa demi- <
gorge. IV. 811. b. Des oreillons dans les baflions. -XI. 649.
b. Capitale du baftion. II. 631. a , b. Centre du baftion. 828. a.
Attaque de baflions. 1. 825. b. Parties.du baftion les plus nécef-
faire à défendre. IX. 523. b. Nombre d’hommes qu’un baftion
doit pouvoir contenir. VIII. 192. b. Nombre d’hommes nécef-
faire pour la défenfe d’un baftion de place bien fortifiée. 517.
b. Battions des citadelles. III. 481. b. Baflions des lignes de
'circonvallation. 465. a. Elpecc de -baftion appellé contre-,
garde. IV. 135. a.
Baftion de France , place en Afrique. Suppl. 111. 429. a.
Son commerce, n . 69. b.
BASTONNADES, infligées à la Chine dans 1 audience
du mandarin. XI. 830.'«, b. Baftonnade qu’on donneaux
chrétiens captifs à Alger. VI. 387. a. Voyez B â t o n .
BAT, battologie , buttubata , ( Gramm. ) -battologie eft une
multiplicité de paroles qui ne difenfrien. Ce mot eft grec.
Le verbe qui lui répond (ef trouve, Matth. VI. 7. Divers
ientimens fur l’étymologie de ce mot. L’auteur de cet article
le tire de Bath. Interjection quand on veut faire connoître
?ue ce qu’on nous dit n’eft pas raifbnnable. Exemple tiré de
laute. II. 131.a. Aulieu de notrepatipata, lesLatins difoient
butubata, 8c les Hébreux bitubote. Auteurs latins cités. lbid. b.
• B a t , cheval de bât. VI. 811. *. Voye^ les planches du
bourrelier, vol. II. ' .
BA TA , ( Gcogr. ) ville & province de ce nom en Afrique.
Suppl. I. 827. a. Voyeç Bata 8c Batta dans l’Encyclopédie.
BATAILLE, combat, aClion , (Synon.) différence? en tre
ces mots. n . 131. b.
B a t a i l l e , (Art milit.) ce qui diftingue les batailles
des combats. Bataille perdue, fuites qui en réfultent. Un-
grand combat perdu, quoique plus fanglant qu une bataille ,
emporte rarement la perte de toute l’artillerie & prefque
jamais celle des bagages. Ainfi un général qui craint de fe
commettre en rafe campagne doit chercher des poftes de
chicane. L’hiftoire des batailles n’eft proprement que l’hif-
toire des défauts & des bévues des généraux : tels font les
mémoires de M. de Feuquieres fur la guerre. II. 132. a.
Eloge de ce général par M. de Folard. Maniere de difpofer
les troupes dans une bataille rangée. Ibid. b. Le fuccès des
batailles ne dépend pas toujours*de.l’habileté du général,
& il lui eft difficile de fe trouver par-tout pour donner les
ordres qui peuvent être néceffaires. lbid. 133 .¿.Au filles généraux
qui n’ont pas grande reflburce dans leur favoir , pré-
ferent-ils toujours les batailles aux autres aétions de la guerre,
qui donnent moins au hazard & qui demandent plus d’habileté.
Inconvéniens des grandes armées : elles font la ref-
fource des mauvais généraux. Ce n’eft que dans les petites
Îlierres que la feiehee & l’intelligence paroiffent le plus.
)ans la perte d’une bataille , c’eft moins la mort des hommes
que le découragement qui s’enfuit, qui eft funefte à
l’état. De ' l’habileté du général en diverfes circonftances.
lbid. 134. a. Ce que doit faire un .général viélorieux pour
rendre la bataille compiette & décifive. lbid. ■ ¿.
Bataille. I, Différence entre bataille & combat. IH. 662.
b. Ordre de bataille des. anciens Grecs. Suppl. UI. 932. a.
933- I l 934. a. Ordre de bataille en tenaille; Suppl. n.
902. b. Suppl. IV. 933. b. En lofange. Suppl. Ul. 779. a , b.
Ordre des Grecs , appellé pléfion. -Suppl. IV, 414. b. PÜque.
Tome I.
41 ç. a. Voyci P h a l a n g e . Cérémonies pratiquées^çhez les
Romains avant la bataille : fignaux qui l’annonçoient. X»
508. b. 509. a. Ordre de bataille des armées romaines. 508.
a. XIII. 714. a , b. Voye[ aufli M il ic e d e s R o m a in s .
Ordre dans lequel les Romains employoient leurs différentes
armes dans une bataille. XII. 626. b. Difpofition de
troupes, appellée le coin, dont les anciens fe fervoient dans
les armées. UI. 610. b. Ordre de bataille des Romains,
appellé quinconce. Suppl. IV. 174. b. Poftes que la cavalerie
occupoit dans les batailles. Suppl. II. 860. a. Comment
l’aâion s’engàgeoit chez les Romains. Suppl. IV. 670. b. Mefures
& précautions qu’on prenoit pour livrer bataille. 671. a.
II. Diverfes obfervations fur le choix des circonftances
dans lefquelles il convient de livrer bataille. VU. 989. b.
Les meilleures font celles, qu’on force l’ennemi de recevoir,.
Suppl. U. 160. a. Maximes fur l’art de livrer bataille. lbid.
Danger d’affoiblir fes troupes par des détachemens lorf-
qu’on a deffein de livrer bataille. 706. a. La prudence 8c
I humanité ne permettent de livrer bataille que dans le cas
de néceffité abfolue. XVn. 243. b. 244. a. Objets qui doivent
occuper le général un jour de bataille. VII. 557. a.
Comment il fe débar rafle des gros équipages , lorfqu’il veut
livrer bataille. V. 882. a .. C’eft à l’ordre & l’exaélitude
avec laquelle deux armées ennemies s’avancent, qu’on peut
juger, félon M. de Puyfégur, laquelle battra l’autre. VI. 879. a.
III. De Tordre de bataille. Ancien ordre de bataille, appellé
cinquain. IU. 456. b. Autre, dit fixain. XV. 234. a. Il ne
convient point à une armée de marcher en ordre de bataille ,
hors le moment d’un combat. IU. 654. b. Difpofition d’une
armée en ordre de bataille. I. 692. a. ÎV. 1044. b. VI. 170.
a f b. 171. a. XI. 605. b. r— 600. a. Voye{ aùfli les planches
de l’art militaire, vol. I. des planches. Diftance entre
les. corps de troupes. .IV. 1053. Intervalle des efeadrons
& des bataillons. VÎU. 837. b. Intervalle des lignes. 838,
a. Où fe place la cavalerie. U. 782. a. Polie du coloneL
UI. 648. a. Difpofition des étendards. V. 711. b. VI. 42. b.
Ordre de bataille des efeadrons de cavalerie. V. 924. a, b.
Les flancs de l’armée mis à l’abri des attaques. VI. 842. a.
Colonne du chevalier Folard. IU. 648. a. On a prétendu
qu’à la bataille de Fontenoi , les Anglois avoient-combattu
en colonne. UI. 654. b. Ordre de bataille d’une armée
navale. VL 205. a , b.
IV. Par rapport à l’adionmême de la bataille, voye[ l’article
F eu. VI. 624. b. &reffources qui relient après la,perte d’une
bataille. XIV. 225. a.
B a t a i lle , ( Peinture ) les batailles d’Alexandre par le
Brun font mifes au nombre des morceaux les plus achevés
qui foient en deçà des Alpes. U. 134. b. Perfonne n’a fi
bien réuffi dans les batailles dont les figures font habillées à
la françoife, que Wandermeulen, peintre flamand. lbid. 13 ç.a.
Batailles, peintres de. XU. 266. a , b.
BATAILLON, hommes à pied affemblés pour agir &
combattre' enfemble, comme s’ils ne faifoient qu’un feul &
même corps. La première chofe qu’on examine ic i, c’eft
le nombrç d'hommes dont le bataillon doit être compofè.
II n’eft pas aifô de le fixer. Cependant il paroît que parmi
. nous il l’eft à-peu-près à 700. U. 135. a. Dans ce nombre
eft une compagnie Ae grenadiers. Ufage & emploi de cette
compagnie. Forme & efpace qu’un bataillon occupe fur le
terrein. Diftances des rangs pour paroître , & pour combattre.
II. faut compter deux .pieds pouf chaque homme
dans le rang, & douze pieds pour l’épaiffeur du. rang, jointe
à fon intervalle. On compte cinq rangs, & environ cent trente
. hommes par rang. lbid. b. ou bien quatre rangs, & cent
foixante - deux hommes par chaque rang. lbid. 136. a.
Bataillon. Angle d’un bataillon. I. 463. ¿. Du nombre
des rangs qu’on doit donner à un bataillon, VI. 170. b.
Différentes méthodes pour augmenter ou diminuer le
nombre des rangs du bataillon. 188. <z, b. Equipage de chaque
bataillon. V . 882. a. Il feroit à fouhaitèr que chaque
bataillon eût avec lui quelques pièces d’artillerie. VI.
. 630. b. Divifions des bataillons. IV. 1082. a. Fraifer un
bataillon. VII. 276. a , b. De l’intervalle des bataillons
dans une armée rangée en bataille. VUI. 837. b. Evolutions
du bataillon. Vl. 171. b. Changement de la face ou
. des ailes, appellé contre-marche. IV. 137. a. Entrelacement
que font les foldats d’un bataillon , lorfou ils doivent tirer,
pour que les fùfils du quatrième rang dépaffent un peu le
premier. V. 556. b.
Bataillon quarré. Deux fortes, 1 un à centre plein , 1 autre
à centre vuide. On forme le premier en extrayant la racine
quarrée du nombre d’hommes dont le bataillon eft com-
pofé j mais ce bataillon eft affez peu d’ufage. Le fécond
inventé , dit-on , par le prince Maurice de Naflâu, n’eft
Sas plus difficile à former. Exemple qui en donne une idée.
[. 136. a. On peut, par la méthode indiquée, former un
bataillon quarré qui paroiffe d’un bien plus grand nombre
■ qu’il n’en renferme réellement lbid. b. Voyez les planches de
. 1 art militaire , vol. I. BQ
?