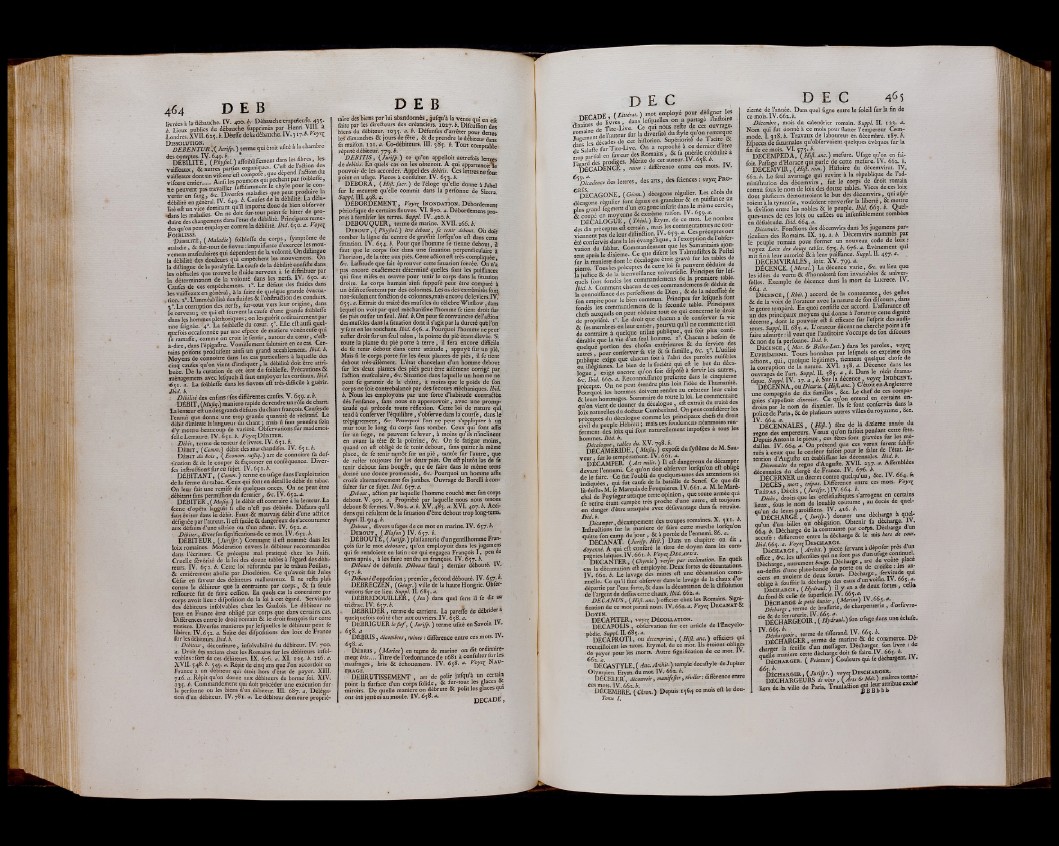
4<>4 D E B
livrées iladébauéhe. IV. 400. b: Délxiuchewaputeufe. 435- i l i eux publics de débauche fuppnmes par Henri VU l. a
tendres. XVII. 6x5. é.Déeffe de la débauche. IV. 317.*. Voyn
D i s s o l u t i o n . I ■ f - . . . ,___.
DEBENIUR Jurifp.) terne qui étoit ufité à la chamore
d é b A t é , des
vaiffeaux, & autres parties organiques. Ceft de laéhon d
vaiffeaux dont un vifcere efl compofé , que dépend la«ton d
vifcere entier .... Ainfi les poumons qui pechent par lo bielle,
ne peuvent pas travailler luffifimment le chyle pour le eon-
v t r r ir e n f iL , bc. Diverfes maladiesque pentproduireU
TV 6410. b. Caufes de la débilité. La débi-
lité cft'un «ce dominant qu’a importe donc de bien obferver
■dans les maladies. On ne doit fur-tout point fe hâter de pro-
«Tuire des chaneemens dans l’état de débilité. Pnncipaux reme-
I s q u t p t f S o y e r contre la débilité. Ibid. 6,0. u. | g |
^Dé b i l i t é , (Maladie) foibleffe du corps, fymptome de
maladie, & fur-tout de fievre : impuiffance d’exercer les mou-
vemens mufculaires qui dépendent de la volonté. Un diltingue
la débilité des douleurs qui empêchent les mouvemem. Un
la diftingue de la paralyfie. La caufe de la débibté c^fifte dans
les obftades que trouve le fluide nerveux a fe diftribuer par
la détermination de la volonté dans les nerfs. IV. 650. a.>
Caufes de ces empêchemens. i°. Le défaut des fluides dans
les vaiffeaux en général, à la fuite de quelque grande évacua-
.tion. i°. L’imméabilité des fluides & l’oMruaion des conduits.
*°. La corruption des nerfç, fur-tout vers leur origme, dans
le cerveau : ce qui eft fouvent la caufe d’une grande foiblefle
dans les hommes pléthoriques ; on les guérit ordinairement par
une faienée. W- La foibleffe du coeur. 30. Elle.eft auffi quelq
u e fo is occafionnée par une efpece de matière vénéneufe qui
le ramaffe, comme on croit le fentir, autour du coeur, celt-
à-dire, dans l’épigaftre. Vomiffement falutaire en ce cas. Certains
porfbns produifent ainfi un grand accablement. Ibid. b.
Moyens de connoitre dans les cas particuliers a laquelle des
cinq caufes qu’on vient d’indiquer, la débibté doit être attribuée
De la curation de cet état de foibleffe. Précautions &
ménaeemens avec lefquels il faut employer les cordiaux. Ibid.
631. a. La foibleffe dans les fievres eft tres-difficile a guérir.
É Ü b. ’ * • • • • • - « , . .
; Débilité des enfens : fes différentes caufes. V. 659.*. b.
-DÉBIT, {Mufiq.) maniéré rapide de rendre un rôle de chant.
La lenteur eft un des grands défauts du chant françois. Caufes de
l’ennui que donne une trop grande quantité de récitatif. Le
débit diminue la langueur du chant ; mais il faut prendre foin
d’y mettre beaucoup de variété. Obfervations fur mademoiselle
Lcmaure. IV. 651. b. V D é b i t e r .
:. Débit y terme de teneur de livres. IV. 65 u b.
D é b i t , (Comm.) débit des marchandifes. IV. 6y.b.
D é b i t du bois, {Econom. ruftiq.) art de connoitre fa destination
&de le couper & façonner en conféquence. Diverfes
inftruétions force fojet. IV.6qi.b. _
DÉBITANT, ( Comm. ) terme en ufage dans 1 exploitation
de la ferme dutabac. Ceux qui font en détail le débit du tabac.
On leur fait une remife de quelques onces. On ne peut être
débitant fans permiflion du -fermier, bc. IV. 65 2. a.
DÉBITER, ( Mufiq. -) le débit eft contraire à la lenteur. La
feene d’opéra languit fi elle n’eft pas débitée. Défauts qu’il
faut éviter dans le débit.'Faux -& mauvais débit d’une aftrice
défignée par l’auteur. 11 eft facile & dangereux de s’accoutumer
aux défauts d’une aôrice ou d’un aâeur. IV. 652. a.
- Débiter.y diverfes figniflcarions-de ce mot. IV. 652. b.
DÉBITEUR, (Junfpr.) Comment il eft nommé dans les
ioix romaines. Modération envers 4e débiteur recommandée
dans l’écriture. Ce précepte mal pratiqué-chez les Juifs.
Cruelle fôvérité de la loi des douze tables à l’égard des débiteurs.
IV. 632. b. Cette loi réformée par le tribun Petilius,
& entièrement abolie par Dioclétien. Ce qu’avoit fait Jules
Céfar en faveur des débiteurs malheureux. Il ne refta nlus
contre le débiteur que la contrainte par corps, & fa feule
reffource fut de faire ceflion. En quels cas la contrainte par
corps avoit lieu : difpofition de- la loi à cet égard. Servitude
des débiteurs infolvables chez les Gaulois. Le débiteur ne
Îeut en France être obligé par corps que dans certains cas.
>ifférences entre le droit romain & le droit françois fur cette
matière. Diverfes maniérés par lefquelles le débiteur peut fe
libérer. IV. 65a. a. Suite des difpoiitions des loix de France
fur les débiteurs. Ibid. b.
Débiteur, déconfiture, infolvabilité du débiteur. IV. 700.
a. Droit des anciens chez les -Romains fur les débiteurs infolvables:
fort de ces débiteurs. IX. 676. a. XI. 125. b. 126. a.
XVII. 548. b. 549. a. Répit de cinq ans que l’on accordoit en
•France à un débiteur qui étoit hors d’état de .payer. XIII.
716. a. Répit qu’on donne aux débiteurs de bonne foi. XIV.
.135. b. Commandement qui doit précéder une exécution fur
laperfonne ou les biens d’un débiteur. III. 687. a. Délégation
d’un débiteur. IV. 781. u. Le débiteur demeure proprié-
D E B
taire des Viens par lui abandonnés , jufqu’à la vente qui en eft
faite par les direfteurs des créanciers. 1027. b. Difcuffion des
biens du débiteur; 1033. a. b. Défenfes d’arrêter pour dettes
le? dimanches & jours de fête, & de prendre le débiteur dans
fa maifon. 121. a. Co-débiteurs. III. 383. b. Tout comptable
réputé débiteur. 779; b.
DEB1TIS, ( Jurifp. ) ce qu’on appelloit autrefois lettres
de debitis. En quels cas on les obtenoit. A qui appartenoitTe
pouvoir de les accorder. Appel des debitis. Ces lettres ne font
point en ufage. Pièces à consulter. IV. 653. b.
DEBORA, ( Hifl.facr. ) de l’éloge qu’elle donne à Jahel
fur le meurtre qu’elle commit dans la perfonne de Sizera.
Suppl. 111.498. a.
DÉBORDEMENT, Voye^ I n o n d a t i o n . Débordement
périodique de certains fleuves. VI. 870. a. Débordemens propres
à fertilifer les terres. Suppl. IV. 420. b.
DEBOUQUER, terme de marine. XVII. 266. b.
D E B O U T , ( Phyfiol. ) être debout, fe tenir debout. Où doit
tomber la ligne du centre de gravité lorfqu’on eft dans cette
fituation. I V . 634. b. Pour que l’homme fe tienne debout, il
fout que le corps foit dans une fituation perpendiculaire à
l’horizon, de la tête aux piés. Cette aftion eft très-compliquée,
bc. Laflitude que foit éprouver cette fituation forcée.' On n’a
pas encore exaftement déterminé quelles font les puiffances
qui font mifes en oeuvre pour tenir le corps dans la fituation
droite. Le corps humain ainfi fuppofé peut être comparé à
un édifice foutenu par des colonnes. Les os des extrémités font
non-feulement fonnion de colonnes,mais encore de leviers. IV.
633. a. Extrait du traité des mufcles du célèbre Winflow, dans
lequel on voit par quel méchanifme l’homme fe tient droit fur
fes piés ou fur un feul. Ibid. b. On peut fe convaincre del’aâion
des mufcles dans la fituation dont il s’agit par la dureté qute l’on
yfcnten les touchant. Ibid. 636. a. Pourquoi l’homme ne peut*
refter droit fur un feul talon, la pointe du pié étant élevée. Si
toute la plante du pié porte à terre, il fera encore difficile
de fe . tenir debout dans cette attitude , appuyé fur un pié.
Mais fi le-corps, porte fur les deux plantes de piés, il fe tient
debout très-aüément. L’état chancelant d’un nomme debout
fur les deux plantes des piés peut être aifément corrigé par
l’aâion mufculaire, bc. Situation dans laquelle un homme ne
peut fe garantir de la chûte, à moins que le poids de fon
corps ne foit contrebalancé par des fecours méchaniques. Ibid.
b. Nous les employons par une forte d’habitude contraâée
dès l’enfonce, lans nous en appercevoir, avec une promptitude
qui précédé toute réflexion. Cette loi de nature qui.
tend à conferver l’équilibre, s’obferve dans la courfe, dans le-
trépignement, Sec. Pourquoi l’on ne peut s’appliquer à un
mur tout le long du corps fans tomber. Ceux qui font aflk
fur un fiege, ne peuvent fe lever, à moins qu’ils n’inclinent
en avant la tête & la poitrine, bc. On fe fotigue moins,
quand on eft obligé de le tenir debout, fans quitter la même
place, de fe tenir tantôt fur un pié , tantôt fur l’autre, que
de refter toujours fur les deux piés. On eft plutôt las de fè
tenir debout fans bouglr, que de foire dans le même tems
donné une douce promenade, bc. Pourquoi un homme affis
I croife alternativement fes jambes. Ouvrage de Borelli à con-
fulter fur ce fujet. Ibid. 6qy.a.
Debout, aétion par laquelle l’homme couché met fon corps
debout. V. 903. a. Propriété par laquelle nous nous tenons
debout & fermes. V. 802. a. b. XV. 403. a. XVI. 407. b. Acci-
densqui réfultent de la fituation d’être debout trop long-tems.
Suppl.M. 914. b.
Debout, divers ufoges de ce mot en marine. IV. 637. b.
D e b o u t , {Blafon") IV. 637. b.
DÉBOUTÉ, ( Jurijp. ) plaifanterie d’un gentilhomme François
fur le mot debotare, qu’on employoit dans lesjugemens
qui fe rendoient en latin : ce qui engagea François I , peu de
tems après, à les foire rendre en françois. IV. 637. b.
Débouté de défenfe. Débouté fatal ; dernier débouté. IV.
*>57->. |
Débouté d’qppofition ; premier, fécond débouté. IV. 637* ••
DEBRECZEN, ( Géogr.S ville de la haute Hongrie. Obfer-
vations fur ce lieu. Suppl. II. 683. a.
DÉBREDOUILLER, ( / « ) dans quel fens U fe dit au
triârac. IV’. 637. b. 4, . î
DÉBRIDER, terme de carrière. La parefle de débrider a
quelquefois coûté cher aux ouvriers. ïV. o 38. a.
DEBRIGUER le fieft ( Jurifp. ) terme uiité en Savoie. IV.
, 638. a ■ ~
DÉBRIS, décombres, ruines : différence entre ces mots. IV.
658. a. .
. D é b r i s , (Marine) en terme de marine on dit ordinairement
bris.-... Titre de l’ordonnance de 1681 à confulter uirles
^naufrages, bris & échouemens. IV. 638. u. Voye^ N a u f
r a g e . • | - - • ‘
' DEBRUTISSEMENT , art de polir |ufquà un cerom
point la furfoce d’un corps folide, St for-tout les glaces
-miroirs. De quelle maniéré on débrute & polit les glaces q
ont été jettées au moule. IV. 658. <*. DECADE
DEC
, I dotâmes de 2 ! ¿ ve Ce qui nous relie de cet ouvrage,
romaine de ( j diverftti du ftyle qu’on remarque
f q l f W g hillorien. Supèrioritl de Tacite &
W g tm f„r Tite-Live. On a reproché à ce dernier dêtre
frop partial en faveur des Romains, & fa puèrtle crédulué a
des prodiges. Mérite de cet auteur.IV. 638. b.
f)ÉCADENCE , ruine : différence entre ces mots. IV.
^Dkaimct des lettres, des arts, des fciences : voytfPRO-
° DÉCAGONE, (Giom.) décagone régulier. Les côtés du
décaeone régulier font égaux en grandeur & en puiffance au
plus|rand fegment d’un exagone infcnt dam le meme cercle,
& emipé en moyenne & extrême raifon. IV. 659.1t.
DÉCALOGUE, W m â Etym- de “ mo1- Lenombre
des dix préceptes eft certain, mais les commentateurs ne con-
viennentpasdeleurdiftinélion.IV.639.-. Cespréceptesont
été confetvés dans la loi é vangélique , a l excepnon de l obfcrvation
du fabbat. Commandement que les Samanmms ajoutent
après le dixième. Ce que difen. les Tatauddte & Poftel
fur la maniéré dont le décalogue étoit gravé fur es tables de
pierre. Tous les préceptes de cette loi fe peuvent deduire de
ja juilice & de la bienveillance univerfelle. Prmcipes fur lefquels
font fondés les commandemens de la premere table.
Ibid. b. Comment chacun de ces commandemens fexléduit de
la connoiffance des perfeaions de Dieu, &de la néceffité de
fon empire pour le bien commun. Principes fur lefquels font
fondés les commandemens de la féconde table. Principaux
chefs auxquels on peut réduire tout ce qui concerne le droit
de propriété. i°. Le droit que chacun a de conferver fa vie
& fes membres en leur entier, pourvu qu il ne commette rien
de contraire à quelque utilité publique, qui foit plus considérable
que la vie d’un feul homme, a . Chacun a befoin de
quelque portion des chofes extérieures & du fervice des
A r l , pour conferver fa vie & fa fomiUe, foc. 3 . L unlite
publique exige que chacun foit a l abri des paroles nuifibles
Su illégitimes. Le bien de la fociété qui eft le but du déca- .
loeue , exige encore qu’on foit difpofé à fervir les autres, 1
bc Ibid. 66a a. ReconnoifTance preferite dans le cmquieme
p r é c e p te O n n e p e u t é te n d r e p lu s lo in 1 id é e d e lh um am te . I
Pourquoi les hommes doivent rendre au créateur leur culte
& leurs hommages. Sommaire de toute la loi. Le commentaire 1
qu’on vient de donner du décalogue, eft extrait du traité des
loix naturelles du doéleur Cumberland. On peut corfidérer les
préceptes du décalogue comme les pnnetpaux chefs du droit
civil iu peuple Hébreu ; mais ces fondemens néanmoins renferment
des loix qui font naturellement impofées i tous les
hommes. Ibid. b.
Décalogue y tables du. XV. 79». b.
DÉCAMERIDE, ( Mufiq.) expofe du fyftême de M. Sauveur.
for le tempérament. lV . 661. a. \
DÉCAMPER. (Art milit. ) U eft dangereux de décamper
devant l’ennemi. Ce qu’on doit obferver lorfquon eft obligé
de le foire. Ce fut l’oubli de quelques-unes des atténuons ici 1
indiquées, qui fut caufe de la bataille de Senef. Ce que dit
là-deffus M. le Marquis de Feuqmeres. IV. 661. a. M. le Maré-
chai de Puyfegur attaque cette opinion, que toute armée qui
fe retire étant campée très proche d’une autre, eft toujours
en danger d’être attaquée avec défovantage dans fa retraite. I
Ibid. b. y l I
Décamper, décampement des troupes romaums. A. M » »•
Inftruélions fur la maniéré de"foire cette marche lorfquon I
quitte fon camp de jour, &àportée de 1 ennemi. 86 a.
DECANAT. (Jurifp. Hifi.) Dans un chapitre on dit ,
doyenné. A qui eft conféré le titre de doyen dans les compagnieslaïques.
IV. 66i.è. Voye^DECMiUS. -tc
DECANTER, (Chyme) verfer pur mcbnulion. En quels
cas la décantation eft employée. Deux fortes de décantations.
IV. 66r. b. Le lavage des mines eft une decantanon conn-
nuelle. Ce qu’il fout obferver dans le lavage de la chaux d or
départie par l’eau forte, & dans la décantation de la diuolution
de l’argent de dèffus cette chaux. Ibid. 662. a. _ • . . .
DEC ANUS, {Hifi. anc.) officier chez les Romains. Signification
de ce mot parmi nous. IV. 66a. a. Voyc{ D eC AN A T &
D o y e n .
DÉCAPITER, voye^ D é c o l l a t i o n .
DECAPOLIS , obfervation for cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. IL 683. a. . ur .
DECArROTI, ou decemprimty (Htft.anc.) officiers qui
recueilloient les taxes. Etymol. de ce mot. Ils étoient obligé
de payer pour les morts. Autre lignification de ce mot. IV.
DECASTYLE, ( Anc. ArchU.) temple decaftyle de Jupiter
Olympien. Etym. du mot. IV. 662. b.
DÉCELER , découvrir, manifefiery révéler: différence entre
ces mots. IV. 662. b. % . A ,
DÉCEMBRE. (Chron.) Depuis 1364 ce mois eft le dou-
Tome I,
DEC 465 zieme de l’année. Dans quel ligne entre le foleil for la fin de
ce mois. IV. 662. b.
Décembre y mois du calendrier romain. Suppl. II. 123. a.
Nom qui fut donné à ce mois pour flatter l’empereur Commode.
I. 318. b. Travaux de laboureur en décembre. 187. b.
Efpeces de faturnales qu’obfervoient quelques évêques for la
fin de ce mois. VI. 373. ., ..
DECEMPEDA, {Hifi.anc.) melure. Ufage quon en fai-
foit. Pairage d’Horace qui parle de cette mefore. IV. 662. b.
DÉCEMVIR, {Hifi- rom.) Hiftoire du décemvirat. IV.
662. b. Le feul avantage qui revint à la république de l’ad-
miniftration des décemvirs , fut le corps de droit romain
connu fous le nom de loix des douze tables. Vices de ces loix
dont plüfieurs démontroient le but des décemvirs, qui alpi-
roient à la tyrannie, vonloient renverfer la liberté, & mettre
la divifion entre les nobles & le peuple. Ibid. 663. b.
ques-unes de ces loix ou caffées ou infenfiblement tombées
en défoétude. Ibid. 664. a.
Décemvir. Fonftions des décemvirs dans les jugemens particuliers
des Romains. IX. 19. a. b. Décemvirs nommés par
I le peuple romain pour former un nouveau code de loix :
voyez Loix des dotvçe tables. 675. b. 676. a. Evénement qui
mit fin à leur autorité & à leur puiffance. Suppl. II. 437. a.
I DECEMVIRALES, loix. XV. 799. a.
! DÉCENCE. {Moral.) La décence varie, bc. au heu que
les idées de vertu & d’honnêteté font invariables & univer-
felles. Exemple de décence dans la mort de Lucrece. IV.
I 664. a. ' . . « a _
! D é c e n c e , {Rhét.) accord de la contenance, des geites
& de la voix de l’orateur avec la nature de fon dtfcours, dans
I le genre tempéré. En quoi confifte cet accord. L affurance elt
I un des principaux moyens qui donne à l’orateur cette dignité
I décente, dont le pouvoir eft fi efficace for 1 efpnt des auditeurs.
Suppl. H. 683. *. L’orateur décent ne cherche point à fe
faire admirer : il veut que l’auditoire s’occupe de fon dilcours
1 & non de fa perfonne. Ibid. b.
D É C EN C E, ( Mot. b Belles-Lett. ) dans les paroles, voy*
1 E u p h é m i s m e . Tours honnêtes par lefquels on exprime des
actions, qui, quoique légitimes, tierment quelque cliofe de
la corruption de la nature. XVI. 158. Décence dans les
ouvrages de l’art. Suppl. II. 383. b. Dans le récit dramatique.
S«w»/. IV. 17. a , b. Sur la décence y voye^ Indécent.
DÉCENNA, ou Décurie. {Hifi.anc.) C’étoit en Angleterre
une compagnie de dix familles , Sic. Le chef de ces compagnies
s’appelloit dixenier. Ce qu’on entend en
droits par le nom de dixenier. Ils fe font confervés dansla
police de Paris, & de plufieurs autres villes du royaume, etc.
VDÉCENNALES, {Hifi.) fête de la dixième année du
reene des empereurs. Voeux qu’on faifoit pendant cette fete.
Depuis Antonin le pieux, ces fêtes font gravées for les mé-
dailles. IV. 664. a. On prétend que ces voeux forent fobfo-
tués à ceux que le cenfeur faifoit pour le falut de l éat. Intention
d’Augufte e n établiffant les décennales. IbuLb.
Décennales du regne d’Augufte. XVD. 237. a. Affemblées
décennales du clergé de France. IV. 676. b.
DÉCERNER un décret contre quelqu un, Sic. IV. 664. te
DÉCÈS, mort, trépas. Différence entre ces mots. Voyeç
T r é p a s , D é c é s , {Jurifpr.) IV. 664. b.
Décès droits (Aie les eccléfiaftiques s’arrogent en certains
lieux, fous le nom de louable coutume, au deces de quelqu’un
de leurs paroiffiens. IV. 416. b.
DÉCHARGE, {Jurifp.) donner une décharge h quelqu’un
d’un billet ou obligation. Obtenir fo décharge. IV.
664. b. Décharge de la contrante par corps. Décharge dun
accufé : différence entre la décharge & le uns hors de cour.
U‘D i c B A U C T T T ^ S ^ c e ferrant à dépofer prés d’un
office? * r. les iftenfiles qoi ne font pas d'un ufage conttnuel
Décharge j auuemen. W . Décharge , are de voûte placé
S ® io În fd e Î e ? x eforte?0rDéJar6e
du fond & celle de fu p e r fic ic . IV. 665. x.
I D É CH A R G E le petit hunier, {Marine) IV.603. .
¿ A W r , terme de brafferie, de charpenterie , dorfévre-
I " '¿CH ARG EOÎR^ ^Aryiïrinii. ) fon ufage dans une éclufe.
terme de rifferand. IV. 66s. b.
DÉCHARGER, terme de manne & de commerce. Décharger
la feuille d’un meffager. Décharger fonhrre : de
ouelle manière cette décltarge doit fe feire.1V. 665. A
D é c h a r g e r . ( Peinture ) Couleurs qm fe déchaxgen .
^ f e iC H A R G E R , ( Junfpr.) VOyerD ESCHARGER.
DÉCHARGEURS de vins , 7 Arts b
liers de la ville de Paris. W a S i o n ^ ¿ ‘|"brba”