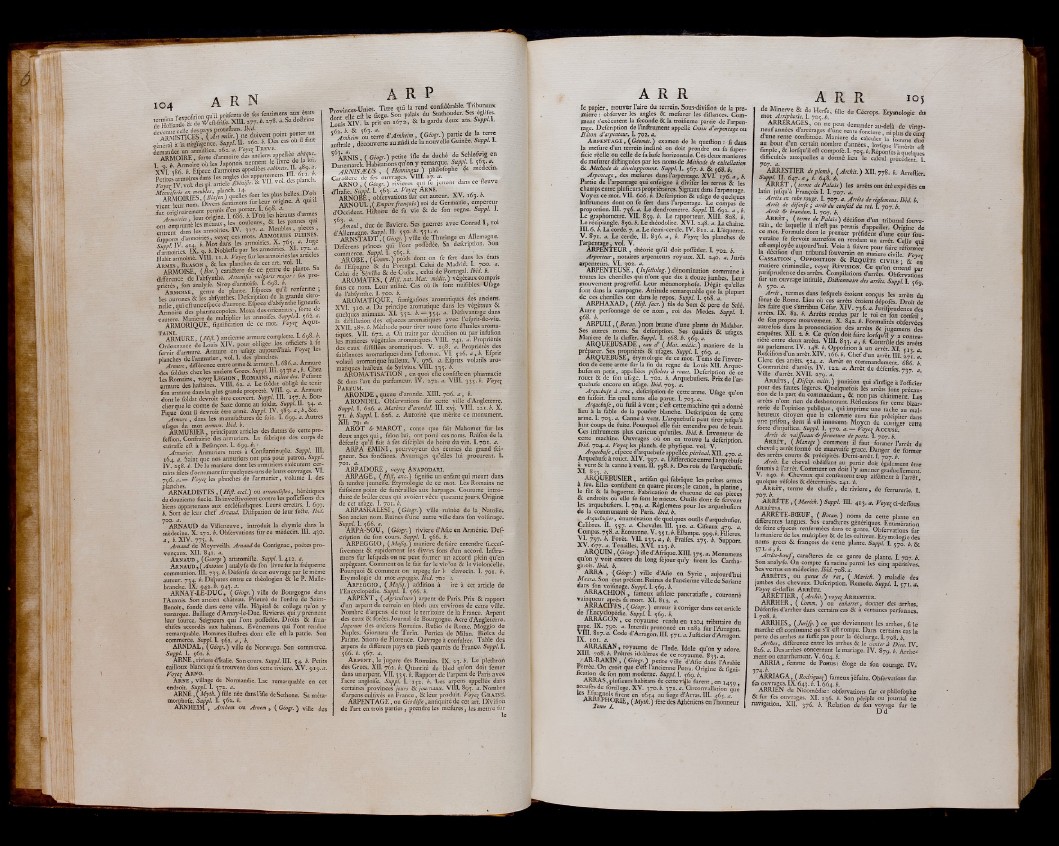
104 A R N
¿ S # ? mm ®S “ou
'h ë Ê sm & S S B ^ Ê Ê à à 1 W & m * Où les Japonois oennent 0 ( « | i |
H i 386. b. Efpece d’armoires appelles *
Petites armoires aans les angles 0 « g " v “ de pMeh
PbW{ XV. v ol des pl. article Éicn,p.Sc VU. vol.,a p M
fon, les plus beUes..D'où
vicnt^emnonu Divem^ lentimens fur km■ engin*. A quitl
fur originairemçm ^ X T ë ' o U lShèrauts d’armes
l i l l I l l I Ü | t l couleurs, & les pannes qui
ênîrem dans les armoiries. IV. 317. <1. Meubles , pièces ,
Supports d’armoiries, jw q ces mots. * ® | p p s .
SudpI IV. 414. é. Mot dans les armoiries. X. 765. a. Juge
d’amioiries. IX. 9. 4. Nobleffe par les armoiries. XL ¡ g ®
Habit annoiriè. VIII. n i Keyrt fur les armoiries les aracles
A r m e s , B l a s o n , & les planches de cet art. vol. I I .
ARMOISE, (Bot.) caraâere de ce genre de plante, ba
différence de l’abfynthe. Jnmijm vttlgorU major : les propriétés,
fon analyfe. Sirop d’armoife I. 69S. i. \
A r m o i s e , genre de plante. Efpeces qu il renferme ,
les aurones & 1« abfynthes: Defalpnon de la grande cttro-
nelle qui eft une efpece d’aurone. Efpece dabfyntliebgneufe.
Armoire des pliarmacopoles. Moxa desonentaux , forte de
cautere. Manière de multipliés les armotfes. SupplA. 562. a.
ARMORIQUE, fignificarion de ce mot. Voyiq a q v i-
TAÀrMURE (Xill. ) ancienne armure complette. I. 698. i.
Ordonnance de Louis XIV. pour obliger les ofSders a fe
fervir d’armure. Armure en ufage aujourd hui. Voytq les
planches de l’armurier, vol. I. des planches.
Armure, différence entre arme 8c armure. 1.686.a. Armure
des foldats chez les anciens Grecs. Suppl. UI. 93 3! u , i. Ghez
les Romains, voy( l L égion , R om a in s , m,ltc,Jts. Pefante
armure des haflaires. VIII. 6a. c. Le foltht oblige de tenir
fon armure dans la plus grande propreté. VI1L 9. a. Armure
dont le foldat devrèit être couvert. Suppl. 11L M7- B0U"
clier que le comte de Saxe donne au foldat. Suppl. 11. 34. a.
Pique dont il devroit être armé. Suvpl. IV. 382. a, ¿, & c.
Amure, dans les manufatares de foie. I. 699. a. Autres
ufages du mot amure. Ibid. b.
ARMURIER, principaux articles desftatutsde cette pro-
feffion. Confrairie des armuriers. La fabrique dès corps de
cuiraffe eft à Befançon. L 699.
Amurier. Armuriers turcs à Conftantmople. Suppl. 111.
164. a. Saint que nos armuriers ont pris pour patron. Suppl.
IV. 258. -i. De la maniéré dont les armuriers exécutent certains
filets d’ornement fur quelques-uns dé leurs ouvrages. VI.
796. a.— Voyelles planches de l’armurier, volume I. des
planches. . . . .
ARNALDISTES, (Hifi. eccl.) ou amaudijles, héreuques
du douzième fiecle. Us inveélivoient contre les poffeffions des
biens appartenait aux eccléiiaftiques. Leurs erreurs. I. 699.
b. Sort de leur chef Arnaud. Dilfipation de leur fêta. Ibid,
700. a.
ARNAUD de Villeneuve, introduit la chymie dans la
médecine. X. 272. b. Obfervations fur ce médecin. UI. 430.
a , ¿.XIV. 775. b.
Arnaud de Meyrveilh. Arnaud de Contignac, poètes provençaux.
XU. 841.
A r n a u d , (George) anatomifte. Suppl.1. 412. a.
A r n au d , (Antoine ) analyfe de fon livre fur la fréquente
communion. UI. 733. b. Défenfe de cet ouvrage par le même
auteur. 734. b. Difputes entre ce théologien & le P. Malle
branche. IX. 942. ¿.943- a-
ARNAY-LE-DUC, (Géogr.) ville de Bourgogne dans
l’Auxois. Son ancien château. Prieuré de l’ordre ae Saint-
Benoît, fondé dans cette ville. Hôpital & collège qu’on y
remarque. Bailliage d’Arnay-le-Duc. Rivieres qui y prennent
leur fource. Seigneurs qui font pofTédée. Droits & fran-
chifès accordés aux habitans. Événemens qui l’ont rendue
remarquable. Hommes illuftres dont elle eft la patrie. Son
commerce. Suppl. I. 562. a , b.
ARNDAL, (Géogr.) ville de Norwege. Son commerce
Suppl. I. 362. b.
ARNE, riviere d’Italie. Son cours. Suppl. III. 34. b. Petits
cailloux blancs qui fe trouvent dans cette riviere. XV. 919.a.
Voyez A rno.
A R P
w — « » n
OU litre (l'oi.M.Wl , (GOp-1 l-r-'O -o j t —Hg
auftrale , découverte au midi de la nouvelle Guinée. Suppl. I.
^ Ï rN I S ( Géogr.) petite ifle du duché de Schlefwig en
Danemarck. Habitations qu’on y remarque. SupplA.363- *•
ARNISÆUS , ( Hennmgus) philofophe & médecin.
Ca rata re de fes ouvrages. V lfl. 27. a. _
ARNO, (Géogr.) rivieres qui fe jettent dans ce fleuve ,
d’ItaUe. Suppl. I. 363. M Voyez A r n e . ,
ARNOBÉ, obfervations fur cet auteur. X V . 103. b.
ARNOUL¿Empire françois) roi de Germanie, empereur
d’Occident. Hiftoire de fa vie & de fon regne. Suppl. I.
5 Amouf duc de Bavière. Ses guerres avec Conrad I , roi
d’Allemagne. Suppl. II. 330. b. 3«..a.
ARNSTADT,(Géogr.) ville de Thurmge en Allemagne.
Différens princes qui l’ont pofTédée. Sa defcription. Son
commerce. Suppl. 1. 363. b. •
AROBE, (Comm.) poids dont on fe fert dans les états
de TEfpagne & du Portugal. Celui de Madrid. « g
Celui de SévUle & de Cadix, celui de Portugal. Ibid. b. a
AROMATES, (Hiß. nat. Mat. mèdic.) végétaux compris
fous ce nom. Leur utilité. Cas où ils font nuifibles. Ufage
de l’äbfynthe. 1 .700. b. »
AROMATIQUE, fumigations aromatiques des anciens.
XVL 310. a. Du principe aromatique dans les végétaux &
quelques animaux. XI. 332. b. — 334. a. Defavantage dans
la diftillarion des efpeces aromatiques avec l’efprit-de-vuj.
XVII. 287. b. Méthode poUr tirer toute forte d’huiles aromatiques.
VII. 672. a. On traite par décoftion ou par infiifion
les matières végétales aromatiques. VIII. 741. a. Propriétés
des eaux diftillées aromatiques. V. 198. a. Propriétés des
fubftances aromatiques dans l’eftomac. VI. 326. a ,b . Efprit
volatil aromatique huileux. V. 076. a. Efprits volatils aromatiques
huileux de Sylvius. v ll l. 333. b.
AROMATISATION , en quoi elle confifte en pharmacie
& dans l’art du parfumeur. IV. 272. a. VIII. 333. b. Voyez
Parfum .
ARONDE, queue d’aronde. XIII. 706. a , b.
ARONDEL. Obfervations fur cette ville d’Angleterre.
Suppl. I. 626. a. Marbres d’arondel. III. xvj. VIII. 221. b. X.
7 1 . b. Suppl. I. 626. a. Autorité que mérite ce monument.
XII. 79. a.
AROT & MAROT, conte que fait Mahomet fur les
deux anges qui, félon lui, ont porté ces noms. Ràifon de la '
défenfe qu’il fait à fes difciples de boire du vin. 1.701. a.
ARPA EMINI, pourvoyeùr des écuries du grand fei-
gneur. Ses fon&ions. Avantages qu’elles lui procurent. I.
701. a.
ARPADORE, voyez A na po d a r i .
ARPAGE, ( Hiß. anc ) fignifie un enfant qui meurt dans
fa tendre jeunefte. Étymologie de ce mot. Les Romains ne
faifoient point de funérailles aux harpages. Coutume introduite
de brûler ceux qui avoient vécu quarante jours. Origine
de cet ufage. I. 701. b.
ARPASKALÉSI, (Géogr.) ville ruinée de la . Natolie.
Son ancien nom. Ruines d’une autre ville dans fon voifinage.
Suppl. I. 566. a.
ARP A-SOU, ( Géogr. ) riviere d’Afie en Arménie. Defcription
de fon cours. Suppl. I. 366. b.
ARPEGGIO, (Mufiq.) maniéré défaire entendre fuccef-
fivement & rapidement les divf rs fons d’un acèord. Inftru-
mens fur lefquels on ne peut former un accord plein qu’en
arpégeant. Comment on le fait furie vio’.ôn & le violoncelle.
•Pourquoi & comment on arpegç fur 1< clavecin. I. 701. ¿.
Etymologie du mot arpeggio. Ibid. 7O2 1.
A r p e g g io , ( Mufiq. ) addition à ire à cet article de
l’Encyclopédie. Suppl. I. 366. b.
ARPENT, (Agriculture) arpent de Paris. Prix & rapport
d’un arpent de terrein en bleds aux environs de cette ville.
Nombre d’arpens de tout le territoire .de la France. Arpent
des eaux & forêts. Journal de Bourgogne. Acre d’Angleterre.
Jugerum des anciens Romains. Rubio de Rome. Môggio de
Naples. Giornata de Turin. Pertica de Milan. Bioîca dé
Parme. Stioro de Florence. Ouvrage à confulter. Table des
arpens de différens pays en pieds quarrés de France. Suppl. I.
ç66. b. 567. a.
A r p en t , le jugere des Romains. IX. 23. b. Le plethroh
des Grecs. XII. 762. b. Quantité de bled qu’on doit ferner
dans un arpent. VII. 333. b. Rapport de l’arpent de Paris avec
l’acre àngloife. Suppl. I. 132. b. Les arpens àppellés dans
certaines provinces jours & journaux. VIlL 893. a. Nombre
d’arpens cultivés en France, & leur produit. Voye[ G r a in S.
ARPENTAGE, ou Géodéfie » antiquité de cet art. Divifion
de l’art en trois parties, prendre les mefures, les mettre fur
le
A rne , village de Normandie. Lac remarquable
endroit Suppl. I. <72. a.
ARNÉ, (Myth.) fille née dansl’ifle deSethone. S
orphofe. Suppl. 1. 362. b.
ARNHEIM , Arnhem ou Amem , ( Géogr. ) ville des
A R R A R R ïoj
le papier, trouver l’aire du terrein. Sous-divifion de la première
: obferver les angles & mefurcr les diftances. Comment
s’exécutent la fécondé & la troifieme partie <le l’arpentage.
Defcription de l’inftrument appellé Croix d’arpentage ou
Bâton d’arpenteur. I. 702. a.
A r p e n t a g e , ( Géomèt. ) examen de la queition : fi dans
]a mefure d’un terrein incliné on doit prendre ou fa fuper-
ficie réelle ou celle de fa bafe horizontale. Ces deux maniérés
de mefurer diftinguées par les noms de Méthode de cultellation
& Méthode de développement. Suppl. I. 367. b. & 368. b.
Arpentage , des mefures dans l’arpentage. XVI. 176. a , b.
Partie de l’arpentage qui enfeigne à diviler les terres & les
champs entre plufieurs propriétaires. Signaux dans l’arpentage.
Voyez ce mot. VII. 606. b. Defcription & ufage de quelques
inimimens dont on fe fert dans l’arpentage. Le compas de
proportion. III. 736. a. Le dendrometre. Suppl. H. 692. a , b.
Le graphometre. VIL 839. b. Le rapporteur. XUI. 808. b.
Le récipiangle. 830. b. Le théodolite. XVI. 248. a. La chaîne.
JCL 6. b. La corde. 7. a. Le demi-cerclé. IV. 811. a. L’équerre.
V . 871. a. Le cercle. 11, 836. b. Voyel les planches de
l ’arpentage , v ol. V.
ARPENTEUR, théorie qu’il doit pofféder. I. 702. b.
Arpenteur, notaires arpenteurs royaux. XI. 240. a. Jurés
arpenteurs. VI. 302. a.
ARPENTEUSE, (InfeElolog.) dénomination commune à
toutes les chenilles qui n’ont que dix à douze jambes. Leur
mouvement progreflu. Leur métamorphofe. Dégât qu’elles
font dans la campagne. Attitude remarquable que la plupart
de ces chenilles ont dans le repos. Suppl. I. 368. a.
ARPHAXAD, ( Hift. facr. ) fils de Sem & pere de Salé.
Autre perfonnage de ce nom, roi des Medes. Suvvl. I.
568. b. n
ARPULI, (Botan.)nom brame d’une plante du Malabar.
Ses autres noms. Sa defcription. Ses qualités & ufages.
Maniéré de la clafter. Suppl. I. 368. b. 369. a.
ARQUEBUSADE, eau d’ (Mat. médic.) maniéré de la
préparer. Ses propriétés & ufages. Suppl. I. 369. a.
ARQUEBUSE, étymologie de ce mot. Tems de l’invention
de cette arme fur la fin du regne de Louis XII. Arque-
bufesen petit, appcllées piftolets à rouet. Defcription de ce
rouet & de fon ufage. I. 702. b. Arquebufiers. Prix de l’ar-
quebufe encore en ufage. Ibid. 703. a.
Arqucbuje à croc, defcription de cette arme. Ufage qu’on
en fauoit. En quel tems elle parut. 1. 703. a.
Arquebufe, ou fùfil à vent; c’eft cette machine qui a donné
lieu à la fable de la poudre blanche. Defcription de cette
arme. I. 703. a. Canne à vent. L’arquebufe peut tirer jufqu’à
huit coups de fuite. Pourquoi elle fait entendre peu de bruit.
Ces inftrumens plus curieux qu’utiles. Ibid. b. Inventeur dé
cette machine. Ouvrages où on en trouve la defcription.
Ibid. 704. a. Voye[ les planch. de phyfiqüe. vol. V.
Arquebufe, efpece d’arquebufe appellée pétrinal. XII. 470. a.
Arquebufe à rouet. XIV. 397. a. Différence entre l’arquebufé
à vent & la canne à vent. II. 398. b. Des rois de l’arquebufe.
XI. 833. b.
. ARQUEBUSIER, artifan qui fabrique les petites armes
f r?’ Î P f f onfiftent en quatre pièces; le canon, la platine
fut & la baguette. Fabrication de chacune de ces pièces
& endroits où elle fe font le mieux. Outils dont fe fervent
les arquebufiers. 1. 704. a. Réglemens pour les arquebufiers
de la communauté de Paris. Ibid. b.
. Arquebufier, énumération de quelques outils d’arquebufier.
Calibres. II. 337. a. Chevalet. III. 310. a. Cifeaux 479. a.
Compas. 73 8. a. Ecouanne. V. 3 31. b. Eftampe. 999. b. Filieres
y i . 797. b. Forêt. VII. 133. b. Fraifes. 273. b. Support’.
XV. 677. a. Tenailles. XVI. 123. b.
ARQUIN, (Géogr.) ifle d’Afrique. XIII. 373. a. Monumens
quon y voit encore du long féjour qu’y firent les Carthaginois.
Ibid. b.
ARRA , '(Géogr.) ville d’Afie en Syrie , aujourd’hui
Maara. Son état préfent. Ruines de l’ancienne ville de Seriane
dans fon voifinage. Suppl. I. 369. b.
ARRACHION , fameux athlete pancratiafte, couronné
Vainqueur après fa mort. XI. 812. a.
, » ( Géogr. ) erreur à corriger dans cet article
de 1 Encyclopédie. Suppl. 1. 569. b.
ARRÀGON, ce royaume rendu en 1204 tributaire du
PfH- o 79r' ?,tf rcl.it Prononcé en 1282 fur l’Arragon.
VIII. 817. ¿. Code d Arragon.III. qyi.a. Jufticierd’Arralon.
IX. 101. a.
ARRAKAN, royaume de l’Inde. Idole qu’on y adore.
XIII. 708. b. Prêtres idolâtres de ce royaume. 833 .a.
/ AR-RAKIN, ( Géogr.) petite ville d’Afie dans l’Arabie
Ferrée. On croit que c eft l’ancienne Perra. Origine & fieni-
fication de fon nom moderne. Suppl. I. 369. b.
ARRAS, plufieurs habitans de cette viile furent, en 14en
accufés de fortilege. XV. 370. b. 371. a. Circonvallation que
ADÏ?n0*s firent en 1634 nu fiege d’Arras. III. 463. a.
AKREPHORIE, (Myth. ) fête des Athéniens en l’honneur
Tome I.
mot Arrepnor&ie. I. 7H0c3r.6î e. > fflle de Cicrcprs . Etay molobgie du
jUlRÉkAGES on ne peut demander au-delà de vingt-
neuf années d arrérages d'une rente foncière, ni nlus de dnn
dune rente conftituee. Manière de calculer la femme du^
au bout d un certain nombre d’années, lorfque l'intérii eft
S gpE g g lo r fq u ’ileft compofé.I. 705-4.Réponfesàquelqnes
difficultés auxquelles a donné lieu le calcul précèdent I
707. a.
ARRESTIER de plomb, (Archit.) XII. 778. b. Arreftier.
Suppl. II. 647. a , b. 648. b.
ARRET, (terme de Palais) les arrêts ont été expédiés en
latin jufqu’à François I. I. 707. a.
Arrêts en robe rouge. I. 707. a. Arrêts de réglemens. Ibid. b.
Arrêt de défenfe ; arrêt du confeil du roi. L 707. ¿.
Arrêt 6* brandon. I. 707. b.
A rrê t , ( terme de Palais ) décifion d’un tribunal fouve-
raui, de laquelle il n’eft pas permis d’appeller. Origine de
ce mot. Formule dont le premier préfident d’une cour fou-
veraine fe fervoit autrefois en rendant un arrêt. Celle qui
eft employée aujourd’hui. Voie à fuivre pour faire réformer
w décifion d un tribunal fouverain en matière civile. Voyez
C a s sa t io n , O p po s it io n & R equête c iv il e • & en
matière criminelle, voyez R év ision. Ce qu’on entend par
jurifprudence des arrêts. Compilations d’arrêts. Obfervations
fur un ouvrage intitulé, Diêlionnaire des arrêts. Suppl. I. «J0
b. 370. a. ’
Arrêt »termes dans lefquels étoient conçus les arrêts du
fénat de Rome. Lieu où ces arrêts étoient dépofés. Droit de
les faire que s’attribua Céfar. XIV. 736. a. Jurifprudence des
arrêts. IX. 82. b. Arrêts rendus par le roi en fon confeil
de fon propre mouvement. X. 842. b. Formalités obfervées
autrefois dans la prononciation des arrêts & jugemens des
enquêtes. XII. 2. b. Ce qu’on doit faire lorfqu’il y a contrariété
entre deux arrêts. VIII. 833. b. Contrôle des arrêts
au jparlemenr. IV. 148. b. Oppofition à un arrêt. XI. 3 1, a
Refcifion d’un arrêt. XIV. 166. b. Chef d’un arrêt. III. 271. à.
Clerc des arrêts. 324. a. Arrêt en commandement. 686 b
Contrariété d’arrêts. IV. 122. a. Arrêt de défenfes 7 à
Ville d’arrêt. XVII. 279. ¿. 737* *
A rrêts , ( Difcip. milit. ) punition qui s’inflige à l’officier
pour des fautes légères. Quelquefois les arrêts font précaution
de la part du commandant, & non pas châtiment. Les
arrêts n’ont rien de deshonorant. Réflexions fur cette bizarrerie
de l’opinion publique, qui imprime une tache au malheureux
citoyen que la calomnie aura fait précipiter dans
une prifon, dont il eft innocent. Moyen de corriger cette
forte d’injuftice. Suppl. I. 370. a. — Voyez A c c u s é
de vaijfeaux 6* femeture de ports. 1. 707. b.
A r r ê t , ( Manège ) comment if faut former l’arrêt du
cheval ; arrêt formé de mauvaife grâce. Danger de former
des arrêts courts & précipités. Demi-arrêt. L 707. b.
Arrêt. Le cheval obéiflant au partir doit également être
fournis à l’arrêt. Comment on doit Vy amener graduellement.
V. 240. b. Chevaux qui confenrenr trop aifément à l ’arrêt *
quoique réfolus& déterminés. 241. ¿.
A rrê t , terme de chaffe, de riviere, de ferrurerie. I
707. b.
A r r ê t * ^Msréch' ) Suppl‘ 4 I3‘ & ci-deffous
,.iA RRÊ^ :"BCEUF» ( Botan- ) «oms de cette plante en
différentes langues. Ses caratares génériques. Enumération
de leize efpeces renfermées dans ce genre. Obfervations fur
la maniéré de les multiplier & de les cultiver. Etymologie des
noms grecs & françois de cette plante. Suppl. 1. c70 ¿ &
371. a,b.
Arrête-boeuf, caratares de ce genre de plante. L 707. ¿.
Son analyfe. On compte fa racine parmi les cinq apéritives.
Ses vertus en médecine. Ibid. 708. a.
A r rê tes , ou queue de rat, (Maréch. ) maladie des
jambes des chevaux. Defcription. Remede. Suppl. L 371. a.
Voye^ ci-deflus A rrête.
ARRÊTIER, (Archit.) voyezArrestier.
ARRHER, ( Comm. ) 011 enharrer, donner des arrhes.
Défenfes d’arrher dans certains cas 8c à certaines perfonnes.
1.708. b.
ARRHES* ( Jurifp. ) ce que deviennent les arrhes', fi le
marché eft conlommé ou s’il eft rompu. Dans certains cas la
perte des arrhes ne fuflit.pas pour la décharge. 1 .708. b.
Arrhes, différence entre les arrhes & le denier à Dieu. IV.
826. a. Des arrhes concernant le mariage. IV. 879. b. Arrhe-'
ment ou enarrhement. V. 604. b.
ARRIA, femme de Poetus: éloge de fon courage. IV.
374-*•
ARRIAGA, (Rodriguez) fameux jéfuite. Obfervations fur.
fes ouvrages. IX. 643. b. 1. 664. b.
o de Nicomédie: obfervations fur ce philofophe
& fur les ouvrages. XI. 136. b. Son périple ou journal de
navigatipn. XII. 376. b. Relation de ion voyage fur le