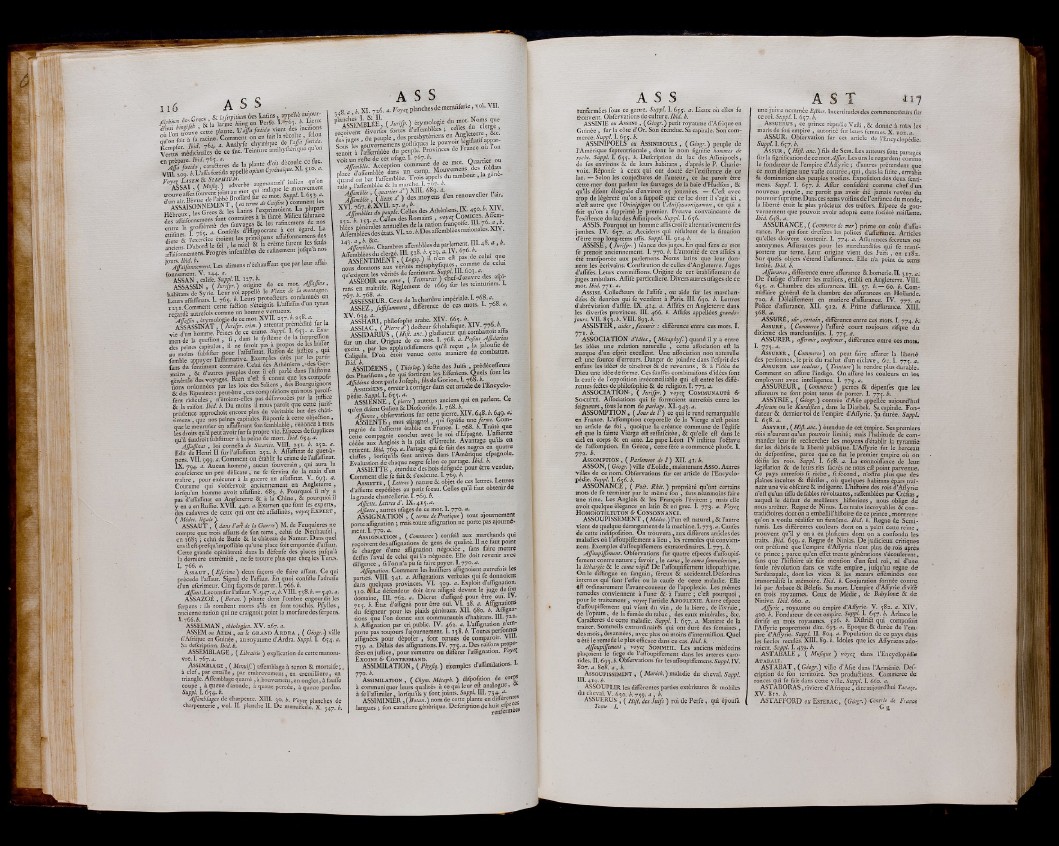
A S S
Uftrm ùim'fo s taons , appettéanjonrl
l 6
quonfcit Analyfe chymique de 1 a p fonda.
S g Ê t i Ê ï ï i m ? ce fuc. Teint3;,re anrihyfténtpe quon
^ Ê j Ê Ë ? U f e de la Plante d'on d é c o ÿ ce fuc
VIÎL 209. 4;L’affafoetida appelléop» Cyrmaup,.XI. 5 10 ..
tro u v e afcfouTentjom'a j ^ a . mot. | | ¡ j g I.653.a.
"rcïilCONNEMENT, (ta urm, i ' Culfinr) comment les
ASSAISO Latins l’exprimoient. La plupart
? ibT fd em e n s font contraires à \ i famé. Milieu falutanre
des aifaifonnemens 10 g¿ ies rafinemens de nos
* « fÜ F U Y “■ Confeüs dllippocrate à cet égard. La
l’cxarcice êtoientles principaux aflà.fonnemens des
•nVns D’abord le fel , le miel & la crème furent les feuls
Sunemens-Progrès infeniibles de rafinement jnfquànos
^AJfaifimèmeni. Les alimens n’èchauffent que par leur aflai-
fonnement. V . 244. a.
ASSAN , calife. Suppl.IL 127. a.
ASSASSIN ( Juàfpr. ) origine de ce mot. Affajfuis,
habta£de Syrie. Leur roi appellé 1= VU*x ic ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ g
Leurs affaffmats. 1. 76;. 4. Leurs protefteurs condamnés en
1221. Comment cette ftétion s’éteigtut. L affaffin d un tyran
regarde autrefois comme un homme vertueux.
AITa/Tm , étymologie de ce mot. XVII. 257. 4. 258. a.
ASSASSINAT, Çjurijpr. crim.) attentat premédtté fur la
vie d’un homme. Peines de ce crime. Suffi. I. t e “■ “ a
men dé la queffion , ft, dans le fyftême de l? f!WÇ®on
des peines capitales , il ne feroit pas a propos de les huiler
au moins fubfdter pour l’affaffmat. Ratfon de juftice qui
femble appuyer l'affirmative.^Exemples Çttés par 1«_?MU-
1 fentin
mains , 8c d’autres peuples dont il eft parlé dans 1 hiftoire
oènèrâîe des voyages. Rien n’eft fi connu que les compou-
tons ordonnées par les lont desSaliens , des Bourguignons
& des Ripuaires : peut-être, ces çompofitions qui nous paroil-
fent ridicules , n étoient-elles pas défavouées par la jultice
8c,la raifon. Ibid. b. Du moins il nous paroît que cette jurii-
prùdence approchoit encore plus du véritable but des chati-
üniens , que nos peines capitales. Réponfe à cette objeéhon,
que le meurtrier en affaflinant ion femblable, renonce à tous
les droits qu’Ü peut avoir fur fa propre vie. Efpeces de fuppüces
qu’il feudroit iubftituer à la peine de mort. Ibid. 654. a.
m as: agNSMi * r°n AccepriOT Mmmrne de ce mon Q u a r tie r ||
jijfaJJmat , loi cornelia de Sicariïs. VIII. 251. b. 252. a.
Edit de Henri II fur l’affaffinat. 232. b. Aflaflinat de guet-apens.
VII. 999. a. Comment on établit le crime de l’affaffinat.
IX. 794. a. Aucun homme, aucun fouverain , qui aura^ la
confcience un peu délicate, ne fe fervira de la main d un
traître, pour exécuter à la guerre un aflàffinat. V. 693. a.
Coutume qui s’obfervoit anciennement en Angleterre,
lorfqu’un homme avoit affaffmé. 68 3. b. Pourquoi il n’y a
pas d’affaffmat en Angleterre & à la Chine, & pourquoi il
y en a enRuflie. XVU. 440. a. Examen que font les experts,
des cadavres de ceux qui ont été affaffmés, voye[ Ex p ert ,
| Midec. légale ).
ASSAUT , ( dans l ’art de la Guerre) M. de Feuquieres ne
compte que trois affauts de fon teins, celui de Neuhaufel,
en 1683 ; celui de Bude 8c le château de Namur. Dans quel
cas il eit-prefqu’impoflible qu’une place foit emportée d’aflaut.
Cette grande opiniâtreté dans la défenfe des places jufqu’à
la derniere extrémité , ne fe trouve plus que cneçles Turcs.
I, 766. a. /
A s sau t , ( Eferme) deux façons de faire affaut. Ce qui
précédé l’affaut. Signal de l’affaut. En quoi confifte l’adreife
«d’un eferimeur. Cinq façons de parer. 1. 766. b.
Affaut. Leçons fur l’affaut. V. 947. a, ¿.VIII. 538^.-— 540. a.
ASSAZOÉ, ( Bot an. ) plante dont l’ombre engourdit les
ferpens : ils tombent morts s’ils en font touchés. Piylles,
ancienne nation qui ne craignoit point la morfure des ferpens.
1.766. b.
ASSELMAN , théologien. XV. 267. a.
ASSEM ou A zem , ou le GRAND A r d r a , ( Géogr..) ville
d’Afrique en Guinée, au royaume d’Ardra. Suppl. L 654. a.
Sa defçription. Ibid. b.
ASSEMBLAGE, ( Librairie ) explication de cette manoeuvre.
1 .767. a.
Assemblage , ( Menuif.) affemblage à tenon & mortaife ; ,
à clef, par entaille, par embrevement, en cremilliere, en
triangle. Auemblage quarré , à bouveinent, en onglet, à faillie
coupe, à queue d aronde, à queue percée, à queue perdue.
Suppl.l.ô'tf.b.
AffmUagts de chmpemc. XIII. jo . 4. Voyc, planches de
charpenterie, vol. n. planche II. De menuiferie. X. 347. b.
A S S
3 48 4, 4. XI. 726.4. Voy 'i planches de menmfene, vol. VII.
‘" A s s em b l é " ;
dupeuple°des
raie , l’affentblée & lamarche. L 767. 4.
Jl f aMi c, ) d e s m0Jens d’e n r e n o u v e l l e r r a i r ’ x^A"feJ:èrdesAthé"ie“
A l l é e s des états. VL 20. i.Des affemblees nattonales. XIV.
l % lm b & s .Chamhresaffembléesdnparlement IH.48. 4 . 4.
Affemblées du clergé. IH. î 28.4. 519 .4. IV. 67 . .
ASSENTIMENT, (Logiq.) S nen eft pas tle cetm que
mÊÈÈÊÊËmÊSÊÊMmde c1e,m ranTen mritrïe. Règlement de ,¿69 ® «trrmners. I.
"^ASSESSEUR. Ceux de la chambre Impériale. 1.768. a.
ASSEZ, fiiffifammcnt, différence de ces mots. I. 768. a.
X ASSEIARI, philofophe arabe. XIV. 665. 4.
ASSIAC, ( Pierre d’ ) dofteur fcholalhque. XIV. 776. b.
ASSIDARIUS , ( Hift. anc.) gladiateur qmcombattoitallis
fur un char. Origine de ce mot. I. 768. Pofius Affidaruu
excita , par les applaudiffemens quil reçut , la ploufiede
Caligula, D’où étoit venue cette mamere de combattre.
^ASSIDÉENS , ( Tkéolog.) fefte des Juifs , Prédéceffeurs
des Pharifiens, de qui fortirent les Effemens. Quels font les
Aflidèens dont parle Jofeph, fils de Gonon. 1. 768. b.
Assidéens , erreur à corriger dans cet article de 1 Encyclo?
A SSIGNE , ^pierre ) auteurs anciens qui en parlent. Ce
qu’en difent Galien & Diofcoride. I. 768.
AiHenne, obfervations fur cette pierre. XTV. 648. ¿.649-^
ASSIENTE, mot efpagnol, qui fignifie une ferme, compagnie
de M e n te établie en France. I. 768. b. Traité que
cette compagnie conclut avec le roi dEfpagne. Lamente
cédée aux Anglois à la paix d’ütrecht. Avantage quils en
retirent. Ibid. 769. a. Partage qui fe fait des negres en quatre
daffes , lorfqu’ils font arrivés dans l’Amérique efpagnole.
Evaluation de chaque negre félon ce partage. Ibid. 4.
ASSIETTE , étendue des bois défignèe pour être vendue.
Comment elle fe fait & s’exécute. 1. 769.4.
Assiette , ( Lettres ) nature 8c objet de ces lettres. Lettres
A S SIETTE , l LXUTCS ) » .u n is . s*.------------------------ --------- -
d’affiette expédiées ■ j. » . . au . . . petit r fceau. f Celles ' . l l . e qu mi’ il !) A faut n r obtenir A n tpn ir n de
i
la grande chancellerie. 1.769. b.
AJJiette. Lettres d’. IX. 413. a.
AJJiette, autres ufages de ce mot. 1 .770. a.
ASSIGNATION , ( terme de Pratique) tout ajournement
porte afTignation ; mais toute aifignarion ne porte pas ajourné»
ment.1.770. a. . . . . . . , .
A s signa tion , ( Commerce ) confeil aux marchands qui
reçoivent des affignations de gens de qualité. Il ne faut point
fe charger d’une aifignarion négociée , fans faire mettrç
deffus l’aval de celui qui l’a négociée. Elle doit revenir avec
diligence , fi l’on n’a pu fe faire payer. L77C». a.
Ajjignation. Comment les huiffiers affignoient autrefois les
parties. VIII. 341. a. Affignations verbales qui fe donnoient
dans quelques provinces. VI. 309. a. Exploit d’aflignarion.
310. ¿vLe défendeur doit être afligné devant le juge de fon
domaine, III, 762. a. Décret d’afligné pour- être ouï. IV.
713. b. État d’affigné pour être ouï. v l. 28. a. Afljgnations
du feigneur pour les plaids généraux. XII. 680. b. Affignations
que l’on donne aux communautés d’habitans. III. 7**«
b. Aifignarion par cri public. IV. 462. a. L’affignation n’emporte
pas toujours l’ajournement. 1. 138. b. Toutes perfonnes
afiignées pour dépofer , font tenues de comparoir. VIU*
739. a. Délais des affignations. IV. 775. <1. Des raifons propo*
fées en juftice, pour remettre ou différer l’affignation. Voyt[
EXOINE & CONTREMAND. T
ASSIMILATION, ( Phyfiq,,) exemples d’aflimilations. L
770. b.
A ssimilation , ( Chym. Mitaph. ) difpofition de corp
à communiquer leurs qualités à ce qui leur eft analogue,
à fel’affimiler, lorfqu’ils y font joints. Suppl. III. 734»*•
ASSIMINIER, (Botan.) nom de cette plante en différente
langues; fon caraftere générique. Defçription de huit eip^
A S S
renfermées fous ce genre. Suppl. 1. 655. a. Lieux où elles fe
trouvent. Obfervations de culture. Ibid. b.
ASSINIE ou A ssini , (Géogr.) petit royaume d’Afrique en
Guinée, fur la côte d’Or. Son étendue. Sa capitale. Son commerce.
Suppl. 1. 655. b.
ASSINlPOELS ou A sSiNib ouls , ( Géogr. ) peuple de
l ’Amérique feptentrionalè, dont le nom fignifie hommes de
roche. Suppl. I. 655. b. Defçription du lac des Alfinipoels,
de fes environs oc de leurs habitans , d'après le P. Charle-
voix. Réponfe à cèux qui ont douté de* l’exiftence de ce
lac. — Selon les conjetures dè l’auteur, ce lac paroît être
Cette mer dont parlent les fauvages de la baie d’Hudfon, 8c
qu’ils difent éloignée d’environ 25 journées. — C’eft avec
trop de légéreté qu’on a fuppofé que ce lac dont il s’agit ic i,
n’eu autre que VOninipigon ou VAnifquaonigamon, ce qui a
fait qu’on a fupprimé le premier. Preuve convaincante de
l’exiftence du lac des Alfinipoels. Suppl. I. 6ç6.
ASSIS. Pourquoi un homme aflis croife alternativement fes
jambes. IV. 657. a. Accidens qui réfultent de la fituation
d’être trop long-tems affis. Suppl. II. 914. b.
ASSISE, ( Jurifpr. ) féance des juges. En quel fens ce mot
fe prenoit anciennement. I. 770. b. L’autorité de ces affifes a
été tranfportée aux parlemens. Noms latins que leur donnent
les écrivains.' Conftitution de celles d’Angleterre. Juges
d’affifes. Leurs commiffions. Origine de cet êtablifïemënt de
juges ambulans. Affife particulière. Divers autres ufages dé ce
mot. Ibid. 771. a.
A ssise. Collefteurs de l’affife, ou aide fur les marChaU-
difes 8c denrées qui fe vendent à Paris. III. 630. b. Lettres
d’abréviation d’aflue. IX. 414. a. Affifes en Angleterre dans
les diverfes provinces. III. 466. b. Affifes appellées grands-
jours. VII. 853. b. VIII. 893. b.
ASSISTER, aider, feçourir : différence entre ces mots. I.
771. b.
ASSOCIATION d’idées, (Métaphyf. ) quand il y a entre
les idées une relation naturelle , cette affociation eft là
marque d’un efprit excellent. Une affociation non naturelle
eft une fource d’erreurs. Danger de joindre dans l’efprit des
enfàns les idées de ténebres 8c de révenanS, 8c à l’idée de
Dieu une idée de forme. Ces faufles combinaifons d’idées font
la caufe de.l’oppoflrion irréconciliable qui eft entre les différentes
feétes dephilofophie 8c de religion. I. 772.a.
ASSOCIATION-, ( Jurifpr.) voye{ C ommunauté 6*
S ociété. Affociations qui fe formoient autrefois entre les
feigneurs, fous le nom de pariage. XI. 943. a.
ASSOMPTION, ( Jour de V ) ce qui le rend remarquable
en France. L’affomption corporelle de la Vierge n’eft point
un article de foi , quoique la créance commune de l’églife
eft que la fainte Vierge eft reffufeitée, 8c qu’elle eft dans le
ciel en corps 8c en ame. Le pape Léon IV inftitua l’oftave
de l’affomption. En Grece, cette fête a commencé plutôt. I.
772. b.
A s s om p t io n , ( Parlement de F) x n . 4î£ b.
ASSON, ( Géogr. ) ville d’Eolide, maintenant Asso. Autres
villes de ce nom» Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. I. 6c6. b.
ASSONANCE, ( Poéi. Rhét. ) propriété qu’ônt certains
mots de fe terminer par le même ion , fans néanmoins faire
une rime. Les Anglois 8c les François l’évitent ; mais elle
avoit quelque élégance en latin 8c en grec. I. 773. a. Voyc{
H om o io te le u to n 6* C o n so n n a n c e .
ASSOUPISSEMENT, (Médec.) l’un eft naturel, 8c l’autre
vient de quelque dérangement de la machine. 1. 773 » a. Califes
de cette indifpofirion. On trouvera, aux différens articles des
maladies où l’affoupiffement a lieu , les remedes qui conviennent.
Exemples d’affoupiffemens extraordinaires. 1. 773. b.
Affoupïfjemcnt. Obfervations fur quatre efpeces d’affoupif-
fement contre nature ; favoir, le carus , le coma fomnolentum,
la léthargie 8c le coma vigif. De l’affoupiffement idiopathique.
On le diftingue en fanguin, féreux 8c accidentel. Défordres
internes qui font l’effet ou la caufe de cette maladie. Elle
éft ordinairement l’avant-coureur de l’apoplexie. Les piêmes
remedes conviennent à l’une 8c- à l’autre ; c’eft pourquoi,
pour le traitement', voyeç l’article A p o p le x ie . Autre efpece
d’affoupiffement qui vient du vin , .de la biere, de l’ivraie,
de l’opium, de la fumée du tabac, des eaux minérales, 8cc.
Carafteres de cette maladie. Suppl. I. 657. a. Maniere de la
traiter. Sommeils extrordinairês qui ont duré des femaines ,
des mois, des années, avec plus ou moins d’intermiffion. Quel
a été le remede le plus efficace dans ce cas. Ibid. b. .
AJfoupiJftment, voye^ .Sommeil. Les anciens médecins
plaçoient le fiege de l’affoupiffement dans les arteres carotides.
II. 693. b. Obfervations fur les affoupiffemens. Suppl. IV.
807. a. 808. a y b.
A ssoupissement, ( Maréch. ) maladie du cheval. Suppl.
n i. 410 .b.
ASSOUPLIR les différentes parties extérieures 8c mobiles
du cheval. V. 630. b. 759. a , b.
ASSUERUS , ( Hift. des Juifs ) roi de Perfe , qui époufà
. Tome I.
A S T i i?
une juive nommée Efthcr. Incertitudes des commentateurs fur
ce roi. Suppl. 1. 637. bi
Assueeus , ce prince répudie Valu | & donhe à tohs les
maris de fori empire , autorité fur leurs femmes. X. 102. a.
ASSUR» Obfervation fur cet article de l’Encyclopédie
Suppl. 1. 637. ¿4
A ssu r , (Hifli and) fils de Sem. Les auteurs foht partagés
fur la bonification de ce mot Affur. Les uns le regardent comme
le fondateur de l’empire d’Affyrie ; d’autres prétendent que
ce nom défigne une vafte contréequi, dans la fuite, envahit
la domination des peuples yoifins. Expofition des deux fenti-
mens. Suppl. I. 637. b. Affur confidéré comme chef d’un
nouveau peuple, ne paroît pas avoir été jamais revêtu du
pouvoir fuprême. Dans ces tems voifins de l’enfànce du monde,
la liberté étoit le plus précieux des tréfors. Eijjece de gouvernement
que pouvoit avoir adopté cette fociété naiftante.
Ibid. 638. a.
ASSURANCE,! Commerce de mer) prime ou coût d’affu-
fance. Par qui font dreffées les polices d’affutëmce. Articles
qu’elles doivent contenir. I. 774» a. Affurances fecretes oit
anonymes. Affurances pour les marchandifes qui fe transportent
par ferre- Leur origine vient des Juits , en 1182.
Sur quels objets s’étend l’aiîurance. Elle n’a point de tems
limite. Ibid. b.
AJfurancc, différence entre affurance 8c bortierie.il. 317. ai
De l’ufage d’affurer les maifons, établi en Angleterre. VIII.
643. a. Chambre des affurances. III.. 37. b. — 60. b. Com-;
miffaire général de la chambre des affurances en Hollande^
10. b. Délaiffement en matière d’affurance. IV. 777. at
oljce d’affurance. XII. 912. b. Prime d’affuranCe. XIII.
368. a
ASSURÉ, sûr, certain, différence entre Ces mots. I. 774. b.
3 A ssuré ÿ ( Commerce ) l’affuré court toujours rifque du
dixiemé des marchandifes. I. 773. a.
ASSURER, affermir, confirmer, différence entre ces mots.'
1 .7 7 3 .* .
A s s u r e r , ( Commerce ) on peut faire affurer là liberté
des perfonnes, le prix du rachat d’un efclave, &c. I. 773. a.
A S SU R E R une couleur, (TeintureS la rendre plus durable.
Comment on affure l’indigo. On allure les couleurs en les
employant avec intelligence. I. 775. a.
ASSUREUR, ( Commerce) pertes 8c dépenfes que les
affureurs ne font point tenus de porter. I. 773. ¿»
ASSYRIE, (Géogr,) contrée d’Afie appeuée aujourd’hui
Arferum ou le Kurdiftan * dans le Diarbek. Sa capitale. Fon*.
dateur 8c dernier toi de l’empire d’Affyrie. Sa durée. SupplJ
A s s y r ie , ( Hift, ahé. ) étenduè de ¿et empire. Ses premiers
iôië n’eurent au’un pouvoir limité; mais l’habitude de commander
leur fit rechercher les moyens d’établir la tyrannie
furies débris de la liberté publique. L’Aflyrie fût le berceau
du defpôtifme, parce que ce fut le premier empire où on
déifia les rois. Suppl. I. 638. a. La connoiffance de leur
légiflation 8t de leurs rits facrés ne nous çft point parvenue.
Ce pays autrefois fi riche, fi fécond, n’offre plus que des
plaines incultes 8c ftériles, où quelques habitans épars traînent
une vie ôbfciire 8c indigente. L’mftojre des rois d’Affyrie
n’eft qu’un tiffu de fables révoltantes, raffemblées par Ctéfias ,
auquel le défaut de meilleurs hiftoriens, nous oblige de
nous arrêter. Regne de Ninus» Les traits incroyables 8c con-
tradiéloires dont on a embelli l’hiftoire de ce prince /montrent -
qu’on a voulu réalifer un fantôme» Ibid» b. Règne de Semi-
famis. Les différentes couleurs dont on a peint cette reine ,
prouvent qii’il y en a eu plufieurs dont on à confondu les
traits. Ibid. 639. a. Régne de Ninias. De judicieux critiques
ont préfumé que l’empire d’Affyrie n’eut plus de rois après
ce prince ; parce qu’en effet trente générations s’écoulèrent,
fans que l’hiftoire ait fait mention d’un feul roi, ni d’une
feule révolution dans ce vafte empire, jufqu’au regne de
Sardanapale, dont les vices 8c les moeurs efféminées ont
immortalifé la mémoire. Ibid. b. Conjuration formée contre
lui par Arbace 8c Bélefis. Sa mort. L’empire d’Affyrie. divifô
én trois royaumes. Ceux de Médie, de Babylone 8c de
NiniVe. Ibid. 660. a.
Affyrie ÿ royaume où empire d’Afiyrie» V. 382. a. XIV.
420. b. Fondateur de cet empire. Suppl. I. 637. ¿» Arhace le
divife en trois royaumes. 316. b. Diftrift qm compofoit
l’Aflyrie proprement dite. 693. a. Epoque 8c durée de l’empire
d’Afiyrie. Suppl. II. 804. a. Population de ce pays dari9
les fieclcs reculés. XIII. 89. b. Idoles que les Aflyriens ado-
roient. Suppl. L 439. b.
ASTABALE , ( Mufique ) vàye[ dans l’Encyclopédie
A ta b a le .
ASTABAT, (Géogr.) ville d’Afie dans l’Arménie. Def-
cription' de fon territoire. Ses productions. Coniirieree de
ronces qui fe fait dans cette ville. Suppl. I. 660. a.
ASTABORAS , rivicre d’Afrique, dite aujourd’hui Tac are.
XV. 812.b.
ASTAFFORD ou EsterAC, (Géogr.) Contrée de France