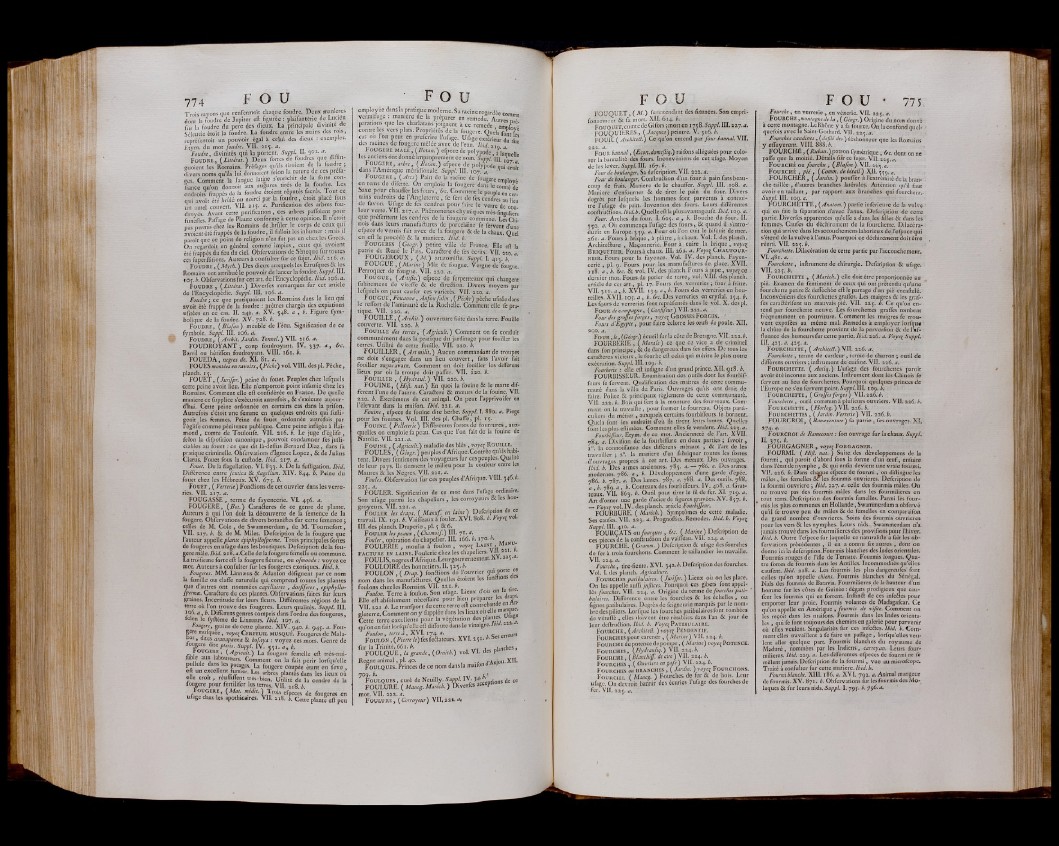
774 F O U
Trois rayons que renfermoit chaque foudre. Deux manieres
dont la foudre de Jupiter eft figurée : plaifanterie de Lucién
fur la foudre du pcre des dieux. La principale divinité de
Séleùcie étoit la foudre. La foudre entre les mains des rois,
repréientoit un pouvoir égal à celui des dieux : exemples.
£tym. du mot foudre. VIL. 215. a.
Foudre, divinités qui la portent. Suppl. II. 902. a.
F o u d r e , (L itté ra l.) Deux fortes de foudres que diftin-
guoient les Romains. Préfages qu’ils tiroient de la foudre;
divers noms qu’ils lui.donnoient félon la nature de ces préfa-
g « . Comment 15 /angue latine s'cnndm de la.-Cotte eon-
liancé qu’on donnoit aux augures tirés de la foudre. Les
endroits frappés de la foudre éto.ent réputés facrés. Tout ce
qui avoit été brûlé ou notre, par la foudre, étott placé fous
tin autel couvert. VII. p® e. Purification des arbres fou-
droyés. Avant cette purification, ces arbres pafloient pour
funefles. Partage de Plaute conforme à cette opinion. Il ri etoit
pas permis chez les Romains de .brûler le corns de ceux qui
avoienr été frappés de la foudre, il falloir les inhumer : mais il
paroît que ce point de religion n’en fut pas un chez les Grecs.
On regardoi.t en général comme impies, ceux qui avoient
été frappés du feu du ciel. Ôbfcrvations de Séneque fur toutes
ces fuperftitions. Auteurs à corifulter fur ce fujet. Ibid. 216. a.
F oudre , ( Myth. ) Des dieux auxquels les Etrufques 8c les
Romains ontattribué le pouvoir de lancer la foudre. Suppl. III.
to<. b. Obfervations fur cet art. de l’Encyclopédie. Ibid. 106. a.
Fo u d r e , (Litté ra l.) Divcrfcs remarques fur cet article
de l’Encyclopédie. Suppl. III. 106. a.
Foudre; ce que pratiquoient les Romains dans le lieu qui
avoit été frappe de la foudre .* prêtres chargés des expiations
ufitées en ce cas. 11. | | | a. X V . 548. a , b. Figure fym-
bolique de la foudre. XV . 728. b.
Foudre , ( Blafon ) meuble de l’écu. Signification de ce
iymbolc. Suppl. III. 106. a.
Foud re, ( Arc hit. Jardin. Tonnel.) VII. 1 16 . a.
FOU D ROYAN T , coup foudroyant. IV . 337. a , &c.
Barril ou hérifion foudroyant. VIII. 161. b.
FO U ED A , negres de. X i. 81. a.
FOUES montées en ravoirs, ( Pêche) vol. VIII. des pl. Pêche,
planch. zc.
FO U E T , ( Jurifpr. ) peine du fouet. Peuples chez lefqucls
cette peine avoit lieu. Elle n’emportoit point infamie chez les
Romains. Comment elle eil confidérée en France. D é quelle
maniere ce fupplicc s’exécutoit autrefois, & s’exécute aujourd’hui.
Cette peine ordonnée en certains cas dans la prifon.
Autrefois c’étoit une femme en quelques endroits qui fufti-
geoit les femmes. Peine du fouet ordonnée autrefois par
féglifc comme pénitence publique. Cette peine infligée à Kai-
mond, comte de Touloufe. VII. 216. b. Le juge d’égüfc,
félon la difpofition canonique, pouvoir condamner fes jufti-
ciables au fouet : ce que dit là-deffus Bernard D ia z , dans fa
pratique criminelle. Obfervations d’Ignace L opc z, 8c de Julius
Clams. Fouet fous la cuflode. Ibid. 217. a.
Fouet. De la flagellation. V I. 833. b. De la fumigation. Ibid.
Différence entre Jcutica 8cJlagellum. XIV. 844. b. Peine du
fouet chez les Hébreux. X V . 675. b.
Fouet , ( Verrerie) Fondions de cet ouvrier dans les verreries.
VII. 217. a.
FOU GA SSE, terme de faycncerie. V I. 456. a.
FOUGERE, (B o t . ) Caracteres de ce genre de plante.
Auteurs & qui l’on doit la découverte de la femcncc de la
fougère. Obfervations de divers botaniflcs fur cette femcncc ;
celles de M. C o le , de Swammerdam, de M. Tournefort,
VII. 217. b. 8c de M. Miles. Defcription de la fougere que
l’auteur appelle plante épiphyllofperme. Trois principales fortes
de fougères en ufage dans les boutiques. Defcriptiori delà fougère
mal t . ibid. 218. ¿.Celle de la fougere femelle ou commune,
-a troifteme forte cil la fougere fleurie, ou ofmonde : vo yez ce
mot. Auteurs à confulter fur les fougères exotiques. Ibid. b.
Fougeres. MM. Linnæus 8c Adanlon défignent par ce nom
la famille ou darte naturelle qui comprend toutes les plantes
que d’autres ont nommées capillaires , dorfiferes, eptphyllo-
fpermet. Cara&ere de ces plantes. Obfervations, faites fur leurs
graines. Incertitude fur leurs fleurs. Différentes régions de la
terre où l’on trouve des fougeres. Leurs qualités. Suppl. III.
106, a , b. Différons genres compris dans l’ordre des fougeres,
félon le fyftéme de Linnæus. Ibid. 107. a.
Fougere, graine de cette plante. XIV. 940. b. 943. a. Fougère
mufquee, voye{ C erfeuil musqué. Fougères de Malabar
, dites aranapanna & bofaya : vo y ez ces mots. Genre de
fougère dite pteris. Suppl. W . eçx. a , b.
r u l 0 n.?vEIïEu W Ê Ê B Ê La fougere femelle eil três-nui-
11 1 4 tab®ur*ur8. Comment on la fait périr lorfqu’clle
pullule dans 1« pacage,. La fougere coupée étant en feve ,
eft un excellent fumier. Le, arbre, plantffdan, le, lieux où
elle c ro ît, réufliffent ire,-bien. Utilité de la cendre de la
fougere pour fertilifer les terres. VII 218 b
Po u g e r i , (A te . Wd«-) Trois ¿fpecis’j . ín
5e chez le , apothicaire,. VII. 118. t . Cette plante eft peu
ï ,
ufase
F O U
employée dans la prafmnc moderne. Sa racine regardée » .
vernutuge : manière t e la préparer en remedí. Autre,
parat.ons que les charlatan, joignent à ce remede, emoloSi
contre les vers plats. Propriétés de la fougere. Otiels I h H
ca, 0,1 l’on peut en preferiré l’nfage. U l f g e « & g g t g
des racines de fougere mêlée avec de l’eau. Ibid. 210 *
F o u g e b e m a le , ( Botan. ) efpcce de polypode, ä iaiíuel!.
les anciens ont donné improprement ce nom. Suppl III ,«
FOUGERE, arbre, (B o ta n .) efpcce de polypode ni.; Z
dans l’Amérique méridionale. Suppl. III. 107. *. • r
F o u g e r e , ( A n s ) Pain de la racine de fouecrccmnim,'
en tems de difette. On emploie la fougere dans le comté ^
Saxe pour chauffer les fours, &c. Comment le peuple en cor
tains endroits de l’Angleterre, fe fert de fes cendres au lie»
de favon. Ufage de fes cendres pour faire Je verre de couleur
verte. V i f 217. a. Phénomènes chymiqucs três-fmgulicrs
que préfentent les cendres de la fougere commune. Les Chinois
dans leurs manufactures de porcelaine fe fervent d’une
efpcce dé vernis fait avec de la fougere 8c de la chaux. Oucl
en eft le procédé jSc la maniere. Ibid. b. '
Fougeres (Géogr .) petite ville de France. F.llc eft la
patrie de René le Pais. Caraélere de fes écrits. VII. ¿kó à
FOUGEROUX , (M . ) anatomifte. Suppl. I, 41 3.
FO U G U E , (Ma rine ) Mât de fougue. Vergue de fougue.
Pcrroqucr de fougue. V i l . 220. a.
F o u g u e , (A r tïfic .) cfpece de ferpenteaux qui changent
fubitement de vîteffe 8c de dircélion. Divers moyens par
lcfouels on peut caufcr ces variétés. VII. 220. a.
rOUGUE, Fouanne, AnfouJalin , (P êch e) pêche ufitée dans
le reflbrt de l’amirauté de la Rochelle. Comment elle fe pratique.
VII. 220. a.
FOU ILL E , (A r c h it .) ouverture faite dans la terre. Fouille
couverte. VII. 220. b.
F ouille des terres, (Ag r icu lt.) Comment on fe conduit
communément dans la pratique du jardinage pour fouiller les
terres. Utilité de cette fouille. VII. 220. b.
FOU IL L ER , (A r tm i li t . ) Aucun commandant de troupes
ne doit s’engager dans un lieu couvert, fans l’avoir fait
fouiller auparavant. Comment on doit fouiller les différens ■
lieux par où la troupe doit paffer. VII. 220. b.
F ouiller , (H y d ra u l.) VII. 220. b.
FOU IN E , (H iß . n a t.) En quoi la fouine 8c le marte different
l’une de l’autre. Caraftere 8c moeurs de la fouine. VII.
220. b. Excrémens de cet anirqal. On peut l’apprivoifcr en
l’élevant dans la mnifon. Ibid. 221. a.
Fouine, efpece de fouine dite berbe. Suppl. I. 880. a. Picge
pour les fouines. Vol. III. des pl. Charte, pl. 13.
F ouine. ( Pelleterie ) Différentes fortes de fourrures, auxquelles
on emploie fa peau. Cas que l’on fait de la fouine de
Ñatolic. VII. 221. a.
F ouine , (Ag r icu lt.) maladie des b lés , voye[ Rouille.
FOU LE S , ( Géogr. ) peuples d’Afrique. Contrée qu’ils habitent.
Divers fentimens dés voyageurs fur ces peuples. Qualité
de leur pays. Ils tiennent le milieu pour la couleur entre les
Maures 8c les Nègres. V II. 221 .a .
Foules. Obfcrvation fur ces peuples d’Afrique. V III. 340.0.
22?. „ - ,. .
FOULER. Signification de ce mot dans l’ufage ordinaire.
Son ufage parmi les chapeliers , les corroyeurs 8c les hon-
groyeurs. VII. 221.0. . . ,
F ouler les draps. ( Manuf. en laine ) Defcription de c
travail. IX. 101. b. Vaifleaux à fouler. X VI. 808. b. Voye| vo
III. des planen. Draperie, pl. $ 8c 6.
F ouler les p ea u x , (Chamoif.) III. 71. a.
Fouler, opération du chapelier. III. 166. b. 170. b.
FOULERIE , moulin à foulon , g g l La în e , manu
fa c tu r e en laine. Foulerie chez les chapeliers. * '
FOULIS, negres d’Afrique. Leur gouvernement. XV. M5-a*
FOU LO IRE des bonnetiers. II. 3 2$, & . . r„
FO U LO N , (D r a p . ) fonftions de l’ouvrier qui porte ce
nom dans les manufaélures. Quelles étoient les fonftio
foulons chez les Romains. V IL 221. b. .
Foulon. Terre à foulon. Son ufage. Lieux d ou on » « ^
Elle eft abfolument néceffaire pour bien préparer 1« .
VII. 221 b. Le tranfport de cette terre eft contrebande en a
gleterre. Comment on y fupplée dans les lieux ou cl e q
Cette terre excellente pour la végétation des PIant**' ß
qu’on en fait lorfqu’elle eft diffoutc dans le vinaigre./««*22 '
Foulon, terre a , X V I . 174. a. __ c.««-reurf
F oulon , ( Pierre le ) fes fcáatcurs. XVI. 2 ç 1 • A Scs
for la Trinité. 66 1 . b. „lanches,
FO U LQ U E , la grande, (Orntth.) vol. VI. des P'an
Regne animal, pl. 40. 4’Anjou. XII.
F oulques. Princes de ce nom dans la maifon a
700. b.
Í o u l q u e s , curé de N cuilly. Suppl. P k M Ê L f rm r de 1
FOULURE. ( Mantg. Marich. ) Diverfi» acccP
mot. VII. 222. a.
F o u lu r e , (Corroyeur) V U .2 it -
FO U Q U E T , (M . ) furintendant des finances. Son empri-
fonnemcnt 8c fa mort. XII. 614. b.
Fouquet, comte de Gifors ; mort en 175 8. Suppl. III. 227. a.
FOUQUIERES, (Jacques) peintre. V. 316. b.
FOUR. ( Architeêl.) Ce qu’on entend par four bannaLMII.
2 F our bannal, (Econ.domejliq.) raifons alléguées pour colorer
la bannalité des fours. Inconvéniens de cet ufage. Moyen
de les IcVcr. Suppl. III. 167. b.
Four de boulanger. Sa defcription. VII. 222. a.
Four de boulanger. Conftruélion d’un four à pain fans beaucoup
de frais. Manière de le chauffer. Suppl. III. 108. a.
Manière d’enfourner 8c de tirer le pain du four. Divers
degrés par lefqucls les hommes font parvenus à connoi-
tre l’ufagc du pain. Invention des fours. Leurs différentes
conftruâions. Ibid. b. Quelle eft la plus avantngeufc. Ibid. 109. a.
Four. Arches du four. I. 6oç. a , b. Bouche du four. II.
350. a. Où commença l’ufage des fours ,_8c quand il s’intro-*
duifit en Europe. 3 59, a. Four où l’on cuit le bifeuit de mer.
a.61. a. Fours à brique, à plâtre , à chaux. Vol. I. des planch.
Architecture , Maçonnerie. Four à cuire la brique, voye{
BRIQUETIER. Fours,â chaux. III. 262. a. Voyer C haufournier.
Fours pour la fayence. Vol. IV. des planch. Fayen-
cerie , pl. 9. Fours, pour les manufactures de, glace. XVII.
118. a , b. b c . 8ç vol. IV. des planch. Fours à pipe, voye[ ce
dernier mot. Fours.du potier de terre, vol.^VlII. despÎanch.
article de cet a r t , pl. 17. Fours des verreries j four, à fritte.
VII. 311. a , b. XVII. 134. a , b. Fours des verreries en bouteilles.
XVII. 105 .* , b. &c. Des verreries en cryftal. 1^4. b.
Les fours de verreries font repréfemés dans le vol. X. des pl.
Fo ur de campagne, ( Confifeur) VII. 222. a.
Four des grojfes forges, voyez GROSSES FORGES.
Fours d'Egypte, pour faire éclorre les oeufs de poule. XII.
200. a. '
Fo ur , le , (Géogr.) écueil fur la côte de Bretagne. VII. 222. b.
FOURBERIE , ( Morale ) ce que ce vice a de criminel
dans fon principe, 8c de dangereux dans fes effets. D e tous les
caraéteres vicieux, le fourbe eft celui qui mérite le plus notre
exécration. Suppl. III. ioo. -é.
Fourberie : elle eft indigne d’un grand prince. XII. 918. A
FOURBISSEUR. Enumération des outils dont les fourbif-
feurs fe fervent. Qualification des maitres de cette communauté
dans la ville de Paris. Ouvrages qu’ils ont droit de
faire. Police 8c principaux réglemens de cette, communauté.
V II. 222. b. Bois qui fert à la monture des fourreaux. Comment
on le travaille , pour former le fourreau. Objets particuliers
du métier, auxquels, certains fourbiffeurs fe bornent.
Quels font les endroits d’où ils tirent leurs lames. Quelles
font les plus eftimées. Comment elles fe vendent. Ibid. 22\ .a .
Fourbiffeur. Etym. de ce mot. Ancienneté de l’art. XVII.
784. a. Divifion de la fourbiffurc en deux parties ; favoir ,
i° . la connoiflance des différens métaux , 8c l’art de les
travailler ; a0, la manière d’en fabriquer toutes les fortes
id’ouvragcs propres à cet art. Des métaux. Des ouvrages.
Ibid. b. Des armes anciennes. 785. a. — 786. a. Des armes
modernes. 786. a , b. Développemens d’une garde d’épée.
786. b. 787. a. Des lames. 787. a. 788. a. Des outils.788.
a , b. 789. a , b. Couteaux des fourbiffeurs. IV. 408. a. Grat-
teaux. V il. 863. b. Outil pour tirer le fil de fer. XI. 719. a.
Art d’orner une garde d’acier de figures gravées. XV. 85 7 . b.
— Voyet-vol. IV . des planch. article Fourbiffeur.
FOURBURE. (Ma réch.) Symptômes de cette maladie.
Ses caufes. VIL 223. a. Prognoftics. Remcdes. Ibid. b. Voye{
Suppl. III. 410. a. .
FOURÇATS ou fourques , &c. ( Marine) Defcription de
ces pièces de la co'nfttuélion du vaineau. V IL 224. a.
FOURCHE. ( Gramm.) Defcription 8c ufage des fourches
de fer à trois fourchons. Comment le taillandier les travaille.
Fourche,’ tire-fiente. XVI. 342. b. Defcription des fourches.
Vol. I. des planch. Agriculture. ,
Fourches patibulaires. (Jurifpr.) Lieux pu on les place.
On les appelle aufli juftices. Pourquoi ces gibets font appel-
lés fourches. V IL 224. a. Origine du terme de fourches patibulaires.
Différence entre les fourches 8c les échelles > ou
fignes patibulaires. Degrés de feigneurie marqués par le nombre
des piliers. Lorfquc les fourches patibulaires font tombées
de vétufté , elles doivent être rétablies dans l’an 8c jour de
leur deftruélion. Ibid. b. Voye{ Pa tibulaire.
Fo urche, (Architeêl. ) voyeç P endentif.
F ourches pour carencr , ( Marine ) VII. 224. b.
FOURCHE de potence de pompe, ( Marine) voyc[ POTENCE.
F ourches, ( Hydrauliq. ) V il. 224.b .
F o urche, (Blanchiff. de cire) VIL 224. b.
Fourches , ( Ouvriers en g ale) VII. 224 .b.
F ourches ou branches , ( Jardin. f x P y n Fourchons.
Fourche. ( Maneg. ) Fourches de fer 6c d e ‘bois. Leur
ufage. On devroit bannir des écuries l’ufage des fourches de
fer. VIL 225. a.
Fourche, en verrerie, en vénerie. VIL 22Ç. a.
F o u r c h e , montagne de la , (Géogr.) Origine du nom donné
à cette montagne. Le Rhône y a fa lource. On la confond quel- •
quefois avec le Saint-Gothard. VII, 225. a.
Fourches caudines, (défilé des) déshonneur que les domains
y effuyerent. VIII. 080.0.
FOU R CH É, (Ruban.) patron fymétrique, &c. dont on ne
paffe que la moitié. Détails fur ce fujet. V lL 225. a.
F ourché ou fou rch u , (B la fo n ) VIL.225.a.
F o u r c h é , p i é , (Comm. de bétail) XIL 339.«.
FOURCHER, (J a rd in .) pouffer à l’extrémité de la branche
taillée, d’autres branches latérales. Attention qu’il faut
avoir en taillant, par rapports aux brandies qui fourchent.-
Suppl. III. 109. a.
FOURCH ETTE, (Anatom.) partie inférieure de la vulve 1
qui en fait la féparatiOn d’avec l’anus. Defcription de cette
partie. Divcrfcs apparences qu’elfe a dans, les filles 8c dans les
femmes. Caufes du'déchirement de la fourchette. Dilacération
qui arrive dans les accouchemens laborieux de l’efpace qui
s’étend de la vulve à l’anus. Pourquoi cç déchirement doit être
réuni. VII. 223. b.
Fourchette. Dilacération de cette partie par l’accouchement.
VI. 481. ¿.
Fourchette , infiniment de chirurgie. Defcription 8c ufaee.
VII. 223. é.
Fourchette , (Maréch.) elle doit être proportionnée au
pié. Examen du fentiment de ceux qui ont prétendu qu’une
fourchette petite 8c dcfféchée eft le partage d’un pié cncaftclé.
Inconvéniens des fourchettes graffes. Les maigres 8c les greffes
caraélérifent un mauvais pié. VIL 223. b. C e qu’on entend
par fourchette neuve. Les fourchettes graffes tombent
fréquemment en pourriture. Comment les maigres fe trouvent
expofées au même mal. Remedes à employer lorfque
la chute de la fourchette provient de la perverfion 8c de 1 affluence
des humeurs fur cette partie. l^id.-226. a. Voyc{ Suppl.
III. 423.0. 423. a.
Fourchette, ( Architeêl.) VII. 226. a.,
Fourchette , terme de cardcur, terme-de charron ; outil de
différens ouvriers ; infiniment de cuifine. y i l . 226. a.
Fourchette. ( A n t iq .) L’ufage des fourchettes paroic
avoir été inconnu aux anciens. Inftrumcnt donc lés Chinois fe
fervent au lieu de fourchettes. Pourquoi quelques princes de
l’Europe ne s’en fervent point. Suppl. III. 109. o.
Fourchette, ( Grojfes forges ; VIL 27.61b. .
Fourchette , outil commun h pluficurs ouvriers. V IL 226. b.
F ourchette , (Horlog. ) VII. 226. b.
F ourchettes, (Jardin. Verrerie) V IL 2 2 6 .b.
FOURCROI, (Bonaventure) fa patrie, fes ouvrages. XI.
»74- 4* É I I
F ourcroi de Ramecourt : fon ouvrage fur la chaux. Suppl.
H. 3 75. b.
FOU RG AGN ER, voye^ F or gagner .
FOURMI. ( Hifl. nat. ) Suite, des développemens de la
fourmi, qui paroît d’abord fous la forme d’un oeuf, enfuite
dans l’état de nymphe, 8c qui enfin devient une vraie fourmi.
VIL 226. b. Dans chaque efpece de fourmi, on diftingue les
mâles, les femelles 8c les fourmis ouvrières. Defcription de
la fourmi ouvrière ; Ibid. 227. a. celle des fourmis mâles. On
ne trouve pas des fourmis mâles dans les fourmilières en
tout tems. Defcription des fourmis femelles. Parmi les fourmis
les plus communes en Hollande, Swammprdam a obfcrvé
qu’il fe trouve peu de mâles 8c de femelles en comparaifon
du grand nombre d’ouvrieres. Soins des fourmis ouvrières
pour les vers 8c les nymphes. Leurs nids.. Swammerdam n’a
jamais trouvé dans les fourmilières des provifionspoiir l’hiver.
Ibid. b. Outre l’efpece fur laquelle ce nattiralifte a fait les obfervations
précédentes, il en a connu fix autres , dont on
donne ici la defcription. Fourmis blanches des Indes orientales.
Fourmis rouges de l’ifle de Ternate. Fourmis longues. Quatre
fortes de fourmis dans les Antilles. Incommodités qu’elles
caufcnt. Ibid. 228. a. Les fourmis les plus dangereuses font
celles qu’on appelle chiens. Fourmis blanches du Sénégal.
Nids des fourmis de Batavia. Fourmilières de la-hauteur d un
homme fur les côtes de Guinée : dégâts prodigieux que caufcnt
les fourmis qui en fortent. Inftinét de ces infeétes pour
emporter leur proie. Fourmis volantes de Madagafcar. C e
qu’on appelle en Amérique , fourmis de vifite. Comment on
les reçoit dans les mailons. Fourmis dans les Indes orientales
, qui fe font toujours des chemins en galerie pour parvenir
où elles veulent. Singularités fur ces infeéles. Ibid. b. Comment
elles travaillent à fe faire un partage, lorfqu’ellcs veulent
aller quelque part. Fourmis blanches du royaumc.de
Maduré, npmmées par les Indiens, carreyan. Leurs fourmilières.
Ibid. 229. a. Les différentes efpeces de fourmi ne fe
mêlent jamais. Defcription de la fourmi, vue au microfcopc.
Traité à confulter fur cette matière. Ibid. b.
Fourmi blanche.XIII. 186.0. XVI. 792. ¿.Animal mangeur
de fourmis. X V . 871. b. Obfervations fur les fourmis des M o-
luques 8c fur leurs nids. Suppl. 1. 793- b. 796. a.