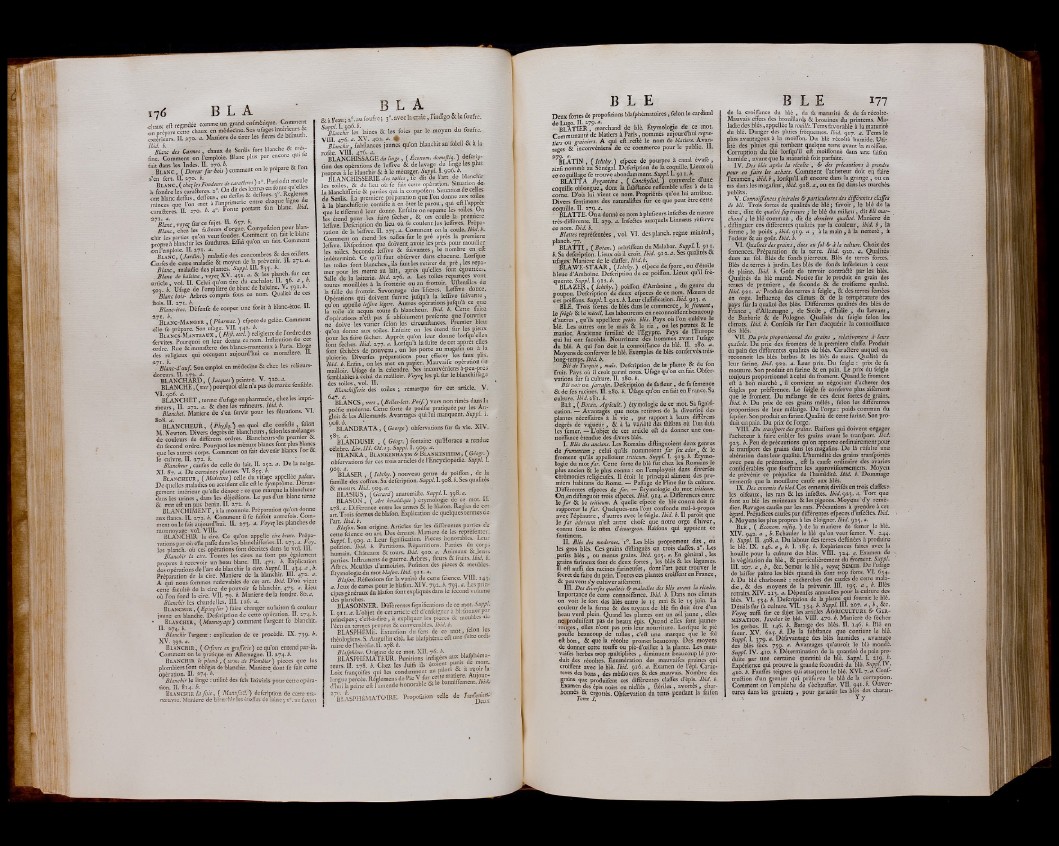
176 B L A
■chiux eft reeardèe comme un grand cafinèdque. Comment
■on prépare cette chaux en médecine. Ses nfeges ultérieurs fie
extérieurs. IL 270. a. Maniéré de tirer les fleurs de bifinuth.
Ib Blanc des Carmes, chaux de SenJis fort blanche & tres-
fine. Comment on l'emploie. Blanc plus pur encore qu. le
fait dans les Indes. IL 270. b. o, i>nn
B lan c , ( Doreur far tais ) comment on le prépare & on asfAA
^Blanc, voyez fur ce fujet. IL 657. b.
Blanc, chekles feaeurs d'orgue Compofiuon pour blanchir
les parties qu’on veut fouder. Comblent on. finie blanc
primre à blanchir les foudures. Eflai quon en fan. Comment
maladie des concombres & des oeillets.
Caufes de cette maladie & moyen de la prévenir. II. 271. a.
Blanc, maladie des plantes. Suffi. 111.835. S
Blanc de baleine, voyez XV. «>• "■ & les planch. fur cet
article, vol. 11. Celui qu’on tire du cachalot. II. 36. a , b.
<01. b. Ufaee de l’emplâtre de blanc de baleine. M M *■
Blanc bois- Arbres compris fous ce nom. Qualité de ces
iois. II. 471. b. , TT
Blanc-étoc. Défenfe de couper uoe forêt à blanc-étoc. 11.
7Blanc-Manger , ( Pharmac.) efpecede gelée. Comment
•èîle fo prépare. Son ufage. VU. 542. b. . , ,
Blancs-Manteaux , m M . ceci ) rel.gieux de 1 ordre des
fervites. Pourquoi on leur donna ce nom. Inltinraon de cet
ordre. Rue Scmonaftere des blancs-manteaux a Paris. fcloee
des religieux qui occupent aujourd’hui ce monaftere. il.
7 Blanc-d'auf. Son emploi en médecine & chez les relieurs-
doreuvs. H. 272. a.
BLANCHARD, (Jacques) peintre. V. zzo.a.
BLANCHE, {mer) pourquoi elle n’a pas de marée ieniible.
VU.oo6.tf. I . . . . . .
BLANCHET, terme d’ufage en pharmacie, çliez les imprimeurs
, II. 272- & chez les rameurs. Ibid.b.
Blanches. Maniéré de s’en fervir pour les hltrations. v i.
BLANCHEUR, (Phyfq.) en quoi elle confifte, félon
M. Newton. Divers degrés de blancheurs, félon les mélangés
de couleurs de différehs ordres. Blancheurs*du premier &
du fécond ordre. Pourquoi les métaux blancs font plus blancs
que les autres corps. Comment on fait devenir blancs 1 or oc
le cuivre. II. 472. b. • _ 1
Blancheur, caufes de celle du lait IL 2 <2. a. De la neige.
XI. 87. a. De certaines plantes. VI. 833..b.
Blancheur , ( Médecine) celle du vifage appellée valeur.
D e quelles maladies ou accident elle eft le fymptôme. Dérangement
intérieur qu’elle dénote : ce que marque la blancheur
dans les urines , dans les déjeôions. Le pus d’un blanc terne
8c mat eft un pus bénin. II. 272. b.
BLANCHIMENT, à la monnoie. Préparation qu on donne
aux flancs. IL 272. b. Comment il fe faifoit autrefois. Comment
on le fait aujourd'huL IL 273. a. royales planches de
monnoyage voL VIIL _ ,
BLANCHIR la cire. Ce qu’on appelle cire brute. Préparations
par ou elle paffe dans les blânehifferies. II. 473. a. Vjy.
les planch. où ces opérations font décrites dans le vol. III.
Blanchir la cire. Toutes les cires ne font pas également
propres a recevoir un beau blanc. III. 471. b. Explication
des opérations de l’art de blanchir la rire. Suppl. II. 434. a , b.
Préparation de la cire. Maniéré de la blanchir. III. 472. a.
A qui nous fommes redevables de cet art. Ibid. D’où vient
cette faculté de la cire de pouvoir fo blanchir. 473’ a- Lieu
où l’on fond la cire. VIL 70. b. Maniéré de la fondre. 80. a.
Blanchir les chandelles. IfL 126. a.
Blanchir , ( Epinglier ) faire changer au laiton fa couleur
jaune en blanche. Defoription de cette opération. EL 274. b.
Blanchir, {Monnayage) comment l’argent fe blanchit.
IL '274.' b . ' t
Blanchir l’argent : explication de ce procédé. IX. 739. b.
XV.392.fl.
Blanchir, ( Orfevre en grofferie) ce qu’on entend par-là.
Comment on le pratique en Allemagne. II. 274. b.
BLANCHIR le plomb , ( terme de Plombier ) pièces que les
plombiers, font obligés de blanchir. Maniéré dont fe fait cette
opération. H. 274. b.
Blanchir le linge : utilité des fols lixiviels pour cette opération.
II. 814.
Blanchir la foie, ( MannfaÜ. ) defeription de cette manoeuvre.
Maniéré de blanchir les étoffes de laine j x°. au favon
B L A
& a l’eau ; 2°. au foufi o ; 31 avec la craie, l'indigo & le foufte.
^ B l 'andnr lés laines & les foies par le moyen du foufre.
VUl. 47.6- a. XV. 402. n. • .
Blanchir, fubftances jaunes qu on blanchit au foleil oc a la
rofée. VUI. 476. a. . .
BLANCHISSAGE du linge , ( Économ. domefltq. ) delcnp-
tion des opérations de leffive 8c de lavage du hnge les plus
propres à le blanchir 8c à le ménager. Suppl. 1.906. b.
BLANCHISSERIE des toiles, fo dit de lart de blanchir
les toiles, 8c du lieu où fe fait cette opération. Situation de
la blanchifferie 8c parties qui la compofent. Situation de celles
de Senlis. La première préparation que l’on donne aux toiles
à la blanchifferie confifte à en ôter le parou, qui eft l’apprêt
que le tifferand leur donne. Enfuite on repame les toiles. On
les étend pour les faire fécher, &; on coule la première
leffive. Defeription du lieu où fe coulent les leffives. Préparation
de la leffive.U. 275.a. Comment onia coule.Ibid.b.
Comment on étend les toiles fur le pré après la première
leffive. Difpofition que doivent avoir les prés pour mouiller
les toiles. Seconde leffive 8c fuivantes, le nombre en eft
indéterminé. Ce qu’il faut obferver dans chacune. Lorfque
les toiles font blanche*, ils faut les retirer du pré, les repa-
mer pour les metre au lait, après qu’elles font égouttées..
Salle de la laiterie. Ibid. 276. a. Les toiles repamçes vont
toutes mouillées à la frotterie ou au frottoir. Uftenfiles (lo
la falle du frottoir. Savonnage des lifieres. Leffive douce.
Opérations qui doivent fuivre jufqu’à la leffive foivante,
qu’on appelle leffive légère. Autres opérations jufqu à ce que
la toile ait acquis toute fa blancheur. Ibid. b. Cette fuite
d’opérations n’eft pas fi abfolument preferite que louvrier
ne doive les varier félon les circonftances. Premier bleu
• qu’on donne aux toiles. Enfuite. on les étend fur les p!Cux
pour les faire fécher. Apprêt qu’on leur donne lorfque es
font feches. Ibid. 277. a. Lorfqu’à la fuite de cet apprêt elles
font féchées de nouveau, on les porte au raagafin ou à la
ploierie. Diverfes préparations pour effacer les faux plis,
Ibid. b. Enfin, on les met en papier. Mauvaife opération cm
mailloir. Ufage de la calendre. Ses inconvéniens à-peu-pres
femblables à celui du mailloir. Voye^ les pl. fur le blanchiffagc
des toiles, vol. II. . . . »,
Blanchifferie des toiles ; remarque fur cet article. V.
647. a. • / j 1
BLANCS, vers, (Belles-lett. Poéf.) vers non rimes dans la
poéfie moderne. Cette forte de poéfie pratiquée par les An-
glois 8c les Allemands. Avantages qui lui manquent. Suppl. 1.
9°BLANDRATÀ, ( George) obfervations fur fa vie. XIV.
^BLANDUSIE , ( Géogr. ) fontaine qu’Horace a rendue
célèbre. Liv. III. Od. 13. Suppl. I. 909. a.
BLANKA, B lan k en h a ym & B lan k en h e im , ( Geogr. )
obfervations fur ces trois articles de l’Encyclopédie. Suppl. L
909. a. . „ , ,
BLASER , ( lchthy. ) nouveau genre de poiffon , de la
j famille des coffres. Sa defeription. Suppl. 1.908. b. Ses qualités
8c moeurs. Ibid. 909. a.
BLASIUS , ( Gérard) anatomifte. Suppl. I. 398. a.
BLASON , | Art héraldique ) étymologie de ce mot. IL
478. a. Différence entre les armes 8c le blafon. Réglés de ceo
art. Trois formes de blafon. Explication de quelques termes de
l’art. Ibid. b. .
Blafon. Son origine. Articles fur les différentes parties de
cette fcience ou art. Des émaux. Maniéré de les reprefenter.
Suppl. 1. 909. a. Leur fignification. Pièces honorables. Leur
pofition. Ibid. b. Partitions. Répartirions. Parties du corps
humain. Châteaux 8c tours. Ibid. 910. a. Animaux 8cjeurs
parties. Inftrumens de guerre. Arbres, fleurs 8c fruits. Ibid. b.
Aftres. Meubles d’armoiries. Pofition des pièces 8c meubles.
Étymologie-du mot blafon. Ibid. 911. a.
Blafon. Réflexions fur la vanité de cette fcience. VUl. 143.
a. Jeux de cartes pour le blafon. XIV. 792..b. 793* a~ ^cs Prin"
cipes généraux du blafon font expliqués dans le fécond volume
^LASONNER. Différentes fignifications de ce mot. Suppl-
1. 911. a. L’objet de cet article eft d’enfeigner à blrfonner par
principes ; c’eft-à-dire, à expliquer les pièces 8c meubles de
l’écu en termes propres 8c convenables. Ibid. b.
BLASPHÈME. Extenfion du fens de ce mot,, fel°n les
théologiens. S. Auguftin cité. Le blafphême eft une fuite ordinaire
de l’héréfie.lï. 278. b.
Blafphême. Origine de ce mot. X ïï. 76. b.
BLASPHÉMATEUR. Punitions infligées aux blafphéma-
teurs. p . 278. i Chez les M 6
Loix françoifes qui les condamnent au puo Aiiirtnrlanguc
percée. Mglémens de Pie V fur cette matière. Aujour-
d'hui la peine eft l’amende honorable & le banniffement. Ibti.
27ÉLASPHÉMAT01RE. Propoüiion telle de JMÎenius-
B L E BLE 177 Deux fortes de propofirions blafphématoires, félon le cardinal
^ B l I t I E R ^marchand de blé. Étymologie de ce mot.
Communauté de bladers à Paris, nommés aujourd’hui regra-
tiers ou grainiers. A qui eft .refté le nom de blatiers. Avantages
8c inconvéniens de ce commerce pour le public. U.
a7&LATIN, ( lchthy.) efpece de pourpre à canal évafé ,
ainfi nommé au Sénégal. Defeription de la coquille. Lieux ou
ce coquillage fe trouve abondamment. Suppl. 1. 911. b.
BLATTA Byiantina , ( Conchyliol.) couvercle d’une
coquille oblongue, dont la fubftance reflemble affez à de la
corne. D’où lui vient ce nom. Propriétés qu’on lui attribue.
Divers fentimens des naturaliftes lur ce que peut être cette
coquille. II. 279. a. ,
BLATTE. On a donné ce nom à plufieurs infeéles de nature
très-différente. IL 279. a. Infeâes auxquels Linnaeus réferve
ce nom. Ibid. b. ■. .
Blattes repréfentées , vol. VI. des planch. regne minéral,
planch. 77. _
BLA TTI, ( Béton. ) arbriffeau du Malabar. Suppl I. 011.
h.Sa defeription. Lieux où il croît. Ibid. 912.a. Ses qualités 8c
ufages.’ Maniéré de le claffer. Ibid. b.
BLAWE-STAAR, {lchthy.) efpece de fpare, ou d étoile
bleue d’Amboine. Defeription tle ce poiffon. Lieux qu il fréquente.
Suppl. 1. 912. b. .. .’i-'.'î-r... .
BLAZER, ( lchthy. ) poiffon d’Amboine , du genre du
poupou. Defeription de deux efpecès de ce nom. Moeurs de
ces poiffons.Suppl.1. 912. b. Leur claffification.Ibid. 913.a.
BLÉ. Trois fortes.de blés dans le commerce, le froment,
le feigle 8c lè méteil. Les laboureurs en reconnoiffent beaucoup
id’autres,. qu’ils appellent petits blés. Pays où l’on cultive le
blé. Les autres ont le maïs 8c le riz , ou les patates 8c le
manioc. Ancienne fertilité de l’Égypte. Pays de l’Europe 3ui lui ont fuccédé. Nourriture des hommes avant 1 ufage
u blé. A qui l’on doit la connoiffance du blé. ïï. 280. a.
Moyens de conferver le blé. Exemples de blés confervés tres-
loné-temps. Ibid. b.
Blé de Turquie, mais. Defeription de la plante 8c de fon
fruit. Pays où il croît parmi nous. Ufage qu’on en fait. Obfervations
fur fa culture. II. 280. b. _ _
Blé noir on farrafin. Defeription de fa fleur, de fafemence
8c de fes racines. U. 280. b. Ufage qu’on en fait en France. Sa
culture. lbid.o.8i.b. _ _
Blé , ( Botdn. Agricult. ) étymologie de ce mot. Sa fignifi-
cation. — Avantagés que nous retirons de la diverfité des
plantes néceffaires à la vie , par rapport k leurs diftérens
degrés de vigueur , 8c à la variété des faifons où l’on doit
les femer. — L ’objet de cet article eft de donner une connoiffance
étendue des divers blés.
I. Blés des anciens. Les Romains diftinguoient deux genres
de frumentum ; celui qu’ils nommoient far feu ador. 8c le
froment qu’ils appelloient triticum. Suppl. I. 913. b. Étymologie
du mot far. Cette forte de blé fut chez les Romains le
plus ancien 8c le plus connu : on l’employoit dans diverfes
cérémonies religieufes. U étoit le principal aliment des premiers
habitans de Rome. — Paffage de Pline fur fa culture.
Différentes eijieces de far. — Étymologie du mot triticum.
On(endiftinguoit trois efpeces. Ibid. 914. a. Différences entre
le far 8c le triticum. A quelle efpece de blé connu doit fe
rapporter le far. Quelques-uns l’ont confondu mal-à-propos
avec l’épéautre , d’autres avec le feigle. Ibid. b. U paroît que
le far adoreum n’eft autre chofe que notre orge d’hiver,
connu fous le ni>m d'écourgeon. Raifons qui appuient ce
fentiment.
U. Blés des modernes. i°. Les blés proprement dits , ou
les gros blés. Ces grains diftingués en trois daffes. 20. Les
.petits blés , ou menus grains. Ibid. 915. a. En général, les
f rains farineux font de deux fortes , les blés 8c les légumes.
I eft auffi des racines farineufes, dont l’art peut trouver le
\ fecret de faire du pain. Toutes ces plantes croiilent en France,
8c peuvent s’y cultiver aifémerit.
III. Des diverfes qualités 6* maladies des blés avant la récolté.
Importance de cette connoiffance. Ibid. b. Dans nos climats
on voit le fort des blés entre le mai 8c le 15 juin. La
couleur de la fanne 8c des tuyaux ae blé fin doit être d’un
beau verd plein. Quand lés plantes ont un oeil jaune , elles
nqjproduifent pas de beaux épis. Quand elles font jaunes-
■ rouges, elles n’ont pas pris leur nourriture. Lorfque le pié
pouffe beaucoup de tulles, c’eft une marque que le fol
eft bon, 8c que la récolte promet beaucoup. Des moyens
de donner cette touffe ou pié-d’oeiliet à la plante. Les mau-
• vaifes herbes trop multipliées , diminuent beaucoup lè produit
des récoltes. Énumération des mauvaifes graines qui
croiffent avec le blé. Ibid. 916. a. Examen de l’épi. Caractères
des bons, des médiocres 8c des mauvais. Nombre des
grains que produifent ces différentes daffes d’épis. Ibid. b.
Examen des épis noirs ou niellés , ftériles, avortés, char-
bonnés 8c ergottés. Obforvation du tems pendant la faifon
Tome I,
de la croiffance du blé , de fa maturité 8c de fa récolte.
Mauvais effets des brouillards 8c brouines du printems. Maladie
des blés, appellée la rouille. Tems favorable à la maturité
du blé. Danger des pluies fréquentes. Ibid. 917. a. Tems le
plus avantageux à la moiffon. Du blé récolté humide. Utilité
des pluies qui tombent quelque tems avant la moiffon.
Corruption du blé lorfqu’il eft moiffonné dans une faifon
humide, avant que la maturité foit parfaite.
IV. Des blcs apfis la récolte , 6* des précautions à prendre
pour en faire Us achats. Comment l’acneteur doit eq faire
l’examen, ibid. b , lorfqu’il eft encore dans la grange , ou en
tas dans les magafins, ibid. 918. <r, ou en fac dans les marchés
publies.
V. Connoiffances générales & particulières dis différentes claffes
de blé. Trois fortes de qualités de blé ; favoir, le blé de la
tête , dite de qualité fuperieure ; le blé du milieu , dit blé marchand
; le blé commun, dit de derniere qualité. Maniere de
, diftingüer ces différentes qualités par la couleur, ibid. b, la
forme, le poids , ibid. 919. a , à la main, à la netteté, à
l’odeur 8c au goût. Ibid. b.
VI. Qualités des grains, dues au fol & àia culture. Choix des
femences. Préparation de la terre. Ibid. 920. a. Qualités
dues au fol. Blés de fonds pierreux. Blés de terres fortes.'
Blés de terres à jardin. Les blés de fonds inférieurs à ceux
de plaine. Ibid. b. Goût de terroir contra&é par les blés.
Qualités du blé marné. Notice fur le produit en grain des
ternes de premiere , de feconde 8c de troifieme qualité.
Ibid. 921. a: Produit des terres à feigle, 8c des terres femées
en orge. Influence des climats 8c de la température des
pays fur la qualité des blés. Différentes qualités des blés de
France , d’Allemagne , de Sicile , d’Italie , du Levant,
de Barbarie 8c de Pologne. Qualités du feigle félon les
climats. Ibid. b. Confeils fur l’art d’acquérir la connoiffance
dés blés.
VIL Du prix proportionnel des grains , relativement à- leurs
qualités. Du prix des fromens de la premiere daffe. Produit
en pain des différentes.qualités de blés. Caraétere auquel on
reconnoit les blés barbus 8c les blés de mars. Qualité de
leur ferine^ Ibid. 022. a. Leur prix. Du feigle : prix de fa _
mouture. Son produit en forine oc en pain. Le prix du feigle S
toujours proportionnel à celiti du froment. Quand le froment B
eft à bon marché ,' il convient au négociant d’acheter des
feigles par préférence. Le feigle, fe conferve plus aifément
que le froment. Du mélange de ces deux fortes de grains.
ibid. b. Du prix de ces grains mêlés, félon les différentes
proportions de leur mélange. De l’orge : poids commun du
feptier. Son produit en farine.Qualité de cette farine. Son produit
en pain. Du prix de l’orge.
VIU. Du tranjport des grains. Raifons qui doivent engager
l’acheteur à faire cribler les grains avant le tranlport. Ibid.
023. b. Peu de précautions qu on apporte ordinairement pouf
le traniport des grains dans les magafins. De là réfulte une
altération dans leiir qualité. L’humimté des grains tranfportés
avec peu de précaution , eft la caufe ordinaire des avaries
confiaérables que fouffrenr les approvifioitnemens. Moyen
de prévénir ce préjudice de l’humidité. Ibid. ¿.’Dommage
immenfo que la mouillure caufe aux blés.
IX. Des ennemis dubled.Ces ennemis divifés en trois claffes ?
les oifeaux, les rats 8c les infeftes. lbid.ozy a. Tort que
font au blé les moineaux 8c les pigeons. Moyens M’y remédier.
Ravages caufés par les rats. Précautions à prendre à cet
égard. Préjudices caufés par différentes efpeces d inïeftes. Ibid.
b. Moyens les plus propres à lès éloigner, ibid. 92 5. a.
Ble , ( Économ. rujliq. ) de la maniere de femer le blé.
XIV. 942. a , b. Echauler le blé qu’on veut femer. V. 244.
b. Suppl. n . 408. a. Du labour des terres deftinées à produire
le ble. IX. 146. a , ¿ .I . 183. b. Expériences faites avec la
houille pour la culture des blés. VIII. 324. a. Examen de
la végétation du blé, 8c particulièrement du froment. Suppl.
III. 207. a , b, 8cc. Semer le blé , voye^ Semer. De l’ufoge
de laiffer paître les blés quand ils font trop forts. VI. 654.
b. Du blé charbonné : recherches des caufes de cette maladie
, 8c des moyens de la prévenir. UI. 19Ç. a » b. Blés
retraits. XIV. 213. a. Dépenfes annuelles pour la culture des
blés. VI. 334. b. Defeription de b plante qui fournit le blé.
Détails fur fo culture. VU. 3 34. b. Suppl. UI. 207. a t b, &c.
Voyez auffi for ce fujet les articles A gricultur e g* G ermination.
Javeler le blé. VIU. 47°- Maniéré dé fécher
les gerbes. II. 146. b. Battage des blés. n . 146. b. Blé en
fueur. XV. 623. b. De la fubftance que contient le blé.
Suppl. L 379- <*• Défavantage des blés numides , avantage
des blés feçs. 739. u. Avantages qu’auroit le blé monde.
Suppl. IV. 410. b. Détermination de la quantité de pain produite
par une certaine quantité de blé. Suppl. I. 210. b.
Expérience qui prouve la grande fécondité du blé. Suppl. IV.
410. b. Faunes teignes qui attaquent le blé. XVI. y. a. Conf-
truftion d’un grenier qui prèferve le blé de la corruption.
Comment on l’empêche de s’échauffer. VII. 041* ^ Ouvertures
dans les grenier;» , pour garantir les blés des charan