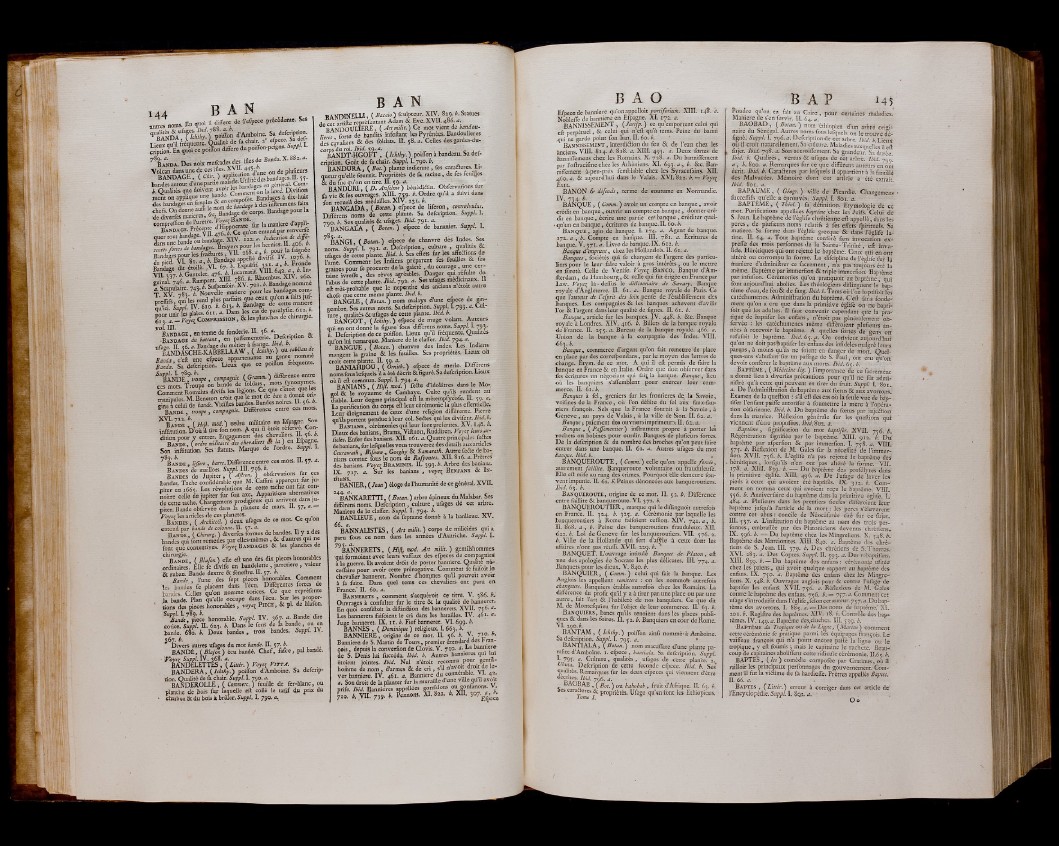
m 4 B A N
P S noms. En É f e É j i^ijaiW^HWBill ^ U ^ -D e s n o -o cm u f c a d e s a e s f e W Battda. X . 88*. *
Volcan dans une de ces riles. X V il. 445- • j „luficufs
B A N D A G E ( Chir, ) „ .
landes autour d une parue e„ „¿„éral. Comt
. Qualités que doivent avoir {“ nf on fc leve. Dlvifion
ment on applique Bandages à dix-huit
des bandages en fimples & en P ^ des ¡ „ ¡ ^ ( . „ s fins
chefs. On donne auffi le noni d/ corps. Bandage pour la
, de diverfes matières. One Bannage r
compreffion dc Lureu'- | | | î_ fur la „„mere d’appli-
I l I l l l S Ë 476:Pr(S V n n entend par renverfé quer tout bandage. ^ 47 n ¡„¿¡cation de diffe- M«T1. fJ% A s f e 7°'-* Bf ”ommi
t W 781 i- Nouvelle ntatiere pour les tandages com-
Tprr'eefffliiffts , oquuti lleKs rend Pp lus ph arfai¿t s Bqauned caeguex dqeu ocnet ate t amnasu jeurfe-
E r 5 ^ - “ a ^ t E ' ! & S î : :
V°Bandage , en terme de fonderie. II. J g * u , . . &
•Bandage du h um a , on paiieiuentene. Defeipuon «
ufaee II. t6.n. Bandage du métier a frange. Jird., ». ,
¿ANDASCHE-KABBELAAW , ( Icluhy.) ou eoUinn *
v ï ï f t K efpece appartenante au genre- nommé
f i & j Sa description. U e ï ï que ce poiûon fréquente.
¿ T Í n D E 9 u ta» r, compagnie (Gramm.) différence entre
ces nmc Troupe ¿u la id e de foldats, mots fynonymes
Comment iomulus divifa les légions.
manipules. M. Beneton croit que le mot de¡ban a^donnè on
cine a celui de ¿dW¿r. Vieilles bandes. Bandes noires. 11. 56. b.
p B a n d e , lou p e, compagnie. Différence entre ces mots.
^ Á n d e moi.) ordre militaire en Efpagne. Son
infiitution. D’où i tire fon nom. A qui d éton réfervé. Condition
pour v entrer. Engagement des i s- S i £ L -
d e^ t S ^ p r éV en ta n t Adam & Eve. XVII. «86 *
BANDOULIERE, (Art milit.) Ce mot vient de bandou-
BANDE, (ordre militaire des chevaliers ai la ) en fclpagne.
Son inffitudon. Ses ftatuts. Marque de l'ordre. Suppl. I.
7 I a n d e , lifiere, larrc. Différence entre ces mots. II. 57. a.
Bandes de maillots. Suppl. III. 75<>- b. .
Bandes de Jupiter, ( 4 ftr0f ; ) obfervaoOTis i b | ces
bandes. Tache confidérable que M. Caifiiu apperçut fur Jupiter
en 1665. Les révolutions de cette tache ont fait con-
noître celle de jupiter fur fop axe. Appantipns alternatives
de cette tache. Changemens prodigieux qui arrivent dans Jupiter.
Bande obfervée dans la planete de mars. II. 57, a.
Voyez les articles de ces planetes.
B an d e s , ( Architeêl. ) deux ufages de ce mot. Ce quon
entend par bande de colonne, 11. 57. T1 .
B a n d e , ( Chirurg. ) diverfes formes de bandes. Il y a des
bandes qui font remedes par eües-mêmes, & d’autres qui ne
font que cçntentiyes. Voye[ B an d a g e s & les planches de
C B a n d e , (Blafon) elle eftune des dix pièces honorables
ordinaires. Elle fe drvife en bandelette, jarretiere, valeur
& ruban. Bande dextre & féjieftre. U. 57. b.
Bande , l’une des fept pièces honorables. Comment
les bandés fe placent dans l’ècu. Différentes fortes de
bandes. Celles qu’on nomme cotices. Ce que reprefente
l a bande. Plan qu’elle occupe dans 1 ¿cu. Sur les proportions
des pleces honorables , voyei P ie c e , 8c p i de blafon.
pi'ecê honorable. Suppl IV . 3Í7. 1 Bande dire
cotice. Snppl. a. 6x3. é. Dans le fens de la bande, ou en
lande. 680. é. Deux bandes, trois bandes. Snppl. IV.
de. n. 57. b.
C h e f, fafee, pal bandé.
BAN 'ÆÈÊBËMBS&ÎÈÊÊBSBÎ&..
3%D,ivers autres ufages du mot bai
BANDÉ, (Blafon) écu bandé.
' 'Voyez Suppl. IV. 369a a.
BANDÉLETTES , ( Unir. ) Voyez ViTTA.
BANDERA, ( Ichthy.) poiffon d’Amboine. Sa defcrip-
rion. Qualité de fa chair. Suppl. L 790. a.
BANDEROLLE, ( Commerc. ) feuille de fer-blanc, ou
planche de bois fur laquelle ,eft collé le tarif 4» p«* du
charbon 8c du bois à brûler. Suppl. L 790. a.
forte de bandits infeftant les Pyrénées. Bandoulières
des cavaliers 8c des foldats. IL 58.fi. Celles des gardes-du-
corps du roi. Ibid. 59. a.
BÀNDT-HGOFT , ( Ichtky. ) poiffon à bandeau. Sa def-
ari'.mon. Goût tic la chair. Suppl. 1. 790. b.
B ANDÜRA, ( Bot.) plante indienne, fes caractères. Liqueur
qu’elle fournit. Propriétés de fa racine, de fes feuilles
8c du foc qu'on en tire. II. 39. a. •
BANDURI, ( D. Anjejme ) bénédiôin. Obfervanons fur
fa vie 6c fes ouvrages. XOE. 759. i . Ordre qu’il a fuivi dans
fon recueil des médailles. X lV. 231. é.
BANGADA, ( Bonn. ) efpece de liferon, convolvulus.
Diffèrens noms de celte plante. Sa deferiprion. Snppl. 1.
700. b. Ses qualités & ufages. Ibii. 791. a
BANGALA , ( Botan. ) efpece de bananier. SnppL 1.
7 BANGI, ( Botan. ) efoece de chanvre des Indes. Ses
noms. Suppl. I. 791. a. Defcription, culture , qualités &
ufages de cette plante. Ibii. b. Ses effets fur les affeéhons de
l’ame. Comment les Indiens préparent fes feuilles 8c fes
graines pour fe procurer de la gaieté du courage, une cer-
taine ivreffe, Ses rêves agréables. Danger qrn rèfulte de ,
l’abus de cette plante. Ibid. 79a. e. Ses ufages médicinaux. 11
eft très-probable que le nepenthe des anciens n étoit autre
chofe que cette même plante. Ibid. b. r a ■
B ANGLE, (Botan.) nom malays d’une efoece de gingembre.
Ses autres noms. Sa deferiprion. Suppl. 1.793- a- Cul"
ture, qualités 8c-ufages de cette plante. Ibid, b.
BANGOT, ( Ichthy. ) efpecç de muge volant. Auteurs
qui en ont donné la figure' fous diffèrens noms. Suppl A. 79}-
b. Deferiprion de ce poiffon. Lieux qu’il fréquente. Qualités
qu’on lui remarque. Maniéré de le daffer. Ibid. 794.
BANGUE , ? Botan. ) chanvre des Indes. Les Indiens
mangent la graine 8c les feuilles. Ses propriétés. Lieux oïl
croît cette plante. H. 59. a. -
BAN1AHBOU, ( Omith. ) efpece de merle. Differens
noms fous lefquels ü a été décrit 8c figuré. Sa deferipnon. Lieux
où il eft commun. Suppl. I. 794-
BANIANS, ( Hijt. mod. ) fefte d’idolatres dans le Mo-,
eol 8c le royaume de Cambaye. Culte qu ils rendent au
diable. Leur dogme principal eft la métempfycofe. II. 59;/*
La purification du corps ellleur cérémonie la plus effenuelle.
Leur éloignement de ceux d’une religion différente. Pierre
qu’ds portent pendue à leur col. Se&es qui les âxviient. Jbid.b.
Ban ian s , cérémonies qui leur fontpreferites. XV. 140. A
Dieux des banians, Brama, Viftnou, Ruddiren. Voyez leurs articles.
Enfer des banians. XII. 161. a. Quatre principales feétes
de banians, fur lefquelles vous trouverez des détails aux articles
Ceurawath , Bifnow , Goeghy 8c Samarath. Autre fefte de banians
connue mus le nom de Rafpontes. XII. 816. a. Prêtres
des banians. Voye^ B ramines. IL 393. b. Arbre des banians.
IX. 717. a. Sur les banians , voye^ B enjans 8c In-
^BANIER, (Jean ) éloge de l’humanité de ce général. XVII.
BANKARETTI, ( Botan. ) arbre épineux du Malabar. Ses
diffèrens noms. Deferiprion, culture , ufages dé cet arbre.
Manière de le claffer. Suppl. I. 794. b.
BANLIEUE, nom de feptame donné à la banlieue. XV.
¿ANNALISTES, ( Art milit.) corps de miliciens quia
paru fous ce nom dans les armées d’Autriche. Suppl. L
79&ANNERETS, ( Hifif mod. Art milit. ) gentilshommes
•qui formoient avec leurs vaffaux des efpeces de compagnies
à la guerre. Us avoient drdit de porter banniere. Qualité nér
ceffaire pour avoir cette prérogative. Comment fe faifoit le
chevalier banneret. Nombre d’nonynes qu’il pouvoit avoir
à fa fuite. Dans quel tems ces chevaliers ont paru en
France.* II. 60. a.
Bannerets , comment s’acquéroit ce titre. V. 380. bj
Ouvrages à confulter fur le titre 8c la qualité de bannerer.
En quoi confiftoit la diftinétion des bannerets. XVII. 756. a.
Les bannerets faifoient le cri dans les batailles. IV. 46?* a'
Juge banneret. IX. 11. b. Fief banneret. VI. 699. b.
BANNÈS , ( Dominique ) religieux. 1. 663. b.
BANNIERE, origine de ce mot. IL 50. b. V. 710. b,
Banniere de S. Martin de Tours, premier étendard des François
, depuis la converfion de Clovis. V. 710. a. y a banniere
de S. Denis lui fuccéda. Ibid. b. Autres banmeres qui lui
étoient jointes. Ibid. Nul n’étoit reconnu pour gentilhomme
de nom, d’armes 8c de cri, s’il navoit dioitde e-
yer banniere. IV. 461. a. Banniere du connétable. VL 42.
v. Son droit do la planter fur la mnraUle d’une ville qû d avott
prife. Ibid. Bannières appeüées gonfalons oü gonfanons. V.
7t0. b. VU. 739. b. Pennons. XI. 8aa. b. Xll. 3 0 7 -^ A
B A O
Efpece de banniere qu’on appelloit portiforium. XIII. 148. à.
Nobleffe de banniere en Efp^ne. XI. 172. a.
BANNISSEMENT , (Jurifp. ) ce qu’emportent celui qui
eft perpétuel, Sc celui qui n’eft qu’à tems. Peine du banni
qui ne garde point fon ban. IL 60. b.
B a n n i s s e m e n t , interdiftion du feu 8c de l’eau chez les
hnciens. VIII. ,814. b. 818. a. XIIL 493. a. Deux fortes de
banniffemens chez les Romains. X. 728. a. Du banniffement
par l’oilracifine chez les Athéniens. XI.- 693. a , b. &c. Ban-
niffemerit à-peu-près femblable chez les Syracufains. XII.
460. a. & aujoùrd’hui dans le Valais. XVI. 822. b. Voye^
E x i l. -
BANON & défends, terme de coutume en Normandie.
IV. 734. b. . m 8 ■■
BANQUE, ( Comm. ) avoir un compte en banque, avoir
crédit en banque, ouvrir un compte en banque, donner crédit
en banque, écrire une partie en*banque , créditer quel-
• qn’un en banque, écritures de banque. II. 60. b.
Banque , agio de banque. I. 174. a. Agent de banque.
172. a , b. Compte en banque. III. 781. a. Ecritures de
banque. V . 371. a. Livre de banque. IX. 61 a. b.
Banque d'emprunt, chez les Hollandois. II. 61. a.
Banques, fociétés qui fe chargent de l’argent des particuliers
pour le leur faire valoir à gros intérêts, ou le mettre
en lùreté. Celle de Venife. Voyc{ Ban co . Banque d’Am-
iterdam, de Hambourg, 8c celle qui fut érigée en France par
Law. Voye^ là-deffus le diilionnaire de Savary. Banque
royale d’Angleterre. II. 61. a. Banque royale de Paris. Ce
que l’auteur de l'efprit des loix,penfe de l’établiffement des
banques. Les compagnies 8c les banques achèvent d’avilir
l’or oc l’argent dans leur qualité de. fignes. II. 61. b.
Banque, article fur les banques. JV. 448. b. 8cc. Banque
royale à Londres. XIV. 416. b. Billets de la banque royale;
de France. EL 255. a. Bureau de la banque royale. 466. a.
Union de la banque à la compagnie des Indes. VIII.
<>63. b.
Banque, commerce d’argent qu’on fait remettre de place
en place par des correfpondans, par le moyen des lettres de
change. Êtym. de ce mot. A qui il eft permis de faire la
banque en France 8c en Italie. Ordre qiie doit obferver dans
fes écritures un négociant qui fa'n la banque. Banque, lieu
où les banquiers s’affemblent pour exercer leur commerce.
IL 61. b.
Banques à fel, greniers fur les frontières de la Savoie,
voifines delà France, où l’on débite du fel aux faux-fau-
niers françois. Sels que la France fournit à là Savoie, à
Geneve, au pays de Valais, à la ville de Sion. II. 62. a.
Banque, paiement des ouvriers imprimeurs. II. 62. a.
Banque , ( Pajfementïer ) infiniment propre à porter les
•rochers ou bobines pour ourdir. Banques de plufieurs fortes.
De la deferiprion 8c du nombre des broches qu’on peut faire
entrer dans une banque. II. 62. a. Autres ufages du mot
banque. Ibid. b. *
BANQUEROUTE, ( Cojnm. ) celle qu’on appelle forcée,
autrement faillite. Banqueroute volontaire ou frauduleuie.
Elle eft mile au rang des crimes. Pourquoi 'elle demeure fou-
vent impunie.Tl. 62. b\ Peines dénoncées aux banqueroutiers.
Ibid. 63. b.
Banqueroute, origine de ce mot. II. 52. b. Différence
entre faillite 8c banqueroute. VL 372. b.
BANQUEROUTIER, marque qui le diftinguoit autrefois
en France.- II. 324. b. 325. a. Cérémonie par laquelle les
banqueroutiers à Rome faifoient cellion. XIV. 741.«, b.
Îï. 868. a , b. Peine des banqueroutiers frauduleux. XII.
622. b. Loi de Geneve fur les banqueroutiers. VII. 576. 2.
b. Ville de la Hollande qui fert d’afyle à ceux dont les
affaires n’ont pas réuifi. XVII. 229. b. *
BANQUET. L’ouvrage intitulé Banquet de. Platon , eft
une des apologies de Socrate les plus délicates. III. 774. a.
Banquets pour les dieux. V. 840. b.
BANQUIER, ( Comm. ) celui qui fait la banque. Les
Anglois les appellent remitters : on les nommott autrefois
changeurs. Banquiers établis autrefois chez les Romains. La
différence du profit qu’il y a à tirer par. une place ou par une
autre, fait l’art 8c Thabiîeté de nos banquiers. Ce que dit
M. de Montefquieu fur l’objet de leur commerce. II. 63. b.
Banquiers, bancs qu’ils tenoiènt dans les places publiques
8c dans les foires. U. 52. b. Banquiers en cour de Rome.
VI. 290.b.
BANTAM, ( Ichthy. ) poilïon ainfl nommé* à Amboine.
Sa deferiprion. Suppl. I. 795. a. •
BANTIALA, ( Botan. ) nom macâffare d’une plante pa-
rafite d’Amboine. 1. efpece, bantiala. Sa deferiprion. Suppl.
L 795* ¡1 Culture, qualités, ufages de cfette plante. 2.
Vhuta. Deferiprion de cette fécondé efpece. Ibid. b. Ses*
qualités. Remarques fur les deux efpeces qui viennent d’être
n aCS' ^ le^‘ 796- a-
BAOBAB , (Bot.) ou kahobab, fruit d’Afrique. II. 63. b.
Ses caractères 8c propriétés. Ufage qu’en font les Ethiopiens.
Tome I.
13 A P 145
Poudre qu’on, en fait au Caire, pdur certaines ihaladies.
Maniéré de s en fervir. II. 64. a.
BAOBAD, (Botan.) nom ’éthiopien d’un arbré origji
naire du Sénégal. Autres noms fous lefquels on le trouve <&•
ligné. Suppl. 1. 796. a. J Jefcripuon de cet arbre. Ibid. b Lieu*
ou il croît naturellement. Sa culture. Maladiesauxquélfesileft
fujet. Ibid. 798. a. Son accroiffement; Sa grandeur. Sa durée.
Ibid. bï Qualités, vertus & ufages de cet arbre. Ibid. 799.
a , bt 800. a. Remarques fur ce que difféfens auteurs en ont
écrit, lbidy b. Caraéteres par lefquels il appartient à la famillé
des MalVacées. Mémoire dont cet article a été extrait
Ibid.' 801. a. 1.; ' .
BAPAUME | ( Gèogï. ) ville dé Picardié. Changemens ■
fucceififs qu’elle a éprouvés; Suppl. I. 801. a.
BAPTÊME, ( Thèol. ) - fa définition. Etymologie de cé
mot. Purifications appcllées baptême :chez les Juifs. Celui dé
S. Jean. Le baptême de l’églife chrétienne eft appellé , dans les
peres, de plufieurs noms relatifs à fes effets fpirituels. Sà
matière. Sa forme dans l’églife grecque 8t dans l’églife Èë
une. II. 64. a. Tout baptême conféré fans invocation ex-
preffe des trois perfonnes de la Sainte-Trinité , eft invalide.
Hérétiques qui ont rejetté le baptême. Ceux qüi en ont
altéré ou corrompu la forme. La difcipUne de l’églife fur là
fnaniere d’adminillrer ce facrement, n’a pas toujours été la
même. Baptême par immeriion 8c triple immeriiônl Baptême
par infufion. Cérémonies qu’on pratiquoit au baptême, qui
font aujourd’hui abolies. Les théologiens diflingueftt le baptême
d’eau, de feu 8c de fang: Ibid. é. Tems où l’on baprifoit les
catéchumènes. Adminiftration du baptême. C’eft far.s fondement
qu’on a cru que dans la primitive églife on ne bapri-
foit que les adultes. Il faut convenir cependant qité la pra-‘
tique de baptifer les enfàns, n’étoit pas généralement obfervée
: les catéchumènes même différoient plufieurs années
à recevoir le baptême. A quelles forte? de gens oh
refufoit le baptême. Ibid. 65. On corivient aujourd’hur
qu’on ne doit pas%aprifer les enfans des infidèles malgré léurs
parens, à moins qu’ils ne foient en danger de mort. Quelques
uns s’abufant fur un paffage de S. Paul, ont cru qu’ori
devoit conférer le baptême aux morts. Ibid. 65. b.
Baptême , ( Médecine lêg. ) l’importance de ce facrèmént
a donné lieu à diverfes précautions pour qu’il ne fât admi-
niftré qu’à ceux qui peuvent en tirer du fruit. Suppl. I. 801.
a. De radminiftration du baptême aux foetus & aux avortons.'
Examen de la queftion : s’il eft des cas où la feule vue de bâp-*
tifer l’enfant p^iffe autorifer à foumettre la mere à l’opération
cèfarienne. Ibid. Du baptême du foetus par injeéUoiï
dans la matrice. Réflexion générale fur les qüeftions qui
viennent d’être propofées. Ibid. 802. a.
Baptême , fignification du mot baptifer. XVII. 756. b.
Régénération fignifiée par le baptême. XIII. 912. b. Dit
baptême par afperfion 8c par iramerfion. I. 758. a. VIIL
'575. b. Réflexion de M. Gales fur la néceflité de l’immer-
fion. XVII. 756. b. L’églife n’a pas rejetté le baptême des
hérétiques, lorfqu’ils n’en ont pas altéré la forme. VII.
178. a. XIII. 839. b. — Du baptême des profélytes dans
la primitive églife. XIIL 496. a. De l’ufage de laver les
pieds à ceux qui avoient été baptifés. IX. 312. b. Comment
on nomma ceux qui avoient reçu le baptême. VIII.
556. b. Anniverfaire du baptême dans Îa primitive églife. I.
484. a. Plufieurs dans les premiers fiecles différoient leur
baptême jufqu’à l’article de la inort : les peres s’élevèrent
contre cet abus : concile de Néocéfarée cité fur ce fujet.
III. 557. a. L’inftitution du baptême au nom des trois per-
fonnés, embraffée par des Platoniciens devenus chrétiens-
IX. 596. b. — Du baptême chez les Minereliens. X. 548. b.
Baptême des Marcionites. XIII. 840. a. Baptême des chrétiens
de S. Jean. III. 379. b. Des chrétiens de S. Thomas.
XVI. 283. a. Des Coptes. Suppl. II. 593. a. Des rébaptiiàns.
XIII. 839. b. — Du baptême des enfans : cérémonie ufitée’
chez les païens, qui avoit quelque rapport au baptême des
enfans. IX. 750. a.- Baptême des enfans chez les Mingre- ■
liens. X. 548. || Ouvrages anglois pour 8c contre l’ufage de
baptifer les enfanS. XVII. 756. a. Réflexions de M. Gales
contre le baptême des enfans. 756. h.— 757. Comment cet
ufage s’introduifit dans l’églife, félon cet auteur. 757. a. Du baptême
des avortons. I. 885. a-— Des noms de baptême." X I ..
201. b. Regiftre des baptêmes. XIV. 18. b. Contrôle des baptêmes.
IV. 149.a.Baptême des.cloches. III. 539. b.
•Baptême du Tropique onde la Ligne, (Marine) comment
cette cérémônie' fe pratique parmi les équipages françois. Le
vaiffeau françois qui n’a point encore pafle la ligne ou le
tropique, y eft fournis ; mais le capitaine le racheté. Beau-*
coup de capitaines aboliffent cette ridicule cérémonie. II.65. b.
BAPTES tm(bts) comédie compofée par Cratinus, ou il ,
railloit les principaux perfonnages du gouvernement. Comment
il fut la viétime de fa haraieffe. Prêtres appeÜés Baptes.
II. 66. a.
B apte s , ( Littèr. ) erreur à corriger dans cet article de'
l’Encyclopédie. Suppl. I. 8q2. <t.
G o