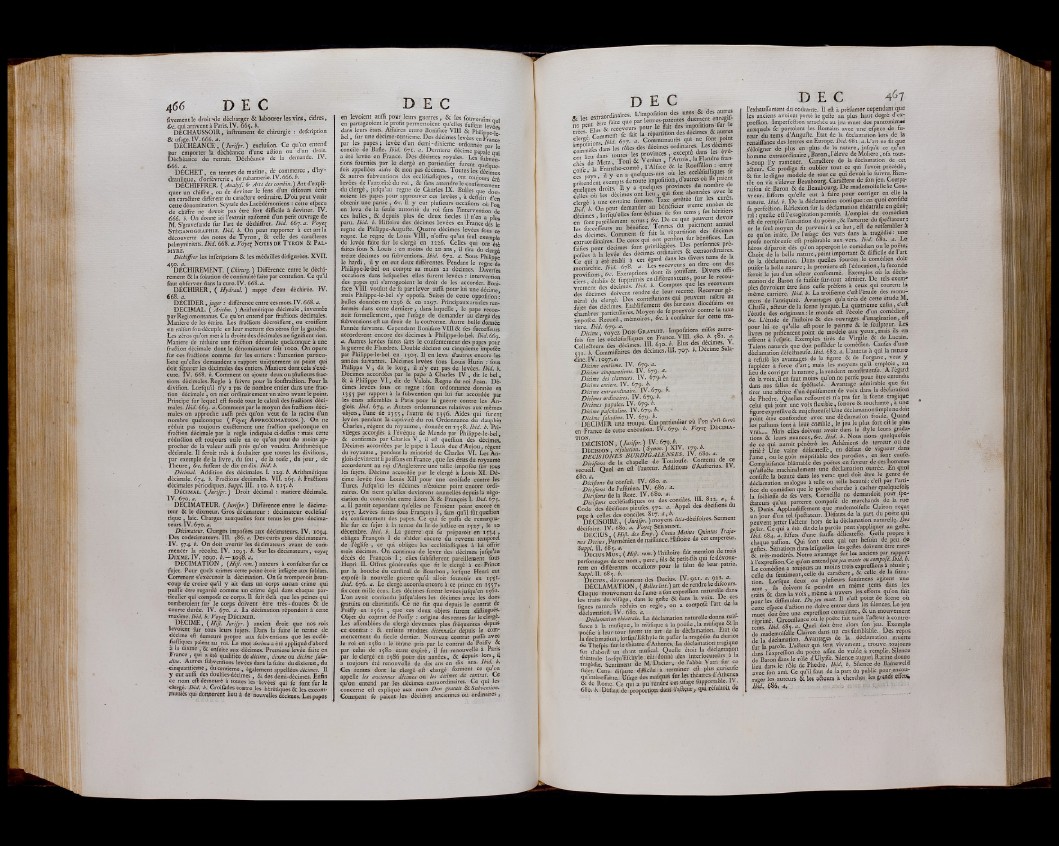
4 66 DEC ihrement le droit yle décharger & labourer les vins, cidres,
&c. qui arrivent à Paris. IV. 065. b.
DECHAUSSOIR, infiniment de chirurgie : defcription
8c ufagè. IV. 666. a.
DÉCHÉANCE, ( Jurifpr.) exclufion. Ce qu’on entend
£ar emporter la déchéance d’une aélion ou d’un droit.
^échéance du retrait. Déchéance de la demande. IV.
666. a. ,,,
DÉCHET, en termes de marine, de commerce , dhydraulique,
d’orfévrerie , de rubannerie. IV. 600. b.
DÉCHIFFRER. ( Analyf. & Arts des combin.) Art d expliquer
un chiffre , ou de deviner le fens d’un difcours ecnt
en caraélere différent du caraélere ordinaire. D’où peut venir
cette dénomination. Scytale des Lacédémoniens : cette efpece
de chiffre ne devoit pas être fort difficile à deviner. IV.
666. b. On donne ici l extrait raifonné d’un petit ouvrage de
M. S’gravefande fur l’art de déchiffrer. Ibid. 667. a. Voye^
S t é g a n o g r a p h i e . Ibid. b. On peut rapporter à cet art la
découverte des notes de Tyron, & celle des caraéleres
palmyréniens. Ibid. 668. a. Voye^ N o t e s d e T y r o n & Pal-
MYRE.
Déchiffrer les infcriptions & les médailles défigurées. XVIL
490. a.
DÉCHIREMENT. ( Chirurg.) Différence entre le déchirement
& la folution de continuité faite par contufion. Ce qu’il
faut obferver dans la cure. IV. 668. a.
DÉCHIRER, ( Hydraul. ) nappe d’eau déchirée. FV.
668. a.
DÉCIDER, juger : différence entre ces mots. IV. 668. a.
DECIMAL. ( Arithm. ) Arithmétique décimale, inventée
par Regiomontanus. Ce qu’on entend par fraélions décimales.
Maniéré de les écrire. Les fraélions décroiffent, ou croiffent
en raifon fou-décuple en leur mettant des zéros fur la gauche.
Les zéros qu’on met à la droite des décimales ne fignifient rien.
Maniéré de réduire une fradion décimale quelconque à une
fraétion décimale dont le dénominateur foit 1000. On opere
fur ces fraélions comme fur les entiers : l’attention particulière
qu’elles demandent a rapport uniquement au point qui
doit féparer les décimales des entiers. Maniéré dont cela s’exécute.
IV. 668. b. Comment on ajoute deux ou plufieurs fractions
décimales. Réglé à fuivre pour la fouftraélion. Pour la
divifion. Lorfqu’il n’y a pas de nombre entier dans une fraction
décimale, on met ordinairement un zéro avant le point.
Principe fur lequel eff fondé tout le calcul des fraélions décimales.
Ibid. 669. a. Comment par le moyen des fraélions décimales
on approche auffi près qu’on veut de la racine d’un
nombre quelconque ( Voye^ A p p r o x im a t i o n . ). On ne
réduit pas toujours exaâement une fraétion quelconque en
fraétion décimale par la réglé indiquée ci-deffus : mais cette
réduéiion eff toujours utile en ce qu’on peut du moins approcher
de la valeur auffi près qu’on voudra. Arithmétique
décimale. Il feroit très à iouhaiter que toutes les divifions,
par exemple de la livre, du fou , de la toife, du jour, de
l’heure, &c. fùffent de dix en dix. Ibid. b.
Décimal. Addition des décimales. I. 129. b. Arithmétique
décimale. 674. b. Fraélions décimales. VIL 265. b. Fraélions
décimales périodiques. Suppl. III. 110. b. 115. b.
D é c im a l . (Jurifpr.) Droit décimal : maüere décimale.
IV. 670. a.
DECIMATEUR. (Jurifpr.) Différence entre le décima-
teur & le dixmeur. Gros décimateur : décimateur eccléfiaf-
tique , laïc. Charges auxquelles font tenus les gros décima-
teurs. IV.670. a.
Décimateur. Charges impofées aux décimateurs. IV. 1094.
Des codécimateurs. III. 586. a. Des curés gros décimateurs.
- IV. 374. b. On doit avertir les décimateurs avant de commencer
la récolte. IV. 1093. b. Sur les décimateurs, voye%
D ixm e . IV. 1090. b.— 1098. a.
DECIMATION , (Hift. rom. ) auteurs à confulter fur ce
fujet. Pour quels crimes cette peine étoit infligée aux foldats.
Comment s’exécutoit la décimation. On fe tromperoit beaucoup
de croire qu’il y ait dans un corps aucun crime qui
puiffe être regardé comme un crime égal dans chaque particulier
qui compofe ce corps. 11 fuit delà que les peines qui
tomberaient fur le corps doivent être très - douces & de
courte durée. IV. 670. a. La décimation répondoit à cette
maxime. Ibid. b. Voye{ DÉCIMER.
DECIME, ( Hift. Jurifpr. ) ancien droit que nos rois
levoient fur tous leurs fujets. Dans la fuite le terme de
¡ta demeuré propre aux fubvéntions que les ecclé-
f p paient au roi. Le mot décima a été appliqué d’abord
a la dixme ,' & enfuite aux décimes. Premier« levée faite en
France , qui a été qualifiée de décime, dixme ou décime fala-
dtne. Autres fubvéntions levées dans la fuite du dixième, du
-cinquantième, du centième , également décimes. Il
y eut auffi des doubles-décimes g & des demi-décimes. Enfin
ce nom eff demeuré à toutes les levée* qui fe font fur le
clergé. Ibid b. Croifades contre les hérétiques & les excom-
immtés qui donnèrent lieu à de nouvelles décimes. Les papes
DEC en levoient auffi pour leurs guerres, & íes fouverainscm?
en partageoient le profit permettoient qu’elles foffent levé«*
dans leurs états. Affaires entre Boniface VIII & Philippe-i
bel, fur une décirae-centieme. Des décimes levées en Franc"
par les papes; levée d’un demi-dixième ordonnée par le
concile de Balle. Ibid. 671. a. Derniere décime papale aià
a été levée en France. Des décimes royales. Les fubven-
tions fournies par le clergé en particulier furent quelque^
fois appellées aides & non pas décimes. Toutes les décimes
& autres fubvéntions des eccléfiaftiques, ont toujours été
levées de l’autorité du roi, & fans attendre le consentement
du clergé, jufqu’au regne de Charles IX. Bulles que don-
noient les papes pouf approuver ces levées, à deffein d’eñ
obtenir une partie , &c. 11 y eut plufieurs occafions où l’on
en leva de la feule autorité du roi fans l’intervention de
ces bulles, & depuis plus de deux fiecles il n’en a plus
paru. Ibid. b. Hifloire des décimes levées en France dès le
regne de Philippe-Augufte. Quatre décimes levées fous ce
regne. Le regne de Louis VIII, n’offre qu’un feul exemple
de levée faite fur le clergé‘ en 1226. Celles qui ont été
faites fous S. Louis : en moins de 20 ans, il tira du clergé
treize décimes ou fubvéntions. Ibid. 672. a. Sous Philippe
le hardi, il y en eut deux différentes. Pendant le regne de
Philippe-le-bel on compte au moins 21 décimes. Diverfes
occafions dans lefquelles elles furent levées : intervention
des papes qui s’arrogeoient le droit de les accorder. Bonr-
face VIII voulut de fa part lever auffi pour lui une décime
mais Philippe-le-bel s’y oppofa. Suites de cette oppofition 1
bulles données en 1296 & en 1297. Principaux articles renfermés
dans cette derniere, dans laquelle, le pape recon-
noît formellement, que l’ufage de demander au clergé des
fubvéntions eff un droit de la couronne. Autre bulle donnée
l’année fuivante. Cependant Boniface VIII & fes fucceffeurs
accordèrent encore des décimes à Philippe-le-bel. Ibid. 669.
a. Autres levées faites fans le confentement des papes pour
la guerre de Flandres. Double décime ou cinquième impofée
par Philippe-le-bel en 1305. Il en leva d’autres encore les
années fuivantes. Décimes levées fous Louis Hutin : fous
Philippe V , dit le long, il n’y eut pas de levées. Ibid. b.
Décimes accordées par le pape à Charles IV , dit le bel,
& à Philippe V I , dit de Valois. Regne du roi Jean. Décimes
levees fous ce regne : fon ordonnance donnée en
1353 par rapport à la fobventiori qui lui fut accordée par
les états aflemblés à Paris pour la guerre contre les An-
glois. Ibid. 674. a. Autres ordonnances relatives aux mêmes
objets, l’une de 1335, l’autre de 1336. Aides qui furent
levées pendant la captivité du roi. Ordonnance du dauphin
Charles, régent du royaume, donnée en -13 38. Ibid. b. Privilèges
accordés à l’évêque de Mende par Philippe-le-bel,
& confirmés par Charles V , il eff queffion des décimes.
Décimes accordées par le pape à Louis duc d’Anjou, régent
du royaume , pendant la minorité de Charles VI. Les An-
glois devinrent fi puiffans en France, que les états du royaume
accordèrent au roi d’Angleterre une taille impofée fur tous
les fujets. Décime accordée par le clergé à Louis XI. Décime
levée fous Louis XII pour une croifade contre les
Turcs. Jufqu’ici les décimes n’étoient point encore ordinaires.
On tient qu’elles devinrent annuelles depuis la négociation
du concordat entre Léon X & François I. Ibid. 673.
a. Il paraît cependant qu’elles ne l’étoient point encore en
1337. Levées faites fous François I , fans qu’il fût queffion
du confentement des papes. Ce qui fe paffa de remarquar
ble fur ce fujet à la tenue'du lit de jufiiee en 1527 , le 20
décembre. Ibid. b. La guerre-qui fe préparait en 1334 ,
obligea François I de s’aider encore du revenu temporel
de l’églife , ce qui obligea les eccléfiaffiqües à lui offrir
trois décimes. On continua:de lever des décimes jufqu’au
décès de François I ; elles fubfiffercnt pareillement fous
Henri II. Offres généreufes que fit le clergé à céi Prince
par la bouche du cardinal'de Bourbon, lorlque Henri eut
expofé là nouvelle guerre qu’il alloit foutenir en 133x»
Ibid. 676. a. Le clergé accorda encore à ce prince en 1337»
fut cent mille écus. Les décimes furent levées jufqu’en 1301.
L’on avoit confondu jùfqu’alors les décimes avec les dons
gratuits ou charitatifs. Ce ne fut que depuis le contrat de
Poifly en 1361 , que ces deux objets furent diiHngués.
Objet du coptrat de Poifly : origine des rentes fur le clergé.
Les affemblées du clergé devenues plus fréquentes depuis
ce contrat : 8c enfuite rendues décennales depuis le commencement
du fiecle dernier. Nouveau contrat paffé avec
le roi en 1380 : lé terme pris par le contrat de Poifly &
par celui de 1380 étant expiré, il fut renouvellé à. Paris
par le clergé en 1386 pour dix années, & depuis lors, il
a toujours été renouvellé de dix ans en dix ans. Ibid.^ b.
Ces rentes dont le clergé cft chargé forment ce qu on
appelle les anciennes décimes ou les décimes^ du contrat* Ce
qu’on entend par les décimes extraordinaires. Ce qui les
concerne eff expliqué aux mots Don gratuit .& Subvention.
Comment fe paient les décimes anciennes ou ordinaires,
DEC
ne Pelî , ètrL receveurs pour le fait des impofinonsTur le
S l l s S i l ?» répartition des décimes & autres
clergé, commen ^ Communautés qui ne font point
iinpofnions. Ib . -g or,fc„aires. Lesdécunes
commifes dans 1 ^ provinces , excepté dans les évê- i
°m Metz Toul & Verdun , l’Artois, la Flandre fran-
■o. ^. Franche-comté, l'Alfac^ & le Rouffillon t entre
ces pays H y en a quelques-uns où les eccléfialùques fe
S t S n t exempts de toute impoftdon . d’autres ou ds paient
auelques droits. Il y a quelques provinces du nombre de
celles où les décimes ont lieu, qui font abonnées avec le
clergé à une certaine fomme. Taxe arrêtée fur es eu .
Ibid b On peut demander au bénéficier trente anné.es le .
dédmes lorfqu’elles font échues de fon tems ; fes hér,tiers
en font pareillement tenus; fe. De ce que peuvent devon
fes fucceffeurs au bénéfice/ Termes du paiement annuel
^“ “ Comment fe fait la
extraordinaires. De ceux qui ont peu ion fur bénéfices. Leç
faif.es pour décimes
nofées il la levée des décimes ordinaires poiees a la icv ies Cde ivexertrsa toermams adier elsa.
Ce qui a été.établi.à £ f™ eccvelll.s en titre ont des
provffionf' fe . Exemptions dont ils ¡ouiffent. Divers ofii-
ciers établis & /opprimés endifférenstems, pour le recouvrement
des décimes. Ibid. b. Comptes que les receveurs
dés déc mes doivent rendre de leur recette. Receveur gé-
nSal dû clergé. Des comeftations qui peuvent naître au
fuiet des décimes. Etabliffement des bureaux diocefams ou
chambres particuliefes. Moyen de fe pourvoir conne a »
impofée. Recueil, mémoires, f e .à confulter fur cette ma
mDéc'm;TOyez'boN-GRATUlT. Im^fitions mifes autrefois
fur les eccléfiaftiques en France. VIII. 580.b. 581. a.
Collefteurs des d é c i III, 630. * Elus
531. b. Commiffaires des décimes.III. 707. b. Décime bala
dîne. IV. 1097. a.
Décime centième. IV. 679. Û.
Décime cinquantième. IV. 679. <*.
Décime des clameurs. IV. 679* ?•
Décime entière. IV. 679. b.
Décime extraordinaire. IV. 679. b.
Décimes ordinaires. IV. 679. b.
Décimes papales. IV. 679. b.
Décime pajehaline. IV. 679. b.
Décime faladtne. IV. 679. b.
DÉCIMER une troupe. Casparnculieroù lonseftfervt
en France de cette exècunon. IV. 679. b. Voyc^ D é c im a
TION. „ % ' ,
DÉCISION , I Jurifpr. ) IV. 67g. b.
D é c i s i o n , réjolution. (Synon.) x iv . 179* *’•
DEC1S10NES BURDIÙALENSES \V.6So. a.
Dicificns de la chapelle de Toulpufe. Çontenu de ce
recueil. Quel en eff l’auteur. Additions dAufrenus. IV.
680. a. '
D ¿cifions du cônfeil. IV. 680. a.
Dicifions de Juftiniem TV. 680. a.
Dédiions de la Rote. IV. 680. a.
Dicifiom eccléfiaftiques ou des concdes. IIL Sia. a , b.
Code des décifions pieufes. 57a. «• Appel des décifions du
oaDe à celles des conciles. 817. at b. .
î)ÉCISOIRE, ( Jurifpr. ) moyens ffiw-décifoires. Serment
dècifoire. IV. 680. a. Voye[ S e r m e n t . n . Trrl:a.
DECIUS ( Hift. des Emp.) Cneus Menus Qumtus Iraja
nus Decius, Parmenien de naiflWe. Hifloire de cet empereur.
S”ffÉcîusMust( Hiji. rom.) l'hiftoire fait mention de trois
perfoimages de « n om , pcrc, fils & pedt-fiU qui fe dévouèrent
en liffèrentes 0003/101» pour le falut de leur patne.
Suppl. II. 683. b. , _ « «
D e c iu s , dévouement des Decius. IV . 921. a. 922. .
DÉCLAMATION, (Belleslett.) art de rendre le dilcours.
Chaque mouvement de l’ame a fon expreffion naturelle ans
les traits du vifage, dans le gefte & dans la voix. De ces
lignes naturels réduits en réglé, on a compofé 1 art de a
xléclamation. IV. 680. a. ■ ' f
Déclamation théâtrale. La déclamation naturelle donna naii-
fance à la mufique, la mùfique à la poéfie, la miifique oc la
p o é fie " à leur tour firent un art de la déclamation. Etat de
la dédamarion, lorfqu’Efchyle fit pafler la tragédie du chariot
rie Thefpis fur-le théâtre d Athènes. La déclamation.tragique
fin d’abord un chant mufical. Quelle étoit la déclamation
théâtrale lorfqu'Efchyle . eût/donné -des interlocuteur à la
tragédie. Sentiment de M. Dacier, de l’abbé Vam fur ce
fujet. Cette difpute difficile, a terminer: eft p t a fflnwfe
qu'intércffafite. Ufage des mafqueS fur les théatres d Athènes
& de Rome. Ce qui a pu rendré cet ufage fupportable. IV.
68o. b. 1 Défaut de proportion dans lXaçWy qui telultott de
DEC 467
l’exhauflentent du cothurne. Il eft à préfumer cependant que
les anciens avoient porté le gefte au plus haut degré d’ex-
preffion. Jmperfeélion attachée au jeu muet des pantomimes
auxquels fe portoient les Romains avec une eipece de foreur
du tems d’Augufte. Etat de la déclamation lors de la
renaiflance des lettres en Europe. Ibid. 681. a. L’art ne fit que
s’éloigner de plus en plus de la nature, iufqù’à ce qu un
homme extraordinaire, Baron,l’éleve de Molière, ofa tout-
à-coup l’y ramener. Caraélere de la déclamation de cet
aâeur. Ce prodige fit oublier tout ce qui l’avoit précédé,
& fut le digne modèle de tout ce qui devoit le foivre. Bientôt
on vit s’élever Beaubourg. Caraôere de fon jeu. Compa-
raifon de Baron & de Beaubourg. De mademoifelle le Couvreur.
Efforts qu’elle eut à foire pour corriger en elle la
nature. Ibid. b. De la déclamation comique: en quoi conlitte
fa perfection. Réflexion fur la déclamation théâtrale en gêné;
ral : quelle eft l’exagération permife. L’emploi du comédien
eft de remplir l’intention du poète, & l’attente du foeélateur :
or le feul moyen de parvenir à ce but, eft de reflembler à
ce qu’on imite. De l’ufage des vers dans la tragédie: une
proie nombreufe eft préférable aux vers. Ibid. 682. a. Le
héros difparoît dès qu’on apperçoit le comédien ou le poete.
Choix de la belle nature,point important & difficile; de lart
de la déclamation. Dans quelles fources le comédien doit
puifer la beüe nature ; la première eft l’éducation, la fécondé
ferait le jeu d’un aéleur confommé. Exemples ou la déclamation
de Baron fe faiioit for-tout admirer. De^ tels exemples
devraient être fans ceffe préfens à ceux qui courent la
même carrière. Ibid. b. La troifieme C’eft l’étude des monu-,
mens de l’antiquité. Avantages qu’a tirés de cette étude M,
Chaffé, aéteur de la feene lyrique. La quatrième enfin,, celt
l’étude des originaux : le monde eft l’école d un comédien ,
&c. L’étude de l’hiftoire & des ouvrages d’imagination, elt
pour lui ce qu’elle eft pour le peintre & le fculpteur. Les
livres ne présentent point de modèle aux yeux, niais ils en
offrent à l’efprit. Exemples tirés de Virgile & de Lucain.
Talens naturels que doit pofféder le comédien. Caules dune
déclamation défedueufe. Ibid. 682. | L’auteur à qui la nature
a refofé les avantages de la figure & de 1 organe, veut y
fuppléer à force d’art; mais les moyens qu’il emploie, au
lieu de corriger la nature, la rendent monftrueufe. A 1 egara
de la voix,il en fout moins qu’on ne penfe.pour être entendu
dans nos folles de fpéftacle. Avantage admirable que lut
tirer une aftrice d’un épuifement de voix dans la déclaration
de Phedre. Quelles reffources n’a pas fur la feene tragique
celui qui joint une voix flexible, fonore & touchante, à une
figure expreffive & majeftueufei Une déclamation fimple ne doit
point être confondue avec une déclamation froide. Quand
les paffions font à leur comble, le jeu le plus fort eft le plus
vrai Mais elles doivent avoir dans le ftyle leurs gradations
& leurs nuances, &c. Ibid. b. Nous rions quelquefois
de ce qui aurait pénétré les Athéniens de terreur ou de
pitié? Une vaine délicateffe, un défaut de vigueur dans
l’ame, ou le goût méprifoble des parodies , en font caufe.
Complaifance blâmable des poètes en faveur de ces hommes
qü’afleéle machinalement une déclamation outrée. En quoi
confifte la beauté dans les vers: quel doit être le genre de
déclamation analogue à telle ou telle beauté : c eft par 1 artifice
du comédien que le poète cherche à cacher quelquefois
la foibleffe de fes vers. Corneille ne demandoit pour ipe-
âateurs qu’un parterre compofé de marchands de la rue
S. Denis. Applaudiffement que mademoifelle Glairon reçut
un jour d’un tel foeélateur. Défoins de la part du poète qui
peuvent jetter 1’aâeur hors de la déclamation naturelle. Des
ee ftes. Ce qui a été dit de la parole peut s’appliquer au gelle.
Ibid. 684. a. Effets d’une fouffe délicateffe. Gefte propre à
chaque paffion. Qui font ceux qui ont befoin de peu de
geftes. Situations dans lefquelles lesgeftes doivent être rares
& très-modérés. Notre avantage fur les anciens par rapport
à l’expreffion.Ce qu’on entend par;«/ mixte ou compofé. Ibid. b.
Le comédien a toujours au moms trois expreffions à réumr ,
celle du fentiment,celle du caraôere, & celle de la fitua-
tion. Lorfque deux ou plufieurs fennmens agitent une
ame , ils doivent fe peindre en même tems dans les
traits & dans la voix, même à travers les efforts quon fait
pour les diffimuler. Du jeu muet. Il n’eft point de feene ou
cette efpece d’aftion ne doive entrer dans les filences.Le jeu
muet doit être une expreffion c o n tra in teu n mouvement
réprimé. Circonftance où le poète foit taire laéleur à contre-
tems. Ibid. 685. | Quel doit être alors fon jeu. Exemple
de mademoifelle Clairon dans un casfemb able. Des repos
de la déclamation. Avantages de la déclamation muette
fur la parole. L’afteur qui fent vivement , trouve, toujours
dans l’expreffion du poète affez de yuide à remplir. Silence
de Baron dans le rôle d’Ulyfle. Silence auquel Racine, donne
lieu dans le rôle de Phedre. Ibid. b. Silence de Bameweld
avec fon ami. Ce qu’il faut de la part du public pour„encou-
rager les auteurs & 1«5 àéleu.rs à chercher les grand?
Ibid, 686«. a%