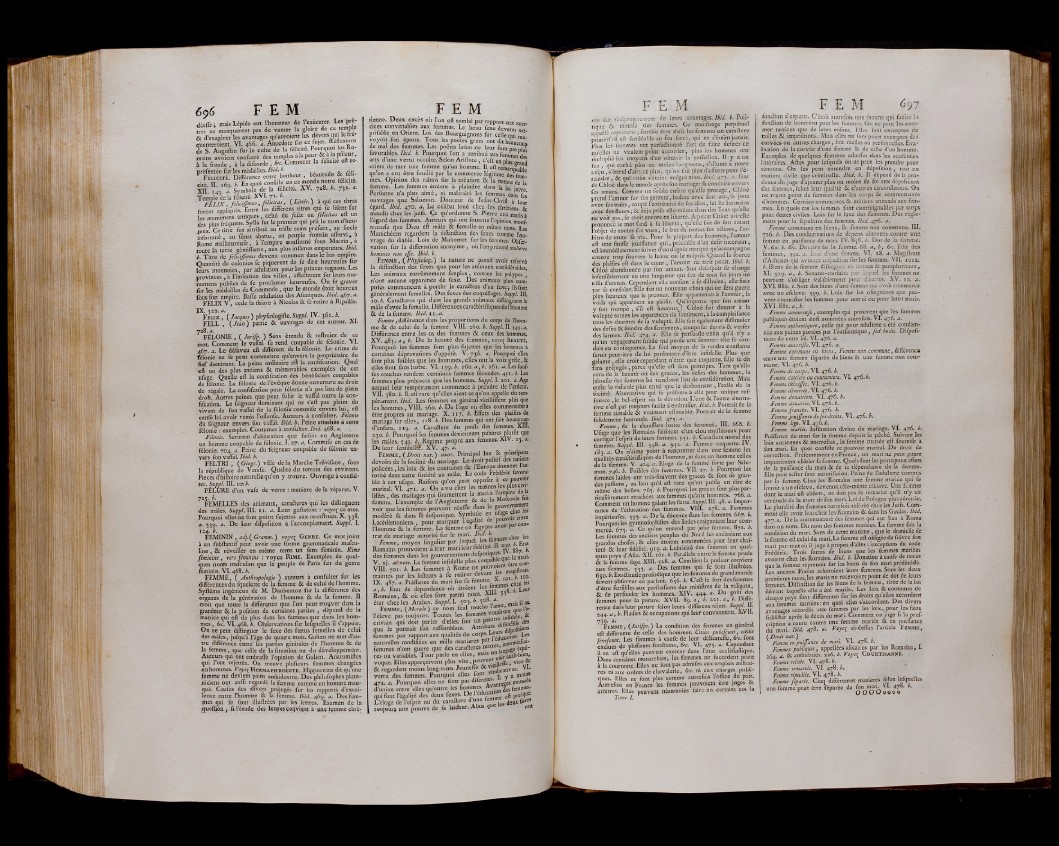
6 $ 6 F E M
déefle ; mais Lépide eut l'honneur de l'exécuter. Les-prêtres
%
ne manquèrent pas de vanter la gloire de ce tÇmP'e
& d’exagérer les avantages qu'aurotent les
tenteraient. VI. 466. a. Anecdote fur ce fujet. Réflexions
S. Auguftin fur le culte de la féltçtté. Pourquoi les Romains
avoient eonfacré des temples àla P“ "
1 la fraude , à la difcorde, «*. Comment la féltetté elt repréfentèe
fur les médailles. /W. b. t,t,,:.,.a- A- fitli-
FÉLICITÉ. Différence entre bonheur , béatitude & félt
cité. II. 169. b. Enuuol c o n f l u encemondenou-e fé tcué.
XII 143. a. Symbole de la félicité. XV. 728. b. 731. a.
Temple de la félicité. XVI. 71. b. - . .
FELIX, felicijfunus, félicitas, ( Littér. ) à qui ces titres
furent appliqués. Entre les différens titres qui fe lifent fur
les monumens antiques, celui de fchx ou félicitas eft un
des plus fréquens. Sylla fut le premier qui prit le nom d heureux
Ce titre fut attribué au trifte tems jjréfent, au fiecle
infortuné, au fénat abattu, au peuple romain afleryi, à
Rome malheureufe, à l’empire «onlterné fous Macnn, a
toute la terre gémiffante, aux plus infâmes empereurs. Ibid.
b. Titre de felicijfunus devenu commun dans le bas empire.
Quantité de colonies fe piquèrent de fe dire heureufes fur
leurs monnoies, par adulation pour les princes regnans. Les
provinces , a l’imitadon des villes, affefterent fur leurs monumens
publics de fe proclamer heureufes. On fit graver
fur les médailles de Commode, que le monde étott heureux
fous fon empire. Baffe aduladon des Aftatiques. Ibid. 467. <*.
FELIX V , cede la thiare à Nicolas 8c fe retire à Ripaille.
JX. 3 22. <*.
F é l i x , ( Jacques ) phyfiologifte. Suppl. IV. 361. b.
FELL , ( Jean ) patrie & ouvrages de cet auteur. XI.
^FÉLONIE, ( Jurifp. ) Sens étendu & reftreint de ce
mot. Comment le vaffal fe rend coupable de félonie. VI.
467. a. Le défaveu eft différent de la félonie. Le crime de
félonie ne fe peut commettre qu’envers le propriétaire du
fief dominant. La peine ordinaire eft la confifcation. Quel
eft un des plus anciens & mémorables exemples de cet
ufage. Quelle eft la confifcation des bénéficiera coupables
de félonie. La félonie de l’évêque donne ouverture au droit
de régale. La confifcation pour félonie n’a pas lieu de plein
droit. Autres peines que peut fubir le vaffal outre la confifcation.
Le leigneur dominant qui ne s’eft pas plaint du
vivant de fon vaffal de la félonie commife envers lui, eft
cenfé lui avoir remis l’offenfe. Auteurs à confulter. Félonie
du feigneur envers fon vaffal. Ibid. b. Peine attachée à cette
félonie : exemples. Coutumes a confulter. Ibid. 468. a.
Félonie. Serment d’abjuration que faifoit en Angleterre
un homme coupable de félonie. I. 27. a. Commife en cas de
félonie. 704. a. Peine duléigiieur coupable de félonie envers
fon vaffal Ibid. b.
FELTRI , ( Géoer.) ville delà MarcheTrévifane, fous
la république de Venife. Qualité du terrein des environs.
P iè c e s d ’h if lo ir e naturelle qu’on y trouve. Ouvrage à confulter.
Suppl. III. ios b.
FÊLURE d’un vafe de verre : maniéré de la réparer. V.
745. b.
FEMELLES des animaux, cara&cres qui les diftinguent
des mâles. Suppl. III. 11. a. Leur geftation : voye{ ce mot.
Pourquoi elles ne font point fujettes aux menftrues. X. 338.
a. 339. a. De leur difpofition à l’accouplement. Suppl. I.
124. b. H H H |
FÉMININ, adj.( Gramm. ) voye^ G e n r e . Ce mot joint
a un fubftantif peut avoir une forme grammaticale mafeu-
line, & réveiller en même tems un fens féminin. Rime
féminine, vers féminins : voyez R im e . Exemples de quelques
noms mafeulins que le peuple de Paris fait du genre
féminin. VI. 468. b.
FEMME, ( Anthropologie ) auteurs à confulter fur les
différences du fquelette de la femme & de celui de l’homme.
Syftème ingénieux de M. Daubenton fur la différence des
organes de la génération „ Ide l’homme 8c de la femme. Il
croit que toute la différence que l’on peut troqver dans la
grandeur & la pofition de certaines parties , dépend de la
matrice qui eft de plus dans les femmes que dans les hommes,
6*c. VI. 468. b. Obfervations fur leiquelles il s’appuie.
On ne peut diftinguer le fexe des foetus femelles de celui
des mâles, jufqu’à l’âge de quatre mois. Galien ne met d’autre
différence entre' les parties génitales de l’homme & de
la femme, que celle de la fituation ou du développement.
Auteurs quiont embraffé l’opinion de Galien. Anatomiftcs
qui l’ont rejettêe. On trouve plufieurs femmes changées
on hommes. Vyye^ H e r m a p h r o d i t e . Hippocrate dit qu’une
femme ne devient point ambidextre. Des philofophes platoniciens
ont aufli regardé la femme comme un homme manqué.
Caufes des divers préjugés fur les rapports d’excellence
entre l’homme & la femme. Ibid. 469. a. Des femmes
qui fe font illuftrées par les lettres. Examen de la
flueftion, fi l’étude des lettres convient à une femme chré-
F E M
tienne. Deux excès oh l’on eft tombé par rapport aux c*.,-
etees convenables aux femmes. Le beau fexe devenu mi
prifable en Orient. Loi des Bourguignons fur celle qui M
voyott fon époux. Tous les poètes grecs ont ditbraucoun
de mal des femmes. Les poètes latins ne leur font pas plu«
favorables. Ibid. b. Pourquoi l’on a attribué aux femmes dos
arts d’une vertu occulte. Selon Ariftote , c’eft un plus gra d
crime de tuer une femme qu’un homme. 11 eft remarauahl
qu’on a cru être fouillé par le commerce légitime des femmes.
Opinion des rabins fur la création & la nature de l"
femme. Les femmes étoient à plaindre dans la loi juive
Perfonne n’a plus aimé, ni maltraité les femmes dans fes
ouvrages que Salomon. Douceur de Jefus-Chrift à leur
égard. Ibid. 470. a. Le célibat loué chez les chrétiens 6c
maudit chez les juifs. Çe qu’ordonne S. Pierre aux maris à
l’égard des femmes. Auteurs qui ont foutenu l’opinion monf-
trueufe que Dieu eft mâle oc femelle en même tems. Les
Manichéens regardent la diftinftion des fexes comme l’ouvrage
du diable. Loix de Mahomet fur les femmes. Obfer-
vation fur la differtation anonyme, où l’on prétend mulieres
hommes non ejfe. Ibid. b.
F e m m e , ( Phyjiolog.) la nature ne paraît avoir réfervé
la diftinétion des fexes que pour les animaux confidérables.
Les animaux extrêmement amples, comme les polypes ,
n’ont aucune apparence de fexe. Des animaux plus com-
poiés commencent à portèr le caraâere d’un-fexe; ils font
généralement femelles. Des fexes des coquillages. Suppl. III,
10. b. Caraftcres qui dans les grands animaux diftinguent le
mâle d’avec la femelle. Différences cara&ériftiques de nvomme
& de la femme. Ibid. 11. a.
Femme, différence dans les proportions du corps de l’homme
& de celui de la femme. VIII. 260. b. Suppl. II. 347. a.
Différence entre les os des femmes & ceux des hommes.
XV. 483. a , b. De la beauté des femmes, voyer B e a u t é .
Pourquoi les femmes font plus fujettes que les hommes à
certaines dépravations d’appetit. V. 736. a. Pourquoi elles
font plus foibles que les hommes, elles ont la voix grêle,8c
elles font fans barbe. VI. 159. b. 160. a, b. 161. a. Les fauf-
fes couches rendent certaines femmes fécondes. 451. b. Les
femmes plus précoces que les hommes. Suppl. I. 201. a. Age
auquel leur tempérament commence a prendre de Pardeur.
VII. 380. b. Il eft rare qu’elles aient ce qu’on appelle du tempérament.
Ibid. Les femmes en générai vieilliffent plus que
les hommes, VIII. 260. ¿.De Page où elles commencent à
être propres au mariage. X. 117. b. Effets des plaifirs du
mariage fur elles, 118. b. Des femmes qui ont fait beaucoup
d’en fans. 119. a. Caraétere du pouls des femmes. XUI.
230. b. Pourquoi les femmes deviennent puberesplutot que
les mâles. 549. b. Régime propre aux femmes. XIV. 13.0.
De leur fenfibilit?. XV. 47. a.
, ( Droit nat. ) uxor. Principal but & principaux
la fociété du mariage. Le droit pofitif des nanons
esloix & les coutumes de l’Europe donnent laudes
F e m m e , ( L
devoirs.de la f i .....
policées, les loix & les coutumes de 1 -- - -, ( .
torité dans cette fociété au mâle. Le code Frédéric fJV®
ble à cet ufage. Raifons qu’on peut oppofer à ce pouvoir
marital. VI. 471. a. On a vu chez les nattons les plus ctv
lilées, des mariages qui foumettent le mari à 1 empir
femme. L’exemple de l’Angleterre & de la Moicove fin
yoir que les femmes peuvent réuflir dans le ggq -
modéré & dans Ife defpotique. Symbole en ufâg
Lacédémoniens , pour marquer 1 égalité de p ^
l’homme & la femme. La femme en Egypte av P
trat de mariage autorité fur le mari. Ibid. b. j
Fm m, moyen fingulier par lequel les
Romainsproitvoient f e * *
femmes dans les gouvernemens defpotiques. 1 • 7
V. xj. | g | La femme infidelle plus coupable
VIII. 70710. 1.b . bL. eLse sfe fmemmmese sà àK oRmome en en eF wpuo;u7v; : " ai(gir:rattrsa. ts.
traintes par les liéteurs à fe retirer devant ^ l03.
IX. 487.1 Puiffance du mari fur fa femme. A. *0 ^
ayb. Etat de dépendance ou étoient les ¿.Leur
Romains, & où elles font parmi nous. Am- 55 •
état chez les Arabes. Suppl. I. 503. b. 50 . a. ^ ,j nC
F e m m e , (Morale) ce nom feul touche la » | |
l’éleve pas toujours. Toutes les femmes y :nfidele, &
crivain qui doit parler d’elles foit un peint des
que le portrait foit reffemblant. Attributs,^ .^/¡¿ons
femmes par rapport aux qualités du corps. "T ., ¿„n. Les
naturelles modifiées en mille maniérés par ic
femmes n'ont guere que des carafteres mixtes, iqm.
res ou variables. Tout parle en elles, mais jr-auifi-bien,
voque. Elles apperçoivent plus vite >JBel^ en-g:|iefire, vice &
& regardent moins long-tems. Jeuneffc tx ^ij^tives: V I .
vertu des femmes. Pourquoi elles font .. a moins
472. a. Pourquoi elles, ne font pas difcreW - mlltUels
d’union entre elles qu’entre les hommes. on les femn>eS'
qui font l’égalité des deux fexes. De 1 idu“ ' t eftiP(# 0 5
L’éloge de l’efprit ou du caraftere dune:fontun ^ fcxes
toujours, une preuve de fa laideur. Abus q ont
F E M
ont fait réciproquement de leurs avantages. Ibid. b. Politique
& morale des femmes. Ce menfonge perpétuel
appelle coquetterie, femble être dans les femmes un caraftere
primitif : il eft femblable au feu .facré, qui ne s’éteint jamais.
Plus les femmes ont perfectionné l’art de faire deurer ce
qu’elles ne veulent point accorder, plus les hommes ont
multiplié les moyens d’en obtenir la poffeflion. Il y a un
feu, qui caché plus ou moins long-tems, s’allume à notre
iiifeù, s’étend d’autant plus, qu’on tait plus d’efforts pour l’éteindre,
& qui enfin s éteint malgré nous. Ibid. 473. a. Etat
de Chloé dans Je monde après fon mariage: fa conduite envers
fés amans. Comme un foible enfant qu’elle protège, Chloé
prend l’amour fur fes genoux, badine avec fon arc, fe joue
avec fes traits, coupé l’extrémité de fes ailes, lui lie les mains
avec des fleurs ; & déjà prife elle-même dans des liens qu’elle
ne voit pas,fe croit encore en liberté. A peine Chloé a-t-elle
prononcé le mot fatal à fa liberté, qu’elle fait de fon amant
l’objet de toutes fes vues, le but de tontes fes aélions, l’arbitre
de toute fa vie. Pour la plupart des hommes, 1 amour
eft une fàuffe jouiffance qui, précédée d un defir incertain ,
eft immédiatement fuivic d’un dégoût marqué qu accompagne
encore trop fouvent la haine ou le mépris. Quand la fource
des plaifirs eft dans le coeur, l’amour ne tarit point. Ibid. b.
Chloé abandonnée par fon amant. Son dcfefpoir fe change
infenfiblement en une langueur qui fait de tous fes jours un
tiffu d’enriuis. Cependant elle confent a fe diftraire, elle finit
par fe confoler. Elle fait un nouveau choix qui ne fera guere
plus heureux que le premier. Elle appartenoit à 1 amour, la
voilà qui appartient au plaifir. Qu’importe que fon amant
y foit trompé , s’il eft heureux^! Chloé fait donner à la
volupté toutes les apparences du fentiment, à la complaifance
tous les charmes de la volupté. Elle fait également diflimuler
des defirs & feindre des fentimens, compofer desris & vêrfer
des larmes. Ibid. 474. a. Elle fe perfuade enfin qu’il n’y a
qu’un engagement folide qui perde une femme: elle fe conduit
en conféquence. Le feul moyen de la rendre confiante
ferait peut-être de lui pardonner d’être infidelle. Plus que
galante, elle croit cependant n’être que coquette. Elle fe dit
fans préjugés, parce qu’elle eft fans principes. Tant qu’elle
aura de la beauté ou des grâces, les defirs des hommes, la
jaloufie des femmes lui tiendront lieu de confidération. Mais
enfin le ridicule plus cruel que le deshonneur , l’exile de la
fociété. Alternative qui fe préfente à elle pour unique ref-
lburcc ,1c bel-efprit ou la dévotion. Lune & 1 autre alternative
n’eft pas toujours facile à embraffer. Ibid. b. Portrait de la
femme aimable & vraiment eftimable. Portrait de la femme
folidement heureufe. Ibid. 475. a.
Femme, de la chauffure haute des femmes, III. 260. b.
Ufage que les Romains fâifoient d’un clou myftérieux pour
corriger l’eiprit de leurs femmes. 551. b. Caractère moral des
femmes. Suppl. 111. 948. a. 932. a. Femme coquette. IV.
183. a. On n’aime point à rencontrer dans une femme les
qualités caraftériftiques de l’homme, ni dans un homme celles
delà femme. V. 404. a. Eloge de la femme forte par Salomon.
746. b. Foibles des femmes. VII. 27. b. Pourquoi les
femmes laides ont très-foùvent des grâces & font de grandes
pallions, au lieu qu’il eft rare qu’on puiffe en dire de
même des belles. 763. b. Pourquoi les grâces font plus particulièrement
attachées aux femmes qu’aux hommes. 766. a.
Comment un homme galant les flatte. Suppl. III. 48. a. Importance
de l’éducation des femmes. VIII. 278. a. Femmes
impérieufes. 393. a. De la décence dans les femmes. 667. A
Pourquoi les gymnofophiftes des Indes craignoient leur commerce.
673. a. Ce qu’on entend par jolie femme. 872. b.
Les femmes des anciens peuples du Nord les excitoient aux
grandes chofes, & elles étoient renommées pour leur chaf-
teté & leur fidélité. 919. a. Lubricité des femmes en quelques
pays d’Afie. XII.. 161. b. Parallèle entre la femme prude
1 la femme fage. XIII. 328. 1 Combien la pudeur convient
aux femmes. 333. a. Des femmes qui fe font illuftrées.
630. b. Exaâitude profodique que les femmes du grand monde
favent pbferver en parlant. 636. b. C’eft le fort des femmes
d’être fenfiblesaux perfuafions des miniftres de la religion,
& de perfuader les hommes. XIV. 444- '*• §ou*
femmes pour la parure. XVII. 89. a , b. zzi. a, b. Diffe-
rence dans leur parure félon leurs différens teints. Suppl. II.
244. u, b. Plaifirs & occupations qui leur conviennent. XVII.
739. a. • , ,
F em m e , ( Jurifpr. ) La condition des femmes en général
eft différente de celle des hommes. Citiùs pubefeunt, citiùs
fenefeunt. Les femmes à caufe de leur délicateffe, &c. font
exclues de plufieurs fondions, 6>c. VI. 473. a. Cependant
il en eft qu’elles peuvent exercer dans l’état eccléfiaftique.
Dans certaines monarchies, les femmes ne fuccedent point
à la couronne. Elles ne font pas admifes aux emplois militaires
ni aux ordres de chevalerie, bc. ni aux charges publiques.
Elles ne font plus comme autrefois 1 office de pair.
Autrefois en France les femmes poiivoient etre juges oc
arbitres. Elles peuvent néanmoins faire en certains cas la
Tome I.
F E M 697
fonction d’experts. Ç’étoit autrefois une fémihe qui faifoit la
fonélion dé bourreau pour les femmes. On ne peut les nommer
tutrices que de leurs enfans. Elles font exemptes de
tailles & impofitions. Mais elles ne font point exemptes des
corvées ou autres charges, foit réelles ou perfonnclles. Evaluation
de la corvée d’une femme 8c de celle d’un homme.
Exemples de quelques femmes admifes dans les académies
littéraires. Aâes pour lefquels on ne peut les prendre pour
témoins. On les peut entendre en dépofition, tant en
matière civile que criminelle. Ibid, b. Il dépend de la prudence
du juge a’ajouter plus ou moins de foi aux dépofitions
des femmes, félon leur qualité & d’autres circonftances. On
ne reçoit point de femmes dans les corps & communautés
d’hommes. Certains commerces 8c métiers annexés aux femmes.
En quels cas les femmes font centraignables par corps
pour dettes civiles. Loix fur leduxe des femmes. Des régie-'
mens pour la fépulture des femmes. Ibid. 476. a.
Femme commune en biens, 8c femme non commune. IIL
726. b. Des condamnations de dépens obtenues contre une
femme en puiffance de mari. IV. 838. b. Dot de la femme.
V. 62. b. &c. Douaire de la femme. 68. at bt &c. Edit des
femmes, 392. a. Etat d’une femme. VI. 28. a. Magiftrats
d’Athenes qui avoient infpeâion fur ies femmes. VII. 1022.
b. Biens de la femme diftingués en dotaux 8c paraphernaux,
XL 919. a f b. Senatus-confulte par lequel les femmes ne,
peuvent s’obliger valablement pour d’autres. XV. 10. a.
XVI. 880. b. Sort des biens d’une femme qui avoit commerce,
avec un efclave. 399. b. Loix fur les obligations que peuvent
contraéler les femmes pour autrui ou pour leurs maris.
XVI. 881. * , b.
Femme amoureufe, exemples qui prouvent que les femmes
publiques étoient ainfi nommées autrefois. VI. 476. a.
Femme authentiquée, celle qui pour adultéré a été condamnée
aux peines portées par l’authentique , fed hodie. Difpofi-
tions de cette loi. VI. 476. a.
Femme autorifée. VI. 476. a.
Femme commune en biens, Femme non commune, différence
entre une femme féparée de biens 8c une femme non commune.
VI. , 476. b.
Femme de corps. VI. 476. b.
Femme cottiere ou coutumiere. VI. 476. b.
Femme, délaijfée. VL 476. b.
Femme divorcée. VI. 476. b.
Femme douairière. VI. 476. b.
Femme douairée. VI. 476. b.
Femme franche. VI. 476. b.
Femme jouijfante de fes droits. VI. 476. b.
Femme lige. VI. 476. b. . .
Femme mariée. Inftitution divine du mariage. VI. 476. b.
Puiffance du mari fur la femme depuis le péché. Suivant les
loix anciennes 8c nouvelles, la femme mariée eft foumife à
fon mari. En quoi confifte ce pouvoir marital. D a droit de
corrcâion. Prefcntement en France, un mari ne peut guere
impunément châtier fa femme. Quels font les principaux effets
de la puiffance du mari 8c de la dépendance de la femme.
Elle peut tefter fans autorifation. Peine de l’adultere commis
par la femme. Chez les Romains une femme mariée qui fe
livrait à un efclave, devenoit elle-même efclave. Une femme
dont le mari eft abfent, ne doit pas fe remarier qu’il n’y ait
certitude de la mort de fon mari. Loi de Pologne plus adoucie.
La pluralité des femmes autrefois tolérée chez les Juifc. Comment
elle avoit lieu chez les Romains 8c dans les Gaules. Ibid.
477.a. Delà communauté des femmes qui eut lieu à Rome
dans un tems. Du nom des femmes mariées. La femme fuit la
condition du mari. Sens de cette maxime, que le domicile de
la femme eft celui du mari. La femme eft obligée de fuivre fon
mari par-tout où il juge à propos.d’aller : .exceptions du code
Frédéric. Trois fortes de biens que les femmes mariées
avoient chez les Romains. Ibid. b. Donation à caufe de noces
que la femme reprenoit fur les biens de fon mari prédécédé.
Les anciens Francs achetoient leurs femmes. Sous les deux
premières races, les maris ne recevoient point de dot de leurs
femmes. Diftinftion fur les biens de la femme, tirée de la loi
fuivant laquelle elle a été mariée. Les loix & coutumes de
chaque pays font différentes fur les droits qu ellesaccordent
aux femmes mariées: en quoi elles s’accordent. Des divers
avantages accordés aux- femmes par les loix, pour les faire
I fubfifter après lé décès du mari. Comment on juge fi la prefi
criPtion a couru contre une femme mariée 8c en puiffance
du mari. Ibid. 478- S ci-deffus l ’article F e m m e ,
(Droit nat.) . 0 ,
Femme en puijfance de mari. VI. 47». b.
Femmes publiques, appellées alicaires par les Romains,.L
264. a. 8c ambubaies. 226. b. Foye% COURTISANNE.
Femme relifle. VI. 478. b.
Femme remariée. VI. 478. b.
Femme répudiée. VI. 478. b. .
Femme féparée. Cinq différentes manières félon lefquolles
une femme peut être féparée de fon mari. V1* 47°- b>
O O O O 0 0 0 0