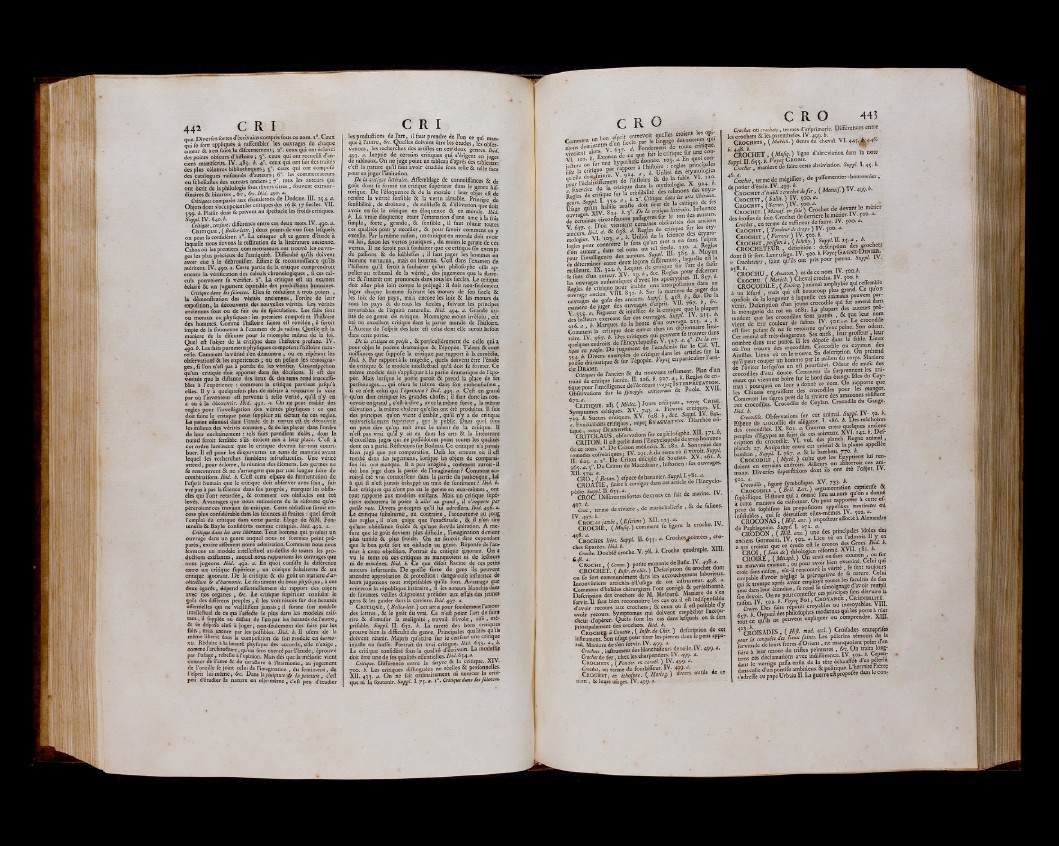
44* C R I
que. Diverfes fortes d’écrivains compris fous ce nom. i°. Ceux
qui fe font appliqués à raflembler les ouvrages de chaque
auteur & à en faire le difcemement; a0, ceux qui ont éclairci
des points obfcurs d’hiftoire ; 30. ceux qui ont recueilli d’anciens
manùfcrits. IV. 489. b. 40. ceux qui ont fait des traités
des plus célebres bibliothèques j 30. ceux qui ont compofé
des catalogues rationnés dauteurs; 6°. les commentateurs
ou fcholiaues des auteurs anciens ; 7". tous les auteurs qui
ont écrit de la philologie fous divers titres , fouvent extraordinaires
& bizarres , &c » &c- 49°* 4-
Critiques comparés aux chauderonsde Dodone.HI. 254. 4.
Objets dont s’occupoicntles critiques des 19 6c 17 ñecles. VIL
399. b. Plaifir dont fo privent au fpçilaçle les froids critiques.
Suppl. IV. 640. b. . ....
Critique t cenfure : différence entre ces deux mots. IV. 400. q.
C r i t i q u e , (Belies-l<ttr. ) deux points de vue fous lefquels
on peut la confidérer. i°. La critique eft ce genre d’étude à
laquelle nous devons la re&tutiçn de la littérature ancienne.
Cahosoù les premiers commentateurs ont trouvé les ouvrages
les plus précieux de l’antiquité. Difficulté qu’iΧ doivent
avoir eue à le débrouiller. E&ime 8c reconnoiflance qu’ils
méritent IV. 400.4. Cette partjç de la critique çomprendroit
encore la vérification des calculs chronologiques , fi cçs calculs
ponvoient fe vérifier. a°, La critique eft un examen
éclaire & un jugement équitable des productions humaines.
Critique dans lesfciences. Elles fe rédtûfont à trois pqipts ,
la démonftration des vérités anciennes, l’ordre de. leur
expofition, la découverte des nouvelles vérités. Les vérités
anciennes font ou de fait ou de fpéculation. Les faits font
ou moraux ou phyfiques. : le? premiers compofent l’hifioire
des hommes. Comme l’hiftoire faipte eA révélée, il feroit
impie de la foumettre à l’examen de Ja raifon. Quelle eft la
maniere de la difeuter pour le triomphe même de la foi.
Quel cil l'objet de la critique dans l’hiftctirç. profane. IV.
490. b. Les fidts purement phyfiques compofent l’hiftoire naturelle.
Comment la vérité s’en démontre , ou en répétant les
observation? & les expériences ; ou en pefant les témoignages
, fi l’on n’eft pas à portée de les vérifier. ÇireonfpeCtion
qu’un critique doit apporter dan; fes décidons. Il eft des
vérités que la diftance des lieux 6l des teins rend inacccïïi-
bles à l’expérience : comment la critique parvient jufqu’à
elles. Il y a quelquefois plus de mérite à retrouver la voie
par où l’inventeur eft parvenu à, telle vérité, qu’il .n’y en
a eu à la découvrir. Ibid. 491. a. Qp ne peut établir des
regles pour l’invcftigaùon des vérités phyfiques : ce que
doit foire le critique pour fuppléer au défaut de ces regles...
Le point effenticl dans l’étude de la nature eft. de découvrir,
les milieux des vérités connues., & de les placer dans l’ordre
de leur enchaînement : tels faits paroiflenr ifolés , dont le
noeud foroit fenfible s’ils étoient nus à leur place. C’eft 4
cet ordre lumineux que le critique devroit fur-tout contribuer.
Il eft pour les déepuvertes un tems de maturité avant
lequel les recherches femblent infruâueufes. Une vérité
attend, pour éclorre, la réunion des élémens. Les germes ne
fe rencontrent & ne s’arrangent que par une longue fuite de
combinaifons. Ibid. b. C’cft cette efpece de fermentation de
l’efprit humain que le critique doit obferver avec foin , fui*
vre pas 4 pas la fcience dans fes progrès, marquer les obfta-
clcs qui 1ont retardée, 8c comment ces obftactes ont été
levés. Avantages que nous retirerions de la réforme qu’o-
péreroicnr ces travaux du cririque. Cette réduâiQP foroit encore
plus confidérable dans les icienecs abftraites : quel feroit
l’emploi du critique dans cette partie.. Eloge de MM. Fpn-
tenellc & Bayle confidérés comme critiques. Ibid. 492. a.
Critique dans les arts libéraux. Tout homme qui prqduit un
ouvrage dans un genre auquel nous ne fommes point préparés
, excite aifément notre admiration. Comment nous nous
formons un modele intelleâuel au-deffus de toutes les pro-
. duâions exiliantes, auquel nous rapportons les ouvrages que
nous jugeons. Ibid. 492. a. En qupj confifte la différence
entre un critique fupérieur, un critique fubalterne & un
critique ignorant. De la critique & du goût en matière d’art
chiteSure 6* d'harmonie. Lefentiment du beau phyfique, à ces
deux égards, dépend efTentiellement du rapport des objets
avec qos organes , 6/c. Le critique fupérieur confulte le
goût des différens peuples, il les voit réunis fur des beautés
effentielles qui ne vieilli fient jamais ; il forme fon modele
intelleâuel de ce qui l’affeâe le .plus dans les modeles çxif-
tans, il fupplée au défaut de l’un par les beautés de l’autre,
& fe 4'tfpofe ainfi 4 juger, non-feulement des faits par les
faits, mais encore par Jes poffibles. Ibid. b. Il ufera de la
même liberté dans la compofuion de fou modele en harmonie.
Réduite 41a beauté phyfique des accords, elle n’exige ,
comme 1 architeâure, qu’un fens exercé par l’étude, éprouvé
par lufage , rebelle 4 l’opinion. Mais dès que la mélodie vient
donner de lame & du caraâere 4 l’harmonie, au jugement
de 1 oreille fe joint celui de l’imagination , du fentiment, de
l’efprit lui-même, &c. Dans la jculpture 6- la peinture , c’eft
peu d’étudier la nature en elle-même , c’eft peu d’étudier
C R I
les praduâions de l’art, il faur prendre de l!un ce qui manque
4 l’autre, &c. Quelles doivent être les études, les obfcr-
vations, les recherches des artiftes en ces* deux genres. Ibid
493. a. Ineptie de certains critiques qui s’érigent en juges
dé tableaux. On ne juge point un tableau d’après des tableaux:
c’eft la nature qu’il faut avoir étudiée fous telle & telle face
pour en juger limitation.
De la critique littéraire. Affemblage de connoiflances & de
goût dont fe forme un critique fupérieur dans le genre historique.
De l’éloquence 8c de la morale : leur objet eft de
rendre la vérité fenfible & la vertu aimable. Principe de
fenfibilité , de droiture , de nobleffe 8c d’élévation que doit
avoir en foi le critique en éloquence 8c en morale. Ibid.
b. La vraie éloquence étant l’émanation d’une ame à la fois
fimple, forte, grande, & fenfible , il faut réunir toutes
ces qualités pour y exceller, 8c pour favoir comment on y
excelle. Par la même raifon, un critique en morale doit avoir
en lui, finon les vertus pratiques, du moins le germç de ces
vertus. Il ne feroit pas à fouhaiter que ce critique fut exempt,
de paillons 8c de foibleffes ; il faut juger les hommes en
homme vertueux;, mais en homme. C’elt dans l’examen de
l’hiftoire qu’il feroit à fouhaiter qu’un philofophe oiat ap-
peller nu tribunal de la vérité , des jugemens que la flatterie
& l’intérêt ont prononcés dans tous les fieçles. Le critique
doit aller pluS loin contre le préjugé : il dojt non-feulement
juger chaque homme fuivant les moeurs de fon fiecle 6c
les loix de fon pays, mais encore les foix 8c les moeurs de
tous, les pays 8ç de tous, les fiecles, fuivant les principes
invariables de l’équité naturelle. Ibid. 494. a. Grande utilité
de ce genre de critique. Montaigne moins irréfplu, eût
été un excellent critique dans la partie morale de l'hiftoire.
L’Auteur de Tefpric des loix eft celui dont elle auroit befoin
dans cette partie.
De (a critique en poéfle , 8c particulièrement de celle qui a
pour objet le poëme dramatique 8c. l’épopée. Talens 8c con*
noifl'ances que fuppofe la critique par rapport à la comédie,
Ibid. b. Par rapport 4 la tragédie, quels doivent être l’étude
du critique 8c le modèle intelleâuel qu’il doit fe former. Ce
même modèle doit s’appliquer à la partie dramatique de l’épor
pée. Mais lorfque le poëte paroit 8c prend la place de f**
perfonnages qui ofera le luivre dans fon enthoufiafme ,
fi ce n’eft celui qui l’éprouye ? Ibid. 495. a. C’eft en grand
' qu’on doit critiquer les grandes chofes ; il faut donc les con->
ccvoir en grand * c’eft-à-uire , avec la même force, la même
élévation , la même chaleur qu’elles ont été produites. 11 fuit
des principes qu’on vient d'établir, qu’il n’y a de critique
univerfellement fupérieur, que le public. Dans quel fens
on peut d;re qu’on naît avec le talent de la critique, ti
n’eft pas vrai qu’jl y ait eu dans les arts 8c la littérature
d’excellens juges qui ne pçffédoient point toutes les qualités
dont on a parlé. Réflexions fur Bciileau. Ce critiqué n’a jamais
bien jugé que par cpmparaifon. Delà les erreurs où il eft
tombe daqs fes jugemens, lorfquç les objets dq comparai-
fon lui ont manqué- Il a peu imàginé , comment anrpjt-U
été bon juge dans la partie de l’imagination ? Comment au-
roit-il été vrai çonpoiffeur dans I4 partie du pathétique , lui
4 qui il n’eft jamais échappé un trait de fentiment ? Ibid. b,
Les critiques qui n’ont pas eu le germe en eux-mêmes, ont
{put rapporté aux modèles exiftans. Mais un critique fupè-
riçur exhortera le pçëte à aller au grand, i l n'impçrte par
Îuelle voie. Divers préceptes qu’il lui adrefiera. Ibid. 490. a.
.e critique fubalterne, au contraire, l’aççoutume au joug
des réglés, il n’en exige que î’exaâitude, 8c il n’en tirç
qu’une obéiffance froide ôç qu’une fervile imitation. A me-
fure que le goût devient plus diffiçile, l’imagination devient
plus timide 8c plus froide. On ne fauroit dire cependant
que le bon goût foit un obftacle ?U génie. Réponfe de l’aur
teur à cette objcâion. Portrait du critique ignoranr. On a
vu le tems où ces critiques ne manquoient ni de leâeum
ni de mécènes. Ibid. b. Ce que difoit Racine dç ces petits
auteurs infortunés. De. quelle forte de gens ils peuvent
attendre approbation & prpteâipn : dangereufe influence de
leurs jugemens tout méprifables qu’ils font. Avantage que
retireroit la république littéraire, fi les auteurs blanchis dans
de favantes veilles daignoient préfider aux eftais des jeunes
gens 8c les guider dans la çarriere. Ibid. 497. a.
C r i t i q u e , ( Belles-lett. ) cet art a pour fondement l’amour
des lettres, 8c le goût du vrai. Ce n’eft point l’art de faire
rire 8c d’amufer la malignité , travail frivole, aifé , mé-
prifable. Suppl IL 6qz. b. La rareté des bons critiques
prouve bien la difficulté du genre. Principales qualités qui»
doivent réunir. Mépris qu’attire fur le cenfeur une critique
injufte ou fàufie. Portrait du vrai critique. Ibid. 653, a, o.
Le critique confidéré fous la qualité d’ecrivain. La moaeltie
doit être une de fes qualités eflëntielles. /Wd. 054.4. .
Critique. Différence entre U fatyre & h crmçe.. XIV.
700. i Les critiques diftmguées en réelles & perfonnelles.
XII. 433. e. On ne fait ordinairement n. exercer b _conque
ni l i fontenir. Supgl. 1. 7S- * • 1 •
C R o
Comment Î a n p i W
nions dominantes duit te ^ | o o d emem' de t0„ K critique.
vivoient aiom. ■ ~ fo u ie critique fur une copi
4. f MExercice dHe la nitiqWi. deis reSlauons xde.s, v.o4y- a*-•
Regles de ^ Crii,tuc dms Us im
gpurs. Suppl- 1. 354- «Æfc d -t ¿rer de la enuque de fes
. Cfage j)t u critique littéraire Influence
ouvrages. XIV. »»4- 3 naffageres fur le ton des auteurs.
W- »1 k & f-, S leW « £ V ! lmogoileosg ipeso.u Vr Lco nnoitre le ¡ens quart mmoot a eu dan^s lR’eèfgplnest
d’un auteur, dans tel tems p . b Moyen
pour HmeUigeuce des
5e déterminer | W k B * @ m B S g for Æt de faifrr
mc'dlenre. IX. 3aa- t J i S î l j S g Règles pour difeerner
le fens d'un auteur- XV- M P W p « S t Z j L . ü . 857. |
les une imerpoLuon dans un
Réglés de s o i « ™ L t 'T s ï f l a ^ ma&r. de juger des
anciens. W ï- q j
quelques endroits de l’Encyclopédie. V -.î^ ' j-' ic Q d VI.
poèfté'dramatique & fut l’épopée. V y * «R pameuLer
dm^pouSSigcMe del’éctiture
Obfervations fo? le fyaopjls erwromnr de Poole. XVII.
é7CMTtOOT. adi. ( Médtc.) Jours critiques, eoyft Çrise.
Symptôm- es cri■ tique■s.. wXV . ■ 743- a - FievresS ucprpitLiq luVes.. 8V42I..
729. b. Sueurs critiques. XV. 628. b, «c. o w »■
a. Evacuations critiques, voyc[ ÉvaCUAT 10* •
tl,CW’f8 '& U S A> ^ '» . io u s f o r cephilofqph=.X!I. S W *
CRtTON. U eft parlé dans l'Eneyelopédie
remedescofmetiques, iv . 291.».«« * _ „ x v ,5 , ¡,
l ï 621 a 20. De Criton difoiple de bocrate. a v . 20».^.
2 6«. 3°-De Criton de Macédoine »h,ftone“ : ouvrages*
C R O 443
V 574* *•_
X*CRO+, “(Botan.) efpece de bananier. Suppl.l.
CROATIE, foute à corriger dans cet article de 1 Ençyclo
*^CROÎ?f Différentesforres de crocs en 6it de manne. IV.
5 É H terme deriviere , de marèchaUeiie , & de faliues.
IV. 497. b. „ TI
CROC en jambe, (Eferme) i. croche IV.
CROCHE, ( Mufiq.) comment fe figure Ja crocne. iv
49Crochis lïtssi Suppl. U. 655. n. Cruches^ointées, cto-
C^ S . rëouSi'/,oclre.V.78. é. Croche rpradrnple. XID.
» B N (Comm.) petite monnoie de Balle. ^ 4 9 8 . n.
CROCHET. ( Inflr. de cftir. ) Deicripnon
on fe fert communément dans les acçouçhçme . - •
Inconvéniens attachés àTufage de cet
Comment d’habiles chirurgiens lont f i Q ï n g é . cv
Defcriprion des crochets de M. Mefnard. Mapiere 4e s eu
Ï Ï S S l faut bien reconnoître les cas
d’avoir recours aux crochets ; 8t ceux ou 4 eftpplbflle p y
avoir recours. Symptômes oui doivent ei^êchçr laccp -
cheur d’opérer. Quels font les cas dans lçfquels ça le fort
principalement des croche». ZWd. b. . ,
C r o c h e * à Cuvette, ( Inflr- 4* Chir. ) dcfçnpupn dé c«
inftrufoent. Son ufagepour tirer les pierres dans le petit appa-
reil Manière de s’en fervir.1V. 4?9* ;
Crochets, inftrument des blanchiffeurs de toile. IV. 499-*•
Crochet de fer, chez les charpentiers. IV. 499. a.
C ro ch e ts , ( Fonder. en caraft. ) IV. 499. a-
Crochet, en terme de fourbiffeur. IV. 499.4- ,
C r o c h e t , ,n ichalv.s. ( HorhS. ) divers o»tds de ce
nom , & leqrs ufages. ÎV. 499.4-
Crochet oü crochets, termes d’imprimerie. Différences entre
les crochets 8c les parenthefes. IV. 499. b.
C rochets , (Maréch.) dents du cheval. VI. 445^BL44
k CROCHET , (Mufla.) ligne d’abréviation dans la note
^ m t fe ^m iim e ‘à f a c e t t e abréviation. Suppl. 1. 4V |
^ to ch ',,.termede mégiffier, de paffementier-bootonnier,
de potier d’étain. IV. 499. b. IV 400. b.
C rochet ¿'établi : crochet de fer, ( MenutJ. ) 1 v . 499*
C ro ch e t, (Salin. ) IV. 500. as
Cachet de^vam ie mé.itr
des étoffes de foie. Crochet de demere
Crochet, en terme de raffineur de fucre. IV. 500. •
C rochet , ( Tondeur de draps ) IV. 500. a.
Crochet , ( Verrerie ) IV. <00. b. '
C ro ch e typoiflonà, U ‘ h[hy-) Supp/.H- tî* » fôfâfâts
CROCHEfEOR , défimnon : dcfiripuon des £r°ch“ .
dont ilfe fert. Leutnfage. IV. J H j g i iB f e S f f B M e i
; te Croclutturs, faint qu’ils ont pris pour patron. Suppl. IV.
2 ,CROCHU, (Anatom.') os de ce nom. IV. 300.é.
Crochu ( Maréch. ) Cheval crochu. IV. 500. b.
CROCODILE (Zoolog. ) animal amphybie quireffembre
à un léford , maU qui eft beaucoup plus grand. Ce quon
connoit de la longueur à laquelle £
tendent que les crocodües font jaunis , & que leur^nom
“ "m de’ leur couleur de « | R I » S S M «
eft fort pefant & ne fe retourne qn
Cet animal eft très-dangereux. Ses
Antilles. Lieux où on le trouve. Sa defcnpnon. On prétmtd
qu’il peut couper un homme par le milieu du corps. Manière
. £ l’Iviter lo V o n en eft pourfo'rri. Odeur de mufe des
crocodiles d’eau douce. Comment ds forpreunent les ant-
maux qui viennent boire fur le bord des étangs. Mes du Cay-
man? pourquoi on leur adoiné ce nom. On rapporte que
les Chinois engraiffent des crocodUes pour les manger.
1« tigres prés de la rivière des amaxpnes réftffenr
S S B B p M g de Ccylan. Croeoddedu Gange.
""¿rnoJÏU. Obfervations fur cet amm^. iuw/. IV' iO é.
Efuece de crocodile dit alligator. I. 286. t. Des mâchoires-
de? crocodiles. IX. 801. g Guerres en tre quelques anciens
Deuples d’Ëeypte au fujet de ces animaux. XVI. 14î * b-.Vcf
ulancli. ad7.S Acnotidpaitlhei.e Mentr em cet dane5im Sal &S la plSmite aappppeeUueéee
W m . f4Wp<iui -- éÊÊmm WÊmBwBw maux. Diverfes fuperftmons dont ils ont été lob)«. IV.
^ Crocodile. fieure fymbolique. XV. 7 3 3 . I' . . _
r C r o c o d i l e , (Bell. Leu.) argumentanon captieufe 8c
fooWffime Hiftoire qui a donné lieu au nom qu’on a donné
à fette btatüere de Sifonner. On peut tRuponer à cene ef-
pece de fophifme les propofmons appellfe ou
' Î t t : f ë t L? run e ' dcs principales idoles de,
r«vmoint tv C02 4 Lieu ou on ladoroit. U y en
coupable d avoir négligé la prwoga ^ ,e? &cultis de fon
qui fe trompe *Prês P y ^mojgnage d’avoir renfpli
ame dans leur étendue, fe rend le wnog g détruir/fo
fondevoù. Onne pemcoutef1er«W | CRtmBIUT^
Cmim Des faits routés croyables ou incroyables. W I .
d i i brgueil des philofophes modernes qui les porte i mer
iom ce q u i ne peuvent expliquer ou comprendre. XIII.
^ROISADES, i m . md. G B Ctoifades entreptifes
oo^U eonqulee lis'lieux hiuis. Les pèlerins témoins d e>
Servitude ïe leurs freres d’Orient, ne manquoient pomt d«t
foire à leur retour de trilles peintures , fec. On traita long
tems ces déclamations avec indifférence. IV. coa- é. Cepem •
dant le vertige paffa enfin de la tête échauffée dunpé|erm
dans celle d’un pontife ambitieux 8c polirique. | S g n E g g |
sVdreffe au pape Urbain II. U guerre eft propofte 4anslv çon: