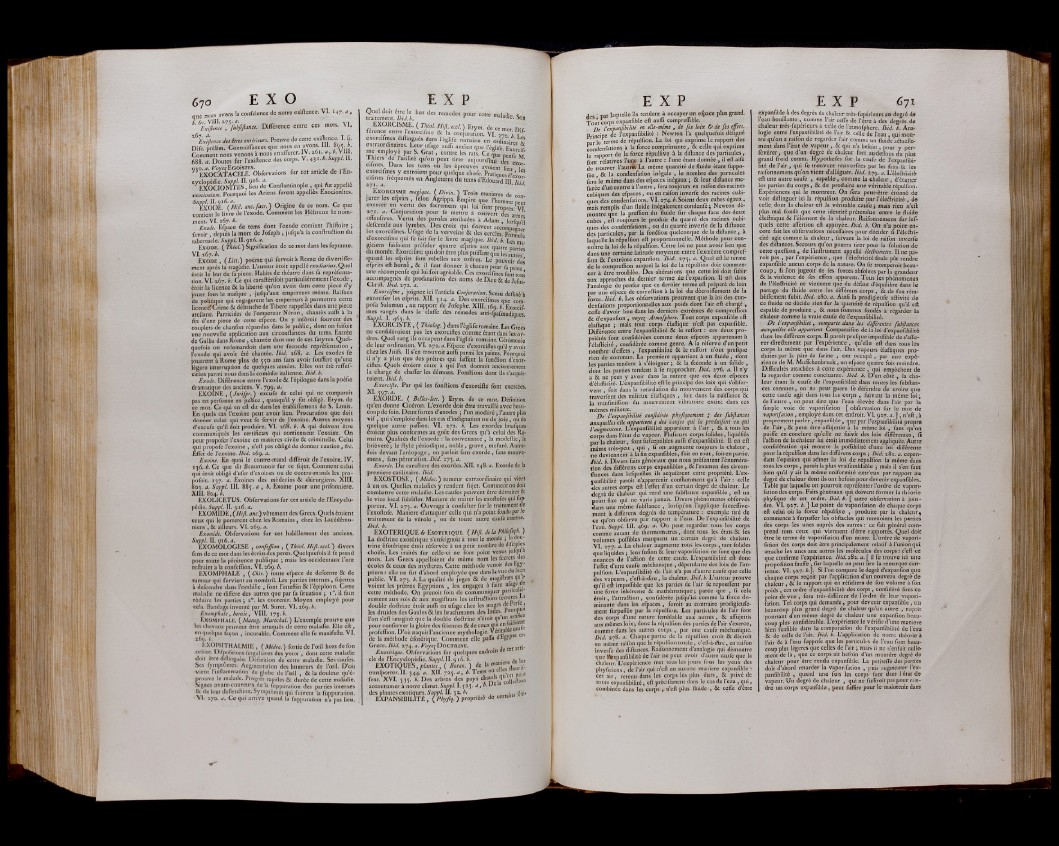
6 7 o E X O
auc nous avons la confcicncede notre cxiftcncc. VI. 147-a»
^ftllctV'fuififlance. Différence entre ces mots. VI.
* enee des êtres extérieurs. Preuve de cette cxiftcncc. X. ij.
Difc. prélim. Connoiffanccs que nous en avons. UI. 89t. b.
Comment nous venons à nous enaffurcr. IV. ao». 0. VIII.
688. a. Doutes fur l’cxiftcncc des corps. V. 431 .b. Suppl. il.
93 EXO^iÏACELE^Ôbfcrvations fur cet article de l'En-
^cu de Conftantinoplc , qui fut appellò
exocionium. Pourquoi les Ariens furent appellés Exodonites.
SU/OExOd V. anc.facr.) Origine de ce nom. Ce que
contient le livre de l’exode. Comment les Hébreux le nomment.
VI. k$È , I „ . . . . . . . .
Exode. Efpace de tems dont 1 exode contient 1 hiitoirc ;
favoir, depuis la mort de Jofcph , jufqu’à la conftruélion du
tabernacle. Suppl. II. 916. a.
Exode. ( Théol.) Signification de ce mot dans les feptante.
VI. 267. A „ ,
Exode , ( Litt.) poëmc qui fervoità Rome de divcrtifle-
ment après la tragedie. L’auteur étoit appellò exodiarius. Quel
¿toit le but de fa piece. Habits de théâtre dans fa repréfenta-
tion. VI. 167. b. Ce qui caraftérifoit particulièrement l'exode,
¿toit la licence 8c la liberté qu’on avoit dans cotte picce d’y
jouer fous le mafquc , jufqu’aux empereurs môme. Raifons
de politique qui engagèrent les empereurs il permettre cette
licencë? Crime 8c débauche de Tibère rappellés dans une picce
atcllane. Parricides de l’empereur Néron, chantés auff» à la
fin d’une picce de cette cfpece. On y inféroit fouvent des
couplets de chanfon répandus dans le public, dont on faifoit
une nouvelle application aux circonftanccs du tems. Entrée
de Galba dans Rome , chantée dans une de ces fatyres. Queluefois
on redemandoit dans une feconde repréfentation eprelt
,
l'exode qui avoit été chantée, lbid. 268. a. Les exodes fc
jouèrent à Rome plus de < 30 ans fans avoir fouffert qu’une
légère interruption de quelques années. Elles ont été rcflùf-
citées parmi nous dans la comédie italienne. Ibid. b.
. Exode. Différence entre l’exode 8c l’épilogue dans la poéfie
dramatique des anciens. V. 799. a, ^
EXOÍNE, ( Jurifpr. ) exeufe de celui qui ne comparoit
pas en perfonne en jufticc , quoiqu’il y fût obligé. Etym. de
ce mot. Ce qui en cft dit dans les établiflemens de S. Louis.
En quels cas l’exoine peut avoir lieu. Procuration que doit
donner celui qui veut fe fervir de l'exoine. Autres moyens
d'exeufe qu'il aoit produire. VI. 268. b. A qui doivent être
communiqués les certificats qui contiennent l'exoine. On
peut propofer l’exoine en matières civile 8c criminelle. Celui
'lui propofe l’exoine , n’eft pas obligé de donner caution, &c.
tffet de l’exoine. Ibid. 269. a.
S
Exo'me. En quoi le contre-mand différoit de l’exoine. IV.
136. b. Ce que dit Beaumanoir fur ce fujet. Comment celui
qui ¿toit obligé d’ufer d’exoines ou de contre-mnnds les pro-
pofoit. 137. a. Exoines des médecins 8c chirurgiens. XIII.
803. a. Suppl. III. 88 ç. a , b. Exoine pour une prifonniere.
XIII. 804. b.
EXOLICETUS. Obfervations fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 916. a.
EXOMIDE,0 /ifl. une.) vêtement des Grecs. Quels étoient
ceux qui le portèrent chez les Romains, chez les Lacédémo-
niens, 8c ailleurs. VI. 269. a.
Exomide. Obfervations fur cet habillement des anciens.
Suppl. II. 916. a.
EXOMOLOGESE , conftfjion , ( Thiol. Hifl. ceci. ) divers
fens de ce mot dans les écrits des peres. Quelquefois il fe prend
pour toute la pénitence publique ; mais les occidentaux l ’ont
reftraint à la confeftion. VI. 269. b.
EXOMPHALE , ( Chir. ) toute cfpece de defeente 8c de
tumeur qui furvient au nombril. Les parties internes, fujettes
li defeendre dans l’ombilic , font l’inteftin 8c l’épiploon. Cette
maladie ne différé des autres que par fa fituation ; i°. il faut
réduire les parties; 20. les contenir. Moyen employé pour
cela. Bandage inventé par M. Suret. VI. 209. b.
Exomphale, hernie, VIII. 175. b.
Exomphale. (Maneg. Maréchal.') L’exemple prouve que
les chevaux neu vent être attaqués de cette maladie. Elle cft,
en quelque façon , incurable. Comment elle fe manifefte. VI.
269. b,
C.XOPHTHALMIE , ( Médec. ) fortic de l’oeil hors de fon
orbite. Difpofitions fingulieres des yeux , dont cette maladie
doit être diftinguée. Définition de cette maladie. Scs caufes.
Scs fymptomes. Augmentation des humeurs de l’ail. D’où
vient l’inflammation du globe de l’oeil , 8c la douleur qu’éprouve
le malade. 1 rogres rapides 8c durée de cette maladie.
Signes avant-coureurs_dc la tuppuration des parties internes
8c de leur deftruétion. Symptômes qui fuirent la fuppuraiion.
VI. 270. a. Ce qui arrive quand la fuppuration n'a pas lieu.
EX P
:§lil|l||®|frcraKfa<,ourÉ! Son
EXORCISME. ( Thiol. Hifl. m l. J Etym. de ce mot Dif
férence entre l exorefnie & la conjuration. VI. » 7
exorcifmes diilinguês dans l’égllfe rimaine en ot S i ' f
extraotd,nattes. Leur ufage auffi ancien que l W S S Î
me employé par S. Grat, contre les rats. Ce q u e «
Thtets de 1 utilité qu’on peut tirer aujourd'hui tfes exm
ctfmes. Dans les tems oit les épreuves avoient lieu w
exorcifme, y entro.cn..pour quclouc eliofc. Pratique s d V J
c.fmes fréquentés en Angleterre du tems d’Edouard III, d l î
Exorcisme motion. (Divin. ) Trois manières de m
jurer les efpr.ts , iclon Agrippa. Empire que l'homme H
exercer en vertu des factcmens qui lui font pron,«-vl
171. a. Conjuration pour fe mettre à couvert des ar
oBenfivcs. Vertu des paroles attribuées à Adam , 1 » S
dcfcend.1aux lymbes. Des croix qui doivent accompagne,
les exorctfmes. Ufage de la verveine & des cercles Formule
d’cxorcifme qui fc fait fur le livre magique, lbid b Les m
giclons failoient préfider quatre cfprits aux quatre partie,
du monde. Exorcifme qui doit être plus puilTant que les autres
quand les cfprits font rebelles aux ordres. Le pouvoir dm
cfprits ëft borné, & il faut donner h chacun pour fa peine
une récompcnfe qui lui foit agréable. Ces exorcifmes font tous
accompagnés de profanations des noms de Dieu & de Jcfus.
ChrilL lbid. 272.
Exorcifme, joignez ici l’article Conjuration. Sceau dcfliné'i
expreifer les efprns. XII. 3.1 q. e. Des exorcifmes que com-
pofa Salomon , au rapport de Jofcphc. XIII. téq. ¿.Exorcîf-
ines rangés dans la claffc des remedes anti-lpafmodiqucs
Suppl. I. 4 6 3 . b. 1
EXORCISTE, ( Théolog. ) dans l’églifc romaine. Les Grecs
ne confidéroicnt pas les cxorciftes comme étant dans les ordres.
Quel rang ifs occupent dans l’églifc romaine. Cérémonie
de leur ordination. VI. 272. a. Efpccc d’cxorciftes qu’il y avoit
chez les Juifs. Il s’en trouvoit aufti parmi les païens. Pourquoi
il n’y a plus que des prêtres qui faflcnt la fonftion d’cxorciftes.
Quels étoient ceux à qui l’on donnoit anciennement
la charge de chaflcr les démons. Fondions dont ils s’acquit-
toient. lbid. b.
Exorcifle. Par qui les fondions d’exorcifte font exercées.
XL <07. a.
EXORDE. ( Belles-lett. ) Etym. de ce mot. Définition
qu’en donne Cicéron. L’exorde doit être travaillé avec beaucoup
de foin. Deux fortes d’exodes ; l’un modéré ; l’autre plus
v i f , qui s’emploie dans les cas d’indignation ou de joie, ou de
quelque autre paflion. VI. 272. b. Les exordes brufques
étoient plus conformes au goût des Grecs qu’à celui des Romains.
Qualités de l’exordc : la convenance , la modcftic, la
brièveté; le ftyle périodique,noble, grave, mefuré.Autrefois
devant l’aréopage, on parloit fans exorde, fans mouve-
mens, fans péroraifon. lbid. 273.a.
Exorde. Du caraétere des exordes. XII. 148. a. Exorde de la
première catiünairc. lbid.
EXOSTOSE, ( Médec. ) tumeur extraordinaire qui vient
à un os. Quelles maladies y rendent fujet. Comment on doit
combattre cette maladie. Les caufes peuvent être détruites 8c
le vice local fubfiftcr. Manière de traiter les exoftofes qui fup*
purent. VI. 273. a. Ouvrage à confultcr fur le traitement de
l’exoftofc. Manière d’attaque^ celle qui n’a point fondu par le
traitement de la vérole , ou de toute autre caufc interne,
lbid. b. ■ I * ; .
EXOTERIQUE 6* Esoterique. ( Hifl. de la Philofoph. )
La doélrinc exotérique s’enfeignoit à tout le monde ; la doctrine
éfotérique étoit réfervée à un petit nombre de difciples
choifis. Les traités fur celle-ci ne font point venus jufqu ¡1
nous. Les Grecs appclloicnt du même nom les fecrcts tics
écoles 8c ceux des myftcrcs. Cette méthode venoit des Egy-
ptiens ! ____ : elle ne fut d’abord t / l , I employée I . . . I que - .d1_a_n_s Ula •vIuIIRe Id IuI bbiieenn
public. VI. 273. b. La qualité de juges 8c de magiftrats qu a-
voient les prêtres Egyptiens , les engagea à faire ufage tie
cette méthode. On prenoit foin de communiquer part
IrVcmIliveInItI IaIIuIAx Irvoliisl L8Ac. a«IuIIAx ImIIaAggilfItlrllalltBs lIVes9 linllfitllr uhév.liiovn..*s fccrctcs..t.
double doélrinc étoit aufti en ufage chez les mages tic 1 cric *
les druides des Gaules 8c les brachmancs des Indes. 1 our9i
l’on s’eft imaginé que la double doélrine n’étoit qu i’un un artificc
^fl.
pour conlcrvcr confcrvcr la gloire des fcicnces 8c de ceux qui
en «au® ,
profeftion. D’où naquit l’ancienne mythologie. Vcritau|c _
de la méthode éfotérique. Comment elle paftè dEgXP
Grccc. lbid. 274. a. Voye-{Doctrine. , , cet arti-
Exotirique. Obfervations fur quelques endroits d®
cle de l’Encyclopédie. Suppl. II. 016. b. . 1. ies
EXOTIQUES, plantes. ( Dotan. j de la ^a,|,crV “ ’f.
mnfporterJI. i B Xlf. 725.2, » S M S B »
fcnt. XVI. 355. b. Des arbres des pays
accoutumer à notre climat, buppl. 1. $23. a, t>. u*
des plantes exotiques. Suppl. II. 32 .b. (lui-
EXPANSIB1LITÉ, (phyjlq. ) propriété de cerou«
E X P
des ' par laquelle ils tendent à occuper un efpace plus grand. I
Tout corps cxpanfible cft auffi comprcffiblc.
De l’expanfibiliU en elle-même , de fes loix 6* de fes effets.
Principe de l’expanfibilité : Newton l’a quelquefois défigné
oar le terme de répulfion. La loi qui exprime le rapport des
condenfations à la force comprimante, 8c celle qui exprime
le rapport de la force répulfive à la diftancc des particules,
font relatives l’unp à l’autre : l’une étant donnée , il eft aifé
de trouver l’autrer La même quantité de fluide étant fuppo-
fée, 8c la condenfation inégale , le nombre des particules
fcra*le même dans des efpaccs inégaux ; 8c leur diftance me-
furée d’un centre à l’autre, fera toujours en raifon des racines
cubiques des efpaccs, ou en raifon inverfe des racines cubiques
des condenfations. VI. 274. b. Soient deux cubes égaux,
mais remplis d’un fluide inégalement condcnfé ; Newton démontre
que la preflion du fluide fur chaque face des deux
cubes , eft toujours le produit du quarré des racines cubiques
des condenfations, ou du quarré inverfe de la diftance
des particules, par la fonélion quelconque de la diftancc, à
laquelle la répulfion eft proportionnelle. Méthode pour con-
noître la loi de la répulfion. Cette loi ne peut avoir lieu que
dans une certaine latitude moyenne entre l’extrême compref-
fion 8c l’extrême expanfion. lbid. 275. a. Quel eft le terme
de la compreffion auquel la loi de la répulfion doit commencer
à être troublée. Des altérations que cette loi doit fubir
aux approches du dernier terme de l’cxpanfion. Il eft dans
l’analogie de penfer que ce dernier terme eft préparé de loin
par une cfpece de correélion à la loi du décroiftement de la
force, lbid. b. Les obfervations prouvent que la loi des condenfations
proportionnelles aux poids dont l’air eft chargé ,
ccfle d’avoir lieu dans les derniers extrêmes de compreflion
& d’expanfion , voye{ Atmofphere. Tout corps expanlible cft
élaftique ; mais tout corps élaftiquc n’eft pas expanfible.
Différence entre l’expanfibilité 8c le reflort : ces deux propriétés
font confidérées comme deux èfpcçes appartenant à
rélafticité , confidérée comme genre. A la réferve d’un petit
nombre d’effets , l’expanfibilitè 8c le reflort n’ont prefquc
rien de commun. La première appartient à un fluide, dont
les parties tendent à s éloigner ; oc la fécondé à un folidc ,
dont les parties tendent à fe rapprocher. lbid. 276. a. Il n’y
a 8c ne peut y avoir dans la nature que ces deux efpeces
d’élafticité. L’expanfibilité eft le principe des loix qui s’obfcr-
vent, foit dans la retardation du mouvement des corps qui
traverfent des milieux élaftiqués , foit dans la naiflancc 8c
la tranfmiflion du mouvement vibratoire excité dans ces
mêmes milieux. ■
De’ l'expanfibilité confidérée physiquement ,* des fubflances
auxquelles elle appartient ; des caufes qui la produifent ou qui
l'augmentent. L expanfibilité appartient à l’air , 8c à tous les
corps dans l’état de vapeur. Pluficurs corps folides, liquéfiés
par la chaleur, font fufceptibles aufti d’expanfibilité. 11 en eft
même très-peu , qui , fi on augmente toujours la chaleur,
ne deviennent à la fin expanfibles, foit en tout, foit en partie.
lbid. b. Divers faits généraux que nous préfentent l’énuméra-
tion des différens corps expanfibles, 8c l’examen des circon-
ftances dans lesquelles ils acquièrent cette propriété. L’ex-
panfibilité paroît n’appartenir conftamment qu’à l’air : celle
des autres corps eft l’effet d’un certain degré de chaleur. Le
degré de chaleur qui rend une fubftance cxpanfible, eft un
point fixe qui ne varie jamais. Divers phénomènes obfervés
dans une même fubftance , lorfqu’on rapplique fucceflive-
ment à différens degrés de température : exemple tiré de
ce qu’on obfervc par rapport à l’eau. De l'expanfibilité de
l’eau. Suppl. 111. 460. a. O11 peut regarder tous les corps
comme autant de thermomètres, dont tous les états 8c les
volumes poftibles marquent un certain degré de chaleur.
VI. 277. a. La chaleur augmente tous les corps, tant folides
que liquides ; leur fufion oc leur vaporifation ne font que des
nuances de l’aâion de cette cauie. L’expanfibilité eft donc
l’effet d’une caufe méchanique, dépendante des loix de l’im-
ptilfion. L’expanfibilité de l’air n’a pas d’autre caufe que celle
des vapeurs, c’eft-à-dire, la chaleur. lbid. b. L’auteur prouve
qu’il eft impoflible que les parties de l ’air fc repouflent par
une force inhérente 8c mathématique ; parce que , fi cela
étoit, l’attraélion, confidérée jufqu’ici comme la force dominante
dans les cfpaces , feroit au contraire prodigieufe-
ment furpaftée par ta répulfion. Les particules de l’air font
des corps d’une nature lemblable aux autres , 8c aflùjcttis
aux mêmes loix ; donc la répulfion des parties de l’air s’exerce,
comme dans les autres corps , par une caufe méchanique.
lbid. 278. a. Chaque partie de la répulfion croît 8c décroît
en même raifon que la répulfion totale, c’eft-à-dire, en raifon
inverfe des diftances. Raifonncmcnt d’analogie qui démontre
que llfcxpanfibilité de l’air ne peut avoir d’autre caufe que la
chaleur. L’expérience met tous les jours fous les yeux des
phyficiens, de l’air qui n’eft en aucune maniéré expanfible :
cet air, retenu dans les corps les plus durs, 8c privé de
toute expanfibilité, eft précifémcnt dans le cas de l’eau, qui
combinée dans les corps , n’eft plus fluide , 8c cefle d'ètr
Ê X P 671
expanfible a des degrés de chaleur très-fupérieurs au degré de
1 eau bouillante, comme 1 air ccfle de l’être à des degrés de
chaleur très-fupérieurs à celle de l’atmofphcrc. lbid. b. Analogie
entre l’expanfibilité de l’air & celle de l’eau, qui montre
qu’on a raifon de regarder l’air comme un fluide aftuelle-
ment dans l’état de vapeur , 8c qui n’a befoin , pour y per-
févérer, que d’un degré de chaleur fort au dellbus du plus
;rand froid connu. Hypothefes fur la caufe de l’expanfibi-
ité de l’air, qui fe trouvent renverfées par les faits 8c les
raifonnemens qu’on vient d’alléguer. lbid. 279. a. L’éleâricité
cft une autre caufc , capable, comme la chaleur, d’écaucr
les parties du corps, 8c de produire une véritable répulfiom
Expériences qui le montrent. On fera peut-être étonné de
voir diftinguer ici la répulfion produite par l’éleâricité, de
celle, dont la chaleur eft la véritable caufe j mais rien n’eft;
plus mal fondé que cette identité prétendue entre le fluide
éleétrique 8c l’élément de la chaleur. Raifonnemens fur lef-
qucls cette aftertion eft appuyée. Ibidt b. On n’a point encore
fait les obfervations néceftaires pour décider (1 l’élcâri-
cité agit comme la chaleur, fuivant la loi de raifon inverfe
des diftances. Secours qu’on pourra tirer pour la folution de
cette queftion , de l'infiruinent appelle éledrometre. Il ne paroît
pas , par l’expérience , que l’éleélricité feule pût rendre
expanfible aucun corps de la nature. On fe tromperait beaucoup,
fi l’on jugeoit de fes forces abfolucs par la grandeur
8c la violence de fes effets apparens. Tous les phénomènes
de l’élcâricité ne viennent que du défaut d’équilibre dans le
partage du fluide entre les différens corps , 8c de fonréta-
bliftement fubit. lbid. 280. a. Ainfi la prodigieufe aélivité de
ce fluide ne décide rien fur la quantité de répulfion qu’il eft
capable de produire , 8c nous fommes fondés à ré garder la
chaleur comme la vraie caufe de l’expanfibilité*
De l ’expanfibilité, comparée dans les différentes fubflances
auxquelles elle appartient Comparaifon de la loi d’expanfibilité
dans les différens corps. Il paroît prefque impoflible de s’aflù-
rer directement par l’expérience , qu’elle eft dans tous les
corps la même que dans l’air. Des vapeurs élaftiqués produites
par la pâte de farine , ont occupé , par une expérience
de M. Muflchenbrock, un efpace quatre fois moindre.
Difficultés attachées à cette expérience , qui empêchent de
la regarder comme concluante. lbid. b. D un côté , la chaleur
étant la caufe de l’expanfibilité dans toutes les fubftan-
ces connues, on ne peut guere fe défendre de croire que
cette caufe agit dans tous les corps , fuivant la même loi ;
de l’autre , on peut dire que l’eau . élevée dans l’air par la
fimple voie de vaporifation [ obfervation fur le mot de
vaporifation, employé dans cet endroit. VI. 927. a. ] , n’eft, à
proprement parler, expanfible, que par l’expanfibilité propre
de l’air , & peut être afliijettie à la même loi , fans qu’on
puifle en conclure qu’elle ne fuivît des loix différentes, fi
l’aélion de la chaleur lui étoit immédiatementappliquée.Autre
confidération qui montre la poflibilité d'une loi différente
pour la répulfion dans les différens corps ; lbid. 281.0. cependant
l’opinion qui admet la loi de répulfion la même dans
tous les corps, paroît la plus vraifcmblable ; mais il s’en faut
bien qu’il y ait la même uniformité entr’eux par rapport au
degré de cnaleur dont ils ont befoin pour devenir expanfibles.
Table par laquelle on pourrait reprefenter l’ordre ae vaporifation
des corps. Faits généraux qui doivent former la théorie
phyfique de cet ordre, lbid. b. [ autre obfervation à join-
| dre. VI. 927. b. ] Le point de vaporifation de chaque corps
eft celui où la force répulfive , produite par la chaleur«
commence à furpafler les obftacles qui retenoient les parties
des corps les unes auprès des autres : ce fait général comprend
tous ceux qui viennent d’être rapportes. Quel doit
être le terme de vaporifation d’un mixte. L ordre de vaporifation
des corps doit être principalement relatif à l’union qui
attache les unes aux autres les molécules des corps: c’eft ce
que confirme l’expérience, lbid. 282. a. [ il le trouve ici une
propofition faillie , fur laquelle on peut lire la remarque contenue.
VI. 927. b!\. Si l’on compare le degré d’expanfion que
chaque corps reçoit par l’application d’un nouveau degré de
chaleur, 8c le rapport qui en réfulteri de fon volume à fon
poids, cet ordre d’expanfibilité des corps, confidéré fous ce
point de vue, fera très-différent de l’ordre de leur vaporifation.
Tel corps qui demande, pour devenir expanfible, un
beaucoup plus grand degré de chaleur qu’un autre , reçoit
pourtant d un même degré de chaleur une expanfion beaucoup
plus confidérable. L’expérience le vérifie d’une maniéré
bien fenfible dans la comparaifon de l'expanfibilité de l’eau
8c de celle de l’air, lbid. b. L’application de notre théorie à
l’air 8c à l’eau fuppofe que les particules de l’eau font beaucoup
plus légères que celles de l’air ; mais il ne s’enfuit nullement
de là , qûe ce corps ait befoin d’un moindre degré de
chaleur pour être rendu expanfible. La petitefle des parties
doit d’abord retarder la vaporifation , puis augmenter l’ex-
panfibilité , quand une fois les corps font dans 1 état de
vapeur. Un degré de chaleur , qui ne fuffiroit pas pour rendre
un corps cxpanfible, peut fuffre pour le maintenir dans