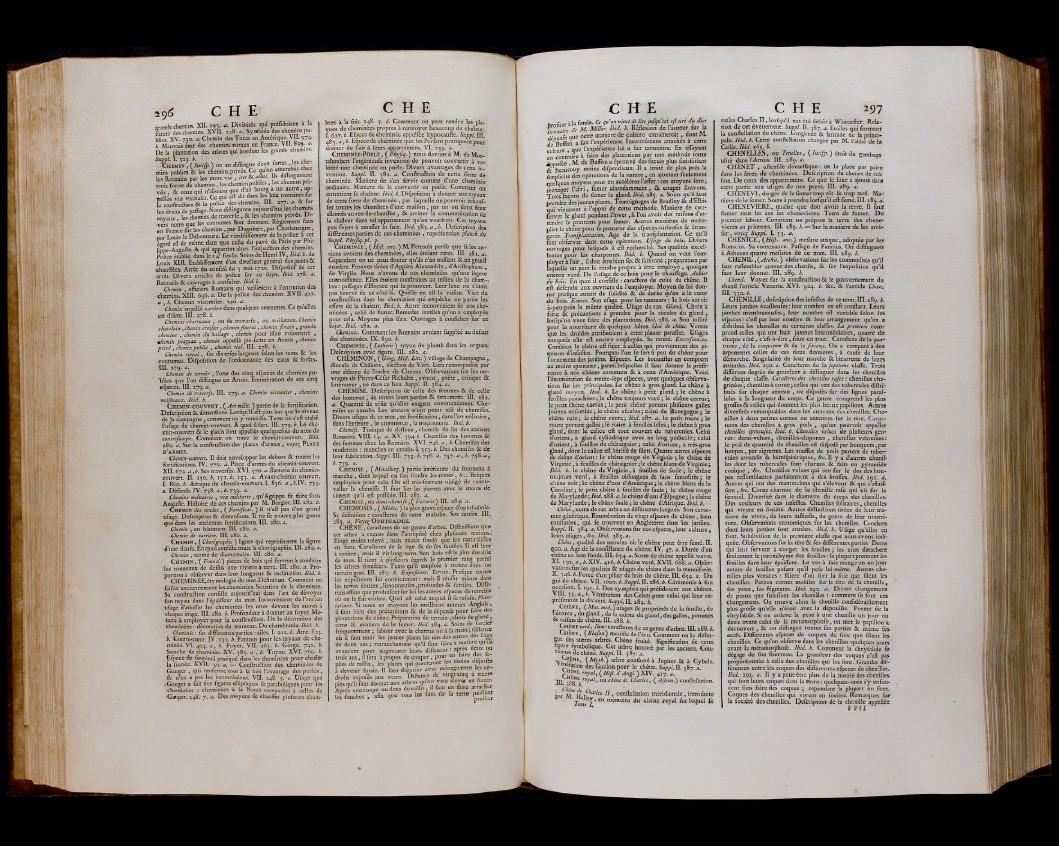
2 9 6 C H E
»rancis chemins. XII. x g g a. Divinités qui métiSoient à la
Breté des chemins. XVII. 128. a. Symbole des chemins pu-
blics. XV. 730. a. Chemin des Yncas en Amérique. VU. 974-
b. Mauvais état des -chemins ruraux en France. VII. 829. a.
Pe la plantation des arbres qui bordent les grands chemins.
J l f e Sl'CJurifo.) on en diftingue deux fortes ,les chemins
publics 8c les chemins privés. Ce qu onT1en*?J?i* oient
les Romains par les mots via , iter 8c aûus. Ils d g
trois fortes de chemins, les cheminsP"j>hcsj Ies^he"Vlf P”
vés , 8c ceux qui n’îdloient que d un bourg à un autre, ap
peHés vice viciLfcs. Ce qui cft dit dans les lonc romaines g *
L conftruûion & la ig U M M ^emins.
les droits de partage. Nous diftinguons aujourd hut les chemins
royaux E les fhemins. de traverfe, & les chemins privés. Di-
vers noms que les coutumes Ifeur donnent. Reelemens faits
en France fur les chemins, par Dagobert, par Charlemagne,
par Louis le Débonnaire. Le rétabUffement de la police a. cet
égard eft de même date que celle du pavé de Paris par Pht-
lmpe-Augufte. A qui appartint alors Knfpeâion des chemins.
Police établie dans le 14e fiecle. Soins de Henri IV, Ibid. b. de
Louis XIII. Etabliffement d’un direaeur général des ponts 8c
-chauffées. Arrêt dueonfeil du 3 mai 1720. Difpofitif de cet
arrêt. Divers articles de police fur ce fujet. Ibid. 278. a.
Recueils 8c ouvrages à confulter. Ibid. b. .
Chemin , officiers Romains qui veilloient à l’entretien des
chemins. XIII. 696. a. De la police des chemins. XVU. 422.
a , b. Chemin vicomtier. 240. a. _ ‘ n
Chemin appellé carrière dans quelques coutumes. Ce qu elles
en difent. IIl. 278. h. . ■
Chemins charruaux , ou de traverfe , ou yoifmaux. Chemin
châtelain, chemin croifier, chemin finerot, chemin forain, grands
chemins , chemin du hallage , chemin pour iffue volontaire ,
chemin péageau , chemin appellé pié-fente en Artois , chemin
privé, chemin public , chemin real. III. 278. b.
Chemin royal, fes diverfes largeurs lelon les tems 8c les
•coutumes. Difpofition de l’ordonnance des eaux 8c forêts.
•HL 279. a. i .
Chemin de terroir , l’une des cinq efpeces de chemins publics
que l’on distingue en Artois. Enumération dé ces cinq
éfpeces. III. 279. a.
Chemin de traverfe. III. 279. a. Chemin vicomtier , chemins
voifinaiix. Ibid. b. '
Chemin-couvert , ( An milit. ) partie de la fortification.
Defcription 8c dimenfions. Lorfqu’il eftplus bas que le niveau
de la campagne , comment on y remédie. Tems où s’eft établi
l’ufage du chemin-couvert. A quoi il fert. III. 279. b. Le chemin
couvert 8c le glacis font appellés quelquefois du nom de
contrefcarpe. Comment on trace le chemin-couvert. Ibid.
280. a. Sur la conftruétion des places d’armes, voye^ Place
j >’armes.
Chemin-couvert. Il doit envelopper les dehors 8c toutes les
fortifications. IV. 770. a. Place d’armes du chemin-couvert.
XII. 672. a ,b. Ses traverfes. XVI. 570. a. Batterie du chemin-
couvert. II. 130. b. 152. b. 153. a. Avant-chemin couvert.
I. 860. b. Attaque du chemin-couvert. I. 836. a , ¿.IV. 739.
a. Défenfe. IV. 738. a,b. 739. a.
Chemins militaires , via militares , qu’Agrippa fit faire fous
Augufte. Hiftoire de ces chemins par M. Bergier. III. 280. à.
C hemin dies rondes, ( Fortifient. ) il n’eft pas d’un grand
ufage. Defcription 8c dimenfions. Il ne fe trouve plus guere
.que dans les anciennes fortifications. III. 280. a.
Chemin , en bâtiment. III. 280. a.
■Chemin .de carrière. III. 280. a.
C hemin, ( Chorégraphie ) lignes qui repréfentent la figure
• d’une danfe. En quoi confifte'toutela chorégraphie. III. 280. a.
Chemin, terme de diamantaire. III. 280. a.
C hemin,.( Tonnel.) pièces de bois qui fervent à conduire
les tonneaux de deffus une riviere à terre. III. 280. a. Proportion
à obferver dans leur longueur 8c inclinaifon. Ibid. b
CHEMINÉE,étymologie du mot. Définition. Comment on
faifoît anciennement les cheminées. Situation de la cheminée.
Sa conftruétion confifte aujourd’hui dans l’art de dévoyer
fon tuyau dans l’épaiffeur du mur. Inconvénient de l’ancien
•ufage d’adoffer les cheminées les unes devant les autres à
chaque étage. III. 280. b. Profondeur à donner au foyer. Matière
à employer pour la conftruâion. De la décoration des
cheminées : décoration du manteau. Du chambranle. Ibid. b.
Cheminée: fes différentes parties : ailes. I. 212. b. Atre. 82'^
b. Contre-coeur. IV. 132. b. Fantonspour les tuyaux de cheminée.
VI. 404. a, b. Foyer. VII. 263. b. Gorge. 742. L
Souche de cheminée. XV. 385. a ', b. Tuyau. X v l. 769.
J~ r— ’ •• • é dans les-cheminées pour chail
Efpece-de founirail pratiqué les pourchaflér
la fumée. XViI. 30. a. —• Conftruâion des cheminées de
dt
Gauger , qui renferme toiit à la fois l’avantage des poêles I
■8c n’en a pas les ineonvénicnsT VII. 248. 3. c. Ufage que
; Gauger a tait des figures elliptiques 8c paraboliques pour fes
cheminées : cheminées à la Nanci comparées à celles de
•Gauger. 248. 7. a. Des moyens de chauffer plufieurs chahi-
C H E
bres à la fois. 248. 3. d. Comment on peut rendre les plaÎues
de cheminées propres a renvoyer beaucoup de chaleur.
, 627. b. Efpece de cheminée appellée hypocaufte. Suppl. in.
483. a, b. Efpece dé cheminée que les Perlans pratiquent pour
donner de l’air à leurs appartemens. VI. 139. a.
C heminée-Poele , ( Phyfiq. ) nous devons à M. de Mon-
talembert l’ingénicufe invention de pouvoir convertir à volonté
une cheminée en poêle. Divers avantages de cette invention.
Suppl. II. 382. a. Conftruétion de cette forte de
cheminée. Maniéré de s’en fervir comme d’une cheminée
ordinaire. Maniéré de la convertir en poêle. Comment on
entretient fa chaleur. Ibid. b. Difpofirion à donner aux tuyaux
de cette forte de cheminée , par laquelle on pourroit échauffer
toutes les chambres d’une maifon , par un ou deux feux
allumés au rez-de-chauffée , 8c arrêter la communication de *
la chaleur dans tel appartement qu’on voudroit. Ces tuyaux
peu fujets à amaffer la fuie. Ibid. 383. a> b. Defcription des;
différentes parties de ces cheminées, repréfentées planch.du
Suppl. Phyfiq.pl. y.
C heminée , ( Hifi. anc. ) M.Perrault penfe qUe fi les an-'
ciens avoient des cheminées, elles étoient rares. III. 281. a.
Cependant on ne peut douter qu’ils n’en euffent 8c en grand
nombre. Preuves tirées d’Appian Alexandrin, d’Ariftopnane,
de Virgile. Nous n’avons dé ces cheminées qu’une légère
connoiffance. Elles étoient conftruites au milieu de la chant-«
bre : partages d’Horace qui le prouvent. Leur luxe ne s’étoit '
pas tourné de cécôté-là. Quelle en efi la raifon. Vice de
conftruâion dans les cheminées qui empêche en partie les'
effets de la chaleur. Ibid. b. Autre inconvénient de nos che-'
minées , celui de fumer. Remedes inutiles qu’on a employés.
pour cela. Moyens plus furs. Ouvrages à confulter fur ce
fujet. Ibid. 282. a.
Cheminée. Comment les Romains avoient fuppléé au défaut-'
des cheminées. IX. 890. b.
C heminée, ( Lutherie) tuyau de plomb dans les orgues.'
Defcription avec figure. III. 282. a.
CHÉMINON, ( Géog. Hifi. Lin. ) village de Champagne,
diocéfe de Châlons, élection de Vitri. Lieu remarquable par
une abbaye de l’ordre de Citeaux. Obfervations for lès ouvrages
de Pierre-Céfar Richelèt, avocat, poëté, critique 8c
littérateur , né dans ce Heu. Suppl. II. 384. a.
CHEMISE. Defcription de celle des femmes 8c de celle
des hommes de toutes leurs parties 8c ornemens. III. 282.
a. Quantité de toile qu’elles exigent communément. Che-
mifes en amadis. Les anciens n’ont point ùfé de chemifes.
Divers ufages de ce mot, en fortification, dans l’art militaire ,
dans l’écriture , le c.ommerce , la maçonnerie. Ibid. b.
Chemife. Tunique de deffous , chemife de lin des anciens
Romains, VIII. 14. a. XV. 394.b. Chemifes des hommes 8c'
des femmes chez les Romains. XVI. 746.a , b. Chemifes des
modernes : manches en amadis. 1. 313. b. Des chemifes 8c de
leur fabrication. Suppl. III. 733. b. 736. a. 737. a , b. 738. a,
b. 759. a. ■ ■
C hemise , (Métallurg.) partie intérieure du fourneau à'
manche , dans lequel on fait fondre les mines , bc. Briques
employées pour cela. On eft très-fouvent obligé de renou-.
veller la chemife. Il faut lier les pierres avec le moins de'
ciment qu’il eff poffible. III. 283. a.
CHEMISE, ou demi-chemife, ( Ferrerie) III. 283s a.
CHEMOSIS , ( Médec. ) la plus grave efpece d’ophthalmie.
Sa définition : caraâeres de cette maladie. Ses caufes. III.
283. a. Voye[ OPHTHALMiE.
CHÊNE, caraéteres de ce genre d’arbre. Diftinétions que
cet arbre a reçues dans l’antiquité chez plufieurs nations-!
Eloge moins relevé, mais mieux fondé que les naturaliftes
en font. Caraéteres de fa tige 8c de fes feuilles. Il eft lent
à croître, mais il vit long-tems. Son bois eft le plus durable
de tous. Il tient à plufieurs égards le premier rang parmi
les arbres foreftiers. Tems qu’il emploie à croître dans un
terrein gras. III. 283. b. Expofition. Terrein. Prefque toutes
les expofitions lui conviennent : mais il réuflit mieux dans
les terres douces , limonneufes, profondes 8c fertiles. Diffé-
rens effets que produifent fur lui les autres efpeces deterreins
où on le fait croître. Quel eft celui auquel il fe refufe. PlanJ
tâtions. Si nous en croyons les meilleurs auteurs Anglois,
il finit, bien, des précautions 8c de la dépenfe pour faire des
plantations de chêne. Préparation du terrein, choix du gland,
tems 8c maniéré de le lemer. Ibid. 284. a. Soins de larder
fréquemment ; labour avec la charrue ou à la main ; diftancp
où il faut tenir les jeunes plants les uns des autres des lag*
de deux ans ; retranchemens qu’il faut faire à me fur e qu us
avancent pour augmenter leurs diftances : après deux ou
trois ans, il fera à propos de couper, pour en faire des le-
pées de taillis, les plants qui paroîtront les moins 1 po s
à devenir futaie. Il faut dégarnir avec ménagement les en-
droits expofés aux vents, foiftanct de vingt-cuiq à n-en»
niés qu’il L t donner aux arbres qu’on veut flev.Mtn fe: a.e
g f c S S S s l S S È p # ! en faire arraeher
tePîu c i e s T S m que tous les fues de la « r r e pud|né
C H E CHE 2 9 7
. r,nr * r, futaie. Ce qu'on vient de lire jufqu k i efi tiré du die*
* 1 , 1 m. Mildr. Ibid. t. Réflexion de l’auteur fur la
dfoenfe que cette maniere culture entraîneroit, dont M.
deBufFon a fait l’expérience. Inconvéniens^ attachés à cette
culture * que l’expérience lui a fait connoître. En effayant
au contraire à faire des plantations par une méthode toute
¿ppofée » M- de Buffon a éprouvé des fuccès plus fatisfaifans
& beaucoup moins difpendieux. Il a imité de plus près la
fimplicité des opérations de la nature , en ajoutant feulement
quelques moyens pour en accélérer l’effet : ces moyens font j
r l’abri » femer abondamment, 8c couper fouvent.
jui viennent à l’appui ----- ------ ---- -
«erver le gland pendant l’hiver, fi l’on avoit des raifons d attendre
le printems pour femer. Autres maniérés de multiplier
le chêne pour fe procurer des efpeces curieufes 8c étrangères.
Tranfplantation. Age de la tranfplantation. Ce qu’il
faut obferver dans cette opération. Ufage du bois. Divers
ouvrages pour lefquels il eft recherché. Ses quaHtés excellentes
pour les charpentes. Ibid. b. Quand on veut 1 employer
à l’air , il doit être bien fec 8c faifonné ; préparation par
laquelle on peut le rendre propre à être employé, quoique
encore vertf De l’ufage de ce bois pour le chauffage. Aubier
du bois. En quoi il confifte : caraâere de celui du chêne. Il
eft défendu aux ouvriers de l’employer. Moyen de lui donner
prefque autant de folidité 8c de durée qu’en a le coeur
du bois. Ecorce. Son ufage pour les tanneurs : le bois auroit
à-peu-près la même qualité. Ufage du tan. Gland. Choix à
faire oc précautions à prendre pour la récolte du gland ,
lorfqu’on veut faire des plantations. Ibid. 286. a. Son utilité
pour la nourriture de quelques bêtes. Gui de chine. Vertus
que les druides attribuoient à cette plante parafite. Ufages
auxquels elle eft encore employée. Sa rareté. Excrefcences.
Combien le chêne eft fujet a celles qui proviennent des pi-
quures d’infeétes. Pourquoi l’on fe fert fi peu du chêne pour
l’ornement des jardins. Efpeces. Les hotaniftes en comptent
au moins quarante, parmi lefquelles il faut donner la préférence
à nos chênes communs 8c à ceux d’Amérique. Voici
rémunération de trente-fept efoeces,avec quelques obfervations
fur les principales. Le cnêne à gros gland. Le chêne à
gland moyen. Ibid. b. Le chêne à petit gland ; le chêne à
feuilles panachées j je chêne toujours verd ; le chêne cerrus;
le petit chêne cetTÙs ; le petit chêne portant plufieurs galles
jointes enfemble ; le chêne efculus ; celui de Bourgogne ; le
chêne nain ; le chêne rourc ; Ibid. 287. a. le petit roure ; le
roure portant galles ; le roure à feuilles liffes ; le chêne à gros
gland, dont le caHce eft tout couvert de. tubercules. Celui
a’orient, à gland cylindrique avec un long pédicule ; celui
d’orient, à feuilles de châtaignier; celui d’orient, à très-gros
gland, dont le calice eft hérifl'é de filets. Quatre autres efpeces
de chêne d’orient : le chêne rouge, de Virginie ; le chêne de
Virginie,à feuilles de châtaignier; le chêne blanc de Virginie;
Ibid. b. le chêne de Virginie, à feuilles de faule; le chêne
toujours verd, à feuilles oblongues 8c fans finuofités; le
chêne noir; le chêne d’eau d’Amérique ; le chêne blanc de la
Caroline ; le petit chêne à feuilles de faule ; le chêne rouge
de MaryLande ; Ibid. 288. a. le chêne d’eau d’Efoagne ; le chêne
de Marylande ; le chêne faule ; le chêne d’Afrique. Ibid. b.
Chine, noms de cet arbre en différentes langues. Son caractère
générique. Enumération de vingt efpeces de chêne, bien
conftatées, qui fe trouvent en Angleterre dans les jardins.
Suppl. II. 384. a. Obfervations fur ces efpeces, leur culture,
leurs ufages, &c. Ibid. 383. a.
Chine, qualité des terreins où le chêne peut être femé. II.
$00. a. Age de la confiftance du chêne. IV. 47. a. Durée d’un
chêne en bon fonds. III. 634. a. Sorte de chêne appellé rouvre.
XI. 192. a , b. XIV. 416. b. Chêne verd. XVII. 660. a. Obfervations
fur les quaHtés 8c ufages du chêne dans la menuiferie.
X. 346. b. Force d’un pilier de bois de chêne. III. 634. a. Du
gui de chêne. VII. 1000. b. Suppl. II. 286. b. Cérémonie à fon
occafion. I. ipi. b. Des nymphes qui préfidoient aux chênes.
. V* H; a > Vénération des Celtes pour celui qui leur re-
•prélentoit la divinité. Suppl. II. 282. b.
, Chêne, ( Mot. méd, ) ufages 8c propriétés de. la feuille, de
1 ecorce, du gland, de la calote du gland, des galles, pommes
& raifins de chêne. III. 288. b.
Chêne v*rd, /&*: caraâeres de ce genre d’arbre. IIL 288. é.
C hene , ( B la fon ) meuble de l’écu. Comment on le diftingue
des autres arbres. Chêne fruité. Signification de cette
ngure fymboUque. Cet arbre honoré par les anciens. Couronnes
de chêne. Suppl. II. 387. a.
v £ S ÈN-E’ ( Myfh-) arbre confacré à Jupiter 8c à Cybelc.
• ”erauon des Gaulois pour le chêne. Suppl. II. -»87. a
cSIhr X IV .4 I7 -
JII agg , ¡ M t ou chene de Charles, ( Afiron.) conftellation.
par^M^H S^lar^s I I , conftellation méridionale, introduite
' TomeL* en m^mo*re c^®ne royal fur lequel fe
retira Charles II, lorfqu’il eut été défait à Worceftef. Relation
de cet événement. Suppl. II. 387. a. Etoiles qui forment
la conftellation du chêne. Longitude 8c latitude de la principale.
Ibid. b. Cette conftellation changée par M. l’abbé de la
Caille. Ibid. 563. b.
CHENELLES, ou Tenellesi ( Jurïfp. ) droit de gambage
ufité dans l’Artois. III. 289. a.
CHENET , uftehfile domeftique : on le place par paire
dans les âtres de cheminées. Defcription du chenet de cui-
fine. De ceux des appartemens. Ce que le luxe a ajouté dans
cette partie aux ufages de nos peres. III. 289« a.
CHENEVI, danger de le femer trop tôt 8c trop tard. Maniéré
de le femer. Soins à prendre lorfqu’il eft femé. III. 289. a.
CHENEV1ERE, qualité que doit avoir la terre. Il faui
fumer tous les ans les chenevieres. Tems de fumer. Du
premier labour. Comment on prépare la terre des chenevieres
au printems. III. 289. b. — Sur la maniéré de les arrO-
fer, voyez Suppl. L 33. a.
CHENlCE, {Hifi. anc.) mefure attique, adoptée par les
Romains. Sa contenance. Partage de Fannius. On diftinguoie
à Athènes quatre mefures de ce nom. IIL 289. b.
CHENIL, ( Archït. ) obfervations fur les commodités qu’il
faut rartêmbler autour des chenils, 8c fur l’expofition qu’il
faut leur donnér. III. 289. b.
Chenil. Voyez fur la conftruâion 8c le gouvernement du
chenil l’article Venerie. XVL 924. b. 8cc. 8c l’article Chient
III. 330. b.
CHENILLE, defcription des infeâes de ce nom. III. 289. b.
Leurs jambes écailleuies : leur nombre en eft confiant. Leurs
jambes membraneufes ; leur nombre eft variable félon les
efpeces : c’eft par leur nombre 8c leur arrangement qu’on a
diftribué les cnenilles en certaines claffes. La première comprend
celles qui ont huit jambes intermédiaires, quatre de
chaque côté, c’eft-à-dire, feize en tout. Caraâere de la qua*
trieme , de la cinquième 8c de la fixieme. On a comparé à des
aipenteurs celles de ces deux dernieres, à cauie de leur
démarche. Singularité de leur marche 8c bizarrerie de leurs,
attitudes. Ibid. 290. a. Caraâeres de la Jeptieme clarté. Trois
différens degrés de grandeur à diftinguer dans les chenilles
de chaque daffe. Caraflcres des chenilles rafes : chenilles chagrinées
; chenilles à corne ; celles cpii ont des tubercules diftri-
bués fur chaque anneau , ou dilpofés fur des lignes parallèles
à la longueur du corps. Ce genre comprend les plus
groffes 8c celles qui donnent les plus beaux papillons. Autres
aiverfités remarquables dans les anneaux des chenilles. Che-*
nillcs à deux petites cornes ou antennes fur la tête. Caractères
des chenilles à gros poils ,, qu’on pourroit appeller
chenilles épineufes. Ibid. b. Chenilles velues de plufieurs genres:
demi-velues« chenilles-cloportes , chenilles veloutées:
le poil de quantité de chenilles eft diipofé par bouquets, par
houpes, par aigrettes. Les touffes de poils partent de tubercules
arrondis 8c hémiij)hériques, &c. Il y a d’autres chenilles
dont les tubercules font charnus 8c faits en pyramide
conique , &c. Chenilles velues qui ont fur' le dos des houpes
reffemblantes parfaitement a des broftes. Ibid. 291. a.
| Autres qui ont des mammelons qui s’élèvent 8c qui s’affaif*
fent, &c. Corne charnue de la chenille rafe qui vit fur le
fenouil. Diverfité dans le diametre du corps des chenilles«'
Des couleurs de ces infeétes. Chenilles folitaires, chenilles
qui vivent en fociété. Autres diftinâions tirées de leur maniéré
de vivre, de leurs initinâs, du genre de leur nourriture.
Obfervations anatomiques fur les chenilles. Crochets
dont leurs jambes font armées. Ibid. b. Ufage qu’elles en
font. Subdivifion de la première daffe que nous avons indiquée.
Obfervations fur la tête 8c fes différentes parties Dents
qui leur fervent à couper les feuilles ; les unes détachent
feulement le parenchyme des feuilles : la plupart prennent les
feuilles dans leur épaiffeur. Le ver à foie mange en un jour
autant de feuilles pelant qu’il pefe lui-même. Autres chenilles
plus voraces : fihere d’ou fort la foie que filent les
chenilles. Petites cornes mobiles fur la tête de la chenille,
fes yeux, fes ftigmates. Ibid. 292. a. Divers changemens
de peaux que fubiffent les chenilles : comment fe font ces
changemens. On trouve alors la chenille confidérablement
plus groffe qu’elle n’étoit avec la dépouille. Forme de la
chryfalide. Si on enleve la peau à une chenille un jour -ou
deux avant celui de la métainorphofe, on met le papillon à
découvert, 8c on diftingue toutes fes parties 8c même fes
oeufs. Différentes efpeces de coques de foie que filent les
chenilles. Ce qu’on obferve dans les chenilles quelques jours
avant la métamorphofe. Ibid. b. Comment la chryfidide fe
dégage de fon fourreau. La grandeur des coques n’éft pas
proportionnée à celle des chenilles qui les font. Grandes différences
entre les coques des différentes efpeces de chenilles.
Ibid. 293. a. Il y a peut-être plus de la moitié des chenilles
qui font leurs coques dans la terre : quelques-unes s’y enfoncent
fans faire des coques ; cependant la plupart en font.
Coques des chenilles qui vivent en fociété. Remarques fur
la fociété des chenilles. Defcription de la chenille appellée
F F f£