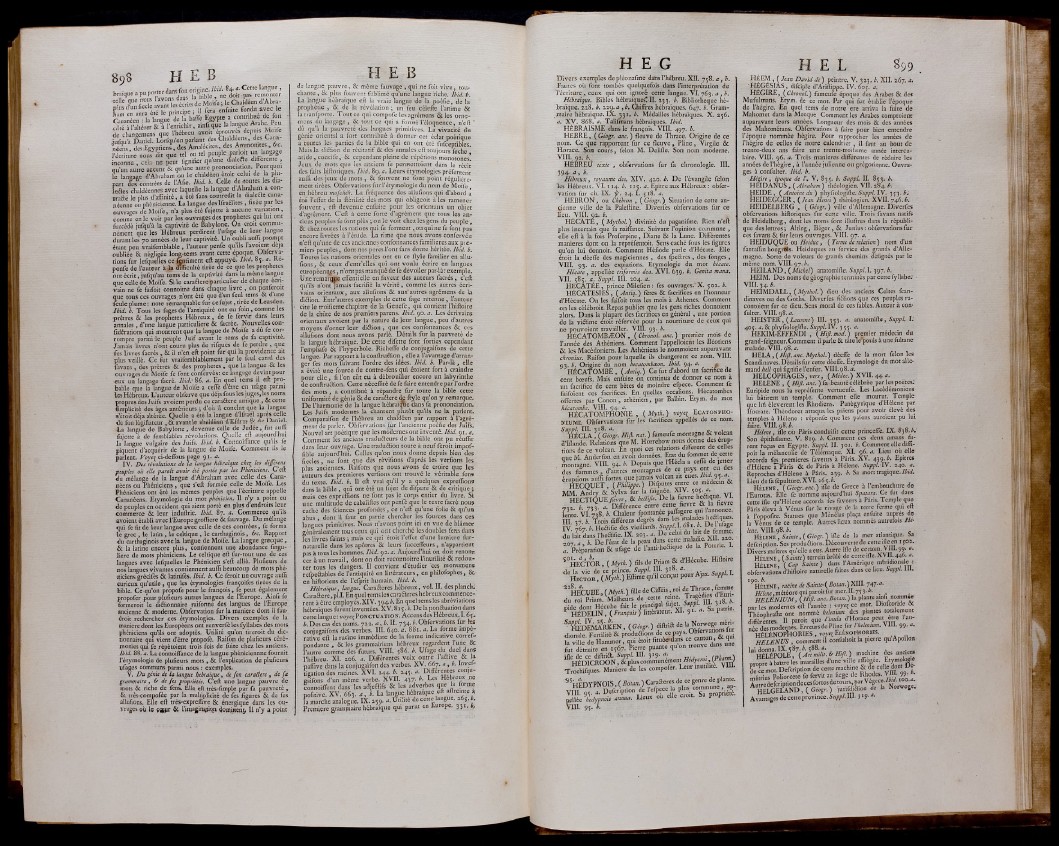
HEB
£
' 1
» „ rAh nrip'me. I ® 84. a. C e tte langu e, j
In iq u e a pu porter dans g remonter 1 S&£SÎÈiî^ss£|| : de changemens que l'hébreu a v eu deP " ,s î ? °
iufqu’à Daniel. Lorfqu’en parlant des Chaldéens, dçs Caua-
n éem , des Egyptiens, des Amalécltcs^des Ammonites, b c
l ’écriture nous d it que tel ou tel peuple parloir un langag
inconnu , cela ne peut lignifier quune tialefte
nu’un autre accent & qu’une autre prononoation. Pourquoi
le langage d’Abraliam ou le cltaldéen étott celui de la plu-
tart f e s contrées de HA fie. Ibid. b. Celle déboutés les dta-
rcélcs chaldéennes a v e c laquelle la langue d Abraham a con-
■traflé le plus d’affinité, a été fans contredit la dtalefte cana-
ncenne ou phénicienne. La langue de slfraé lite s, fixee par les
ouvrages de M o ïfe , n’a plus été fujette à aucune varia tion,
comme on le voit par les ouvrages des prophètes qui lui ont
fuccédé iufqu’à la captivité de Babylone. O n croit communément
que les Hébreux perdirent l’u fage de leur langue
durant les 70 années de leur captivité. Un oubli aufli prompt
étant peu vraifemblable, l’auteur penfe qu’ ils 1 avoient déjà
oubliée & négligée long-tems avant cette époque. Obferva-
tions fur lefquelles ce ¿animent eft appuyé. Ibid. 83. a. Ré-
ponfe de l ’auteur à la difficulté tirée de ce que les prqphetes
ont é c r it , jufqü’au tems de la captivité dans la même langue
que celle de Moïfe. Si le cara&ereparticulier de chaque écrivain
ne fe faifoit connoître dans chaque livre , on penferoit
que tous ces ouvrages-n’ont été que d’un feul tems & d une
jeule plume: note remarquable fur c e fu je t , tirée de Leusden.
Ibid. b. Tous les fages de l’antiquité ont eu lo in , comme les
prêtres 8c les prophètes H é b reu x , de fe fervir dans leurs
annales, d’une langue particulière 8c facrée. Nouvelles confédérations
qui montrent que la langue de Moïfe a du fe corrompre
parmi 'le peuple Juif avant le tems de fa captivité.
Jamais livres n’ont couru plus de rifques de fe perdre, que
fes livres fa cré s , 8c il n’en eft point fer qui la providence ait
plus veillé. -Ce fut vraifemblablement par le feul canal des
favans , des prêtres 8c des prophètes , que la langue -8c les
ouvrage sde Moïfe fe font confervés: ce langage devint pour
•eux un langage facré. Ibid.' 86 . a. En quel tems il eft probable
que la langue de Moïfe a ceffé d’être en ufage parmi
■les Hébreux. L’auteur obferve que déjà fous les juges,les noms
propres des Juifs avoient perdu ce caraôere antique, 8c cette
umplicité des âges antérieurs ; d’ou il conclut que la langue
s’etoit déjà altérée. Qu elle a été la langue d’ifraël après celle
d e fon légiflateur , 8c avant le chaldêcn d’Efdras 8c de Daniel.
L a langue de B ab y lon e, devenue celle de Judée, fut aufli
fujette à de femblables révolutions. Qu elle eft aujourd’hui
la langue vulgaire des Juifs. Ibid. b. Connoiflance qu ils fe
piquent d’acquérir de la langue de Moïfe. Comment ils le
parlent. Fbyrç ci-deffous page 9 1 . a. |
IV . D e s révolutions de la langue hébraïque chc{ les dijferens
peuples oh elle paroît avoir été portée par Us Phéniciens. G’eft
du mélange de la langue d’Abraham avec celle des Cananéens
ou Phéniciens, que s’eft formée celle de Moïfe. Les
Phéniciens ont été les mêmes peuples que l’écriture appelle
Cananéens. Etymologie du mot phénicien. I l n’y a point eu
de peuples en occident qui aient porté en plus d’endroits leur
commerce 8c leur induftrie. Ibid. 87. a. Commerce quils
avoient établi avec l’Europe groffiere 8c fauvage. D u mélange
qui fe fit de leur langue avec celle de ces contrées, fe forma
le grec , le latin , le celtique, le carthaginois, 6*c. Rapport
du carthaginois avec la langue de Moïfe. La langue grecque,
& la latine encore plus, contiennent une abondance fingu-
liere de mots phéniciens. L e celtique eft fur-tout une de ces
langues avec lefquelles le Phénicien s’eft allié. Plufieurs de
nos langues vivantes contiennent aufli beaucoup de mots phéniciens
grécifés 8c latinifés. Ibid. b. C e ferait un ouvrage aufli
curieux qu’utile, que les étymologies françoifes tirées de la
bible. C e qu’on propofe pour le françois, fe peut également
propofer pour plufieurs autres langues de l’Europe. Ainfi fe
formeroit le dictionnaire raifonné des langues de l’Europe
ancienne 8c moderne. Obfervation fur la maniéré dont il faudrait
rechercher ces étymologies. D iv er s exemples de la
maniéré dont les Européens ont renverfé les fyllabes des mots
phéniciens qu’ils ont adoptés. Utilité qu’on tirerait du dictionnaire
qui vient d’être prapofé. Rai ion de plufieurs cérémonies
qui fe répétoient trois fois de fuite chez les anciens.
Ibid. 86. a. La connoiflance de la langue phéniciennne fournit
l’étymologie de plufieurs m o ts, 8c Fexplication de plufieurs
yfages communs parmi nous : exemples.
V . D u génie de la langue hébraïque, de fo n caraélere, de fa
grammaire, 6* de fes propriétés. C/eft une langue pauvre de
mots 8c riche de fens» Elle eft très-fimple par fa pauvreté ,
8c très-compofée par la multiplicité de fes figures 8c de fes
allufions. EUe eft très-expreflive & énergique dans les ouvrages
où le & l’iniagin viqn dominent. Il n’y a point
H E B
de langue p au v re , 8c même fauvag e, qui ne foit v i v e , touchante
, 8c plus fouvent fublimê qu’une langue riche. Ibid. b.
L a langue hébraïque eft la vraie langue'de la poéfle, de la
.prophétie , 8c de la révélation ; un feu célefte l’anime 8c
la tranfporte. T o u t ce qui compofe lesagrémens 8f. les orne-
mons du langage , 8c tout ce qui a formé l’éloquence, n’eft *
dû qu’à la pauvreté des langues primitives. La vivacité du
génie oriental a fort contribué à donner cet éclat poétique
à toutes les parties de la bible qui en ont été fufceptibics.
Mais la diétion du récitatif 8c des annales eft toujours fechc
•aride, con c ile, Sc cependant pleine de répétions monotones.
Jeux de mots que les anciens fe permettoient dans le récit
des faits hiftoriques. Ibid. 89. a. Leurs étymologies préfentent
aufli des jeux de m o t s , 8c fouvent ne font point régulièrement
tirées. Obfervations fur l’étymologie du nom de M o ïfe ,
en hébreu mofehéh. La fréquence des allufions qui d’abord a
été l’effet de la ftérilité des mots qui obligeoit à les ramener
fo u v en t , eft devenue enfuite pour les orientaux un objet
d’agrément. C ’eft à cette forte d’agrément que tous les anciens
peuples fe font plus ; on le voit chez les gens du peu ple,
8c chez toutes les nations oui fe forment, ou qui ne fe font pas
encore livrées à l’étude. La rime que nous avons confervée
n’eft qu’une de ces anciennes confonnances familières aux pi e-
raiers peuples, dont nos peres l’ont fans doute héritée. Ibid. b.
Toutes les nations orientales ont eu ce ftyle familier en allu-
fions, 8c ceux d’entr’elles qui ont voulu écrire en langues
européennes, n’ont pas manqué de fe dévoiler par-là : exemple.
Une remarque eflentielle en faveur des auteurs fa c ré s , c ’efl:
qu’ils n’ont jamais-facrifiè la v é r ité , comme les autres écrivains
orientaux, aux allufions 8c aux* autres agrémens de la
diétion. Entr’autres exemples de cette fage retenue , l’auteur
cite le troifieme chapitre de la G en e fe , qui contient l’hiftoire
de là chute de nos premiers parens. Ibid. 90. a. Les écrivains
orientaux avoient par la nature de leur langue, peu d’autres
moyens d’orner leur diétion | que ces conlonnances 8c ces
allufions dont nous avons parlé. Détails fur la pauvreté de
la langue hébraïque. D e cette difette font forties cependant
l’emphafe 8c l’hyperbole. Richefle de conjugaifons de cette
langue. Par rapport à la conftruftion, elle a l’avantage d’arranger
fes mots fuivant l’o rdre des idées. Ibid. b. Pa r- là , elle
a évité une fource de contre-fens qui étoient fort à craindre
pour e l l e , fi l’on eût eu à débrouiller encore un labyrinthe
de conftruétion. Cette néceflité de fe faire entendre par l’o rdre
des m o ts , a contribué, à répandre fur toute la bible cette
uniformité de génie 8c de caraftere de ftyle qu’on y remarque.
D e l’harmonie de la langue hébraïque dans fa prononciation.
Les Juifs modernes la chantent plutôt qu’ils ne la parlent.
Comparaifon de l’hébreu au chaldéen par rapport à l’agrément
de parler. Obfervations f e r l’ancienne poéfie des Juifs.
Nouvel art poétique que les modernes ont inventé. Ibid. 91. a.
Comment les anciens tradufteurs de la bible ont pu réuflir
dans feur ouvrage. Une traduction toute à neuf ferait impof-
fible aujourd’hui. Celles qu’on nous donne depuis bien des
fie c le s , ne font que des révifions d’après les verfions les
plus anciennes. Raifons que nous avons de croire que les
auteurs des premières verfions ont trouvé le véritable fen9
du texte. Ibid. b. Il e f t . v rai qu’il y a quelques expreflion9
dans la bible , qui ont été un fiijet de difpute 8c de critique ;
mais ces exprelfions ne font pas le corps entier du livre. Si
une multitude de cabaliftcs ont penfé que le texte facré nous
cache des fciences profondes, ce n’eft qu’une folie 8c qu’un
abus , dont il faut en partie chercher les fources dans ces
langues primitives. Nous n’avons point ici en vue de blâmer
généralement tous ceux qui ont cherché les doubles fens dans
les livres faims-; mais ce qui étoit l’effet d’une lumière fur-
naturelle dans les apôtres 8c leurs fucceffeurs | n’appartient
pas à tous les hommes. Ibid. 92. a. Aujourd’hui on doit renon*
cer à un rravail , dont on doit reconnoître l’inutilité 8c redouter
tous les dangers. Il convient d’étudier ces monumens
refpeétables de l’antiquité en littérateurs, en philofophes, 8 t
en hiftoriens de l’efprit humain. Ibid. b.
Hébraïque, langue. Cara&cres hébreux, vol. II. desplanch:
CaraCtere,pl.I. En quel tems les cara&eres hebreux commencèrent
à être employés. X IV . 3 0 4 En quel tems les abréviations
hébraïques furent inventées. X V .813./». D e la pon&uation dans
cette langue: voye^ P o n c t u a t i o n . Accens des Hébreux. 1. 63.
b. Des cas des noms. 722. a , b. II. 734. b. Obfervations fur les
conjugaifons des verbes. III. 640. a. 881. a. La forme impé-
rative eft la racine immédiate d e la forme indicative ^correspondante
, 8c les grammairiens hébreux regardent 1 une 8c
rautre comme des futurs. V I I I . 386. b. Ufage du duel dans
l’hébreu. XI. 206. a. Différentes vo ix outre la éliv e 8c Ja
paflive dans la conjugaifon des verbes. X V . 667. a , b. Invei-
tigation des racines. X V I . 244- ¡ ¡ I B Différentes conjug
u o n s d’un même verbe. X V I I . 437- S | É B E i Ü
connoiflent dans les adjeftifs 8c les adverbes que la forme
pofitive. X V . 663. a , b. La langue hébraïque eft aft rein te a
la marche analogue. IX . 239. a. U tilité de cett^ a"8 | 2 S* *
Première grammaire hébraique qui parut en Europe. 331 .b ,
H E G
D iv e r s exemples depléonafme dans l ’hébreu. XII. 738. a , b.
Fautes où font tombes quelquefois dans l’interprétation de
l ’é c r itu re , ceux qui ont ignoré cette langue. V I . 763. a , b.
Hébraïque. Bibles hébraiquesMI. 233. b. Bibliothèque hébraïque.
228. b. 229. a , b. Chiffres hébraïques. 647. b. Grammaire
hébraïque. IX . 331. b. Médailles hébraïques. X . 236.
a . X V . 868. a. Talifmans hébraïques. Ibid.
HÉ BR A ISME dans le françois. VIII. 497. b.
H E B R E , ( Géogr. anc. ) fleuve de Thrace. Origine de ce
nom. C e que rapportent fur ce f le u v e , P lin e , Virgile 8c
Horace. Son co u r s , félon M. Delifle. Son nom moderne.
V in . 92. b..
HÉBREU texte , obfervations fur fà chronologie. III.
394. a y b.
Hébreux, royaume des. X IV . 420. b. D e l’évangile félon
les Hébreux. V I . 114. b. 1 13. a. Epitre aux Hébreux : obfervation
fur ch. IX . ÿ . 24. I. 318. a.
H E B R O N , ou Chébron , ( Géogr. ) Situation de cette ancienne
v ille de la Paleffinc. Diverfes obfervations fur ce
lieu. V I I I . 92. b.
H É C A T E , ( My thol. ) divinité du paganifme. Rien n’eft
plus incertain que fa naiflance. Suivant l’opinion commune ,
elle eft à la fois Proferpine, Diane 8c la Lune. Différentes
maniérés dpnt on la repréfentoit. Sens caché fous les figures
qu’on lui donnoit. Comment Héfiôde parle d’Hécate. Elle
étoit la déeffe des magiciennes , des fpeftres, des fon ges,
V I I I . 93. a. des expiations. Etymologie du mot hécate.
Hécate , appellée triformis dea. A V I . 639. b. Genita mana.
V I I . 383. a. Suppl. III. 204. a.
H E C A T É E , prince Milefien: fes ouvrages.’ X. 302. b.
H É C A T E S IE S , ( A n t iq .) fêtes 8c facrificcs en l’honneur
d ’H écate. O n les faifoit tous les mois à Athènes. Comment
on les célébrait. Repas publics que les gens riches donnoient
alors. Dans la plupart des facrinces en général , une portion
d e la viétime étoit réfervée pour la nourriture de ceux qui
n e pouvoient travailler. VIII. 93. b.
H É C A T O M BÆ O N , ( Chronol. a n c .) premier mois de
l’année des Athéniens. Comment l’appelloient les Béotiens
8c les Macédoniens. Les Athéniens le nommoient auparavant
chronius. Raifon pour laquelle ils changèrent ce nom. VIII.
03. b. Origine du nom hecatombaon. Ibid. 94. a. « ■
H É C A T O M B E , ( A n t iq . ) C e fut d’abord un facrifice de
cent boeufs. Mais enluite on continua de donner ce nom à
un facrifice de cent bêtes de moindre efpece. Comment fe
faifoient ces facrifices. En quelles occafions. Hécatombes
offertes par C o n o n , athénien, par Balbin. Etym. du mot
hécatombe. V I I I . 94- a- v
H É C A TOM PH O N IE , ( Myth. ) vo ye [ E c a t o n ph o -
NEUME. Obfervations fur les facrifices appellés de ce nom.
Suppl. III- 318. a. 0 1
H É C L A , ( Géogr. H ith nat. ) fameufe montagne & volcan
d’Iflande. Relations que M. Horrcbow nous donne des éruptions
de ce volcan. En quoi ces relations différent de celles
que M. Anderfon en avoir données. Etal: du fommet de cette
montagne. V I I I . 94- A Depuis que l’H éda » « M
des flammes, d’autres montagnes de ce pays ont eu des
éruptions aufli fortes que jamais volcan ait eues. U id . a
H E C Q U E T , (P h i lip p e .) Difputes entre ce médecin &
MM. A n d ry & S y lv a fur la faignée. X IV . 505. a.
H E C T IQ U E fiè v r e , & hcSÏfie. D e la fievre heéhque. V I.
4 7 ,T . „ . Différence entre cette fievre & la fievre
fente V { 718. i . Chaleur fpontanée paflagere qui l annonce,
n ? H . W o u différens d grés dans les
I V 767. h. Heélifie des vieillards. Suppl. i . 681. b. D e 1 mage
du lait^ans p * . D£. ao 3. a D e celm dt' g "
î0 7 . a , b. D e l’état de la peau dans cette maladie. X ll- aîO.
a . Préparation & ufage de l’anu-heiiique de la Poterie. 1.
* °H E C T O R , (M y t h . ) fils de Priam & d’Hécube. Hiftotre
S IHE CU B E f M y th .) fille de Cifféis, roi de T h rac e, femme
<le,ce.t= t=;ne. Tragédms ’E n r ,
pide dont Hécube fait le pnncmal Suppl.^ l i }
H É D E L IN , ( François ) littérateur. X I. 9 1. • P
5 “f f r n E M A R K E N , ( G t cg r .) difiri» de laNorwege méridionale
Fertilité & proditûmns de ce pays. Obfervations fur
la v ille de Hammer, mil étoit fituée-tfans ce canton & qm
fut détruite en . ï 6 7. Pierre puante q u o n trouve dans une
^H ^ÉDICROON f & pluscommiinément Hedyeroi,
T ™hffques. Maniere'de les compofer. Leur mutUtté. VIII.
9SH E D yPN O IS „ ( Boean. ) Caraélercs de ce genre de plante.
V I I I . 5 5 . b.
H E L 8 9 9
H É EM , ( Jean D a v id de ) peintre. V . 323. b. X It. 267. à.
-HÉGÉSIAS * difciplc d’Ariftippc. IV . 603. a.
H É G IR E , (Chronol.) fameufe époque des Arabes & de«
Mufulmans. Etym. de ce mot. Par qui fut établie l’époque
de l’hégire. En quel tems de notre ere arriva la fuite de
Mahomet dans la Mecque Comment les Arabes comptoicnt
auparavant leurs années. Longueur des mois & des années
des Maliométans. Obfervations à faire pour bien entendre
l’époque nommée hégire. Pour rapprocher les années de
l’hégire de celles de notre calendrier , 1 1 faut au bout de
trente-deux ans faire une trente-troifieme année intercalaire.
VIII. 96. a. Trois maniérés différentes de réduire les
années de l’hégire, à l’année julienne ou grégorienne. Ouvrages
à confulter. Ibid. b.
H ég ir e , époque de V. V . 833. b. Suppl. II. 833. b.
H EID A N U S , ( Abraham ) théologien. V II. 284. b.
H E ID E , ( Antoine du ) phyfiologifte. Suppl. IV . 333. Æ.’
HE IDEG GER , | Jean Henri ) théologien. X V I I . 746. b.
HEIDELBERG , ( Géogr. ) ville d’Allemagne. D iv erfes
obfervations hiftoriques fur cette ville. Trois favans natifs
de Heidelberg, dont les noms font illuftres dans la république
des lettres ; Altin g , B é g e r , 8c Junius: obfervations fur
ces favans 8c fur leurs ouvrages. VIII. 97. a.
H E ID U Q U E ou H e idu c, (Terme de relation) nom d’un
fantaflin hongrois. Heiduqucs au fervice des grands d’A llemagne.
Sorte de voleurs de grands chemins aéfignés par le
même nom. V I I I . 97. b.
H E IL A N D , (M ic h e l) anatomifte. S u p p l.I. 397. b.
HEIM. Des noms de géographie terminés par cette fyllabe.' -
VIII. 34. b.
H E IM D A L L , (M y th o l. ) dieu des anciens Celtes fean-
dinaves ou des Goths. Diverfes fictions que ces peuples ra-
contoient fur ce dieu. Sens moral de ces fables. Auteur à confulter.
VIII. 98. a.
H E IS T E R , (L a u r en t ) III. 333. a. anatomifte, Suppl. I .
403. a. 8c phyfiologifte. Suppl. IV . 333-0.
HEKIM-EFFENDI , (H i ft .m o d .) premier médecin du
grand-feigneur. Comment il parle 8c tâte1e*pouls à une fultanc
malade.- VIII. 98. a.
H E L A , ( H ijl. anc. Mythol. ) déeffe de la mort félon les
Scandinaves. Détails fur cette déeffe. Etymologie du mot allemand
hell qui fignifie l’enfer. V I I I . 98. a.
H E LCO PH AG E S , vers , ( Médec. ) X V I I . 44. *.
H E L EN E , ( H iß . anc. ) fa beauté célébrée par les poètes.’
Euripide nous la repréfente vertueufe. Les Lacédémoniens
lui bâtirent un temple. Comment elle % mourut. Temple
que lui éleverent les Rhodiens. Panégyrique d’Hélene par
Ifocrate. Théodoret attaqua les païens pour avoir élevé des
temples à Hélène : réponfe que les païens auraient pu lui
faire. VIII. 98. b.
HéUne, ifle où Paris conduifit cette princeffe. IX. 83 8. lù
Son épithàlame. V . 819. b. Comment ces deux amans furent
feçus en Egypte. Suppl. II. 3®*- A Comment elle difli-
poit la mélancolie de Télemaque. XI. 96. a. Lieu où elle
accorda fes premières faveurs à Paris. X V . 439. L Epitres
d’Hélene àP â r is 8c de Paris à Hélene. Su pp l A V . 240. a.
Reproches d’Hélene à Pâris. 239. b. Sa mort tragique. Ibid.
Lieu de fa fépulture. X V I . 263. L
H é le n e , (G éo g r .a n c .) ifle de Grcce a 1 embouchure de
l’Eurotas.- Elle fe nomme aujourd’hui Spatara. C e fut dans
cette ifle qu’H élene accorda les faveurs a Paris. T emple que
Pâris éleva à Vénus fe r le rivage de la terre ferme qui elt
à l’oppofite. Statues que Ménélas plaça enfuite auprès de
la Venus de ce temple. Autres lieux nommés autrefois H é '
le n e .'V W l .r t .b . < f - c
H é le n e , Sa inte , (G é o g r .) ifle de la mer atlantique. Sa
defeription. Ses produRions. Découverte de cette ifle en 1302.
Divers maîtres qu’elle a eus. A utre ifle de ce »wim y lü .9 9 . a.
HÉLENE, ( Sainte) terrein brûlé de cette ifle. X V 11. 44®- a.
HÉLENE, (C a p S a in te ) dam rAménque minffionale;
obfervations d’hifloire naiurelie faites dam ce beu. Stippl. 111.
^HéLENE, racine de Sainte-(Botan. ) \ l i t 747-
Hé lene,m h to r e qui paroitfur mer. H. 755- »■ .
H E L E N 1V M A H i l l .a n c . Satan. ) la plante arofi nommee
par les modernes eft l’aunèe : voyc[ ce mot. Diofconde &
Théopbrafte ont nommé heleninm des plantes totalement
dlfféremesi I l paroît que l ’inula d Horace peut être 1 année
des modernes. Erreurs de Pline fur / htlcmum. VIII. 99. n.
HÉLÉNOPÜORIES., Wyr{ ElenopMor.es .
H E L E N U S , comment il confuhott la pierre qu Apollon
' “ ‘ hÉLÉPOLIi f 7(^rnni/ir. te H iß . ) machine des anciens
propre à battre les murailles d'une v iile affiégée. E t y™ 1^ 1«
L ee mot. Defeription de cettemachine & de celle dont Dè-
inétrius Poliorcète fe fervitau fiege de Rhod«- ^ ï ï ' i o ô a
d e fe r ip t io n de ces fortesde tours, par Végece. lbtd. 100.a.
H E LG E LAN D , ( Géog r.) ju riidàion & la Nonvege.
Avantages de cette province. Suppl. III. 319. e.