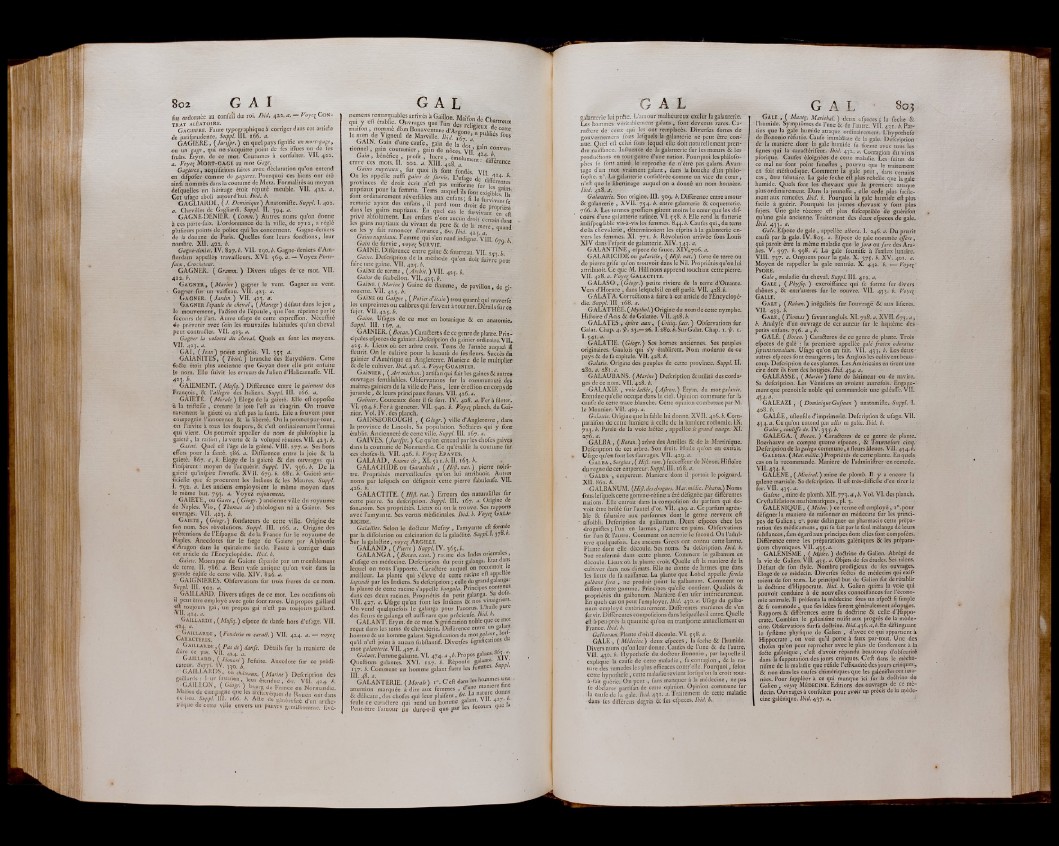
8 o 2 G A I G A L
fil* ordonnée au confcil du roi. Jbid. 421. a .— V jwwj C o n t
r a t aléatoire. . . .
G ageure. Faute typographique h corriger dans cet article
de juriiprudcnce. Suppl. î l l . 166. a.
G A G IER E , ( JuriJ'pr. ) en quel pays fignific un mort-gage,
ou un gage, qui ne s’acquitte point de les iffucs ou de fes
fruits. Etym. de ce mot. Coutumes à confulter. VII. 42a.
a. Voyc{ Mo r t -g a g e au mot Gage.
Gagieres, acquittions faites avec déclaration qu’on entend
en difpofer comme de gagieres. Pourquoi ces biens ont été
ainfi nommés dans la coutume de Metz. Formalités au moyen
defquellcs un héritage étoit réputé meuble. VII. 422. a.
C e t ufage aboli aujourd’hui. Ibid. b.
G AGLIA KD I, (/• Dominique) Anatomiftc. Suppl. 1. 402.
a. Chevilles de Gagliardi. Suppl. II. 394. a.
GAGNE-DENIER. ( Comm. ) Autres noms qu’on donne
à ces porte-faix. L’ordonnance de la ville, de 1 7 1 2 , a réglé
phificurs points de police qui les concernent. Gagnc-dcnicrs
de la douane de Paris. Quelles font leurs fonctions, leur
nombrç. XII. 422. b.
Gagne-denier. IV . 827. b. V II. 190. b. Gagne-deniets d’Am-
fterdam appcllép travailleurs. XV I. 569. a. — V o y e z Portefaix
, Croc licteur.
GAGNER. ( Gramm. ) Divers ufages de ce mot. VII.
422. b.
G a g n e r , ( Marine ) gagner le vent. Gagner au vent.
• Gagner fur un vaiffeau. v i l . 423. a.
G a g n e r . {Ja rd in .) VII. 423. a.
G a g n e r F épaule du cheval, ( Manège ) défaut dans le jeu ,
le mouvement, l’aélion de l’épaule, que l'on réprime parle
fccours de l’art. Autre ufage de cette exprcifion. Néceffné
do prévenir avec foin les mauvaifes habitudes qu’un cheval
peut contraéler. VII. 423. a.
Gagner la volonté du cheval. Quels en font les moyens.
VII. 423. *.
G A I , (J e a n ) poëte anglois. VI. 353 a.
GAIANITE S, ( Théol. ) branche des Eutychiens. Cette
fcéte ¿toit pins ancienne que Gayan dont elle prit enfuite
le nom. Elle fuivit les erreurs de Julien d’Halicarnafle. VII.
423. b.
GAIEMENT. ( Mufiq. ) Différence entre le gaiement des
François, & l’allegro des Italiens. Suppl. III. 106. a.
GAIETÉ. ( Morale ) Eloge de la gaieté. Elle cil oppofée
à la trifteffe, comme la jo ie l’eil au chagrin. On trouve
rarement la gaieté où n’eu pas la fanté. Elle a fou vent pour
compagnie l’innocence 8t la liberté. On la promet par-tout,
on l’invite h tous les foupers, & c’efl ordinairement l’ennui
qui vient. On pourrait appcller du nom de philofophie la
gaieté, là raifon, la vertu & la volupté réunies. V II. 423. b.
Gaieté. Quel cil l’âge de la gaieté. V I I I . 277. a. Scs bons
effets pour la fanté. 306. a. Différence entre la joie 8c la
gaieté. 867. a , b. Eloge de la gaieté & des ouvrages qui
l ’infpirent : moyen de l’acquérir. Suppl. IV . 396. b. De la
gaieté qu’infpirc l’ivreffc. XVII. 679. b. 681. ¿. Gaieté artificielle
que fe procurent les Indiens & les Maures. Suppl.
I. 792. a. Les anciens employoient le même moyen dans
le même but. 793. a. V o y e z enjouement.
G A IE T E , ou Gaete, ( Géogr. ) ancienne ville du royaume
de Naples. V io , ( Thomas d e ) théologien né à Gaiete. Ses
diivragêst VII. 423. b.
G a i e t e , {Géogr.) fondateurs de cette ville. Origine de
fon nom. Scs révolutions. Suppl. III. 166. a. Origine des
prétentions de l’Efpaene 8c delà France fur le royaume de
Naples. Anecdotes lur le fiege de Gaiete par Alphonfe
d ’Aragon dans le quinzième fiecle. Faute à corriger dans
cet article de l’Encyclopédie. Ibid. b.
Gaiete. Montagne de Gaiete feparée par un tremblement
de terre. II. 786? a. Beau vafe antique qu’on voit dans la
grande églife de cette ville. XIV. 826. a.
GAIGNIERES. Obfervations fur trois freres de ce nom.
Suppl. III. 502. a.
GAILLARD. Divers ufages de ce mot. Les occafions où
d peut ctre employé avec goût font rares. Un propos gaillard
•»toujours gai, un propos gai n’cfl pas toujours gaillard,
•vil. 424. a.
G a i l l a r d e , {Mufiq.) cfpcce de danfe hors d’ufage. VII.
jjjjgwf a.
G a i l l a r d e , {Fonderie en carafl.) VII. 424. a. — voyez
C a r a c t e r e s . 1 ' •
. G a i l l a r d e ( Pas d e) danfe. D é ta i l s fu r la m a n ie r e d e
fa i r e c e pas. V il. 4Î4.
LL.ann ’ k .H m m i ) Jefuite. Anecdote fur ce prédicateur.
suppi. iv. 510. e.
G A IL LA R D S , ou châteaux. ( Marine ) Dcfcription des
6’ r ï ? m G A 1L LO N , ( t(reoïgr.' ) *bou'rg cdned uFera> nce enU Nol r m4aMn-d ie%.
Madon de campagne une les archevêques de Rouen ont dans
ce heu Suppl. III. 166. b. Afin de généroftté d'un archevêque
de cette ville envers un pauvre gentilhomme. Evén
em e n s r em a r q u a b le s a r r iv é s iGaillon M.lfnnJ n t
qui y elt établie. Ouvrages que f f i U Î S S g Chartreux
mailon, nommé dom Bonaventurc d’Areone i v ? CCIte
le nom de Vignenl de Marville. ih y , % a fdus
G AIN. Gain d’une cattfe, gain de la dot « ■
tionncl, gain coutumier, gain dé nôces. V il’ “ n« n -
G a in , bénéfice , profit, lucre . Émâunio'S^TqS
entre ces mots. II. aoa. e. XIII. 418. a. ' dlffi!rence
Gains nuptiaux, fur quoi Ils font fondés VII
•n le s n n n e lle nhiTi aminé a . r.. n r . **• •
provinces de droit écrit „ 'eli pas „„¡forme fur les „ ë ?
nuptiaux pour la fcm m cT c u is auquel Ils font exigible! ïï
font ordinairement révcrfibles aux enfans; fi le f f i s S i*
remane ayant des ehfans, ¡1 perd tour droit de S I
dans ies gains nuptiaux. En quel cas le furvivant en cft
privé abfolument. Les cnfàns o’ont aucun droit certain dan.
les gains nuptiaux du vivant du pere & de la mere ttuaud
on les y fait renoncer d’avance, 6-c. Ibid. 42«. a. *
Gains nuptiaux. Femme qui s’en rend indigne. VIII, 670 b
Gain de fu rv ie , voye[ Su r v ie . ’ *
GAINE. Différence entre gaine & fourreau. VII %
p Gatne- Defcription de la méthode qu’ori doit fuivre oôur
faire une gaine. V II. 4 2 5 . b. r
G aine de terme, (Ar chit. ) V II. 4 2 3. b.
Gaine de fcabcllon. VII. 423. b.
G h i s e ¡M a r in e ) Gaine de flamme, de pavillon, de ei-
rouette. VII. 425. b. °
G aine ou Gaigne, ( Potier d'étain ) trou quarré qui traverfe
les empreintes ou calibres qui fervent à tourner. Détails fur c
fujet. VII. 423.
Game. Ufages de ce mot en botanique & en anatomie.
h. III. 167. a.
GAINIER. (B o ta n .) Caraétcrcs de ce genre de plante. Principales
Sup^fh
ejpeccs de gaînier. Dcfcription du gaînier ordinaire.VII.
423. b. Lieux où cet arbre croît. Tems de l’année auquel il
fleurit. On le cultive pour la beauté de fes fleurs. Succès du
gainier d’Amérique en Angleterre. Manière de le multiplier
8c de le cultiver. Ibid. 426. a. Vbyeç G uainier.
G a î n i e r , ( A r t mcchan.) artilan qui fait les gaines & autres
ouvrages Semblables. Obfervations fur la communauté des
maîtres gainiers de la ville de Paris, leur ércétion en corps de
jurande, & leurs principaux flaturs. VII. 426. a.
Gaînier. Couteaux dont il fe fert. IV. 408. a. Fer h fileter.
V I. 504. b. Fer h greneter. VII. 940. b. Voyt{ planch. du Gaî;
nier. V o l. IV . des planch.
GAINSBOROUGH , ( Géogr. ) ville d’Angleterre , dans
la province de Lincoln. Sa population. Seétaircs qui y font
établis. Ancienneté de cette ville. Suppl. III. 167. a.
G AIVES. (Jurifpr. ) Ce qu’on entend par les chofcs gaives
dans la coutume de Normandie. Ce qu’établit la coutume fur
ces chofcs-là. VII. 426. b. Vdyc[ E p a v e s .
G A L A A D , baume d e , XÎ. 511. ¿.II. 16 “) . b.
G A LA CH ID E ou Garachide , ( Hift. nat. ) pierre noirâtre.
Propriétés merveillcufes qu’on lui attribuoit. Autres
noms par lcfqucls on défignoit cette pierre fabuleufe. VIL
426. b.
G A LA C T IT E . {H iß . n a t.) Erreurs des naturalises fur
cette pierre. Sa dcfcription. Suppl. III. 167. a. Origine de
fon.nom. Scs propriétés. Lieux où on la trouve. Ses rapports
avec l’amyante. Ses vertus médicinales. Ibid. b. Voyc{ G a l a -
RICIDE. 1
Galaflite. Selon le doélcur M c fn y , l’amyante cil for^è®
par la diffolution ou calcination de lagalaélite. Suppl. I- 370. b.
Sur lagalaélite, voyez A rgille.
G A LAN D , {Pie rr e) Suppl. IV. 36<.L.
G A LAN G A , {Botan. exot. ) racine des Indes orientales,
d’ufage en médecine. Dcfcription du petit galanga. Etat dans
lequel on nous l’apporte. Caraélcrc auquel on reconnoit le
meilleur. La plante qui s’élève de cette racine eil appellce
lagundi par les Indiens. Sa defcription ; c e lle du grand galanga-
la plante de cette racine s’appelle bangula. Principes contenus
dans ces deux racines. Propriétés du petit galanga. Sa doie.
VII. 427. a. Ufage qu’en font les Indiens & nos vinaigriers.
On vend quelquefois le galanga pour l’acorus. L’huile pure
des fleurs degalanga cilauflirare que précicufe. Jbid. b.
G A LAN T . Etym. de ce mot. Signification noble que ce mot
reçut dans les .tems de chevalerie. Différence entre un galant
homme 8c un homme galant. Signification du mot g<ydnj »lor.J
qu’il n’cfl joint à aucun fubflantif. Divcrfes figninçations
mot galanterie. V II. 427. b.
Galant. Femme galante. VI. 474. a , b. Propos galans. Y• •
Queflions galantes. X V I . 127. b. iiépoiife galante. *
137. b. Comment un homme galant flatte les rcmnic . py •
1 GALANTERIE, ( M o ra l,) i». C ’nlt dans I« ho*"™« “|5 '
attention marquée à dire aux femmes , d ''nC donne
8c délicate, des chofcs qui leur plaifcnr, 6rc. La
feule ce caraélcrc qui rend un homme ßala”i' v ‘ 4 J " . '
Peut-être l’amour ne durc-t-il que par l*s *ccou ^
G A L
gaîantérie lui prête. L’ainour malhcurèux exclût la galanterie.
Les hommes véritablement galans, font devenus rares. Ca-1
raélcrc de ceux qui les ont remplacés. Divcrfes fortes de
gouvernemens fous lcfqucls la galanterie ne peut être connue.
Quel efl celui fous lequel elle doit naturellement prendre
naiffancc. Influence de la galanterie fur les moeurs & les
produélioiis en tout genre d’une nation. Pourquoi les philofo-
phes fe font attiré le reproche de n’être pas galans. Avan- •
tage d’un mot vraiment galant, dans la bouche d’un philo-
fophe. 20. La galanterie confidérée comme un vice du coeur,
n’efl que le libertinage auquel on a donné un nom honnête.
Ibid. 428. a.
Galanterie. Son origine. III. 309. b. Différence entre amour
& galanterie , XVII. 734. b. entre galanterie & coquetterie.
766. b. Les termes grofners gâtent moins le coeur que les discours
d’une galanterie rafinée. V I. 558. b. Elle rend la flatterie
indifpcufabic vis-à-vis les femmes. 844^. Caufcs qui, du tems
de la chevalerie, déterminoient les efprits à la galanterie envers
les femmes. XI. 7 7 1 . b. Révolution arrivée fous Louis
X IV dans l’efprit de galanterie. XIV. 343. a.
G A LAN T IN E , etpccc de faucc. X IV .706. a.
GALARICIDE ou galariéle, ( Hifl. n a t.) forte de terre ou
de pierre grife qu’on trouvoit dans le Nil. Propriétés qu’on lui
attribuoit. C e que M. Hill nous apprend touchant cette pierre.
VII. 428. a. Voye^ G A L A C T IT E .
G A LA SO , {Géogr.) petite rivicre de la terre d’Otrante.
Vers d’Horacc , dans lcfqucls il en efl parlé. VII. 428. b.
G A LA T A . Correélions à faire à cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III 168. a.
GALATHÉE. (Mythol. ) Origine du nom de cette nymphe.
Hiiloire d’Acis & de Galatée. VII. 428. b.
G A L A T E S , épitre a u x , {Critiq. fa c r .) Obfervations fur
Galat. Chap. 4. ÿ . 2 3 .-2 6 .1. 280.¿.SurGalat. Chap. i . ÿ . 1.
■ r
GALATIE. (Géogr.) Scs bornes anciennes. Ses peuples
originaires. Gaulois qui s’y établirent. Nom moderne de ce
pays & de fa capitale. VII. 428. b.
Gala tic. Origine des peuples de cette province. Suppl. II.
280. a. 281. a.
GALAUBANS. (Marine) Defcription & utilité des cordages
de ce nom. V II. 428. b.
GALAXIE , voie laflée, ( Afiron. ) Etym. du mot galaxie.
Etendue qu’elle occupe dans le ciel. Opinion commune fur la
■eaiife de cette trace blanche. Cette opinion combattue par M.
le Monnier. VII. 429. a.
Galaxie. Origine que la fable lui donne. XVII. 416. b. Com-
paraifon de cette lumicre à celle de la lumière zodiacale. IX.
723.^. Partie de la voie laélée , appcllcc le grand nuage. XI.
270. a.
G A L B A , (Bota n.) arbre des Antilles 8c de la Martinique.
Dcfcription de cet arbre. Son fruit. Huile qu’on en extrait.
Ufage qu’en font les fauvages. VII. 429. a.
G a l b a , Sergius ,(H i f l. rom.) fucceffeur de Néron. Hifloire
du regne de cet empereur. Suppl. 111.168. a.
G a l b a , empereur. Maniéré dont il portoit le poignard.
XII. 862. b.
GALBANUM. (Hifl.desdrogues. Mat.médic. Pharmi) Noms
fous lcfquels cette gommc-réfine a été défignéc par différentes
nations. Elle entrait dans la compofition du parfum qui devoir
être brûlé fur l’autel d’or. V il. 429. a. Ce parfum agréable
& falutairc aux perfonnes dont le genre nerveux cil
• affoibli. Defcription du galbanum. Deux efpeces chez les
droguiftes ; l’un en larmes, l’autre en pains. Obfervations
fur l’un & l’autre. Comment on nettoie le lccond. On l’adul-
tere quelquefois. Les anciens Grecs ont connu cette larme.
Plante dont elle découle. Ses noms. Sa defcription. Ibid. b.
Suc renfermé dans cette plante. Comment le galbanum en
découle. Lieux où la plante croit. Quelle efl la maniéré de la
cultiver dans nos climats. Elle ne donne de larmes que dans
les lieux de fa naiffance. La plante que Lobel appelle ferula
galbant fera , ne produit point le galbanum. Comment on
diffout cette gomme. Principes qu’elle contient. Qualités &
propriétés du galbanum.. Maniéré d’en ufer intérieurement.
En quels cas on peut l’employer. Ibid. 430. a. Ufage du galbanum
employé extérieurement. Différentes manières de s’en
fervir. Différentes coinpofitions dans lefqucllcsil entre. Quelle
cil à-peu-pres la quantité qu’on en tranfporte annuellement en
France. Ibid. b.
Galbanum.Plante d’o iiil découle. VI. 338.a.
G A L E , ( Médecine ) deux efpcces, la feche & l’humide.
Divers noms qu’on leur donne. Caufcs de l’une & de l’autre.
VII. 430. b. Hypothcfe du doélcur Bononio , par laquelle il
explique la cauie de cette maladie , fa contagion , 8c la nature
dés remedes les plus efficaces contr’cllc. Pourquoi, félon
cette hypothefc, cette maladie revient lorfqu’on la croit tout-
à-fait guérie. On peut , fans manquer à la médecine, ne pas
ic déclarer partifan de cette opinion. Opinion commune fur
la caufe de la gale. Ibid. 431. a. Traitement de cette maladie
dans fes différons degrés & fes efpeces. Ibid. b.
G A L fjgj
l | | f i | ’ £ Maneg. Maréchal. ) d e u x e fp e c e s } la feche &
1 humide. Symptômes de l’une & de l’autre. VII, 431. b. Par-
ties* que la gale humide attaque ordinairement. L’hyporhefe
de Bononio réfutée. Caufe immédiate de la gale. Defcription
de la maniéré dont la gale humide fe forme avec tous les
fignes qui la caraélérifent. Ibid. 43a. a. Contagion du virus
piorique. Caufcs éloignées de cette maladie. Les fuites de
ce mal ne font point funeiles , pourvu que le traitement
en foit méthodique. Comment la gale peu t, dans certains
cas, être falutairc. La gale feche elt plus rebelle que la gale
humide. Quels font les chevaux que Ja première attaque
plus ordinairement. Dans la jeuneiïe , elle cede. plus facilement
aux remedes. Ibid. b. Pourquoi la gale humide cil plus
facile à guérir. Pourquoi les jeunes chevaux y font plus
fujets. Une gale récente eft plus fufceptible de guérifon
au’une gale ancienne. Traitement des deux c/peccs-de gale.
Ibid. 433. a.
Gale. Efpece de eale, appellée albora. I. 246. a. Du prurit
caufé par Ja gale. l v . 803. a. Efpece de gale nommée ejfere,
qui paraît être la même maladie que le Jora ou fare des Arabes.
V . 997. b. 998. d. La eale foumife à l’infiux lunaire.
VIII. 737. a. Onguens pour Ta gale. X. 375. b. XV . 401. a.
Moyen de rappeller la gale rentrée. X. 442. b. — Voye^
P s o r e .
G a le , maladie du cheval. Suppl. III. 412. a.
G a l e , ( Phyfiq. ) excroiffance qui fe forme fur divers
chênes, 8c entr’autres fur le rouvre. VII. 433. b. Voyc{
G a l l e .
G a l e , (R u b an .) inégalités fur l’ouvrage & aux lifieres.
VII. 433. b.
G a l e , ( Thomas ) favant anglois. XI. 728. a. XVII. 673. a ,
b. Analyfe d’un ouvrage de cet auteur fur le baptême des
petits enfans. 73 6. a +b.
GALÉ. ( B ota n .) Caraéleres d e ce genre de plante. Trois
efpcces de galé : la première appellcc gale frutex odoratus
fcpuntrionaltum. Ufage qu’on en fait. VII. 433. b. Les deux:-
autres efpcces font étrangères ; les Anglois les cultivent beau- ■
coup. Dcfcription de ces plantes. Les Américains en tirent une
cire dont iis font des bougies. Ibid. 434. a,
GALÉASSE, (M a r in e ) forte de bâtiment ou de navire.
Sa defcription. Les Vénitiens en aVoient autrefois. Engage-'
ment que prenoit le noble qui commandoit une galéaffe. VII.
434. a.
GALEAZI , ( Dominique-Gufman ) anatomiilc. Suppl. 1.
408. b.
G A LÉE, ufienfilc d’imprimerie. Defcription 8c ufage. V II.
434. a. Ce qu’on entend par aller en galée. Ibid. b.
C a lé e , coulijfe de. IV. 33q.b.
GALEGA. ( Botan. ) Caraéleres de c e genre de plante.'
Boerhaave en compte quatre eipcccs, & Tournefort cinq.
Defcription de la galega commune, à fleurs bleues. VII. 434. b.
G a l e g a . (Mat.médic.) Propriétés de cette niante. En quels
cas on la recommande. Maniéré de l’adminiftrer -en remede.
VII. 434.^
GALENE, (Minéral.) mine de plomb. Il y a encore la
galène martiale. Sa defcription. Il cil très-difficile d’en tirer le
fer. V II. 433. a.
Galene , mine de plomb. XII. 773,a ,b . Vol. V I. des planch.
Cryftallifations mathématiques, pl. 3.
GALENIQUE, ( Médec. ) ce terme eft employé, i°. pour
défigner la manière de raifonner en médecine fur les principes
de Galicn ; 2°. pour diftinguer en pharmacie cette préparation
des médicamens, qui fe fait par le fcul mélange de leurs
fubftances, fans égard aux principes dont elles font compofées.
Différence entre les préparations, galéniques & les préparations
chymiques. VII. 43 3. a.
GALENIoME , (M fd ec . ) do&rine de Galien. Abrégé de
la vie de Galien. V il. 43 3. a. Objets de fes études. Ses talens.
Défaut de fon ftyle. Nombre prodigieux de fes ouvrages.
Eloge de ce médecin. Divcrfes feâcs de médecins qui exif*
toient de fon tems. Le principal but de Galicn fur de rétablir
la doélrine d’Hippocrate. Ibid. b. Galien quitta la voie qui
poùvoit conduire à de nouvelles connoiffances fur l’économie
animale. Il préfenta la médecine fous un afpeâ fi fimple
& fi commode, que fes idées furent généralement adoptes.
Rapports & différences entre fa doélrine & celle d’^lippo-
crate. Combien le galénifme nuifit aux progrès de la médecine.
Obfervations fur fa doélrine. Ibid. 4^6. a, ¿.En diftinguant
le fyftême phyfique de Galien , d’avec ce qui appartient à
Hippocrate , on voit qu’il porte à feux par-tout. Une des
chofes qu’on peut reprocher avec le plus de fondement à la
feéle galéniquc, c’cft d’avoir répandu beaucoup d’obfcurité
dans la Amputation des jours critiques. C ’cft dans le média-
nifmc de la maladie que réfidc l’emcacité des jours critiques,
& non dans les caufes chimériques que les galéniftes ont ima-
nées. Pour fuppléer à ce qui manque ici lur la doélrine de
Galien , voye^ M é d e c in e . Editions des ouvrages de ce médecin.
Ouvrages à confulter pour avoir un précis de la njède-
cinc galénique. Ibid. 437. a.