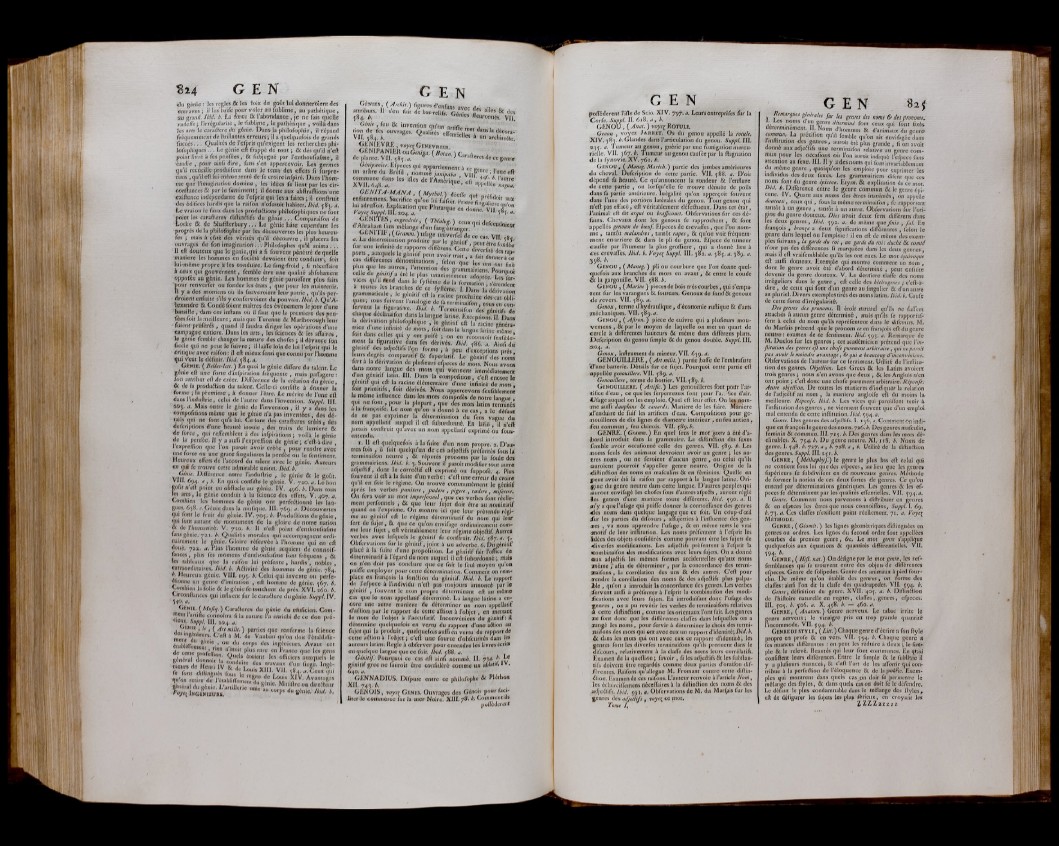
$14 G E N G E N
<ht génie : les réglés fit les loi* du goût lui donneraient des
entraves ; il les nrifè pour voler au Aiblime, au pathétique,
au grand, Ibid, h, La farce fit l'abondance, je ne fais quelle
rnaefib} l'irrégularité* le fublmie » le pathétique , voila dans
les arts le caraélere du génie. Dans la philofophie , il répand
fréquentrhent de brillantes erreurs « il a quelquefois de grands
fuccé*» >; , » . * v Qualités ua,,w* de *Fêfôrit g’i . qu'exigent " tes les rccuercnes recherches phi'
jmt'
In/nnltlmij». I .f» 0t*M6 é*(r tfann^ fit* .Aiat i «/ y|2c
lofojdiiques, , , Le génie eA frappé de tout ; fie dès qu'il n’cA
point livré à fes p sn fé e s , fit fuhjugué par l'enthouuaftne. lafti
il
étudie , pour ainA dire, fans s'en appercevoir, Les germes
emnic wml uirc,wra 9 en appcrccvotr«L/CS germe*
qu'il recneille recueille produifent dans le tems des effets A turpre-furpre-
nans. ou’il eff lui-même tenté de fe croire infni ré. Dm«« l’kAmluece
nans,qu’il eA infpiré,Dans l’homme
nue l'imagination domine , les idées fe lient par les cir-
conffancesfit par le femimentj il donne aux abAraélions une
exiAenceindépendante de Pefpritqui lésa faites} il ceoAruit
des édifices hardis que la raifon n'oferoit habiter, Ibid, dm, a.
Le vrai ou le faux dans les nroduélions nlulofqiihiques ne font
point les caraéierc* diAiimifs du gétuc . , , Comparaifon de
Locke fit de SbafAerbury, . . Le génie hite cependant les
progrès de la pbilofophie par les découvertes les plus lieureu-
fes ; mais h côté des vérités qu'il découvre, il placera les
ouvrages de fon imagination. . . Philofbpbes qu’il an im a ...
Il cA douteux que le génie, nui a A fou vent pénétré de quelle
maniéré les hommes en foctété devoient être conduits -, foit
lui-même propre k les conduire, Le fsng-frold , A néceffaire
h ceux qui gouvernent, femble être une qualité ahfolument
oppofée au génie. Les hommes de génie paroiffenr plus faits
pour renverfer ou fonder les états, que pour les maintenir,
il y a des moniens oh ils fauveroient leur patrie, qu’ils per-
droient en fuite s'ils yconfcrvoicnt du pouvoir, Ibid, b, Q n'A-
lexandre fit Coudé (oient maîtres des événemens le jour d’une
oxraiiie, dans ces inAans où il faut que la première des peu-
fées foit la meilleure} mais que Turenne fit Marlborough leur
fuient-préférés, quand il faudra diriger les opérations d’une
campagne enflera. Dans les arts, les feiences fié les affaires,
le génie femble changer la nature des chofes} il dévance fon
ftecle qui ne peut le fuivre} il lai (Te loin de lui 1 efprit qui le
critique avec raifon ; il eA mieux fenti que connu par l'Iiomme
qui Veut te déAuir, Ibid, $ 4 .0 ,
Géw«, ( I ie lle t- le iiA En quoi le génie différé du talent. Le
génie eA une forte dwpiratlon fréquente , mais partagera ;
ion attribut eff d e créer, Différence de la création du génie
fit de la nroduftïon du talent. Celle-ci conffAe à donner la
forme } fa pfcmlere , k donner l’être. Le mérite de l'une eA
dans l’induArie, celui de l’antre dan* l’Invention, Suppl, III,
003, a. Mais outre le génie de l'invention , il y a dans les
eqmpofitions même que le génie n'a pas inventées, des détails
qui ne font qu’a lui, C e (ont des caraélcres créés, des
defcrqtflons « d’une •» ...... beauté inouïe,iiK.mw , des MB» iraittraits » ae de tumiere Jnmiere oc
fic
-de force . oui relleinhlent h At>s In/ntmiÎA.» , i„
«e force , qui reffemblenr à des Infpiroflons ; voilà le génie
de la penfée, Il y a auffi l'expreflion de g énie} c ’eA-àdira,
I expreiïion que l'on paraît avoir créée . pour rendre avec
une force ou une grâce fingulieres la penfée ou le fentiment,
Heureux effets de l’accord du talent avec le génie. Auteurs
en qui fe trouve cette admira Me union, Ibid, b,
i n n S ' D ' ft6rence entre l'induArie . le génie fie le goût,
V fyf' a l ^ ffAoi conAAe le génie, V , 7»©, n, Le bon
goût n’eA point un onAacle au génie, IV. 490, b. Dans tous
les arts, le génie conduit à la fcience des effets, V , 407, n,
Combien les hommes de génie ont perfectionné les langues,
A38, e, Génie.dans la muftque, 111,7^9, a, Découvertes
qui font le fruit dp génie, IV , 703, b, Produirions du génie,
nui font autant de monumens de la gloire de notre nation
fit de l'humanité. V , 7*0, b, Il n'eA point d’enthonfiafme
(ans génie. 7 * * . b, Qualités morales qui accompagnent ordinairement
le génie, Gloire réfeivée à l'homme qui en eA
doué, 72a, a, rlu6 l’Iiomme de génie acquiert de eonnoif-
fances, plus fes inomens d'enthoufiafme font fréquent , fié
les tableaux que la raifon lui préfente * hardis, nobles,
extraordinaires. Ibid, b, Aélivité des hommes de génie. 784.
b. Heureux génie, VIII, 195, b, Celui qui invente on perfectionne
un genre d'imitation , «A homme de génie. <¿7, b.
Combien la folie fié le génie fe touchent de prés, XV I, ado, b,
GirconAances qui influent fur le caraélere du génie, Suppl, IV, 340, a, ■ v r r
Gêjjigi ( Mufiq, ) Caroéleres du génie du nfuAcien. Comment
larrifte connoltra A la nature l’a enrichi de ce don pré-
«eux» Suppl, III, *04, a. 1
S i ( j r tm U h , ) parties que renferme -la fcience
menf1 /*; ù de Vauhan qu'on doit rétabliffèétabliffenitîf,
’ P f i c<îrps ^e6 Î t t S S l P Avant cet
de cette n étoir plus rare en v rance que les gens
général tL n n n h* !' fitoicstt les officiers auxquels le
« Ü B « . r | | u S t e r 9" *® 11
a..rd ,u ,, h \ en u S “ G é S 1 1 ai,' ‘ & p
384, b. ren ies ffeuronnés. VIL
Génie , feu fie invention qu'un m 1
ziXTuvr^ Æ •«tet' ïÆsr
déniante, V IL 583, a. •witeres de ce genre
(iénipan'ter, Efpeces qui appartiennent h «
un nrlire du H ,k l , ndmml/¿»l/wi,, v f l P ' w eli
a s ies ines 1 |,a^». I l l i i
O E N I T A -M A N A , ( M v th o l\ m a 'm ,
enfanremens. Sacrifice qn'ou lui ¿ fo i ,. |,,ier^
“ S f t l “’ |1 W""^e É d"J ||“7ÏÏ
univcrfel de ce c» . VII ,8 ,
a. l a diiermination produite par le cénliif , JW*
fur une Inimité de rapuort, dlfféren»?Celte' , |S|U II ,
ca. différent«, dénomfnsilons, félon que le. un. ont ifixé
plus que les autres, Iattention des grammairien«! j
e .lle de i«w(//a été le plu» unaniniÆieut adoptée, Le» fer-
v ie « tpid nmd dan» le fyrtéme de la form.tlon ¡,’émi£
| ,m" “ , lc,‘ '"■fuiltM de ee fyfléme. I, la dé r iv a tif
grammaticale, le génitif eft la racine prochaine de» cas olill-
«11«, ton» fulvcnr I analogie de fa terniinalfon, 10111 en eon-
fervent a igurauve, é. Terminaifnn d k géndif. da
cliaque décllnaifon dane la langue latine. Exception., II, Dan.
la dérivation pliilofopluque , °e génliif eft la racine généra-
î î t e f W ® de ma,i, f i l dan» la langue lutine même,
folt dan» celle« qui y ont pulfé j on en reconnolt fenfilileô
in V f? i‘.»8S ' f e i i ! " s V dériv4*’ / iw ' I*«, n, Ainfi du
génitif de» adjeilif» Ion forme , h peu d'exception, pré«.
H ® B B i fuperlatlt. Le génitif de. nom.
fert a la dérivation de jffnAeurs efpeces de mots, Nous avons
dans notre; langue des mots qui viennent immédiatement
d un gcninf latin. III, Dans la compofition, c'eA encore le
genuit qui eA la racine élémentaire d'une infinité de mors
foit primitifs, foit dérivés. Nous appcrcevons fenfiblement
la même influence dans les mots compofés de notre langue
oui ne fo n t , pour la plupart, que des mots latins terminés
a la françoife, Le nom qu’on a donné à ce cas a le défaut
de ne pas exprimer la détermination du fens vague du
nom appellatif auquel il eA fubordonné. En latin ,1 1 n'eA
jamais conflruit qu avec un nom appellatif exprimé ou fous-
entendu.
i. Il eA quelquefois h la fuite d’un nom propre, », D’au«
très fo i s . U fuit quelqu’un de cet adjeéllfs préfentés fous là
terminaifon neutre , fié réputés pronoms par la foule des
grammairiens, Ibid. b, 3, Souvent il paroit modifier tout autre
adjeélif, dont le corrcélif eA exprimé ou fuppofé, 4. Plus
fouvent il eA à la fuite d’un verbe ; c’eA une erreur de croire
qu’il en foit le régime. On trouve communément le génitif
après les verbes paniiere, pudtre , p ip r e , tadere, mUertre,
On fera voir an mot unpirfonntl, que ces verbes font réellê"
ment perfonnels , fie que leur fujet doit être au nominatif
quand on l'exprime. On montre ici que leur prétendu régime
au génitif eA le régime déterminatif du nom qui leur
fert de fujer, fit que ce qu'on envifage ordinairement comme
leur fu je t , eA véritablement leur régime objeélif, Autres
verbes avec lefquel* le génitif fe conflruit, Ibid. <87, a. 3.
Obfervaiions fur le génitif, joint à un adverbe. 6, Diigéniiif
placé à la fuite d’une propofnion. Le génitif fait l'office de
déterminatif à l’égard dimom auquel il eA fubordonné} mais
on n’en doit pas conclure que ce folt le feul moyen qu’on
puiffe emjdoyer pour cette détermination, Comment on remplace
en frsnçoi* la fonélion du génitif. Ibid, b. Le rapport
de l’efpece à l’individu n’eA pas toujours annoncé par ie
génitif , fouvent le nom propre déterminant eff au même
cas que le nom appellatif déterminé, La langue latine, a encore
une autre maniéré de déterminer un nom ajipellatif
d’aélion par le rapport de cette aftion à l’o b jet, en mettant
le nom de l'objet à l'accufatif, Inconvéniens du génitif: U
détermine quelquefois en vertu du rapport d'une aÂion au
fujet qui la produit, quelquefois aufli en vertu du rapport de
ce t te aélion à l'objet ; c'eA une iourte d'obfcurités dans les
auteurs latine. Réglé à obferver pour entendre les livre» écrite
en quelque langue que ce folt, Ibid, <88, a,
Génitif. Pourquoi ce cas eA ainu nommé. II. 7M/11' } f ?
génitif grec ne fauroit être confldéré comme un aWanf. IV.
04 Oi u,
GENNADIUS, Dlftmoe cmre c« [ililloftinlio & Pléihon HHli , - ,
G EN O IS , voyer GtiNtte, Ouvrages des Génois pour faciliter
le commerce fur la mer Noire. XIII. 78» b, (ànnincnti
pofféderm
G E N
pofféderent l’iffe de Scio. XIV. t y f . h, Leut» entreprifet Air la
Corfe, Suppl. IL O18, //, b.
GENOU , ( Anat. ) voyt{ R o t v l i i .
Genou , voyer. / a iik e t. Os du genou appellé lit rotule.
X IV . 383. b, Glandes dans l'articulation du genou. Suppl. III.
»3 y a. Tumeur au genou, guérie par une fumigation itierctt-
TÎeile, VIL 367, b, Tumeur au genou Caufée par la Aagnation
«Je la fy n o v i e ,X V .y é i , b.
(.if.n o m , (Maneg,Muréc/i.) partie des jambes antérieures
du cheval, Defcription de cette partie. VIL 388, a. D'où
dépend fa beauté. Ce qu’annoncent la rondeur fie l'enflure
de cette partie , 011 lorfqii’elle fe trouve dénuée de poils
dans fa partie antérieure. Inégalité qu'on apperçoit fouvent
dans l'une des portions latérales du genou. Tout genou qui
n'eA pas effacé, eA véritablement défectueux. Dans cet é tat,
l ’animal eA dit arqué ou brafficourt. Obfervations fur Ces défauts.
Chevaux dont les genoux fe rapprochent, fie font
appellé» p n o u x de boeuf. Efpeces de crevaffes, que l’on nomme
, tantôt malandret, tantôt râpes, fie qu’on voit fréquemment
en-arriere fie dans ie pli du genou, Efpece de tumeur
caufée par l'humeur la plus grofficre, qui a donné lieu à
ces crevaffes. Ibid. b, Voye[ Suppl, III. 382. a, 383. a. 389, a.
398, b.
G en o u , f Maneg. ) pli ou courbure que l'on donne quelquefois
aux branches du mors en avant, fie entre le coude
fie la gargouille. V IL 388. b,
G en o u , ( Marine ) pièces de bois trés courhes, qui s'empâtent
fur les varangues fie fourcats, Genoux de fond fie genoux
de revers. VIL 389. a,
Genou, terme d'hydraulique, d'économie ruAique fie d'arts
tnéchaniques. VII. 380,1t.
G e n o u . ( Aflron, ) piece de cuivre qui a pluffeurs mouv
em e n t , fie par le moyen de laquelle on met un quart de
cercle à différentes hauteurs fie même dans différens plans.
Defcription du genou Ample fie du genou double. Suppl, III.
¿104. a.
Genou, InArument du mineur. V II. (n o . a.
GENOUILLERE. ( Ar t rnilit. ) partie baffe de l'embrafiife
'd'une batterie. Détails fur ce fujet. Pourquoi cette partie eA
fljtpcllée genouillère, VII. 389. a.
Genouillère, terme de bottier. VII, 389, b.
G e n o u i llè r e . ( Artiflc. ) L e t genouillères fbnt pour l’artifice
d'eau, ce que les ferpenteàux font pour l'a. /Ace d’air.
Affage auquel on les emploie. Quel eA leur effet. On les nomme
auffi dauphins fic canards, Maniéré de les faire, Manière
d'enduire de fuif les arfiflecs d'eau. Compofitions pour gc-
mouilleres de dix lignes de diamètre intérieur, en feu ancien,
(feu commun , feu chinois. VII. 389. b,
GENRE, ÇGramm. ) En quel fens le mot genre A été d'a-
Lord introduit dans la grammaire. La diAinction des fexes
iemble avoir occaffonné celle des genres, VIL 389. b. Les
moms fctils des animaux devraient avoir un genre } les autres
noms, ou ne feraient d'aucun genre, ou celui qu'ils
auraient pourrait s’appeller genre neutre. Origine de la
diffinélion des noms en mafeuhns fi1 en féminins. Quelle on
tient avoir été là raifon par rapport à la langue latine. Origine
du genre neutre dans cette langue, D'autres peuples qui
ouïront envifagé les chofes fous d'autres afpeéls, auront réglé
le s genres d une manière tome différente. Ibid, 390. a. Il
m'y a que l'ufage qui puiffe donner la connoiffance des genres
d e s noms dans quelque langage que ce foit. Un coup-d'oeil
dur les parties du diicours, auiijetrics à l'influence des genres
, va nous apprendre l'ufage , fie eu même tems le vrai
•motif de leur inflitmion. Les noms préfentent à l'efprit les
Idées des objets confidérés comme pouvant être les fujets de
diverfes modifications. Les adjeélirs préfentent à l’efprit 1a
Kombinnifon des modifications avec leurs fujets. Ou a donné
«ux adjeélifs les mêmes formes accidentelles qu'aux noms
même / afin de déterminer, par la concordance des tenni-
¡naifons, la corrélation des uns fit des uiitres, C'eA pour
¡rendre la corrélation des noms fit des adjeélifs plus palpable
, qu'on n introduit la concordance des genres, Les verbes
fe r v en t auffi k préfenter k l’efprit la combinaifon des modifications
avec leurs fuiets. Eu introduiront donc l'ufage des
genres, on a pu revêtir les verbes de terminaifons relatives
a cette diAinétion . comme les orientaux l'ont fait. Les genres
ne font donc que fes différentes claffes dans lefnuelles 011 n
¿rangé les noms, pour fervir à déterminer le choix des terminaifons
des mots qui ont avec eux un rapport d'identité} Ibid. b,
fit dans les mots qui ont avec eux c e rapport d'identité, les
Senres font les diverfes terminaifons qu ils prennent dans le
ifeours, relativement à la clnffe des noms leurs corrélatif)).
Examen de lu qiieAion} favolr , A les adjeélifs fit les fuhAan-
tifs doivent être regardés comme deux parties d'oraifon différentes.
Rnifons qu'allégué M. Pramnnr contre cette diflin-
élion, Examen de ces raifons. L'auteur renvoie à l'article Nom ,
les édaù cifl'einens tléccffnires à la diflinélion des noms fit des
jtdjeélifs. Ibid, 301, a, Obfervations de M. du Marffds fur les
genres des odjeflijï , voy<i ce mot.
Tome /,
G E N 821
f I IH I I h I f ur h . gtnrti d u nomi &• des pronome.
B I S m l ” rè d lu m M déterminémont. IL léom. df!,0„,meIs &I |« $" *OE P i f oAnl t fixé, sm L- réa,w" ü£ Sll 1 »f®®
il/! I r s t f " ™ ■ aurÎ ' M P'»« S '^ llc , fi «I «volt
donné aux sd/eélil. une terminaifon relative au «cnre commun
pour le» oeçafion, où l'on auroit Indiniié lU c c e fan,
attention au fexc. III. Il y a de» nom» qui font invariablement
<1U même genre , quoiqu’on les emploie pour exprimer les
individus des deux fexes. Les grammairiens dilent que ce»
noms font du genre ¿picene. Etym. fit explication de ce mot.
Ibid. b. Différence entre le genre commun fit le genre épi-
ccnc, IV. Quant aux noms des êtres inanimés, on appelle
douteux, ceux q u i, fous la même terminaifon, fe rapportent
tantôt à un genre , tantôt à un autre, Obfervations fur l'origine
du genre douteux, Dies avoir deux fens différens d ans
les deux genres, Ibid, 39», a, de même que f in i s , (al. En
français , bronze a deux AgniAcations différentes, félon le
genre dans lequel on l’emjiloie : il en cA de même des exemples
fui vans, la garde du r o i , un garde du roi: duché fit comté
n ont pas des différences A marquée» dans les deux genres,
mais il eA vraifemblable qu’il« les ont eues, Le mot équivoque
eA auffi douteux. Exemple qui montre comment un nom ,
dont le genre avoit été d’abord déterminé , peut enfuite
devenir du genre douteux. V. La derrtiere clafre des noms
irréguliers dans le genre , cA celle des hétérogènes / c’cA-i-
dire, de ceux qui font d'un genre au fingnlier fit d’un autre
au pluriel, Divers exemples tires des nomsTatins. Ibid* b. Caufe
de cette forte d'irrégularité.
Des genres des pronoms. Il ètoÎt tlatUtei qu’ils rtc fuffent
attachés à aucun genre déterminé , mais qu’ils fe rapporraf-
fent à celui du nom qu'ils repréfentent dans le difeours. M.
du Marfais prétend que le pronom ce en franÇoi* eA du genre
neutre : examen de ce fentiment, Ibid, 393,a . Remarque de
M. Duclo* fur les genres} cet académicien prétend que IV«-
fiitution des genres ejl une chofe purement arbitraire, qui ne paroit
pas avoir le moindre avantage, & qui a beaucoup d'inconvénient.
Obfervations de l’auteur fur c e fentiment. Utilité de l’inAiui-
tion des genres. Objcflion. Les Grecs fit le» Latins avoient
trois genres} nous n'en avons que deux, fit les Anglois n'en
ont point } c'eA donc une chofe purement arbitraire. Uéponfe.
Autre objcflion. De toutes les manières d'indiquer la relation
de l'adjeélif ait nom , la maniera angloife en du moin» la.
meilleure« Réponfe. Ibid. b. Les vices qui paroifl'ent tenir à.
l'inAitmion des genres, ne viennent fouvent que d'un emploi
mat entendu de cette inAitution, Ibid. 394, a.
Genre. De» genres des adjeélifs. 1. 136. a. Comment On indique
en françoi» le genre des noms, 726. b, De» genre» mafciiiin,
féminin fit commun. III, 713. b. Des genres dans let mots déclinables.
X . 734. b. Du genre neutre. XL 118. b. Noms de
genre, 1, 348. b, 727. a , b. 428. a , b. Utilité de la diAinélion
desgenre».Suppl, I II,231.E
G e n r e , ÇMéthaphyJ',) le genre le plus bas eA celui qui
ne contient tous lui que des efpeces, au lieu que les genre»
fupérieurs fe fubdivifent en de nouveaux genres. Méthode
de former la notion de ces deux fortes de genres. Ce qu’on
entend pnr déterminations génériques. Les genres fit les e f peces
fe déterminent par les qualités effentielles. VII. 394 .a.
Genre, Comment nous parvenons à diAribuer en genres
fit en efpeces les êtres que nous connoiffons, Suppl. I. 69.
é.73.«. Ces claffes n'exiflent point réellement. 71, a, Voye[
MfiTHODE,
G e n r e , ( Giomét, ) les lignes géométriques difliitgtiées en
genres ou ordres, Les lignes du fécond ordre font appellées
courbes du premier genre, b c . Le mot genre s'applique
quelquefois aux équations fit quantités différentielles, v i l .
394. b,
G e n r e , (M f i , nat.) Ondéffgnepar le mot gente, les ref*
femblances qui fe trouvent entre des objet# de différente»
efpeces. Genre de folipedes, Genre des animaux à pied fourchu.
De même qu'on établit des genres} on rormo des
claffes t ainft l'on ait la claffe des quadrupèdes. VIL <94. b.
Genre s définition du genre. XVII. 403, a, b. Diflinélion
de l'hiAoire naturelle en régnés, claffes,.genres, efpeces.
III, 303. b. 306, a. X . 4381 b. — 4Ô0. a.
G e n r e , (A n a tom .) Genre nerveux, Le tabac irrite la
genre nerveux; le Vinaigre pris en trop grande quantité
Fincommode. VII, 394, b.
G e n r e de s t y l e , ( Lit t .) Chaque genre d'écrire n fon fiyla
propre en profe fit en ver». V il. 394. b. Chaque genre a
fes nuancos différentes ; on peut les réduire à deux ; le fini*
pie fit le relevé. Remués qui leur font communes, En qi',ol
confifient leurs différences, Entre le Amnle fit le fubllrnc il
y a plufieurs nuances, fit c’eA l'art de les affortir qui contribue
à la perfeélion de l'éloquence fit de la jioéfic. Exemples
qui montrent dans quels cas^ph doit fit permettre le
mélange des Ayles, fit dans quels cas on doit fe le défendre*
Le défaut le plus condamnable dans le mélange des Ayles #
eA de défigurer les fujets les plus féWeux, en croyant Je»
i Z / Z Z x z x z z