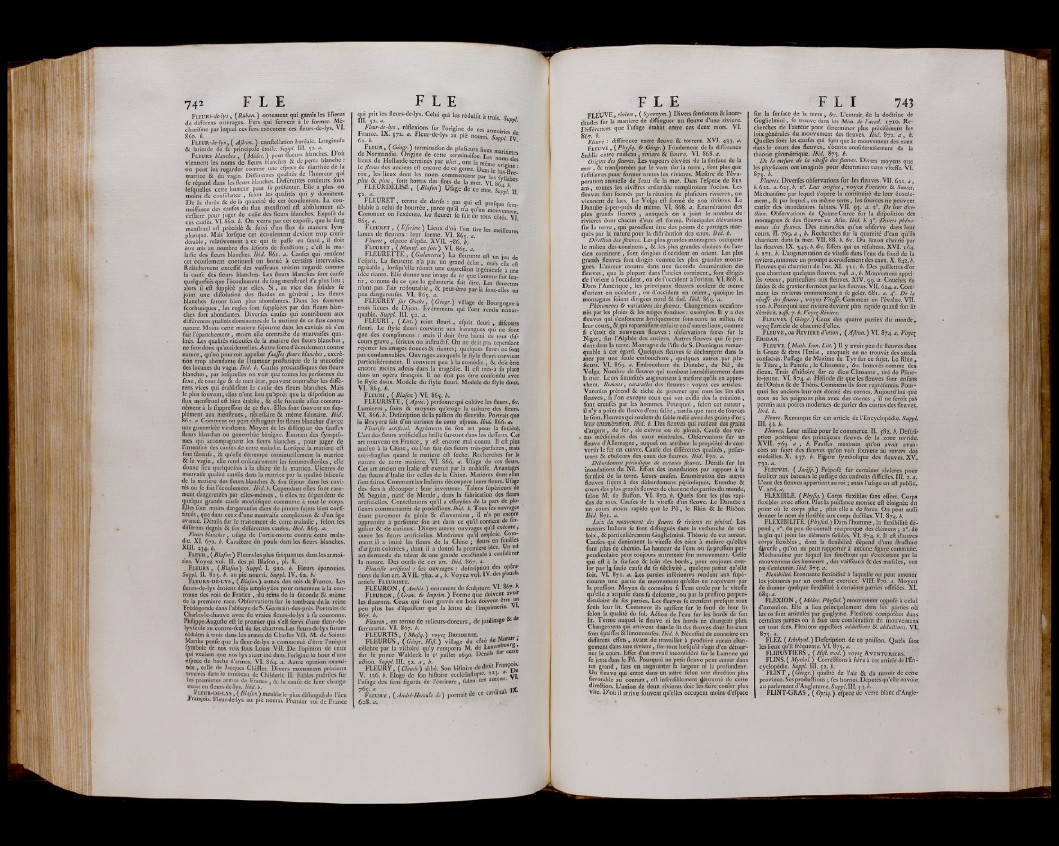
11 II
» i i l i
f i 'p ï i
7 4 2 F L E
1 1
l||i|
<1 i l i
11
H i
,
F le u r s-de-lys, {Ru ba n.) ornement qui garnit les liSeres
J e différons ouvrages. Fers qui fervent à le former. Mé-
chanifme par lequel ces fers exécutent ces fleurs-dc-lys. VI.
860. b. 1 W Ê Ê Ê t , , , T . .
FLEUR-i?i-/yi, ( Aflron. Y conftcllation boreale. Longitude
& latitude de fa principale étoile. Suppl. III. ï 2- a- ,
Fleurs blanches , ( Médec. ) pour flucurs blanches. D ou
viennent les noms de fleurs blanches & de perte blanche :
on peut les regarder comme une cfpecc de diarrhée de la
matrice & du vagin. Différentes qualités de 1 humeur qui
fe répand dans les fleurs blanches. Différentes couleurs fous
lcfquclles cette humeur peut fe présenter. Elle a plus ou
moins de confiflance , félon les qualités oui y dominent.
D e la durée & de la quantité de cet écoulement. La con-
noiffancc des caufes du flux mcnftruel cft abfolument né-
ceffaire pour juger de celle des fleurs blanches. Expofé de
ces caufcs. VI. 860. b. On verra par cet expofé, que le fang
menflrucl eft précédé 8t fuivi d’un flux de maticre lymphatique.
Mais lorfque cet écoulement devient trop considérable
, relativement à. ce qui fe palTc en famé , il doit
être mis au nombre des léfions de ronflions ; c’cft la maladie
des fleurs blanches. Ibid. 861. a. Caufes qui rendent
cet écoulement continuel ou borné à certains intervalles.
Relâchement exceflif des yaïffeaux utérins regardé comme
la caule des fleurs blanches. Les fleurs blanches font caufc
quelquefois que l’écoulement du fang mcnftruel n’a plus lieu ;
alors il eft fuppléé par elles. S i , au vice des lolides fe
joint une diflolution des fluides en général , les fleurs
blanches feront bien plus abondantes.. Dans les femmes
feorbutiques, les règles font fuppléées par des fleurs blanches
fort abondantes. Divcrfcs caufcs qui contribuent aux
différentes qualités dominantes de la matière de ce flux contre
nature. Moins cette matière fejourne dans les cavités où s’en
fait l’épanchcmcnt, moins elle contrade de mauvaifes qualités.
Les qualités vicieufes de la maticre des fleurs blanches,
ne font donc qu’accidentelles. Autre forte d’écoulement contre
nature, qu’on pourrait appeller fauffes fleurs blanches, cxcré-
tion trop abondante ‘ 5 de l’hu l’humeur proftatique "
de la inucofité
des lacunes du vagin. Ibi
Ibid. b. Caufes procataftiques des fleurs
blanches, par lesquelles on voit que toutes les pcribnnes du
fcx c ,d c tout âge 6c de tout état, pc
rens vices qui étabiiffent la caille des fleurs blanches. Mais
le plus fouvent, elles n’ont lieu qu’après que la difpofition au
flux iqcnftruel eft bien établie, & elle fuccede affez communément
à la fuppreflion de ce flux. Elles font fouvent un fup-
plément aux mcnftrues, ncceffairc & même falutaire. Ibid.
062. a. Comment on peut, diftinguer les fleurs blanches d’avec
une gonorrhéc virulente. Moyen de les diftinguer des faufles
fleurs blanches ou gonorrhée bénigne. Examen des fymptô-
mes qui accompagnent les fleurs blanches, pour juger de
l’intenflté des cauics de cette maladie. Lorfque la matière cft
fort féreufe, & qu’elle détrempe continuellement la matrice
& le vagin | elle rend ordinairement les femmes ftériles, elle
donne heu quelquefois à la chute de la matrice. Ulcères de
mauvaife qualité caufés dans la matrice par la qualité bilieufe
de la maticre des fleurs blanches & fon féjour dans les cavités
où fe fait l’écoulement. Ibid. b. Cependant elles font rarement
dangereufes par elles-mêmes , ii elles, ne dépendent de
quelque grande caufc morbiflque commune à tout le corps.
Elles font moins dangereufes dans de jeunes fujets bien conf-
titués, que dans ceux d’une mauvaife complexion 6c d’un âge
avancé. Détails fur le traitement de cette maladie, félon les
différons degrés & fes différentes caufes. Ibid. 863. a.
Fleurs blanches > 11 fa go de l’or tic-morte contre, cette maladie.
XI. 672. b. Caractère du pouls dans les fleurs blanches.
XIII. »34.*.
. F l e u r , ( B lafon ) Fleurs les plus fréquentes dans les armoiries.
Voyez vol. II. des pl. Blafon, pi. 8..
. F l e u r s , ( Blafon) Suppl. I. 910. ¿ .F le u r s épanouies.
Suppl. II. 813. b. au pié nourri.. Suppl. IV . 62. b.
h le u r s -d e - ly s , ( Blafon ) armes des rois de France. Les
fleurs-dc-lys étoient déjà employées pour ornement à la couronne
des rois de France , du tems de la féconde & même
de la première race. Obfcrvations fur le tombeau de la reino
Frédégondc dans l’abbaye de S. Gcrmain-des-prés. Portraits de
Charles-le-chauve avec de vraies fleurs-dc-lys à fa couronne.
Philippe-Augufte eft le premier qui s’cft.fcrvi d’une flcur-dc-
Lys feule au contre-fccl de fes Chartres. Les fleurs-dc-lys furent
réduites à trois dans les armcs.de Charles VII. M. de Sainte-
Marthc penfc que la flcur-de-Lys a. commencé d’étre l’unique
fymbole de nos rois fous Louis VIL D e .l’opinion de ceux
qui veulent que nos lys aient été dans, l'origine le bout d’une
eipcce de hache d’armes. V I. 864. a. Autre opinion examir
née , celle de Jacques Chifflct. Divers monumens précieux
trouvés dans le tombeau de Childeric II. Fables puériles fur
les premières armes de, France, 6c lm caufc de leur changement
en fleurs-dc-lys. Ibid. b.
F leu r -d e -ly s , ( Blafon.) meublede plus diftinguède l’éctt
François. Flcur-dc-lys au pié nourri. Premier roi de France
F L E
ÎS ‘ 2* P I qui les riduifit i trois. Suppl
Fltur-de-lys , réflexions fur l’oricinc de ces . 1
France. IX. S7e. e. Flcur-dc-lys l pié n o Z ^ p T l V *
Fl e u r , ( Géogr.) terminaifon de pluftcurs lieux m«;,'
de Normandie. Origine de cette terminaifon. Les t f l l I P
lieux de Hollande terminés par u lie t, ont la mêmr»
le flevus des anciens eft encore de ce genre. Dans le i°n^ ne :
ton , les lieux dont les noms commencent par U S u
pieu & p lo u , font battus des flots de la mer VI ,
^ L E U R D E L IS É , ( B lafon ) Ufage de cc m o î . l ^ / u .
iÉÉÉjpl -, *frmc B 111 i Î>* qui cft prefque fon-
blable à celui de bourrée, parce qu'il n’a q u ’un moïvemem
Comment on 1 exécute. Le fleuret fe fait de tous côtés. VI
86ç. a.
F leuket , (E fc r im c ) Lieux d’où l'on tire les meilleures
lames de fleureis : leur forme. VI. S6c. a.
Fleuret, cfpecc d’épéc. XVII. 786. b.
Fleuret .jfAiemi/ eu f o ie ) VI. 865. a.
F L EU R E T TE , ( Galanterie) La ftenrette eft un ¡eu de
1 elprtt. La fleurette n a pas un grand éc la t, niais elle cft
agréable , lorfqu’elle réunit une expreflion ingénicttfc à une
idée riante. Elle donne une image de ce que l’amour fait fen-
ttr , comme de ce que la galanterie fait dire. Les fleurettes
n om pas l’air redoutable , & peut-être par-là font-elles un
peu dangereufes. VI. 865. a.
FLEUREY fu r O u c h e , ( Géogr. ) village de Bourgogne à
trois lieues de Dijon. Evénemcns qui font rendu remarquable.
Suppl. III. 52. a.
FLEURI , ( L in . ) teint fleuri , efprit fleuri , difeours
fleuri. Le ftyle fleuri convient aux harangues qui ne font
que des complimcns : mais il doit être banni de tout difeours
grave , férieux ou inftruélif. On ne doit pas cependant
rejetter les images douces & riantes; quelques fleurs ne font
pas condamnables. Ouvrages auxquels le ftyle fleuri convient
particulièrement. Il convient peu à la comédie, & doit être
encore moins admis dans la tragédie. Il eft; très-à fa place
dans un opéra françois. Il ne doit pas être confondu avec
le ftyle doux. Modelé du ftyle fleuri. Modèle du ftyle doux.
V I. 865. b.
F l e u r i , ( B la fon ) VI. 86ç. b.
FLEURISTE, ( Agric. ) perfonne qui cultive les fleurs, &c.
Lumières , foins 6c moyens qu’exige la culture des fleurs.
V I. 866. b. Defcription de la paillon du fleurifte. Portrait que
la Bruyere fait d’un curieux de cette cfpecc. Ibid. 866. a.
Fleurifle artificiel. Agrémcns de fon art pour la fociété.
L’art des fleurs artificielles brille fur-tout dans les defferts. Cet
art nouveau en France, y eft encore mal connu. Il eft plus
ancien h la Chine, où l’on fait des fleurs très-parfaites, mais
très-fragiles quand la matière cft feche. Recherches fur la
nature de cette matière. VI. 866. a. Ufage de ces fleurs.
Cet art ancien en Italie eft exercé par la nonleffe. Avantages
des fleurs d'Italie fur celles de la Chine. Matières dont elles
font faites. Comment les Italiens découpent leurs fleurs. Ufage
des fers à découper : leur inventeur. Talens fupérieurs de
M. Seguin, natif cle Mende, dans la fabrication des fleurs
artificielles. Contcftations qu’il a effuyées de la part de plu-
fleurs communautés de profefflons. Ibid. b. Tous les ouvrages
étant purement de génie & d’invention, il n’a pu encore
apprendre à perfonne fon art dans ce qu’il contient de fin-
gulicr & de curieux. Divers autres ouvrages qu’il exécute,
outre les fleurs artificielles. Matériaux qu il emploie. Commentai
a imité les fleurs de la Chine ; fleurs en feuilles
d’argent colorées, dont il a donné la première idée. Un tel
art demande du talent & une grande exaélitude à confiucref
la nature. Des outils de cet art. Ibid. 867. «•
Fleurifle artificiel : fes ouvrages : defcription des opérations
de fon art. XVII. 780. a , b. V o y e z vol. I V .desplaucir.
article F le u r i s te . ,
FLEURO N , (A r ch it. ) ornement de fculpture. VI. 867. f-
F leuron , ( Grav. 6* Imprim. ) Forme que doivent avoir
les fleurons. Ceux qui font gravés en bois doivent
peu plus bas d’épaiffeur que la lettre de l’imprimerie. V .
867. b. § ,
Fleuron, en terme de rclicurs-dorcurs, de jardinage oc
fcrrureric. VI. 867. b.
F LEURTIS, ( Mufiq, ) voyez Broderie, .
FLEURU S, ( Géopr. Hifl. ) village du côté de *
célcbre par la viéloirc qu’y remporta M. dé Fwtcm B »
fur le prince Waldeck le i r juillet 1690. Détails 1"
a ¿lion. Suppl. III. <2. a . b. , .
F L E U R Y , ( Claude ) abbé. Son hirtoire du droit François.
V . 126. b. Eloge de ion hiftoire eccléfiaftiq,,e* y r
l’ufage des fens figurés de l’écriture, félon cet aut
Î leury , ( Àndrl-Herculc de) portrait de ce cardinal. IX
6 x B .a .
F L E F L I 743
FLEUVE, rivière, ( Synonym. ) Divers fentimens & incertitudes
fur la maniéré de diftinguer un fleuve d’une rivicre.
Différences que l’ufage établit entre ces deux mots. VI.
^Fleuve : différence entre fleuve & torrent. XVI. 4 3 3 . a.
F l e u v e , ( Phyfiq. & Giogr. ) Fondement de la différence
établie entre ruiffe'au, rivière & fleuve. VI. 868. a.
Origine des fleuves. Les vapeurs élevées de la furface de la
mer, & tranfportées par le vent fur la terre, font plus que
fliffifantes pour former toutes les rivieres. Mefure de l’éva-
poradon annuelle de l’eau de la mer. Dans l’efpece de 812
ans, toutes les rivifres cnfemble rempliraient l’océan. Les
fleuves font formés par la réunion de pluftcurs rivières, ou
viennent de lacs. Le Volga eft formé de 200 rivieres. Le
Danube à-peu-près de même. VI. 868. a. Enumération des
plus grands fleuves , auxquels on a joint le nombre de '
rivieres dont chacun d’eux cft formé. Principales élévations
fur la terre , qui paroiftent être des points de partages marqués
par la nature pour la diftribution des eaux. Ibid. b.
DireRion des fleuves. Les plus grandes montagnes occupent
le milieu des contincns, & les plus grandes chaines de l’an-
cicn continent, font dirigées d’occident en orient. Les plus
grands fleuves font dirigés comme les plus grandes montagnes.
L’auteur montre dans une féconde énumération des
fleuves, que la plupart dans l’ancien continent, font dirigés
de l’orient à l’occident, ou de l’occident à l’orient. VI. 868. b.
Dans l’Amérique, les principaux fleuvés coulent de même
d’orient en occident, ou d’occident ch orient, quoique les
montagnes foient dirigées nord & fud. Ibid. 869. a.
Phénomènes 6* variations des fleuves. Changemens occafion-
nés par les pluies & les neiges fondues : exemples. 11 y a des
fleuves qui s’enfoncent brufqucment fous terre au milieu de
leur cours, &.qui reparoiffent en fui te en d’autres lieux, comme
ft c’êtoit de nouveaux fleuves : obfcrvations faites fur le
Niger, fur l’Alphée des anciens. Autres fleuves qui fe perdent
dans la terre. Montagne de l’ifle de' S. Domingue remarquable
à cet égard. Quelques fleuves fe déchargent dans la
mer par une feule embouchure, quelques autres par plu-
fieurs. VI. 869. a. Embouchure du Danube, du N il, du
Volga. Nombre de fleuves qui tombent immédiatement dans
la mer. Leurs ftnuofités augmentent à mefure qu’ils en approchent.
Remous t eut ara (les des'fleuves : voyez ces articles.
Varenius prétend & tâche de prouver que tous les lits des
fleuves, li l’on excepte ceux qui ont exifté dès la création ,
font creufés par les hommes. Pourquoi, félon cet auteur,
il n’y a point de fleuve d’eau faléc, tandis que tant de fourecs
le font, r leuves qui roulent du fable mêlé avec des grains d’or ;
leur énumération. Ibid. b. Des fleuves qui roulent des grains
d’argent, de fe r , de cuivre ou de plomb. Caufe des ver-
> tus médicinales des eaux minérales. Obfervations fur un
fleuve d’Allemagne, auquel on attribue la propriété de convertir
le fer en cuivre. Caufe des différentes qualités, pefan-
teurs & cbuleurs des eaux des fleuves. Ibid. 870. a.
Débordement périodique de certains fleuves. Détails fur les
inondations du Nil. Effets des inondations par rapport à la
fertilité de la terre. Leurs caufes. Enumératibn des autres
fleuves fujets à des débordemens périodiques. Etendue &
cours des plus grands fleuves de chacune dcS parties du monde*
félon M. de Buffon. V I. 870. b. Quels font les plus rapides
de tous. Caufcs de la vîteffe d’un fleuve. Le Uanube a
un cours moins rapide que le P ô , le Rhin 8c le Rhône.
Ibid. 871. a.
l o i x du mouvement des fleuves & rivieres en général. Les
auteurs Italiens fe font diflingués dans la recherche de ces
lo ix , & particulièrement Guglielmini. Théorie de cet auteur.
Caufcfr qui diminuent la vîteffe des eaux à mefure qu’elles
font plus de chemin. La hauteur de l’eau où fa preflion perpendiculaire
peut toujours entretenir fon mouvement. Celle
qui eft à la furface oc loin des bords, peut toujours couler
par 1% feule caufc de fa déclivité , quelque petite' qu’elle
foit. VI. 871. a. Les parties inférieures rehdent aux ftipé-
rieures une partie du mouvement qu’elles en reçoivent par
la preftion. Moyen de connoître ft l’eau coule par là! vîteffe 3u elle a acquiie dans fa defeente, ou par la preftion perpen-
iculairc de fes parties. Les fleuves fe creufent prefque tout
feuls leur lit. Comment ils agiffent fur le fona de leur lit
félon la qualité du fol. Aélion de l’eau fur les bords de fon
lit. Terme auquel le fleuve ni les bords ne changent plus;
Changemens qui arrivent dans le lit des fleuves dont les eaux
font épaiffesoClimonnenfcs. Ibid. b. Néccffitéde connoître ces
différons effets, avant de travailler à produire aucun changement
dans une riviere, fur-tout lorfqu’il s’agit d’en détourner
le cours. Effet d’un travail inconftdcré fur le Lamone qui
fe jette dans le Pô. Pourquoi un petit fleuve peüt entrer dans
un grand, fans en augmenter la largeur ni la profondeur.
Un fleuve qui entre dans un autre félon une direélion plus
favorable au courant, cft infcnftblcment détourné de cette
direélion. L’union de deux rivieres doit les faire couler plus
vite. D ’où il arrive fouvent qu’elles occupent moins d’efpace
ftir la furface de la terre, 6*c. L’extrait, de la doélrinc de
Guglielmini, fe trouve dans les Mém. de l ’acad. 1710. Recherches
de l’auteur pour déterminer plus précifément les
loix générales du mouvement des fleuves. Ibid. 872. a , b.
Quelles font les caufes qui fgnt que le mouvement des eaux
dans le cours des fleuves, s’écarte confidérablement de la
théorie géométrique. Ibid. 873. b.
D e la mefure de la vîteffe des'fleuves. Divers moyens que
les phyficiens ont imaginés pour déterminer cette vîteffe. VI.
873. b.
Fleuves. Diverfes obfervations fur les fleuves. VII. 621. a ,
¿.622. a. 625. b. 1°. Leur origine, voyez Fontaine & Source.
Méchanifme par lequel s’opère la continuité de leur écoulement
, & par lequel, en même tems, les fourecs ne peuvent
caufcr des inondations fubites. VII. 193. a. 2°. D e leur dire-
dion. Obfervations de Quinte-Curce fur la difpofttion des
montagnes & des fleuves en Afie. Ibid. b. 30. Divers phénomènes
des fleuves. Des cataraéles qu’on obferve dans leur
cours. II. 769. a , b. Recherches fur là quantité d’eau qu’ils
charrient dans la mer. VII. 88. b. 6>c. Du limon charrie par
les fleuves. IX. 343. b. 6>c. Effets qui en réfultent. XVI. 164.
b. 171. b. L’augmentation de vîtene dans l’eau dü fond de la
riviere,annonce un prompt accroiflefflcnt des eaux. X. 842. b.
Fleuves qui charrient de l’or. XI. «21. b. Des paillettes d’or
que charrient quelques fleuves. 748. a , b. Moüvcmcns appel les
remous, particuliers aux fleuves. XIV. 99. a. Couches de
fables & de gravier formées parles fleuves, v i l . 624. a. Comment
les rivieres commencent à fe geler. 681. a. 40. De la
vîteffe des fleuves \ voyez Vîteffe. Comment on l’évalue. V II.
120. b. Pourquoi une rivicre devient pliis rapide quand fon lit
s’étrécit. 248.7. b. Voyeç Riviere.
F leuves. ( Géogr. ) Ceux dés quàtré parties du mondé,
voye^ l’article de chacune d’elles.
Fleuve , ou R iviere d ’orion, ( Aflron. ) V I. 874. a. Voye(
Eridan.
Fleuve. ( Math. Icon% Litt. ) Il y avoir peu de fleuves dans
la Grèce & dans l’Italie , auxquels on ne trouvât des autels
confacrés. Paffage de Maxime de T y r fur ce fujet. Le Rhin,
le T ib re , la Pamife, le Clitomne, &c. honorés comme des
dieux. Trait d’hiftoire fur ce dieu Clitomne , tiré de Pline-
le-jeune. VI. 874. a. Héftode dit que les fleuves font enfans
de l’Océan & de Thétis. Comment ils font repréfentés. Pourquoi
les anciens leur ont donné des cotnes. Aujourd’hui que
nous ne les peignons plus avec des cornés , il ne ferait pas
permis aux poètes modernes de parler des cornes des fleuves.
Ibid. b.
Fleuve. Remarque fur cet article de l’Encyclopédie. Suppl.
III. <2. b.
Fleuves. Léur utilité pour le commerce. II. 582. b. Defcription
poétique des principaux fleuvés de la , zone torridé.
XVII. 769. a , b. Faufles maximes qu’on a voit avancées
au fujet des fleuves qu’on voit fouvent au revers des
médailles. X . 237. b. Figure iymbolique des fleuves. X V .
73 2. a.
Fleuves. ( Jurifp.) Prépofé fur certaines rivieres pour
faciliter aux bateaux le paflage des endroits difficiles. III. 2. a.
L’eau des fleuves appartient au roi ; mais l’ufage en eft public.
V . 206. a.
FLEXÏBLE. (Phyfla. ) Corps flexibles fans effort. Corps
flexibles avec effort. Plus la puiffancc motrice cft éloignée çlii
point où le corps plie , plus elle a de force. On peut aufli
donner le nom de flexible aux corps duéliles. V I. 874. b.
FLEXIBILITÉ.' (PhyfiolA Dans l’homme, la flexibilité dépend
, i° . du peu de contait réciproque des élémens ; 2°. dé
la glu qui joint lés élémens folidés. VI. 874. b. Il cft d’autres-
corps flexibles, dont la flexibilité' dépend d’une ftruéliirè
diverfe , qu’on ne peut rapporter à aucune ftgnre commune.
Méchaniftûe par lequel les fonéHons qui s’exécutent par le
nlouvement des humeurs , des vaifleaux & d c s mufclcs, ont
pu s’exécuter. Ibid. 875. a.
Flexibilité. Etonnante flexibilité à laquelle dn peut amener
les jointures par un confiant exercice. VIII. 870. a. Moyen
de donnér quelque flexibilité à certaines parties oflifiéeS. XI.
680.0.
FLEXION, ( Médec. Phyflot. ) moùvériiè'nt' oppofé à celui
; d’extenfton. Elle a lieu principalement dans lés parties oùf
les os font articulés par ginglyme. Flexions conijfofécs dans
certaines parties où il faut une combirtaifoh de ihouvemcns
en tout fens. Flexions appcllées addudiohs & abdudiohs. V I .
a ‘
FLEZ. ( Ichthyol. ) Defcription de ce poiflbn. Quels fônt
les lieux qu’il fréquente. VI. 875. a.
FLIBUSTIERS, ( Hifl. mod. ) voyeç A venturiers.
FLINS. ( Mythol. ) Corrcélions à faire à cet article de l’En-
cyclopédic. Suppl. III. 52. b.
FLINT , (Géogr.) qualité de ’air & du terroir dé celte
province. Ses productions ; fes bornes. Députés qu’elle envoie
au parlement d’Angleterre. Suppl.III. 13. b.
FLINT-GRAS, (Op tiq .).cfpecc de verte blanc d’Angle