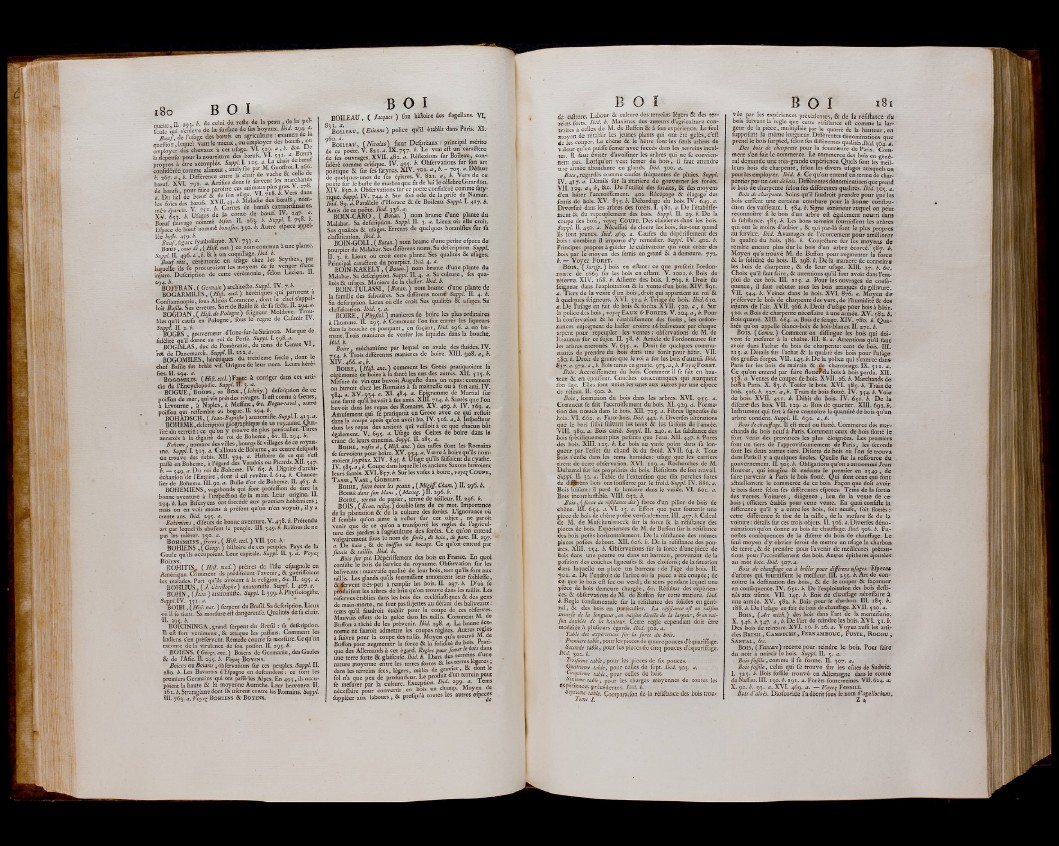
iBo B O I
omruc. U. 29Î- *• de cehd du re.fte_de, Ü pMU ?,d? U pC!'
2-ule qui s’enieve de la furface de fes boyaux. Ibid. »94- •
W , de l'ufage des boeufs en agriculture : exameu de la
oueffion, lequel vaut le mieux, ou employer desboeuts.ou
employer des chevaux à cet ufage. VI. eao. a , b. SCO.
la dêpenfe pour la nourriture des boeufs. VI- Î31- j boeuf
propres à etre accouplés. Suppl. l. 125.
confidèrée comme aliment, analyße par M. Gcoftot L a66
b 167 a , b. Différence entre la chair de vache & celleOe
boeuf? XVI. 791. 1 Artifice dont fe fervent les | | | | | | | |
de boeufs, pour faire paroitre ces ™’^ x p g J ry ers'
I W * l XVII Z S * 2 . ¿ 2 ? nomt
“ " * - , .T c o r 3nes de boeufs extraordinaires,
xüt X,, b Ufages de la corne de boeuf. IV. 147. e.
Roeûf fiuivage nommé bifon. II. 163. A Suffi. I. 75»- *•
E^ece de boeuf nommé tonnfns. 350. i. Autre efpece appellée
bnfle. 439. b.
Baufj figure fymbolique. XV. 733. e.
Bxv? ,ctmrât nul.) ce nom commun à une plante.
W / . II. 496. , , A & à un coquillage. Âid. A
Sauf rôti, cérémonie en ufage chez les Scythes, par
laquelle ils fe procuroient les moyens de fe venger dune
injure. Defcription de cette cérémome, félon Lucien, 11.
’ ^BOFFRAN ( Germain ) architeâe. Suffi. IV. 7. A
BOGARMILES, (Hiß. .cd.) hérétiques qui parurent a
Conftannnople, fous Alexis Conuiene , dont le chef s appel-
lolt Èafilt. Ses erreurs. Sort de Bafile & de j g g » 7Î4'
BOGDAN, ( Hiß. dt Pologne ) fcigncur Moldave. Troubles
qu’il caufa en Pologne, fous le regne de Cafimir IV.
^ÎOGÈS2', gouverneur dlone-fur-le-Strimon. Marque de
fidélité qu'il donne au roi de Perfe. Suffi. I. spe.u.
BOGBLAS, duc de Poméranie, du tems de L>anut v i ,
rdi de Danemarck. Suppl. II. 222. . , ,
BOGOMÏLES, hérétiques du treizième fiecle , dont le
chef Bafile fut brûlé vif. Origine de leur nom. Leurs héré-
fies. II. 294. a. ,
B ogomiles. {HiJl.eccL)Faute à corriger dans cet article
de l'Encyclopédie. Suppl. Ü. y a. . S
BOGUE, B o o p s , ou BOX ,{Ichthy.) defcnpnon de ce
poiffon de mer, qui vit près des rivages. Il eft connu à Genes,
à Livourne , à Naples, à Meffine, &c. Bogue-ravel, autre
poiffon qui reffemble au bogue. II. 294. b. ^
BOHADSCH, ( Jean-Baptifie) anatomifte. S«pp/.I.413.a.
BOHEME,defcription géographique de ce royaume. Qualité
du terrein: ce qu’on y trouve de plus particulier, l itres
annexés à la dignité de roi de Boheme , &c. II. 294. b.
Boheme, nombre des villes, bourgs & villages de’ ce royaume.
Suppl. I. 313.0. Cailloux de Boheme, au centre defquels
on trouve des rubis. XII. <94. Hiftoire de ce qm seit
paffé en Boheme, à l’égard des Vaudois ou Picards. XU. 347-
b. - 549. 0. Du roi de Boheme. IV. 65. b. Dignité d archi-
échanfon de l’Empire', dont ü eft revêtu. I. 614. b. Chancelier
de Boheme. 111.92. a Bulle d’or de Boheme. II. 463. b.
BOHÉMIENS, vagabonds qui font profeflion de dire la
bonne aventure à l’infpeétion de la main. Leur origine. II.
294. b. Les Bifcayens ont fuccédé aux premiers bohémiens j
mais on en voit moins à préfent qu’on n en voyoit, il y a
«rente ans. Ibid. 295. a.
• Bohémiens , difeurs de bonne aventure. V. 438. b. Prétendu
art par lequel ils abufent le peuple. III. 349. é. Raifonsdene
pas les tolérer. 350. a.
Bohémiens ,/reres, ( Hift. eccl. ) VH. 301. b.'
BOHIENS , ( Giogr. ) hiftoire de ces peuples. Pays de la
Gaule qu’ils occupoient. Leur capitale. Suppl. H. 3. a. Voyt{
B oïens. ,
BOHITIiL ( Hiß. mod. ) prêtres de M e efpagnole en
Amérique. Comment ils prédifoient l’avenir, & guériffoient
les malades. Part qu’ils avoient à la religion, &c. II. 293. a.
BOHLIUS, (/ . Chriftophe) anatomifte. Suppl. I. 407.a.
BOHN, ( Jean ) anatomifte. Suppl. 1. 399. b. Phyfiologifte.
5,^OIBI ,1& . nat. ) ferpent du Brefil. Sa defcription. Lieux
où il fe tient. Sâ morfure eft dangereufe. Qualités de fa chair.
H. 293. b. • I
BOICININGA,grand ferpent du Brefil : fa defcription.
11 eft fort venimeux, & attaque les paftans. Comment les
Indiens s’en préfervent. Remede contre fr morfure. Ce qu’on
raconte de la virulence de fon poifon. IL 293. b.
BOIENS. (Géogr. anc.) Boiens de Germanie, des Gaules
& de l’Afie. II. 293. b. Voye{ Boyens.
Boiens ou Boiares, obfervations fur ces peuples. Suppl. II.
a8o. b. Les Bavarois d’Efpagne en defeendent : ce font les
premiers Germains qui ont paffé les Alpes. En 493, ils occu-
poient la haute 8c la moyenne Autriche. Leur bravoure. II.
i6t. b. Stratagème dont ils uferent contre les Romains. Suppl.
III. 763. a. Voyei BOHIENS 8c BOYENS.
B O I
BOILEAU, ( Jacquts ) fon hifloire des flagellais. VL
3èoiLEAU, (Etienne) police qu’il établit dans Paris. XI:
^ B o i l e a u , ( Nicolas) fleur Defpréaux : principal mérite
de ce poete. V. 8al.4-IX.7s7. A Le vrai eft un caraftere
de fes ouvrages. XVII. 482. a. Réflexions fur Boileau, con-
fidéré comme critique. IV. 493. b. Obfervations fur fon art
poétique & fur fes fatyres. XIV. 702. * , b. - 703. a. Défaut
de quelques-unes de fes épîtres. V. 821. a , b. Vers de ce
poète fur le bufte de marbre que fit de lui le célebre Oirardon,
XIV. 830. b. Obfervations fur ce poète confidéré comme faty-
rique. Suppl. IV. 744. b. Sur fon ode de la prife de Namur.
lbid. 89. a. Parallèle d’Horace &de Boileau. Suppl. I. 417. b.
Amis de ce poète. Ibid. 336. a.
BOIN-CARO, ( Botan. ) nom brame aune plante dii
Malabar. Sa defcription. Suffi. II. 3. a. Lieux où elle croît.
Ses qualités & ufages. Erreurs de quelques botaniftes fur fa
dafiihcation. lbid. b. .
BOIN-GOI1 , ( Botan.) nom brame d une petite efpece de
pourpier du Malabar. Ses différens noms. Sa defcription. Suppl.
II. 3. b. Lieux où croît cette plante. Ses qualités & ufages.
Principal caraàere du pourpier. Ibid. 4. a.
BOlN-KAKELY, ( Botan.) nom brame dune plante du
Malabar. Sa defcjiption. Suppl. II. 4. a. Sa culture, fes qualités
8c ufages. Maniere de la daffer. Ibid. b.
BOIN-TULASSI, {Botan. ) nom brame d’une plante de
la famille des falicaires. Ses différens nom* Suppl. II. 4. b.
Sa defcription. Lieux où elle croît. Ses qualités & ufages. Sa
daftification. lbid. 3. a. . . .
BOIRE, CPhyJiol.) manieres de boire les plus ordinaires
à l’homme. II. 293. b. Comment l’on fait entrer les liqueurs
dans la bouche en pompant, en fuçant, Ibid. 296. a. en humant.
Trois manieres de verfer les liquides dans la bouche,
Ibid. b.
Boire, méchanifme par lequel on avale des fluides. IV.
734. b. Trois différentes manieres de boire. XIII. 908. a , b.
XIV. 466. a , b. t „ . .
B o ir e , (Hift.anc.') comment les Grecs prauquoient la
cérémonie de boire à la fanté les uns des autres. XII. 313. b.
hïefure dé vin que buvoit Augufte dans un repas : comment
on buvoit chez les Romains à fa maîtreffe ou a fon ami. IV.
384. a. XV. 934. a. XI. 484. a. Epigramme de Martial fur
une fanté qu’il buvoit à fes amis. XUI714. b. Santés que l’on
buvoit dans les repas des Romains. XV. 409. b. IV. 169. a.
Amufement qui fe pratiquoit en Grece avec ce qui reftoit
dans la coupe après qu’on avoit bu. IV. 316. ayb. lnfpe&eur
dans les repas des andens qui veilloit à ce que chacun bût
également. V^ 693. a. Ufage des Celtes de boire dans le
crâne de leurs ennemis. Suppl. IL 283. a.
Bo ire , vafes à, {Hift. une.) des taffes dont les Romains
fe fervoient pour boire. XV. 934. a. Verre à boire qu’ils nom-
moient fcyphus. XIV. 843. b. Ufage qu’ils faifoient du cyathe.
IV. 383.a, é. Coupe dans laquelle lès anciens Saxons buvoienç
leurs fantés. XVI.-837. b. Sur les vafes à boire, voyt[ C o up e,
T asse, V ase , G obelet.
Bo ire , faire boire les peaux , (Méùff. Cham. ) H. 296. b.
BOIRE dans fon blanc , ( Maneg. ) IL 296. b.
Bo jre, terme de papier, terme de tailleur. IL 296. b. .
BOIS, (Écon. rufliq.) double fens de ce mot. Importance
de la plantation & de la culture des forêts. L’ignorance ou
i! femble qu’on ^ ù e à relier fur cet objet, ne paroîc
venir que de ce qu’on a tranfporté les regles de l’agriculture
des jardins à l’agriculture des forêts. Ce qu’on entend 1
vulgairement fous le nom de forêt, de bois, de parc. II. 297. *
a. De haie , & de buiffon ou bocage. Ce qu’on entend par
futaie & taillis. Ibid. b.
Bois fur pié. Dépériffement des bois en France. En quoi
confifte le bois de fervice du royaume. Obfervafion fur les
baliveaux: mauvaife qualité de leur bois, tort qu’ils font aux
raillis. Les glands qu’ils fourniffent annoncent leur foibleffe,
ôûfervent très-peu à remplir les bois. II. 297. b. D’où fe
produifent les arbres de brin qu’on trouve dans les taillis. Les
réferves établies dans les bois des eccléfiaftiques & des gens
de main-morte, ne font pas fujettes au défaut des baliveaux :
tems qu’il faudrait établir pour la coupe de ces réferves.
Mauvais effets de la gelée dans les taillis. Comment M. de
Buffon a tâché de les prévenir, lbid. 298. af La bonne économie
ne fauroit admettre les coupes réglées. Autres regles
à fuivre pour la coupe des taillis. Moyen qu’a trouvé M. de
Buffon pour augmenter la force 8c la folidité du bois. Pratique
des Allemands à cet égard. Regles pour fen/er le bou dans
une terre forte 8c glaifeufe. lbid. b. Dans des terreins d une
nature moyenne entre les terres fortes 8c les terres légères,
dans les terreins fecs, légers, mêlés de gracier, 8c ont e
fol n’a que peu de profondeur. Le produudun terremneur
fe mefurer par la culture. Excepuon. *99- Tems
néceffaire pour convenir.en bols un champ. Moyen de
fupplier aux labours , 8t prefqu’à toutes les autres efpeces
B O I
de culture. Labour 8c culture des terreins légérs 8c des terreins
forts. Ibid. b. Maximes des auteurs d’agriculture contraires
à celles de M. de Buffon 8c à fon expérience. Le feul
moyen de rétablir les jeunes plants qui ont été gelés, c’éft
.«le les couper. Le chêne 8c le hêtre font les fèuls arbres de
valeur qu’on puifle femer avec fuccès dans les ,terreins incultes.
Il faut éviter d’avoifiner les arbres qui ne fe conviennent
pas. Lorfqu’on veut femer du bois, il faut attendre
•une année abondante en glands. Ibid. 300. a.
Bots, regardés comme eau fes fréquentes de pluies. Suppl.
IV. 417. a. Détails fur la manière de gouverner les forêts.
iVlI. 129. a 9 bt 8cc. De l ’utilité des futaies, 8c des moyens
d’en hâter l’accroiflement. 402. Récépage 8c élagage des
femis de bois. XV. 833. b. Débardaee du bois. IV. 649. a.
Diverfité dans les arbres des forêts. I. 381. a. De l’établifle-
ment 8c du repeuplement des bois. Suppl. ü . 29. b. D e la
coupe des bois, vove^ C oupe. Des clairières dans les bois.
Suppl. II. 430. a. Néceifité de clorre les bois, fur-tout quand
ils font jeunes. Ibid. 469. a. Caufes du dépériffement des
bois : combien il importe d’y remédier. Suppl. IV. 402. b.
Principes propres à guider le cultivateur qui veut créer des
bois par le -moyen des femis en grand 8c à demeure. 772.
b. — Voyez F oret.
Bo is , ( JurifpA bois en eftant: ce que preferit l’ordon-
jiance de 1669 fur les bois en eftant. V. 1001. b, Bois de
xéferve. XIV. 168. b. Afliette des bois. 1. 769. b. Droit du
feigneur dans l’exploitation 8c la vente d’un bois. XIV. 891.
a. Tiers de la vente d’un .bois, droit qui appartient au roi 8c
à quelques feigneurs. XVI. 324. b. Triage de bois. Ibid. 610.
a. D e l’ufage en fait de bois 8c forêts. XVQ. 320. a 9 b. Sur
la police des bois, voye^ Eau x 6* F orets. V. 204. a, b. Pour
La confervation 8c le rétabliflement des forêts, les ordonnances
enjoignent de laiffer croître 16 baliveaux par chaque
arpent pour repeupler les ventes : obfervations de M. de
Reaumur fur ce fujet. Ü. 38, b. Article de l’ordonnance fur
les arbres encroués. V. 635. a. Droit de quelques communautés
de prendre du bois dans une forêt pour bâtir. VII.
i.80. b. Droit de grurie que le roi a fur les bois d’autrui. Ibid.
837. a. 972. a , b. Bois tenus en grurie. 973.a, b. VbyefFORET.
Bois. Accroiffeinent du bois. Comment il fe fait en hauteur
8c en épaiffeur. Couches concentriques qui marquent
fon âee. Elles font unies les unes aux autres par une efpece
de réleau. H. 300. b.
Bois y formation du bois dans les arbres. XVI. 933. a.
Comment fe fait l’accroiffement du bois. XI. 929. a. Formation
des noeuds dans le bois. XII. 725. a. Fibres ligneufesdu
bois. VI. 662. a. Faux-bois. Ibid. 442. b. Diverfes altérations
que le bois fubit fuivant les tems 8c les faifons de l’année.
VIII. 389. a. Bois carié. Suppl. II. 240. a. La fubftance des
bois fpécifiquement plus pefante que l’eau. XII. 447. ¿.’Pores
«les bois. XIII. 123. b. Le bois ne varie point dans fa lon-
ueur par l’effet du chaud 8c du froid. aVII. 64. b. Tout
ois s’enfle dans les tems humides: ufage que les carriers
tirent de cette obfervafion. XVI. 119. a. Recherches de M.
Duhamel fur les propriétés du bois. Réfultats de fon travaiL
Suppl. II. 32. a. Table de l’extenfion que dix perches faites
de différens bois ont foiïfferte par le froid. Suppl. IV. 886. a.
Bois luifant : il perd fà lumière dans le vuiae. VI. 601. a.
Bois incombuftible. VIII. 632. b.
Bois y (force de rèfiftance des) force d’un pilier de bois de
chêne. III. 634. a. v l. 13. a. Effort que peut foutenir une
piece de bois ae chêne pofee-verticalement. III. 437. b. Calcul
de M. de Mufchenbroeck fur la force 8c la rèfiftance des
pièces de bois. Expériences de M. de Buffon fur la rèfiftance
des bois pofés horizontalement. De la rèfiftance des mêmes
pièces pofées debout. XII. 606. b. De la rèfiftance des pou-
ares. XIII. 234. b. Obfervations fur la force d’une piece de
bois dans une poutre ou dans un barreau, provenant de la
pofition des couches ligneufes 8c des cloifons; de lafituafion
dans laquelle on place un barreau : de l’âge du bois. II.
301. a. De l’endroit de l’arbre où la piece a été coupée j de
c a que le bois eft fec ou verd ; du tems pendant lequel une
piece de bois demeure chargée, &c. Réfultat des expériences
8c obfervations de M. de Buffon fur cette matière. Ibid.
b. Réglé fondamentale fur la rèfiftance des folides en général
, oc des bois en particulier. La rèfiftance ejl en raifon
inverfé de la longueur, en raifon direêle de la largeur y 6* en raifon
doublée de la hauteur. Cette régie cependant doit être
modifiée^ plufieurs égards, lbid. 302. a.
Table des expériences fur la force du bois*
Première table, pour les piece» de quatre pouces d’équariffage.
Seconde table 9 pour les pièces de cinq pouces d’équariffage,
lbid. 302. b.
Troifieme table y pohr les pièces de fix polices.
Quatrième table, pour celles de fept. lbid. 303. a.
Cinquième table, pour celles de huit.
■ dixième table 3 pour les charges moyennes de toutes les
expériences précédentes, lbid. b.
Septième table. Comparaifon de la rèfiftance des bois trou-
Tome I.
B O I i8t
vée par les expériences précédentes, 8c de la rèfiftance du
bois luivant la regle que cette rèfiftance eft comme la lar-
geur de la piece, multipliée par le quarré de la hauteur, en
fuppofant la meme longueur. Différentes dénominations que
prend le bois fur pied, félon fes différentes qualités./éid, 3Ô4. a.
Des bois de charpente pour la fourniture de Paris, Com*
ment s’en fait le commerce. Le commerce des bois en général
demande une très-grande expérience. Quels font les meilleurs
bois de charpente, félon les divers ufages auxquels on
peut les employer. Ibid. b. Ce qu’on entend en terme de charpentier
par un cent de bois. Différentes dénominations que prend
le bois de charpente félon fes différentes qualités. Ibid. 303, a.
Bois de charpente. Soins qu’il faudrait prendre pour que le9
bois enflent une certaine courbure pour la bonne conftpu-
élion des vaiffeaux. I. 384. ¿.Signe extérieur auquel ©il peut
reconnoitre fi le bois a’un arbre eft également' nourri dans
fa fubftance. 383. b. Les bons terreins raurniftent les arbres
qui ont le moins d’aubier, 8c qui par-là font le plus propres
au fervice. Ibid. Avantages de l’écorcement pour améliorer
la qualité du bois. 386. b. Conjeâure fur les moyens de
rendre encore plus dur le bois d’un arbre écorcé. 387. b.
Moyen qu’a trouvé M. de Buffon pour augmenter la force
8c la folidité du bois. II. 298. b. De la maniere de connoître
les bois de charaente, 8c de leur ufage. XIII. 27, b. &c.
Choix qu’il faut mire, 8c attentions qu’il faut avoir dans l’emploi
de ces bois. ID. 213. a. Pour les ouvrages de confé-
quence, il faut rebuter tous les bois attaqués degélivure.
VIL 344. b. Veines dans le bois. XVI. 876. a. Moyen de
préferver le bois de charpente des vers, de l’humidite & des
injures de l’air. XVII. 306. b. Droit d’ufage pour bois à bâtir.
320. a. Bois de charpente néceffaire à une armée. XV. 382 .b.
Bois quarré. XIII. 664. a. Bois de feiage. X IV. 780. b. Qualités
qu’on appelle blancs-bois 8c bois-blancs; II. 271. b.
Bois. ( Comm. ) Comment on diftingue les bois qui doivent
fe mefurer à la chaîne. III, 8. a. Attentions qu’il faut
avoir dans l’achat du bois de charpente: cent de bois. III.
213. a. Détails fur l’achat 8c la qualité des bois pour l’ufage
des groffes forges. VII. 143. b. De la police qui s’exerce
Paris fur les bois de mairain 8c de charronage. IX. 311. a.
Ce qu’on entend par faire flotte^du bois à bois perdu. XII.
338. a. Ventes de coupes de bois. XVII. 26, b. Marchands do
boSà Paris. X. 83. b. Toifer le bois. XVI. 383. b. Train de
bois. 326. b. 327. at b. Train de bois flotté. IV. 334. b. Voie
de bois. XVII. 421. b. Débit du bois. IV. 631. ¿. De 1s
dilate- des bois. VII. 129. a. Bois de quartier. XIII. 692. ¿.
Infiniment qui fert à frire connoître la quantité de bois qu’un
arbre confient. Suppl. II. 692. a, b.
Bois de chauffage, il eft neuf ou flotté. Commerce des marchands
de bois neuf à Paris. Comment ceux de bois flotté le
font Venir des provinces les plus éloignées. Les premiers
font un tiers de l’approvifionnement de Paris ,• les féconds
font les deux autres tiers. Difette de bois où l’on fe trouva
dans Paris il y a quelques fiedes. Quelle fut la reffource du
gouvernement. IL 305^. Obligations qu’on a au nommé Jean
Kouvet, qui imagina 8c exécuta le premier en 1349, de
frire parvenir à Paris le bois flotté. Qui font ceux qui font
aitiiellemerit le commerce de ce bois. Façon que doit avoir
le bois flotté félon fe9 différentes efpeces, Tems de la fortie
des ventes. Voitures , diligence , lieu de la vente de ce
bois ; officiers établis pour cette vente. En quoi confiffe la
différence qu’il y a entre les bois, foit neufs, foit flottés i
cette différence fe tire de la taille, de la mefure 8c de la
voiture : détails fur ces trois objets. II. 306. a. Diverfes dénominations
qu’on donne au bois de chauffage, lbid. 306. b. Fu-
neftes conicquences de la difette du bois de chauffage. Le
feul moyen d’y obvier ferait de mettre en ufage le charbon
de terre, 8c de prendre pour l’avenir de meilleures précautions
pour l’accroiffement des bois. Autres épithetes ajoutées
au mot bois. Ibid. 307. a.
Bois de chauffage ou à brûler pour différens ufages. Efpece«
d’arbres qui fourniffent le meilleur. III. 233. ¿. Art de connoître
la deftination des bois i 8c de le couper 8c façonner
en conféquence. IV. 631. ¿, De l'exploitation des bois deiti-
nésaux üfines. VII. 143. b. Bois de chauffage néceffaire à
une armée. XV. 382. b. Bois pourle charbon. III. 183. b.
188. ¿. De l’ufage en frit de bois de chauffage. XVJI. 320. a.
BÓIS, {Art méch.S des bois dans l’art de la menuiferie.'
X. 346. ¿,347. ayb. De l’art de teindre les bois. XVI. 31. b.
Des bois de teinture. XVI. 10. i . 26. a. Voyez aufli les articles
B r é s il, C am p e c h e ,F e rn am b o u c , F u s te , R o c o u ,
S a n t a l , &c.
Bo is , {Teinture) recette pour.teindre le bois. Pour frire
du noir à noircir le bois. S.uppl. II. 3. a.
Bois foffile, comme il fe forme. H. 307. a.
Bois foJJiUy celui qui fe trouve fur les côtes de Sudwie.
I. 323. ¿. Bois foffile trouvé en Allemagne dans le comté
de Naffau. III. 190.^.191. a. Forêts fouterreines. VII. 624. <2.
X. 92. b. 93. a. XVI. 469. a. — Voyci FOSSILE.
Bois d'aloès. Diofcoride l’a décrit fous le nom d'agallochum,
Z %