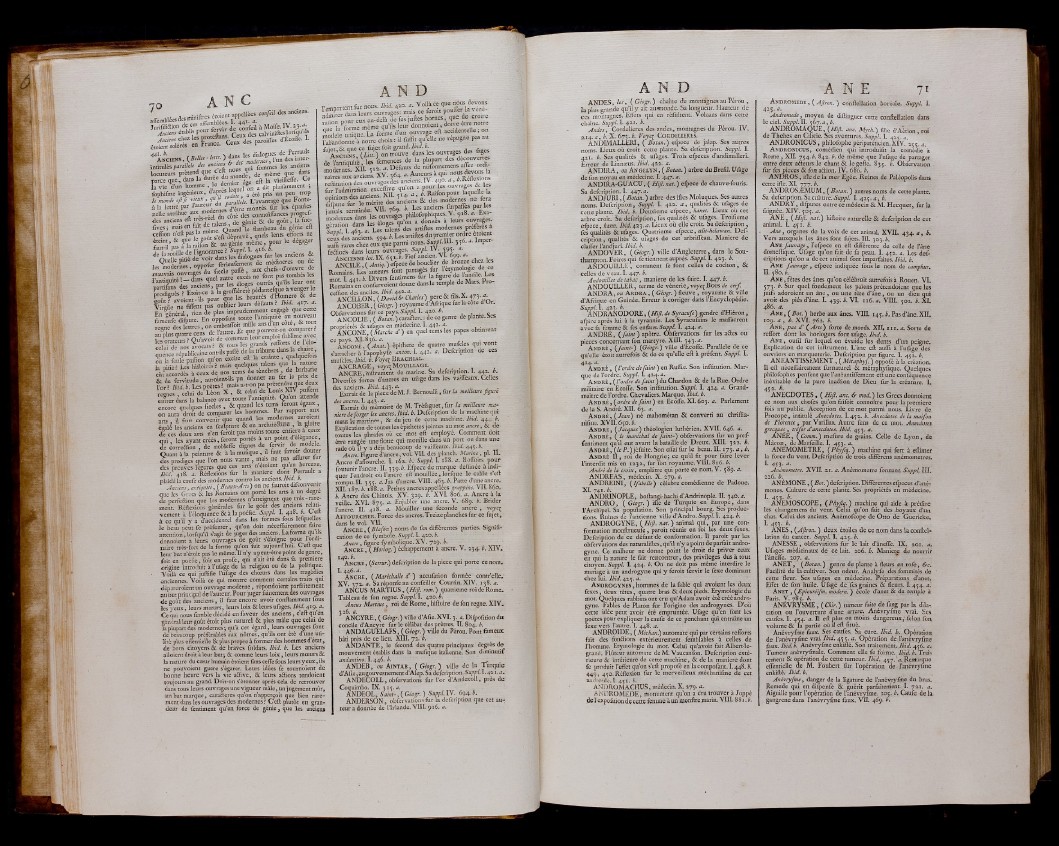
70 A N C
j . ¿toient tippellèes ctmjctl des anôens.
oerfdi à Moïfe. IV. p - f
Aucuns érablis pour le rar u calvinilles lorfqu ik
H ^
(Bclks-Uttr. ) "
intitulès parallèle des ancuns fouîmes' les anciens
locuteurs prétend que c =« " ntfo, de même que dans
parce que, dans la dur . ^ ia vieiUeffe. Ce
la vie d’un homme > le cl ou a dit plaifamme.it ;
fophifine ingénieux, damai ieq ^ ^ . un peu trop
le monde efifi vieux, qui ^ j L’avantage que Fonte- I
i l a l e .« par 1 les épaules
nelle du côté des connoiffances progrefdes
ÏÜ anciens eft très r e & de , > foc
iives ; mais m en fait de ta aMQ ■ A flambeau ls du Id gente 5a5er eft 1
ceftion n’eft pas la me i f f l é lents | fo fB île 1 r de ia rouille de Kg“ ™ “ ? S ' f o ^ s fin les anciens &
de
5 ? ‘TÆ ' * Ï Î -
ï # ï S l H B R B s i ï
j0 & B S s S S Ê i B S S i i f t a s ^ W p S
ii&ïkfêÊ&StBÊÊ f j s , jjgBK | 1 rennes celui de Léon X , & celui de Louis XIV puflént I
entrer dans la balance avec toute l’anuqmté. Quon attende I
encore quelques fiecles , & quand les tems feront égaux ,
on aura droit de comparer les hommes. Par rapport aux I
arts il faut convenir que quand les modernes auiotent I
égalé les anciens en fculptme & en archtteaure , la gloire
de ces deux arts n’en feroit pas moins tonte enttere a ceux 1
q u i, les ayant créés, feront portés a un point d élégance,
2e correftion , de nobleffe dignes de femr de modèle
Quant à la peinture & à la muftque, il faut favour douter
des prodiges que l’on nous vante , mais ne pas affluer iur
des preuvcs-legeres que ces ans n’étoient qu au berceau.
Ibid. 418. a. Réflexions fur la maniéré dont Perrault a
plaidé la caufe des modernes contre les anciens. Ibti.b.
Anciens, annqmti, ( Beaux-Arts) on ne fauro.it ifeonvemr
que les Grecs & les Romains ont porté les ans à un degré
de perfefüon que les modernes ffiattmgnmt que très - rarement.
Réflexions générales fur le goût des anciens relativement
à l’éloquence &àlapoéfie. Suppl. I. 418. b. feelt
à ce qu’il y a d’accidentel dans les formes fous lelquelles
le beau peut.fe préfenter, qu’on doit néceffairement faire
attention, lorfqu’il s’agit de jueer des anciens. La forme qu ils |
donnoient a leurs ouvrages de gout s’éloigne pour 1 ordinaire
très-fort de la forme qu’on fuit aujourdhiu. Ueltque
leur but n’ètoit pas le même. Il n’y a peut-être point de genre,
foit en poéfxe, foit en profe, qui n’ait été dans fa première
origine introduit à l’ufage de la religion ou de la politique.
Voilà ce qui juififie l’ufage des choeurs dans les tragédies
anciennes. Voilà ce qui montre comment certains traits qui
dépareraient un ouvrage moderne, répondoient parfaitement
au but principal de l’auteur. Pour juger fainement des ouvrages
de goût des anciens, il faut encore avoir conftamment fous
les yeux, leurs moeurs, leurs loix & leurs ufages. Ibid. 419. a.
Ce qui nous femble décidé en faveur des anciens, c’eft qu’en
général leur goût étoit plus naturel & plus mâle que celui de
Ta plupart des modernes; qu’à cet égard, leurs ouvrages font
de beaucoup préférables aux nôtres, qu’ils ont été d une utilité
plus eflentielle & plus propre à former des hommes d’état,
de bons citoyens & de braves foldats. Ibid. b. Les anciens
alloient droit à leur but ; & comme leurs loix, leurs moeurs &
la nature du coeur humain étoient fans ceffe fous leurs yeux, ils
ne pouvoient guere s’égarer. Leurs idées fe tournoient de
bonne heure vers la vie aftive, & leurs aftions tendoient
toujours au grand. Doit-on s’étonner après cela de retrouver
dans tous leurs ouvrages une vigueur mâle, un jugement mûr,
un but marqué, caraéteres qu’on n’apperçoit que bien rarement
dans les ouvrages des modernes ? Ceft plutôt en gran-
deur de fentiment qu’en force de génie, que les anciens
A N D
que la tonne incm q ouvrai» eft accidentelle ; on
notre choix: ¡ ¡ f a f t y U k « W au
les ouvrages des fages
de l’antiquité, les fentences de la plupart des découvertes
modëraës XII <!i. n. Défauts de raifonnemens affez ordi-
« anciens. XV. ,64. a. Auteurs à ft™ not,SRdevo„s la .
reftitutiqn des ouvrages^ancteias.J ^ • & ^
fur l’admiration excclfive qu . g ^ ’ pour laquelle ^
?^“te tf“ rm-méeéVII ^ r ^ L e ^ n e i ë n T t o p Æ s p ë p
M m ‘ Les uU J d e s attiftes modernes préférés à
I ceux^dés anciens. P i M É E
aufti rares chez eux que parmi nous. ■SupvL ffl. 3 j 6. u. Imper
feélioùs dans leurs ouvrages. S u ffi 1V- Î9S- ■
I Ancienne foi. IX. 6< t> Fief ancien. VI. 699. a.
I ANCILE (Antiq.) efpece de bouclier de bronze chez les
11 M | HESES 1 mot I 441. b. Divers fentunens fur la figure de 1 ancile. Les
I Romains en confervoient douze dansle temple de Mars. Pro-
I ceflion des anciles. Ibid. 442- „ fi. y , a I ANCILLON, ( David & Charles) pere & fils. X. 473 .a.
1 ANCOBER, ( Géogr. ) royaume d’Afrique fur la côte d Or.
I Obfervations fur ce pays. Suppl. I. 4 * °-b- , . «
I ANCOLÏE, ( Botan.) caraften.3 de ce genre de plante, bes
I propriétés & ufages en médecine. I. 442- d-
I ANCONE, (Marche d’ ) en quel tems les papes obtinrent
I ce pays. XI. 836. a. .
I ANCONÉ, (Anat.\ épithete de quatre mufcles qui vont
s’attacher à l’apophyfe aneon. I. 44a- n. Defcripdon de ces
mufcles. Ibid. b. Voye[ B r a ch ia l.
ANCRAGE, voyc{M o uillage .
ANCRE,infiniment de marine. Sa defeription. 1. 442,. b.
Diverfes fortes d’ancres en ufage dans les vaifleaux. Celles
des anciens. Ibid. 443. a. ... . . ... . -
Extrait de la piece de M. J. Bernoulli, fur la meilleure figure
des ancres.1 .443- <*• . ^ ,r ' r 1 •;/
Extrait du mémoire de M.Tréfaguet,fur la meilleure maniéré
de forger les ancres. Ibid. b. Defer iption de la machme qm
meut le martinet, & du jeu de cette machine. Ibid. 444. b.
Explication de toutes les épithetes jointes au mot ancre, & de
toutes les phrafes où ce mot eft employé. Comment doit
j être rangée une flotte qui mouille dans un port ou dans une
rade où i y a déjà beaucoup de vaifleaux. Ibid. -445. b.
Ancre. Figure d’ancre, vol. VU. des planch. Manne, pl. II.
Ancre d’affourche. I. 162. b. Suppl. 1. 188. Bofloirs pour
foutenir l’ancre. II. 339.^ Efpecq de marque deftmée à indiquer
l'endroit où l’apcre eft mouillée, lorfque le cable s’eft
rompu. II. 3 5 5. a. Jas d’ancre. VIII. 462. b. Patte d’une ancre.
XII. 187. b. 188. a. Petites ancres appellées grappins. VII. 860.
b. Ancre des Chinois. XV. 329. b. XVI. 806. a. Ancre à la
veille. XVI. 875. a. Enjabler une ancre. V. 689. b. Brider
l’ancre. II. 418. a. Mouiller une fécondé ancre , voyeç
I A f fou rch er . Force des ancres.Treize planches fur ce fujet,
I dans le vol. VII. .c
S A n c r e , (Blafon) noms de fes différentes parties, bignih-
I cation de ce fymbole. Suppl. 1 .4*°-b-
I Ancre, figure fymbolique. XV. 729. b.
I A n c r e , ( Horlog.) échappement à ancre. V. 234. b. XTV.
I 140. b. , , . •
I A ncre , (Serrur.) defeription de la piece qui porte ce nom.
I 1 .446. à.
A n c r e , ( Maréchalle d’ ) accufation formée contr’elle.
I XV. 372. a. Saréponfe au confeiller Courtin. XIV. 138. a.
ANCUS MARTIUS, (Hifi. rom. ) quatrième roi de Rome.
I Tableau de fon regne. Suppl. I. 420. b.
Ancus Martius, roi de Rome, hiftoire de fon regne. XTV.
! ^ ANCYRE, ( Géogr. ) ville d’Afie. XVI. 3. a. Difpofition du
I concile d’Ancyre fur le célibat des prêtres. II. 804. b.
I ANDAGUELAFS, (Géogr.) ville du Pérou. Pont fameux:
bâti près de ce lieu. XIII. 72. b.
ANDANTE, le fécond des quatre principaux degrés de
mouvement établis dans la mufique italienne. Son diminutif
andantino. 1 .446. b.
ANDEB, ou Aintab , ( Géogr. ) ville de la Turquie
d’Afie, au gouvernement d’Alep. Sa defeription. Suppl. 1.421. a.
ANDECOLL, obfervations fur l’or d’Andecoll, près de
Coquimbo. IX. 3x5.^.
ANDEOL, Saint-, (Géogr. ) Suppl. IV. 694- b-
ANDERSON, obfervations far la defeription que cet au-;
teur a donnée de l’Irlande. VIII. 916. a.
A N D A N E 71
ANDES, les, (Géogr.) chaîne de montagnes au Pérou ,
la plus grande qu’il y ait au «monde. Sa longueur. Hauteur de
ces montagnes. Effets qui en réfultent.. Volcans dans cette
chaîne. Suppl. 1. 421. b. ,
Andes, Cordelieres desandes, montagnes du Pérou. IV.
214. a ,b .x . 673. b. Voyei CORDELIERES.
ANDLV1ALLERI, | Botan.) efpece de jalap. Ses autres
noms. Lieux où croît cette plante. Sa defeription. Suppl. I.
421. b. Ses qualités & ufages. Trois efpeces d’andimalleri.
Erreur dé Linnæus. Ibid. 422. a.
ÀNDIRA, ou A n g e l y n , ( Botan. ) arbre du Brefil. Ufage
de fon noyau en médecine. I. 447. a. .
ANDIRA-GUACU, ( Hifi.nat.) efpece de chauve-fouris.
Sa defeription. I. 447. a.
ANDJ URI, ( Botan. ) arbre des ifles Molucjues. Ses autres
noms. Defeription, Suppl. I. 422. a , qualités & ufages de
cette plante. Ibid. b. Deuxième efpece, hanet. Lieux où cet
arbre croît. 'Sa defeription, fes qualités & ufages. Troifieme
efpece, hann. Ibid. 423. a. Lieux où elle croît. Sa defeription,
fes qualités & ufages. Quatrième efpece 9 ulit-helawan. Defeription,
qualités 8c ufages de cet arbriffeau. Maniéré de
clalfer l’anajuri .Ibid.b. V
ANDOVER, (Géogr.) ville d’Angleterre, dans le Sou-
thampton. Foires qui fe tiennent auprès. Suppl. I. 423. b.
ANDOUILLE, comment fe font celles de cochon, &
celles de veau. 1 .447. b. • i
Andouilles de tabac, maniéré de les faire. I. 447. b.
ANDOUILLER, terme de vénerie, voyrç Bois de cerf.
ANDRA, ou A r d r a , ( Géogr. ) fleuve , royaume & ville
d’Afrique en Guinée. Erreur à corriger dans l’Encyclopédie.
Suppl. 1. 423. b.
ANDRANODORE, (Hifi. de Syracufe) gendre d’Hieron,
afpire après lui à la tyrannie. Les Syracufains le maffacrent
avec fa femme & fes enfàns. Suppl. I. 424. a.
ANDRÉ, (faint) apôtre. Obfervations fur les aftes ou
pièces concernant fon martyre. XUI. 343.a.
A n d r é , (faint-) (Géoer.) ville d’Ecofle. Parallèle de ce
qu’elle étoit autrefois & de ce qu’elle eft à préfent. Suppl. I.
424. a.
A ndré , (l'ordre defaint) en Ruflie. Son inftitution. Marque
de l’ordre. Suppl. 1. 424. a.
A ndré , ( l'ordre de faint ) du Chardon & de la Rue. Ordre
militaire en Ecoffe. Son inftitution. Suppl. I. 424. a. Grand-
maître de l’ordre. Chevaliers. Marque. Ibid. b.
A ndré , ( ordre de faint ) en Ecoffe. XI. 603. a. Parlement
de la S. André. XII. 62. a.
A n d r é , (Jean) ne mahométan & converti au chriftia-
nifine. XVIÎ. 650. b.
A n d r é , ( Jacques) théologien luthérien. XVII. 646. a.
A n d ré , ( le maréchal de Jdint-) obfervations fur un pref-
fentiment qu’il eut avant la bataille de Dreux. XIII. 322. b.
A n d ré , (leP .) jéfuite. Son effai fur le beau. U. 173. a , b.
A nd ré I I , roi de Hongrie; ce qu’il fit pour faire lever
l’interdit mis en 1232, fur fon royaume. VIII. 816. b.
André de la croix, emplâtre qui porte ce nom. V. 589. a.
ANDREAS, médecin. X. 270. a.
ANDREINI, (Ifabelle) célébré comédienne de Padoue.
XI. 741. b.
ANDRINOPLE, boftangi-bachi d’Andrinople. II. 340. a.
ANDRO, ( Géogr.) ifle de Turquie en Europe, dans
l’Archipel. Sa population. Son principal bourg. Ses productions.
Ruines de l’ancienne ville d’Andro. Suppl. I. 424. b.
ANDROGYNE, ( Hifi. nat.) animal qui, par une conformation
monftrueule, paroît réunir en foi les deux fexes.
Defeription de'ce défaut de conformation. 11 paroît par les
obfervations des naturaliftes, qu’il n’y a point de parfait andro-
gyne. Ce malheur ne donne point le droit de priver ceux
en qui la nature le fait rencontrer, des privilèges dus à tout
citoyen. Suppl. I. 424. b. On ne doit pas même interdire le
mariage à un androgyne qui y feroit fervir le fexe dominant
chez lui. Ibid. 425. a.
A nd ro g yn e s , hommes de la fable qui avoient les deux
fexes, deux têtes, quatre bras & deux pieds. Etymologie du
mot. Quelques rabbins ont cru qu’Adam avoit été créé androgyne.
Fables de Platon fur l’origine des androgynes. D’où
cette idée peut avoir été empruntée. Ufage qu’en font les
poètes pour expliquer la caufe de ce penchant qui entraîne un
fexe vers l’autre. X 448. a.
ANDROIDE, (Méchan.) automate qui par certains refforts
fait des fondions extérieurement femblables à celles de
l’homme. Etymologie du mot. Celui qu’avoit fait Albert-le-
grand. Flûteur automate deM. Vaucanfon. Defeription extérieure
& intérieure de cette machine, & de la maniéré dont
fe produit l’effet qu’on s’eft prôpofé en la compofant. 1.448. b.
449, 450. Réflexion fur le merveilleux méchanifme de cet
anaroïdo.I. 451. b.
ANDROMACHUS, médecin. X. 279. a.
ANDROMEDE, monument qu’on a c'ru trouver à Joppé
de l’expofition de cette femme à un monftre marin. VHI. 881. b.
A ndromède , ( Afiron. ) conftellarion boréale. Suppl. I.
425. a.
Andromède, moyen de diftinguer cette confteUation dans
le ciel. Suppl. 11. <67.0, b.
ANDRÔMÂQUE, (Hifi. anc. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡g g fg d’Aétion, roi
de Thebes en Cilieie. Ses aventures. Suppl. I. 42* . a.
ANDRONICUS, philofophe péripatéticien.XlV. 23^.0.
ANDRONieusj comédien qui introduifit la comédie à
Rome, XII. 754. b. 842. b. de même que l’ufage de partager
entre deux aéleurs Je chant & legefte. 835. A. Obfervation
fur fes pièces & fon a&ion. IV. 686. b.
ANDROS, ifle de la mer Egée. Ruines de Paléopolis dans
cette ifle. XI. 777. b.
ANDROSÆMUM, ( Botan. ) autres noms de cette plante.
Sa defeription. Sa culture. Suppl. I. 425. <z, b.
AN D R Y , difputes entre ce médecin & M. Hecquet, fur la
faignée. XIV. 505. a.
AN E , (Hifi. nat.) hiftoire naturelle 8c defeription de cet
animal. I. 451. b.
. Ane, organes de la voix de cet animal. XVII. 434. a , b.
Vers auxquels les ânes font fujets. IIL 303. b.
A n e fauvage, l’efpece en eft différente de celle de l’âne
domeftique. Ufage qu’on fajt de fa peau. I. 452. a. Les descriptions
qu’on a de cet animal font imparfaites. Ibid. b.
A n e Jauvage , efpece indiquée fous le nom de camphur.
U. c8o. b.
A n e , fêtes des ânes qu’on célébrait autrefois à Rouen. VI.
573. b. Sur quel fondement les païens prétendoient que les
juifs adoraient un âne, ou une tête d’âne, ou un dieu qm
avoit des piés d’âne. L 439'. b. VL 116. a. VIH. 502. b. a L
486. a.
A n e , ( Bot. ) herbe aux ânes. VHI. 14?. b. Pas d’âne. XH.
109. * , b. XVI. 762. b.
A ne, pas d’ (Arts) forte démords. XD, 111. a. Sorte de
reffort dont les horlogers font ufage. Ibid. b.
A ne , outil fur lequel on évuide les dents d’un peigne.
Explication de cet inftrument. L’âne eft aufli à l’ufage des
ouvriers en marqueterie. Defeription par figure. I. 4c 2. b.
ANEANTISSEMENT, ( Métaphyf. ) oppofé à la création.
Il eft néceffairement furnaturel & métaphyfique. Quelques
philofophes penfent que l’anéantiffement eft une conféquence
inévitable de la pure inaâion de Dieu fur la créature. L
452. b.
ANECDOTES, ( Hifi. anc. & mod. ) les Grecs donnoient
ce nom aux chofes qu’on faifoit connoître pour la première
fois au public. Acception de ce mot parmi nous, liv r e de
Procope, intitulé Anecdotes. I.452. b. Anecdotes delà maifon
de Florence, par Varillas. Autre fens de ce mot. Anecdotes
grecques , tréfor d'anecdotes. Ibid. 453. a.
ANÉE, ( Comm. ) mefure de grains. Celle de Lyon, de
Mâcon, de Marfeille. I. 453. a.
ANÉMOMÈTRE, (Phyfiq. ) machine qui fert à eftimer
la force du vent. Defeription ae trois différens anémomètres.
I. 453. a.
Anémomètre. XVII. 21. a. Anémomètre fonnant. Suppl, HI.
226.X
ANÉMONE, ( Bot. ) defeription. Différentes eipeces d’anémones.
Culture de cette plante. Ses propriétés en médecine.
’ AÎ&MOSCOPE, ( Phyfiq. ) machine qui aide à prédire
les changemens du vent. Celui qu’on fait des boyaux d’un
chat. Celui des anciens. Anémofcope de Otto de Gùericke,
!• 453- *■
ANES, (Afiron. ) deux étoiles de ce nom dans laconftci-
lation du cancer. Suppl.X 425. b.
ANESSE, obfervations fur le lait d’ânefle. IX. 201. a.
Ufages médicinaux de ce lait. 206. b. Maniéré de nourrir
l’ânefle. 207. a.
AN E T , (Botan. ) genre de plante à fleurs en rafr, &ci
Facilité de la cultiver. Son odeur. Analyfe des fommités de
cette fleur. Ses ufages en médecine. Préparations d’anet.
Effet de fon huile. Ufage de.'Tes graines 8c fleurs. 1. 454. al
A n e t , (Epicuréifm. modem. ) école d’anet & du temple à
Paris. V. 785. b.
ANÉVRYSME, ( Ckir. ) tumeur faite de fang par la dilatation
ou l’ouverture d’une artere. Anévryfme vrai. Ses
caufes. I. 454. a. Il eft plus ou moins dangereux,’ félon fon
volume 8c la partie où il eft fitué.
Anévryfme faux. Ses caufes. Sa cure. Ibid. b. Opération
de l’anévryfme vrai. Ibid. 455. a. Opération dè l?OTevryfme‘
faux. Ibid. t. Anévryfine enkifté. Son traitement. Ibid. 456. a*
Tumeur anévryfmale. Comment elle fe forme. Ibid. b. Trar-j
tement & opération de cette tumeur. Ibid. 457. <z. Remarque
eflentielle de M. Foubert fur l’opération de l’anévryime
enkifté. Ibid. b.
Anévryfme, danger de la ligature de l’anévryfme du bras.
Remede qui en difpenfe & guérit parfaitement. I. 721. a.
Aiguille pour l’opération de l’anévrylme. 205. b. Caule de la
gangrene dans l’anévryfme faux. VH. 469. X