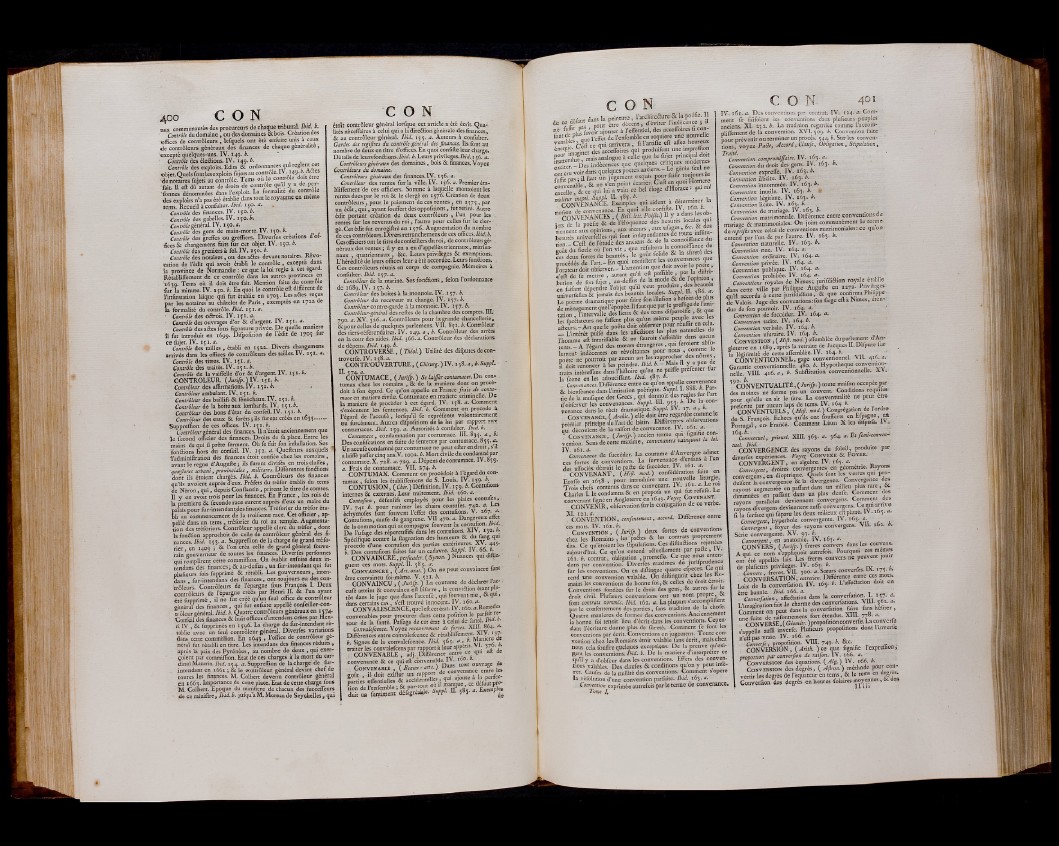
4 0 0 CON aux communautés des procureurs de chaque tribunal. Ibid.b.
Contrôle du domaine, ou des domaines oc bois. Création des
offices de contrôleurs , lefquels ont été enfuite unis «i çeux
de contrôleurs généraux des finances de chaque généralité.
excepté quelques-uns. IV. 149. b.
Contrôle des éleâions. IV. 149. b. g • , §3 .
Contrôle des exploits. Edits 8c ordonnances qui reg e
o b j e t .Q u e k f o n t l e s e x p lo i t s fu j e t s a u c o n t r o l e .lv . 1 4 9 . .
denoudres fujets au contrôle. Tems ou le coniraijgô.iPjttc
fcir. Il eft du autant de droits de contrôle qu d y a de per
•donnes dénommées dans ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ g La formalité du contrde
des exploits n'a pas été établie dans tout le royaume en mente
tems. Recueil à confulter. 150. <t.
1 Contrôle des finances. IV. g 50. b.
Contrôle des gabelles. IV. 150. b.
Contrôle général. IV. 150. a.
■ Contrôle des gens de main-morte. IV. içq. .
Contrôle des greffes ou greffiers. Diverfes créations d 01-
rices Sc changemens faits for cet objet. IV. 150. b.
Contrôle des greniers à fel. IV. 150. b.
Contrôle des notaires, ou des aftes devant notaires. Révocation
de l’édit qui avoit établi le contrôle , excepté dans
la province de Normandie : ce que la loi réglé à cet égard.
Rétabliffement de ce contrôle dans les autres provinces en
1639. Tems où il doit être fait. Mention faite du contrôle
fur la minute. IV. 150. b. En quoi le contrôle eft différent de
l’infinuation laïque qui fut établie en 1703. Les actes reçus
£ar les notaires au châtelet de Paris, exemptés en 172a de
1 formalité du contrôle, lbid. i ç i .a.
• Contrôle des oftrois. IV. .
Contrôle des ouvrages d’or 8c d’argent. IV. xçi. a.
Contrôle des aftes fous fignature privée. De quelle manière
il fut introduit en 1699. Difpofition de l’édit de 1705 fur
ce fujet. IV. 131. a.
Contrôle des tailles, établi en 1522. Divers changemens
arrivés dans les offices de contrôleurs des tailles.IV. i ç i -a.
Contrôle des titres. IV. 151. a.
Contrôle des traités. IV. 151. b.
Contrôle de la vaiffelle d’or 8c d’argent. IV. 151. b.
CONTROLEUR. {Jurifp-) IV. 1.51. b.
Contrôleur des affirmations. IV. 151. b.
Contrôleur ambulant. IV. 151. b.
Contrôleur des baillifs 8c fénéchaux. iV. iç i. é.
Contrôleur de la boîte aux lombards. IV. 151 .b.
Contrôleur des bons d’état du confeil.IV. i r i . b.
Contrôleur des eaux 8c forêts ; ils furent créés en 163 5
Suppreffion de ces offices. IV. i<i. b.
Contrôleur général des finances. Il n’étoit anciennement que
le fécond officier des finances. Droits de fa place. Entre les
mains de qui il prête ferment. Où fe fait fon inftallation. Ses
fondions hors du confeil. IV. 152. <*. Quefteurs auxquels
Tadminiftration des finances étoit confiée chez les romains ,
avant le regne d’Augufte ; ils furent divifés en trois claffes,
auæflores urbnni, provinciales , militares. Différentes fondions
dont ils étoient chargés, lbid. b. Contrôleurs des finances
qu’ils avoient auprès d’eux. Préfets du tréfor établis du tems
de Néron, qui, depuis Conftantin, prirent le titre de comtes.
Il y en avoit trois pour les finances. En France, les rois de
la première 8c fécondé race eurent auprès d’eux un maire du
palais pour fur-intendant des finances. Tréforier du tréfor établi
au commencement de la troifieme race. Cet officier, appellé
dans un tems , tréforier du roi au temple. Augmentation
des tréforiers. Contrôleur appellé clerc du tréfor , dont
la fonftion approchoitde celle de contrôleur général des finances.
lbid. 153. a. Suppreffion de la charge de grand tréforier
en 1409 ; 8c l’on créa celle de grand général fouve-
rain gouverneur de toutes les finances. Diverfes perfonnes
qui remplirent cette commiffion. On établit enfuite deux in-
tendans des finances; 8c au-deffus , un fur-intendant qui fut
plufieurs fois fupprimé 8c rétabli. Les gouverneurs, rnten-
dans fur-intendans des finances, ont .toujours eu des contrôleurs.
Contrôleurs de l’épargne fous François I. Deux
contrôleurs de l’épargne créés par Henri II. 8c lun ayant
été fupprimé , il ne fut créé qu’un feul office de contrôleur
général des finances, qui fut enfuite appellé confeiller-con-
trôleur général. lbid. b. Quatre contrôleurs généraux en 1374.
Confeil des finances 8c huit offices d’intendans crées par Henri
IV , 8c fupprimés en 1596. La charge de fur-intendant rétablie
avec un feul contrôleur général. Diverfes vananons
dans cette commiffion. En 1643 , l’office de contrôleur général
fut rétabli en titre. Les intendans des finances réduits,
après la paix des Pyrénées, au nombre de deux, qui exer-
çoient par commiffion. Etat de ces charges à' la mort du cardinal
Mazarin. lbid. 154. a. Suppreffion de la charge de fur-
intendant en 1661 ; oc le contrôleur général devint chef de
toutes les finances. M. Colbert devenu contrôleur général
en 1663. Importance de cette place. Etat de cette charge fous
M. ColDert. .Epoque du miniftere de chacun des fucceffeurs
de ce miniftre, lbid. b. jufqu’à M. Moreau de Seychelles, qui
C O N
étoit contrôleur général lorfque cet article a été écrit. Qualités
néceffaires à celui qui a la direélion générale des finances ,
& au contrôleur'général. lbid. tçç. a. Auteurs à confulter.
Gardes des regiflres du contrôle général des finances. .Ils font au
nombre de deux en titre d’offices. En quoi confifte leur charge*
Détails de leurs fonftions. lbid. b. Leurs privilèges. Ibid.i 56. a.
Contrôleurs généraux des domaines, bois 8c finances. Voyez
Contrôleurs du domaine.
Contrôleurs généraux des finances. IV. 156. a.
Contrôleur aes rentes fur la ville, IV. 156. a. Premier éta-
bliffement 'de ces .officiers. Somme à laquelle montoient les
rentes dues par le roi 8c le clergé en 1576* Création de deux
contrôleurs, pour le paiement de ces rentes , en 1575 , par
un édit, qui, ayant fouffert des oppofitions , fot retiré. Autre
¿dit portant création de deux contrôleurs , l’un pour les .
rentes fur les revenus du roi, l’autre pour celles fur. le cler-
gé. Cet édit fut enregiftré en 1 $76. Augmentation du nombre
de ces contrôleurs. Divers retranchemens de ces offices./¿h/, b.
Ces officiers ont le titre de confeillers du roi, de. contrôleurs gé- .
néraux des rentes ; il y en a eu d’appellés triennaux, mitrien-
naux , quatriennaux , 8cc. Leurs privilèges 8c exemptions.
L’hérédité de leurs offices leur a été accordée. Leurs fon&ions. .,
Ces contrôleurs réunis en corps de compagnie. Mémoires à
confulter. lbid. 157. a.
Contrôleur de la marine. Ses fondions, félon 1 ordonnance
de 1689. IV. 157. b ..
Contrôleur des boîtes à la.monnoie. IV. .157. b.
Contrôleur du receveur au change. IV. 157. b.
Contrôleur contre-garde à la momxoie.IV. 157. b.
Contrôleur-général des reftes de la chambre des comptes. IH.
790. a. XV. 326. a. Contrôleurs pour la grande chancellerie,
8c pour celles de quelques parlemens. Vil. 8çi. b. Contrôleur ;
des tiers-référendaires. IV. 149. a , b. Contrôleur des arrêts
en la cour dés rides, lbid. 3 66. a. Contrôleur des déclarations
de dépens, lbid. 149. b. .
CONTROVERSE, ( Théol. ) Utilité des difputes de con-
troverfe. IV. iç8.<i. .. I ‘
CONTR’OUVERTURE, ( Chirurg.) IV. 138. <*, b. Suppl.
H. 574.a. -
CONTUMACE, ( Jurifp. ) Se laijfer contumacer. Du con« .
tumax chez les romains , 8c de, la maniéré dont on procé-
doit à fon égard. Ce qu’on appelle en France frais de contumace
en matière civile. Contumace en matière criminelle. De
ou iuiwciucm. nui.» Jifpofitions de la loi par rapport aux
contumaces, lbid. 1 59. a. Autorités à confulter. lbid. b. . .
Contumace, condamnation par contumace. III. 835. <*, b.
Des confifcations en fuite de lentence par contumace. 855. a.
Un accufé condamné par contumace ne peut efter en droit, s il
a laiffé paffer cinq ans.V. 1002. b. Mort civile du condanmé par
‘ contumace. X. 728. a. 729. a. Dépens de contumace. IV. 859.
a. Frais de contumace. VII. 274. b.
CONTUMAX. Comment on procédpit à l’égard du con-
tumax, félon les établiffemens de S. Louis. IV. 159. b.
CONTUSION, ( Chir.) Définition. IV. 159. b. Contufions
internes 8c externes. Leur traitement. lbid. 160. a.
Contufion, défenfifs employés pour les plaies contules,
IV. 741 b. pour ranimer les chairs contufes. 742. a- Lcs
échymofes lont fouvent l’effet des contufions. V. 267. a.
Contufions, caufe de gangrene. VII 470. a. Dangereux effet
de la commotion qui accompagne fouvent la connmon. ma. .
De l’ufage des répereuffifs dans les contufions. I3°*
Spécifique contre la ftagnation des humeurs 8c du lriig qui
procédé d’une contufion des parties extérieures. AV. 445.
b. Des contufions frites fur un cadavre. Suppl. IV. 66. b.
CONVAINCRE, perfuader. {Synon. ) Nuances qui divulguent
ces mots. Suppl. II. 585. a. |
C o n v a i n c r e , {Art. orat. ) On ne peut convaincre fans
être convaincu foi-même. V..521. b. .
CONVAINCU, ( Jurifp. ) La coutume de déclarer lac- -
eufé atteint 8c convaincu eft bifarre , la coriviélion étant plutôt
dans le juge que dans l’accufé , qui fouvent nie, 8c qui,
dans certains cas , s’eft trouvé innocent. IV. 160. a._
CONVALESCENCE, quel eftxet état. IV. 160. a. Remettes
convenables pour procurer dans cette pofition le P 0M ,re'
tour de la fanté. Faffage de cet état à celui de lanté. •
Convalefcence. Voyez recouvrement de forces. XIII-op4-- *
Différences entre convalefcence 8c rétabliffement. Aiy*
b. Signes de la convalefcence. lbid. 565. a , b. Mamcr
traiter les convalefcens par rapport à leur appétit. . 37 • •
CONVENABLE , adj.^Diffé rence mitre c e qui elt de
convenance 8c ce qui eft convenable. IV. tào. • ^
Convenable enfre 1«
gout , il doit exifter un rapport ae . . ceç.
manque, ce défau.prv
CON C O N 4 0 1
'Jlftni dans la peinture, l'architeaure & la poéfte.Il
de ce defant décent, d'éviter 1 indécence ; il
ne ajouter à l'eflcntlel, des acceffoiresfi confaut
de plu ff de penfembie en acquière une nouvelle
Tena v fc'eft ce qui arrivera , fi l’arrifte eft affea heureux
énergie. • es qui produifent une impreflion
inattendue,- 8 quelques critiques modernes
eK,‘ ™ s tur dan quelculcs p ris anciens.8 L i génie feul ne
r ffiÎ oas ■ U fiut un jugement exquis pour faifir toujours le
«mvenable & ne s’en point écatter. C’eft en quoi Homere
excelle , & ce qui lui a valu ce bel éloge d’Horace : }u. ml
Lxcmpies qui aident à déterminer la ¡ItaïStfgÊ
goût du fiecle ou Ion v i t , que reiuuci - ¿es JüEÿRÎ.» Forateur doit obferver. - Attention que do t avour le: poet^,
c’eft de fe mettre ,
de ménagement quel'épopée.D 6utquepar le prefttgedelimi-
«dou , l’intervalle deS lieux & des tems d.fparo.<re . &^que
les fpeilateurs ne faffent plus qu’un même peuple avec les
afteurs. - Art que le poëte doit obferver pour réuflir en cela.
L’intérêt puifé dans les affeaions les plus naturelles de
l’homme efttatariffable & ne fauroit s^aiod.br dans aucun
tems - A l’égard des moeurs étrangères, qui ferment ablm
lument indécentes ou révoltantes pour .
poëte ne pourrait par aucun art les rapprocher des nStres,
5 doit renoncer à les peindre, lh i . b- - Mais l y i p ™ I
traits intêreffans dans l’hiftoire quon ne puiffe préfenter lur
la feene en les adouciffant.. Convrnencrr.Différence en tlrbei dc.e çq8u^o. nb .a ppelle ç_o_n_v_en Mce 1
6 bienféance dans l’imitation poétique. Suppl. 1. 888- »• rar
de de la mufique des Grecs, qui donnoit Jes reries fur 1«
d’obfervér les convenances. Suppl. III. 913. b. De la_con
venance dans le récit dramatique. Suppl. IV. 1 7 . a , ».
C o n v e n a n c e , ( Archit.) elle don être regardée comme le
premier principe de l’art de bâtir. Différentes obfervauons
qui découlent de la raifon de convenance. IV. 161. u.
C o n v e n a n c e , {.Jurifp.) ancien terme qui figmfie convention.
Sens de cette maxime, convenantes vainquait la loi.
W ’Convenance de fuccéder. La coutume d’Auvergne admet
ces fortes de conventions. L a furvenance d enSns à 1 un
des affociés détruit le pafte de fuccéder. IV. 161. a.
CONVENANT, IHijl. moi.) confedéranon faite en
Ecoffe en 1638 , pour introduire une nouvelle 1“ “^ ' :
Trois chefs contenus dans ce convenant. IV. ro‘
Charles 1. le condamna & en propofa un qui t o refufé. Le
cônvenant figné en Angleterre en 164^. Voyez Co v e n a n t .
CONVENIR, obfervationfurla conjugaifon de ce verbe.
^CONVENTION, confentement, accord. Différence entre
* C o n v e n t i o n , (.Jurifp.) deux fortes de convennons 1
cher les Romains , les’ paries & les t g g g i PTOP'e," i " ‘ I
dits. Ce qu’étoient les flipulations. Ces diflinriions rejettees 1
aujourd’hui. Ce qu’on entend usuellement par parie, IV. I
161. b. contrat, obligation , promeffe. Ce que nous enten 1
dons par convcnrion. Diverfes maximes de junfprudence
fur les conventions. On en diftingue quatre efpeces. Ce q
rend une convention valable. On diltinguoit chez les Kc-
mains les conventions de bonne foi, 8c celles de droit etro,t- |
Conventions fondées fur le droit des gens, 8c autres lur le
droit civil. Plufieurs conventions ont un nom propre, oc
font contrats nommés. lbid. 162. a. La plupart s’accomplnlent
par le confentement des parties, fans tradition de la choie.
Quatre maniérés de former des conventions. Anciennement
la bonne foi tenoit lieu d’écrit dans les conventions. Cependant
l’écriture donne.plus.de fureté. Comment fe font les
conventions par écrit. Conventions en jugement. Toute convention
chez les Romains étoit valable lans écrit, mais chez
nous cela fouffre quelques exceptions. Dé la preuve qu’exigent
les conventions, lbid. b. De la maniéré d’interpréter ce
qu’il y a d’obfcur dans les conventions. Effets des conventions
valables. Des claufes 8c conditions qu’on y peut inférer.
Caufes de la nullité des conventions. Comment s opere
la réfolution d’une convention parfaite. lbid. 163. a.
Convention exprimée autrefois par le ternie de convenance.
Tome I, ,
IV. 161. a. Des conventions par contrat. IV. 124- <*• Comment
fe faifoient les conventions chez plufieurs peuples
anciens. XI. 232. b. La tradition. regardée comme l’accom-
pliffement de la convention. XVI. 509. b. Convention frite
pour prévenir ou terminer un procès. 5 44. b. Sur les conventions,
voyez Pafle, Accord, Claufe, Obligation , Stipulation ,
Traité. - . _ „ .
Convention compromijfatre. I V. 103. a.
Convention du droit des gens. IV. 163. b.
Convention expreffe. IV. 163. b.
Convention illicite. IV.
Convention innommée. IV. 163. b.
Convention inutile. IV. 163. b. *■
Convention légitime. IV. 163. b.
Convention licite. IV. 163. b.
Convention de mariage. IV. 163. b.
Convention matrimoniale. Différence entre conventions de
! mariage 8c matrimoniales. On joint communément le terme-
de reprifts avec celui de conventions matrimoniales: ce quon
entend par l’un 8c par l’autre. IV. 163. b.
Convention naturelle. IV. 163. b.
Convention nue. IV. 164. a-
Convention ordinaire. IV. 164*
Convention privée. IV. 164. a. ■
Convention publique. IV. 164. a.
Convention prohibée. IV. 164. a. , '
Conventions .loyales dë Nimcs; jurifdiriion royxle é^hhe
dans cette ville par Philippe Augufte en 117*- g gj g g g
qu’il accorda à cette jurifdiriion, & que eonfirina^PM'PP'
de Valois. Juge des conventions: fon fiege eft a Nîmes, éten.
due de fon pouvoir. IV. 164. a.
Convention de fuccéder. IV. 164. a.
Convention tacite. IV. 164. b.
Convention verbale. IV. 164. b.
Convention ufuraire. IV. 164. b.
C o n v e n t i o n , ( Hifi. mod. ) affemblee du parlement d Angleterre
en 1689, après la retraite de Jacques II. Difpute fur
la légitimité dé cette affemblée. i y . 164. b. '
CONVENTIONNEL, gage conventionnel, v u . 410. a.
Garantie conventionneUe. 480. b. Hypothéqué conventionnelle.
VHI. 416. a y b. Subftitution convennonneüe. a v .
59CONVENTUALITÉ, {Jurifp.) toute maifon occupée par
des moines ne forme pas un couvent. Cmndii
pour qu’elle en ait le titre. La conventuahtè ne peut être
Drefcrite par aucun laps de tems. IV. 164■ \
I CONVENTUELS, (Hijl. moi.) Congréganoeide 1 ordre
de S. François. Echecs quils ont foufferis en Efpagne, en
Portugal, en- France. Comment Léon X les difpofa. IV.
16Conventuel, prieuré. XIII. 3*3- *• 3^4- ^ ^ femi-conven- I tUCONVERGENCE des rayons du foleft, produite par
I diverfes expériences. Vryrr Convexe & Fover.
CONVERGENT, en algèbre. IV. i6y a.
\ Couver¡cm, droites convergentes en géométrie. Rayons
1 convergens, en dioptrique. Quels font les verres qui pro
1 duifent la convergence & la divergence. Convergence d« I rayons augmentée enpaffantdans “n ,m,'ieu J 1“
diminuées en paffant dans un plus denfe. Commen des I ravons parallèles deviennent convergens. Comment des 1 rayons divergens. deviennent aufli converecns. Ce mn arnve
fi la furface qui fépare les deux imlieux eft plane. IV. 163. a.
Convergent, hyperbole convergente. IV. ,
Convergent, foyer des rayons convergens. VII. a6a. b.
Série convergente. XV. 93. b.
Convergent u en anatomie. IV. 165• a.
CONVERS, ( Jurifp. ) freres convers dans les couvens*
A oui ce nom s’appliquoit autrefois. Pourquoi ces memes
on?ïté appêïés f i s l e s freres convers ne peuvent jornr
Convrrr rS freres'vll. fe .'^ Soe urs eonverfes. IX. f R
CONVERSATION, entretien. Différence entre ces mors.
I Loix de la eonyerfation. IV. 165: b. L’afferianon doit en
être bannie, .lbid. 166. a. ^ _ .
Converfation, affeftation dans la converfanoml. 137* g
L’imagination fait le charme des convergions. Vni. |6a_ -<.
Comment on peut dans la eonverfanon finre fans héfiter , II une fuite de raifonnemens fort étendus. XIII. 778. a. < 'ON VERSE, ( Giornc’.r. ) propofmor. convenu. La convcriè 1 s’appeUe aufli inverfe. Plufieurs propofitions dont 1 mverfe II .n ’eCfto pnavse rvfrea, iep.r oIpVo.f in1o6n6.. Va.III. 749- b. &c.
CONVERSION, (Arttk. ) ce que figmfie lexpreffton, I proportion par converfton i t raifon. Vf. 166. a. .
II C o n v e r s i o n des équations. (Alg.) IV. too. 0. C o n v e r s i o n des degrés, ( A (Iron.) méthode pour con-
I vertir les degrés de l’èquateur en tems, & le rems en degres.
I Converfton des degrés en heures folaires moyennes, de de*