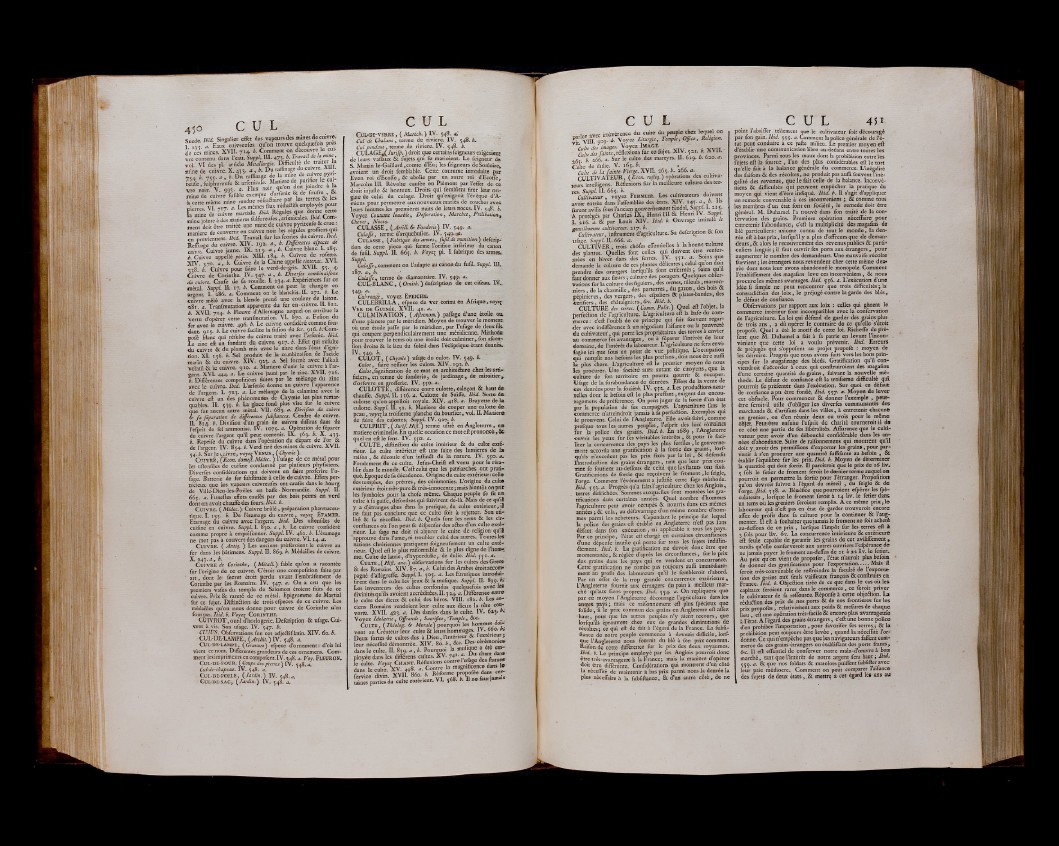
450 C U L
Suède Ibid- Singulier eflfet des vapeurs des mines de cuivre.
T « t a. Eaux cuivreufes qu’on trouve quelquefois près
de ces mines. XVII. 714. *• Gomment on découvre k ciu-
vre contenu dans Veau. Suppl III. 473; Travail de la ,
vol. VI des pl. article Métallurgie. Difficulté de traiterla
mine de cuivre. X. 433. a , b. Du raffinage du cuivre. XU1.
734. b. 755. a , b. Du raffinage de la mine de c“,vr®PX""
leufe fulphureufe 8c arienicale; Manière de purifier le cul
W ¿fin V. 993* * T1"1 ¿o.t joindre à £
Itfiiie de cuWre^ufible exempre
pie“ ' LesmÊmes flux réiiffifsemployés pour Fà mlue de euiv» marfiale. OU. Régules « e donne ceue
mine jointe à des nlarieres fulfureufes,arfcmcales. ÛldgQgm?
ment doit être traitée une mine de cuivre pyrueufe 8c crue,
maniéré de convertir en cuivre noir les régules greffiers qui
en proviennent, Ibid. Travail,fur tefeones du cuivre. M
Reffiiage du cuivre. XIV. 19a. a, b. Différentes efpeces de
cuivre. Cuivre jaune. IX. 213. a , b. Cuivre blanc. I. 285.
b. Cuivre appellè potin. XIII. 184. É ^ul.Yre. de r°vÎn‘
XIV. 370. a t b. Cuivre de la Chine appelle ummae. AVI.
418. b. Cuivre pour faire le verd-de-gris. XVU. 55. *.
Cuivre de Corinthe. IV. 347- « » b- Diverfes combinaisons
du cuivre. Caufe de fa rouille. I. 234. a. Expériences fur ce
métal. SuppL H. 17. é. Comment on peut le changer en
argent L 286, a Comment on le blanchit. -II. 272. b. Le
cuivre mêlé avec la blende prend une couleur de laiton,
2.81. a. Tranfmutatiort apparente du fer en.cuivre. IL 812.
b, XVII. 714. b. Fleuve d’Allemagne auquel on attribue la
vertu d’opérer cette tranfinutation. VI. 070. a. Fufion du
fer avec le cuivfe. 496. b. Le cuivre conuderé comme fondant.
913. b. Le cuivre facilite la fufion du fer. 916. f. Com-
pofé blanc qui réiulte du cuivre traite avec larfenic. Ibid.
Le zinc eft un fondant du cuivre. 917. b. Effet qui réfulte
du cuivre 8c du plomb mis avec le nitre dans létat digni-
tion XL 136. b. Sel produit de la combinaifon de l’acide
marin 8c du cuivre. XIV. 923, a Sel formé avec l’alkali
volatil 8c le cuivre. 910. a. Maniéré d’unir le cuivre a Urgent.
XVL 444. a. Le cuivre jauni par le zinc. XVII. 716.
b. Différentes compofitions faites par le mélange du zinc
avec le cuivre. Ibid. L’arfenic donne au çuivre Tapparence
de l’argent. L 713. a. Le mélange de la calamine avec le
cuivre eft un des phénomènes de Chymie les plus remar-
quables. II. 339. b. La glace fond plus vite fur le cuivre
que fur aucun autre métal. VII. 683. a. Divifion du cuivre
& fa feparation de différentes fubfiances. Cendre de cuivre.
II. 814. b. Divifion d’un grain de cuivre diffous dans de
l’efprît de fel ammoniac. IV. 1073. a. Opération de féparer
du cuivre l’argent qu’il peut contenir. IX. 363. b. X. 433.
b. Reprife du cuivre dans l’opération du départ de l’or 8c
de l’argent. IV. 834. b. Verd tiré des mines de cuivre. XVIL
54. b. Sur le ici vre, voye[ VÉNUS, ( Chymie ).
CUIVRÉ, (Econ. dôme fi. Médec. ) l’ufage de ce métaL pour
les ufienfiles de cuifine condamné par plufieurs phyficiens.
Diverfes confidérarions qui doivent en faire proferire l’u-
fage. Batterie de fer fubffituée à celle de cuivre. Effets pernicieux
que les vapeurs cuivreufes ont caufés dans le bourg
de Ville-Dieu-les-Poëles en baffe - Normandie. Suppl. IL
663. a. Funeftes effets caufés par des bois peints en verd
dont on avoit chauffé- des fours. Ibid. b.
C u i v r e . {Médec.) Cuivre brûlé, préparation pharmaceutique.
I . 133. b. De l’étamage du cuivre, voyer É t a m e r .
Etamage du cuivre avec l’argent. Ibid. Des ufienfiles de
cuifine en cuivre. Suppl. L 830. a , b. Le cuivre confidéré
comme propre à empoifonner. SuppL IV. 462. b. L’étamage
ne met pas à couvert des dangers du cuivre. VI. 14. a.
C u iv r e . ( Antiq. )• Les anciens préféroient le cuivre au
fer dans les bâtimens. Suppl. IL 869. b. Médailles de cuivre.
X. 243. a y b.
C u i v r e «* Corinthe, {MétalL) fable qu’on a racontée
fur l’origine de ce cuivre. G’étoit une compofidon faite par
' art, dont le/ fecret étoit perdu, avant l’embrâfement de
Corinthe par les Romains. IV. 347. a. On a cru que les
premiers vafes du temple de Salomon étoient faits de ce
cuivre. Prix & rareté de ce métal. Epigramme de Martial
fur ce fujet. Diffinâion. de trois efpeces de ce cuivre. Les
médailles qu’on nous donne pour cuivre de Corinthe n’en
font pas. Ibid. b. Voyer CORINTHE.
CÙ1VR0T,outil d’horlogerie. Defcription 8c ufage. Cui-
vrot à vis. Son ufage. IV. 347. b.
CUJÜS. Obfervations fur. cet adjeâif latin. XIV. 60. b.
CUL-DE-LAMPE, (Archit.)W. 348. a
C u l -d e -l a m p e , | Gravure) efpece d’ornement: d’où lui
vient ce nom. Différentes grandeurs de ces ornemens. Comment
lesimprimeursen compofent.IV. 348. a. Voy. F l e u r o n .
C u l -d e -f o u r . {Coupe-des pierres) IV. 348. a.
Çulrde-chapeau. IV. 348. a.
CuL-DE-POELE , {Jardin.) IV. 548. a.
C u l -d e -SA C , {Jardin.) IV. 548. a.
C U L
CüL-DE-VERRE, ( Maréch. ) IV. 348. ai
Cul de Chalans, terme de riviere. IV. 348. b.
Cul pendant y terme.de riviere. IV. 348. b.
CuLA.GEjfJurifp. ) droit que certains feigneurs exigeaient
dé leurs vaflaux 8c fujets qui fe marioient. Le feigneur de
; S. Martin le-Gaillard,comte d’Eu; les feigneurs de Sonloire*
avoient un droit femblable. Cette coutume introduite par
Even roi d’Ecoflè, 8c abolie par un autre roi d’Ecoffe,
Marcolm 111. Révolte caufée en Piémont par l’effet de ce
droit injufie 8c honteux. Droits qui femblent tirer leur origine
de celui du culage. Droit qu’exigeoit l’évêque d’Amiens
pour permettre aux nouveaux mariés de coucher avec
leurs femmes les premières nuits de leurs noces. IV. 548. b.
Voyez Coutume louable, Défloration y Marchett Prélibation. 9
Chevet, Noces»
CULASSE, {ArtilL 6* Fonderie) IV. 549. a.
Culaffe s terme d’arquebufier. IV. 349.*?.
CULASSE, {Fabrique des armes, fujîl de munition) deferip-'
tion de cette piece qui ferme l’orifice inférieur du canon
de fufil. SuppL II. 663. b. Voyei pL I fabrique des armes*
Suppl. ■
Culaffe, comment on l’adapte au canon du fufil SuppL I1L
187. a>y bi
Culaffe, terme de diamantaire. IV. 349. a.
CUL-BLANC, ( Omith. ) defcription de cet oifeau. IV..
349. a.
Cul-rouge, voyez ËPEICHE»
CULEBRILLA, efpece de Ver torintién Afrique, voye^
V e r d e G u in é e . XVII. 4t. a.
CULMINATION, {Afironom.) paffage d’une étoile on
d’une planete par le méridien. Moyen de trouver le moment
où une étoile paffe par le méridien, par l’ufage de deux fils
qui coupent perpendiculairement une méridienne. Méthode
pour trouver le tems où une étoile doit culminer, fon afeen-
fion droite 8c le lieu du foleil dans l’éclipdque étant donnés.
c h t o i { Chymie) ufage du culot. IV. 349.
Culot y faire reffuer les culots. XIV. 192. b.
Culot jfignifîcation de ce mot en architecture chez les artificiers
, en terme de fonderie, de jardinage, de miroitier,
d’orfevre en grofferie. IV. 330- a-
CULOTTE, différence entre culotte, câlâçotl 8c haut de
chauffe. SuppL II. 116. a. Culotte de Suiffe. Ibid. Sorte de.
culotte qu’on appelloit royale. XIV. 418. a. Brayette de la
culotte. Suppl. IL 51. b. Maniéré de couper une culotte de
peau,ypyeçla troiueme planche dubourfier, vol. II.Manier«
de faire des culottes, Suppl. IV. 927. b.
CULPR1T , { Jurifl Hijl. ) terme ufité en Angleterre , eu
matière criminelle. En quelle occafion ce mot efi prononcé , 8c
quel en eft le fens. IV. 3 50. a.
CULTE, diftinâion du culte intérieur 8c du culte exté-'
rieur. Le culte intérieur eft une fuite des lumières de la
raifon, 8c découle d’un inftinâ de la nature. IV. 330. aj
Fondement de ce culte. Jefus-Chrift eft venu pour le rétablir
dans le monde. C’eft celui que les patriarches ont pratiqué.
Epoque de fa décadence. Origine du culte extérieur: celle
des temples, des prêtres, des cérémonies. L’origine du culte
extérieur étoit très-pure & très-innocente ; mais bientôt on prit
les fymboles pour la chofe même. Chaque peuple fe fit un
culte à fa guife, défordres qui fuivirent de-là. Mais de ce qu’il
y a d’étranges abus dfcns la pratique, du culte extérieur, il
ne faut pas conclure que ce culte foit à rejetter. Son utilité
8c fa néccffité. Ibid. b. Quels font les tems 8c les cir-
conftances où l’on peut fe difpenfer des aâes d’un culte exté--
prieur. Le fage ne doit ni abjurer le culte de religion qu’il
approuve dans l’ame, ni troubler celui des autres. Toutes les
nations chrétiennes pratiquent foigneufement un culte extérieur.
Quel eft le plus raifonnable 8c le plus digne de l’homme.
Culte de latrie, d’hyperdulie, de dulie. Ibid. 331. a.
C u l t e , ( Hift. anc.) obfervations fur les cultes des Grecs
8c des Romains. XIV. 87. a, b. Celui des Arabes étoit accom*
pagné d’allégreffe: Suppl. I. 303. a. Les Etrufques introdui-
firent dans le culte les jeux 8c la mufique. Suppl. II. 899. bi
Les inventeurs des cultes confondus quelquefois avec les
divinités qu’ils avoient accréditées. II. 324. a. Différence entre
le culte des dieux 8c celui des héros. VIII. 182. b. Les anciens
Romains rendoient leur culte aux dieux la tête couverte.
XVIL 423. a. Des danfes dans le culte. IV. 623. bi
Voyez Idolâtrie y Offrande, Sacrifice y'Temple y 8cc.
C u l t e , {Théolog. & Morale) pourquoi les hommes doivent
au Créateur leur culte 8c leurs hommages. IV. 660. «
Deux fortes de cultes dus à Dieu, l’intérieur 8c 1 exteneur,
leur néceffité démontrée. XIV. 80. b, 8cc. Des c r
dans le celle. II. 839• «. *- Pourquoi la •¡ “ HPKSwpm ^ 1 -******
C U L
Culte des images. Voyez IMAGE
Culte des joints t réflexions fur ce fujet. XIV. 321. ¿-A V i l .
b. 266. a. Sur le culte des martyrs. II. 619. b. 620. a.
ClCuüedededUl%bue Vierge. XVIL 263. L 266. a.
CULTIVATEUR, (Econ. ruft'iq.) opérauons des cultivateurs
intelligens. Réflexions fur la meilleure culture des terres.
SuppL IL 663. b. .
Cultivateur, voyez F e rm i e r . Les cultivateurs doivent
avoir entrée dans l’affemblée des états. XIV. 143- a > lls
furent avilis fous l’ancien gouvernement féodal, Suppl. 1. :213.
b. protégés par Charles IX, Henri III 8c Henri I V. Suppl.
I 216. a. 8c par Louis XIV, Ibid, b. Ouvrage intitulé le
gentilhomme cultivateur. 217. b. , . . . 0rf
Cultivateury infiniment d’agriculture. Sa defcnpnon 8c fon
II (^LtÎÎvER ÿ ^ttois chôfes effentielles à la bonne culture
des plantés. Quelles font celles qui doivent être renfermées
en hiver dans des ferres. TV. 331. a Soins que
demande la culture de ces plantes délicates ; celui guon doit
prendre des orangers lorfqu’ils font enfermés j foins qu il
faut donner aux fleurs ; culture des potagers. Quelques obfervations
fur la culture des figuiers, des ormes, tdleuls, marronniers
, de la charmille, des parterres, du gazqn, des bois 8c
pépinières, des vergers, des efpahers & plates-bandes, des
cerifiers, des châtaigniers, frc. Ibid. b. ,
CULTURE des terres. {Comm.Polit.) Quel eft 1 objet, la
berfeâion de l’agriculture. L’agriculture eft la bafe du commerce
: c’eft l’oubli de ce principe qui fait fouvent regarder
avec indifférence à un négociant l’aifance ou la pauvreté
du cultivateur, qui porte les propriétaires des terres à envier
au commerce fes avantages, ou à féparer l’intérêt de leur
domaine, de l’intérêt du laboureur. L’agriculture ne fera envi-
iàgée ici que fous un point de vue politique. L’occupation
qui remplit nos befoins les plus preflans, doit nous être aufli
la plus chere. L’agriculture eft le premier moyen de nous
les procurer. Une fociété aura autant de citoyens, que la
culture de fon territoire en pourra nourrir 8c Occuper,
Ufage de la furabondance de denrées. Effets de la vente de
ces denrées pour la fociété. IV. 332. a. Les produirions naturelles
dont le befoineft le pluspreffant,exigent des encou-
ragemens de préférence. On peut juger de la force d un état I
par la population dé fes campagnes. L’agricnlture fans le
commerce n’atteindroit jamais à fa perfeétion. Exemples qui
le prouvent. Celui de l’Angleterre. Elle avoitfuivi, comme
prefque tous les autres peuples, l’eforit des loix romaines
fur la police des grains. Ibid. b■. En 1689 , 1 Angleterre
ouvrit les yeux fur tes véritables intérêts, 8c pour le faciliter
la concurrence des pays les plus fertiles, le gouvernement
accorda une gratification à la fortie des grains, lorfi*
qu’ils n’excedent pas les prix fixés par la loi, 8c défendit ,
l’introduirion des grains étrangers, tant que leur prix courant
fe foutient au-deffous de celui que les ftatuts Ont fixé.
Gratifications de fortie que reçoivent le froment,lefeigle,
l’orge. Comment l’événement a juftifié cette fage méthode.
ibid. 333. a Progrès qu’a faits l’agriculture chez les Anglois,
terres défrichées. Sommes auxquelles- font montées les gratifications
dans certaines années. Quel nombre d hommes
l’agriculture peut avoir occupés 8c nourris dans ces mêmes
années18c cela, au défavantage d’un même nombre d’hommes
parmi les acheteurs. Cependant le principe fur lequel
la police des grains eft établie en Angleterre n eft pas fans ,
défaut dans fon exécution, «ii applicable à tous lespays.
Par ce principe, l’état eft chargé en certaines circonfbnces
d’une dépente inutile qui porte fur tous les fujets indiftin-
ôement. Ibid. b. La gratification ne devoit donc être que
momentanée, 8c réglée d’après les circonftances, fur le prix
des grains dans les pays qui en vendent en concurrence.
Cette gratification ne tombe pas toujours aufli immédiate-:
ment au profit des - laboureurs qu’il le fembleroit d’abord.
Par un effet de la trop grande concurrence extérieure,
L’Angleterre fournit aux étrangers du pain à meilleur marché
qu’aux fiens propres. Ibid. 334. a. On répliquera que
par ce moyen l’Angleterre décourage l’agriculture dans les
autres pays ; mais ce raifonnement eft plus fpécieux que
folide, fi le prix commun des grains en Angleterre eft affez
haut, pour que les autres peuples n’y aient recours, que
lorfqu’ils éprouvent chez eux de grandes diminutions de
récoltes ; ce qui eft de fait a l’égard de la France. La fubfi-
ftance de notre peuple commence à devenir difficile, lorf-
que l’Angleterre nous fournit du blé à fon prix commun.
Kaifon de cette différence fur le prix des deux royaumes.
Ibid. b. Le principe employé par les Anglois pourroit donc
être très-avantageux | la France; mais la maniéré d’opérer
doit être différente. Confidérarions qui montrent d’un côté
la néceffité de maintenir à bas prix parmi nous la denrée la
plus néceffaire à la fubfiftance, 8c d’un- autre côté, de ne
C U L 4 5 i
point i’abaiffer tellement que le cultivateur foit découragé
par fon gain. Ibid. 333. a Comment la police générale de l’état
peut conduire à ce jufte milieu. Le premier moyen eft
d’établir une communication libre au-dedans entre toutes les
provinces. Parmi tous les maux dont la prohibition entre les
fujets eft la fburce , l’un des plus confidérables eft le tort
qu’elle fait à la balance générale du commerce. L’inégalité
des faifons & des récoltes, ne produit pas aufli fouvent l’inégalité
des revenus, que le fait celle de la balance. Inconvè-
niens 8c difficultés qui peuvent empêcher la pratique du
moyen qui vient d’être indiqué. Ibid. b. Il s’agit d’appliquer
un remede convenable à ces inconveniens ; & comme tous
les membres d’un état font en fociété, le remede doit être
général. M. Duhamel l’a trouvé dans fon traité de la con-»
lervation des grain9. Première opération néceilàire pour
entretenir l’abondance, c’eft la multiplicité des magafins de
blé particuliers : axiome connu de tout le monde, la denrée
eft àbasprix,lorfqu’ily a plus d’offreurs que de demandeurs,
8c alors le recouvrement des revenus publics 8c particuliers
languit ; il faut ouvrir fes ports aux étrangers, pour
augmenter le nombre des demandeurs. Une mauvaife récolte
furvient ; les étrangers nous revendent cher cette même denrée
dont nous leur avons abandonné le monopole. Comment
l’établiffement des magafins leve ces inconvéniens, 8c noua
procure les mêmes avantages. Ibid. 336. <1. L’exécution d’une
idée fi fimple ne peut rencontrer que trois difficultés ; la
cohtradiâion des loix, le préjugé contre la garde des blés,
le défaut de confiance,
Obfervations par rapport aux loix : celles qui gênent le
commerce intérieur font incompatibles avec la confervation
de l’agriculture. La loi qui défend de garder des grains plus .
de trois ans , a dû opérer le contraire de ce qu’elle s’étoit
propofé. Quel a été le motif de cette loi. Richeffe du pré*
font que M. Duhamel a fait à fa patrie en levant l’inconvénient
que cette loi a voulu prévenir. Ibid. Erreurs
8c préjugés qui s’oppofent au projet propofé : moyen de
les détruire. Progrès que nous avons faits vers les bons principes
fur le magafinage des bleds. Gratification qu’il con-
viendroit d’aêcorder à ceux qui conftruiroient des magafins
d’une certaine quantité de grain9, fuivant la nouvelle méthode.
Le défaut de confiance eft la troifieme difficulté qui
pourroit fe préfentèr dans l’exécution. Sur quoi ce défaut
ae confiance a pu être fondé, Ibid. 337. a. Moyen de lever
cet obftacle. Pour commencer 8c donner l’exemple , peut-
être feroit-il utile d’obliger les diverfes communautés des
marchands 8c d’artifans dans les villes, à entretenir chacune
un grenier, ou d’en réunir deux ou trois pour le même
objet. Peut-être enfuite l’efprit de charité toumeroit-il d*
ce côté une partie de fes libéralités. Affurance que le cultivateur
peut avoir d’un débouché confidérable dans les années
d’abondance. Suite de raifonnemens qui montrent qu’il
doit y..avoir des permiffions d’exporter les grains, pour parvenir
à s’en procurer une quantité fuffifante au befoin , 8c
établir l’équilibre fur les prix. Ibid. b. Moyen de déterminer
la quantité qui doit fortir. Il paroîtroit que le prix de 16 liv.'
3 fols le fetier de froment feroit le dernier terme auquel on
pourroit en permettre la fortie pour l’étranger. Propofition
qu’on devroit fuivre à l’égard du méteil , du feigle 8c dé
l’orge. Ibid. 338. a Bénéfice que pourroient efpérer les ipé-
culateurs , lorfque le froment feroit à 14 liv. le fetier dans
un tems où les greniers feroient remplis. A ce même prix, le
laboureur qui n’eft pas en état de garder trouveroit encore
affez de profit dans fa culture pour la continuer 8c l’augmenter.
D eft à fouhaiter que jamais le froment ne foit acheté
au-deffous de ce prix, lorfque l’impôt fur les terres eft i
3 fols pour liv. &c. La concurrence intérieure 8c extérieure
eft feule capable de garantir les grains de cet aviliffement,
tandis qu’elle conferveroit aux autres ouvriers l'efpérance de
ne jamais payer le froment au-deffus de 21 à 22 liv. le fetier.
Au prix qu’on vient de propofer, l’état n’auroit plus befoin
de donner des gratifications pour l’exportation.....Mais il
feroit très-convenable de reftreindre la faculté de lexportar
tion des grains aux feuJs vaiffeaux françois 8c conftruits en
France. Ibid. b. Objeétion tirée de ce que dans le cas ou les
capitaux feroient rares dans le commerce, ce feroit priver
le cultivateur de fa reffource. Réponfe à cette objeôion. La
réduétion des prix de nos ports 8c de nos frontières fur les
prix propofés, relativement aux poids 8c mefures de chaque
lieu f eft une opération très-facile 8c encore plus avantageufe
à-l’état. A l’égard des grains étrangers, c’eft une bonne police
d’en prohiber l’importation, pour favorifer fes terres.; 8c la
prohibition peut toujours être levée , quand la néceffité l’ordonne.
Ce qui n’empêche pas que les navigateurs faffent commerce
de ces grains étrangers en établiffant des ports flancs,
6*c. Il eft effentiel de conferver notre main-d’oeuvre à bon
marché, tant que l’intérêt de notre argent fera haut ; Ibid.
339. a 8c que nos foldats 8c matelots puiffent fubfifteravec
leur paie médiocre. Comment on peut comparer l’aifance
des fujets de deux états, 8c mettrq à- cet égard lès- uns au