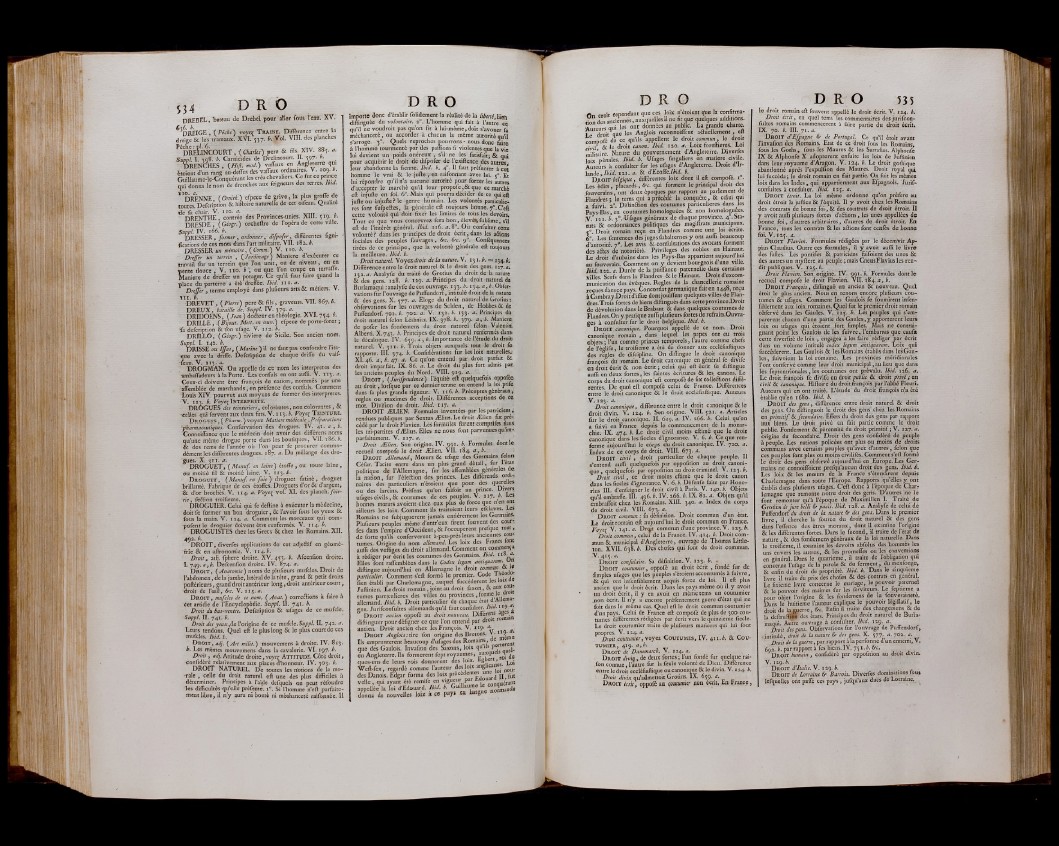
53 4 D R Ö
DREBEL, bateau de Drebel pour aller fous Veau. XV.
^DRÉIGE, { Pêche) voyez T r a în e . Différence entre la
drcige & les tramaux. XVI. 537. ¿. .Vol. V I I I .-des planches
^DRÉîliNCOURT, -( Charles) f t n & fils. XIV. 885. a.
Suppl. I. T 9& h. Carnicides de Drcüncourt. II. 597. b.
DRENCHES , (Hif. moi.') vafTïux en Angleterre qui
é,nient d'un rang ïn-deffits des vaflâûx ordinaires. V. toq- i .
Gutllattme-le-Conqucrant les créa chevaliers. Ce fut ce prince
qui donna le nom de drenches aux fcigneurs des terres, lbii.
"dR EN NE , ÎOmii/i.) cfpece de grive, la plus greffe de
toutes. Defcription & hiftoire naturelle de cet oifcau. Qualité
de fit chair. V. no. a. . , .
DRENTHE, contrée des Provmces-umes. Alll. 319■ b.
DRESDE, ( Géogr.) orcheftre de l’opéra de cette ville.
Suppl- IV. 166. b. ’ . .
DRESSER, former, ordonner, difpofer, différentes iigrn- •
fications de ces mots dans l’art militaire. VII. 182. b.
DRESSER un mémoire, {Comm.) V. iro. b.
Dreffer un terrein , {Jardinage) Maniéré d’exécuter ce
travail fnr un terrein que l’on unit, ou de niveau, ou on
pente douce , V. 110. b% ou que l’on coupe en terrafie.
Maniéré de dreffer un potager. Ce qu’il faut faire quand la
pTacc du parterre a été dreffée. Jbid. n i . a.
Dreffer , terme employé dans plufteurs arts & métiers. V.
" ¿R E V E T 9 ( Pierre) pere & fils, graveurs. VII. 867. b.
DREUX , bataille de. Suppl IV. 370. tf.
DRIDOENS, (Jean) docteur en théologie. XVI. 754- b-
DRILLE, XBijout. Mett. en auv.) efpece de porte-foret ;
Ta defcription oC’fûn ufage. V. 112. b.
DRILLO, {Géogr.) tiviere de Sicile. Son ancien nom.
P r i s s e 4*« ïjfas, (Marine ) i l ne faut pas confondre l’ita-
que avec la driffe. Defcription de chaque driffe du vaif-
feau. V . 113. a.
DROGMAN. On appelle de oc nom les interprètes des
ambaffadeurs à la Porte. Les confuls en ont aufii. V. 113. a.
Ceux-ci doivent être françois de nation, nommés par une
affemblée de marchands, en préfence des confuls.^ Comment
Louis XIV pourvut aux moyens de former des interprétés.
V . lia . b. Voyez INTERPRETE.
DROGUES des teinturiers, colorantes, non colo rante s , &
•celles qui fervent aux deux fins. V. u^.b. Voyez T e in t u r e .
D r o g u e s , {P/¡arm.) voyez Matière médicale , Préparations
"pharmaceutiques. Confervation des drogues. IV. 41. a , b.
Connoiffance que le médecin doit avoir des différens noms
qu’une même drogue porte dans les boutiques, VII. T 86. b.
& des tems de l’année où l’on peut fe procurer commodément
les différentes drogues. 187. a. Du mélange des drogues.
X. 311. a.
DROGUET, {Manuf. en laine ) étoffe , ou toute lame,
ou moitié fil & moitié laine. V. 113. b.
D r o g u e t , {Manuf. en foie )- droguet fariné, droguet
brillante. Fabrique de ces étoffes. Droguets d’or & d’argent,
& (For brochés. V. 114. a. Voyez vol. XI. des planch. foie-
rie, feftion troifieme.
DROGUIER. Celui qui fe deftine à exécuter la médecine,
doit fe former un "bon droguier, & l’avoir fous les yeux 8c
fous la main. V. 114. a. Comment les morceaux qui com-
pofent le droguier doivent être renfermés. V. 1x4. b.
DROGUISTES chez les Grecs & chez les Romains. XII.
492. b.
DROIT, diverfes applications de cet adjcâif en géométrie
& en aftronomie. V. 114. b.
Droit, adj. Fphere droite. XV. 433. b. Afcenfion droite.
1. 749. a, b. Defcenfion droite. IV. 874. a.
D r o i t , {Anatomie) noms de plufieurs mufclcs. Droit de
l’abdomen, de la jambe, latéral de fa tête, grand & petit droits
poftérieurs, grand droit antérieur long, droit antérieur court,
droit de l’oeil, bc. V. 115. a.
D r o i t , mufclcs de ce nom, { Anat. ) corrcélions à faire à
cet artidle de l’Encyclopédie. Suppl. fl. 741. b.
Droit du bas-ventre. Defcription 8c ufages de ce mufcle.
Suppl. II. 741. b.
Droit des yeux fie l’origine de ce mufcle. Suppl. II. 742. a.
Leurs tendons. Quel eft le plus long 8c le plus court de ces
mufcles. Ibid. b.
D r o i t , adj. {Art milit.) mouvemens à droite. IV. 8x3.
b. Les mêmes mouvemens dans la cavalerie. VI. 197. b. ^
Droit, adj. Attitude droite, voyez ATTITUDE. Côté droit,
confidéré relativement aux places d’honneur. IV. 303. b.
DROIT NATUREL. De toutes les notions de la morale
, celle du droit naturel eft une des plus difficiles à
déterminer. Principes à l’aide dcfqucls on peut réfoudre
les difficultés qu’elle préfente. x°. Si l’homme n’eft parfaitement
libre , il n’y aura ni bonté ni méchanceté raifônnée. Il
D R O
importe donc d’établir folidement la réalité de la liberté, Ken
diflinguée du volontaire. z°. L’homme « . , qi u—i —fait ~à »l ’«auutnree ccee
qu’il ne voudrait pas quon fît à lui-même,doit s’avouer fa
méchanceté, ou accorder à chacun la même autorité qu’il
s’arroge. 3®. Quels reproches pourrons - nous donc faire
à l'homme tourmenté par des partions fi violentes que la vie
lluuii /dleAvViÎeAnnt, uunn npnoiiddcs nonnéirrpeuiixv -, sc’iill nr/e> lIensc fCaiOtiSsCfa-“iMt; &a. qui
pour -acquérir le droit de difpofer de l’cxiftence -dés autres,
leur abandonne la ficnne. Ibid. b. 40. Il faut présenter à cet
homme le vrai & le jufte , en raifonnant avec lui. 50. Et
lui répondre qu’il n’a aucune autorité pour forcer les autres
d’accepter le marché qu’il leur propofc,8c que ce marché
eft injufte en foi. 6". Mais qui pourra décider de ce qui eft
jufte ou injufte ? le genre humain. Les volontés particulier
res font fufpeéles, la générale eft toujours bonne. 7°.Ceft
cette volonté qui doit fixer les limites de tous les devoirs.
Tout ce que vous concevrez fera bon, élcvé% fublime, s’il
eft de l’intérêt général. Ibid. 116. a. 8“. Où confulter cette
volonté? dans les principes de droit écrit, dans les aâions
focialcs des peuples fauvages, bc. bc. 9". Conféquences
tirées de ce principe, que Ta volonté générale eft toujours
la meilleure. Ibid. b.
Droit naturel. Voyez droit de la nature. V. 131. ¿. —• 134.
Différence entre le droit naturel & le droit des gens. 127. a,
13a.a. Analyfe du traité de Grotius du droit de la nature
& des gens. 128. b. 129. a. Principes du droit naturel de
Burlamaqui : analyfe de cet ouvrage. 133. b. 134. a, ¿. Observations
fur l’ouvrage de Puffcndorf, intitulé droit de la nature
& des gens. X. 577. a. Eloge du droit naturel de Grotius :
obfervations fur les ouvrages de Sclden, de HobbesÔc de
Puffendorf. 701. b. 702. a: V. 132. b. 133. a. Principes du
droit naturel félon Léibnitz. IX. 378. b. 379. a , b. Maniéré
de pofer les fondemens du droit naturel félon Valeniin
Albcrti. X.743. ¿.Principes de droit naturel renfermés dans.
le décalogue. IV. 659. a., b. Importance dé l’étude du droit
naturel. V. 311. b. Trois objets auxquels tout Je droit fe
rapporte. III. 374. b. Confidérations iùr les loix naturelles.
XI. 46. a, b. 47. a. Ce qu’on entend par droit parfait &
droit imparfait. IX. 86. a. Le droit du plus fort admis pat
les anciens peuples du Nord. VIII. 919. a.
D r o i t , (Jurifprudence) l’équité eft quelquefois oppolée
au droit, lorfque par ce dernier terme on entend la loi.prife
dans fa plus grande rigueur. V. 116. b. Préceptes généraux,
règles ou maximes de droit. Différentes acceptions de ce
mot. Divifion du droit. Ibid. 117. a. g
DROIT ÆLIEN. Formules inventées par les patriciens »
rendues publiques par Sextus Ælius. Le droit Ælien fut pré-,
cédé par le droit Flavien. Les formules furent comprifes dans,
les tri-partites d’Ælius. Elles ne nous font parvenues qulm-.
parfaitement. V. 117. a. 1
Droit Ælien. Son origine. IV. 991. b. Formules dont le
recueil compofe le droit Ælien. v il. 184. <x, ¿. :
D r o i t Allemand, Moeurs & ufage des Germains félon
Céfar. Tacite entre dans un plus grand détail, fur 1 état
politique de l’Allemagne, fur les affcmblées générales de.
la nation, fur l’éleétion des. princes. Les différends ordi-»
naires des particuliers n’étoient que pour, des querelles
ou des larcins. Préfcns qu’on faifoit au prince. Divers
ufagés civils ,& coutumes de ces peuples. V. 117. b. Les
bonnes moeurs avoient chez eux plus de force que nen ont
ailleurs les loix. Comment ils trairaient leurs efelayes. Les
Romains ne fubjuguerent jamais entièrement les Germains.
Plufieurs peuples même d’entr’eux firent fouvent des cour-,
fes dans l’empire d’Occident,& l’occuperent prefque tout,
de forte qu’ils conferverent à-peu-prés leurs anciennes cou-t
tûmes. Origine du nom allemand. Les loix des Francs lo
aufii des veftiges du droit allemand. Comment on commença
à rédiger par écrit les coutumes des Germains. Ibid.
Elles font raffcmblées dans le Codex legum antiquarum.vn
diftingue aujourd’hui en Allemagne le àtoit commun «
particulier. Comment s’eft formé le premier. Code l h
fien établi par Charlemagne, auquel fuccédercnt les loix ae
Juftinien. Le droit romain, joint au droit faxon, 8c aux cour
tûmes particulières des villes ou provinces, forme le uro
allemand. Ibid. b. Droit particulier de chaque état d Alie
gne. Ju ri feonfuites allemands qu’il faut confulter. Ibid. 119- ^
D r o i t ancien oppofé au droit nouveau. Différens aS .
diftinguer pour défigner ce que l’on entend par droit ro
ancien. Droit ancien chez les François. V. 1x9* a‘ a.
D r o i t Anglois : tire fon origine des Bretons. V.
Ils empruntèrent beaucoup d’ufages des Romains, oc
que des Gaulois. Invafion des Saxons, loix quils p j.
en Angleterre. Ils formèrent fept royaumes, auxque q_ ^
ques-uns de leurs rois donnèrent des loix. loi
weft-fex, regardé comme l’auteur des loix an6“^a. ’nW.
des Danois. Kgar forma des loix précédentes u
v d le , qui ayant été remife en
appcUée la foi d'Edauard. IbU. i- Gu,UaT ' ^ “ X a n d i
donna de nouvelles lobe à « paya en norrol
D R O D R O 535
On croit cependant que ces loix n’éroient que la confirmation
des anciennes, auxqucllesil ne fit que auelques additions.
•Auteurs qui les onr données au public. La grande charte.
| drojt que les Anglois reconnoiffcnt aâucllement, eft
«npofé de ce qu’ils appellent le droit commun, le droit
civil & le droit canon. Ibid. 120. a. Loix foreftieres. Loi
militaire. Nature du gouvernement d’Angleterre. Diverfes
loix pénales. Ibid. b. Ufages finguliers en matière civile.
Auteurs ii confulter fur les ufages d’Angleterre. Droit d’Irlande,
Ibid. x 21. a. 8c d’Ecoffc./éi<£ ¿.
D r o i t belgique, différentes loix dont il eft compofé. 1 .
Les ¿dits, placards, bc. qui forment le principal droit des
fouverains, ont deux époques par rapport au parlement de
Flandres; le tems qui a précédé la conquête, & celui qui
a fuivi. 2°. Diftinétion des coutumes particulières dans les
Pays-Bas, en coutumes homologuées & non homologuées.
,V. . 121. b1 . 3.00 . UITf/a*g.e..s. /g.éUnéir»a iu.vx #d1.e. fclhi-ianqnur»e pnrrnovviinnrci*e.. 4ri"".. SSttaa-tuts
& ordonnances politiques des magiftrats municipaux.
1°. Droit romain reçu en Flandres comme une loi écrite.
6°. Les fcntenccs des juges fubalternes y ont aufii beaucoup
d’autorité. 7°. Les avis ütconfultations des avocats forment
des aéles de notoriété. Privilèges des nobles en Hainaut.
Le droit d’aubaine dans les Pays-Bas appartient aujourd but
au fouverain. Comment on y devient bourgeois d une ville.
Ibid. 122. a. Durée de la puiffance paternelle dans certaines
.villes. Serfs dans la Flandres & le Hainaut. Droit d’excommunication
des évêques. Réglés de la chancellerie romaine
reçues dans ce pays. Concordat germanique fait en 1448, reçu
àCambray.Droitd’iffue dontiouiffent quelques villes de Flandres.
Trois fortes de biens diftingués dans cette province.Droir
de dévolution dans le Brabant & dans quelques coutumes de
Flandres.On y pratique aufii plufieurs fortes de refraits.Ouvra-
ges à confulter fur le droit belgique! Ibid. b.
D r o i t canonique. Pourquoi appcllé de ce nom. Droit
canonique romain , dans lequel les papes ont eu trois
objets ; l’un comme princes temporels, l’autre comme chefs
de l’églife, le troifieme a été de donner aux cccléfiaftiques
des réglés de difeipline. On diftingue le droit canonique
françois du romain. Le droit canonique en général fe divife
en droit écrit & non écrit ; celui qui eft écrit fe diftingue
aufii en deux fortes, les faintes écritures & les. canons. Le
corps du droit canonique 'eft compofé de fix colleâions différentes.
De quoi eft compofé celui de France. Différences
entre le droit canonique & le droit eccléfiaftique. Auteurs
,V. 123. a. ■
Droit canonique, différence entre le droit canonique & le
droit divin. V. 124. b. Son origine. VIII. 521. a. Articles
fur le droit canonique. II. 619. a. IV. 266. b. Celui qu’on
a fuivi en France depuis le commencement de la monarchie.
IX. 474. b. Le droit civil moins cftimé que le droit
canonique dans les fiecles d’ignorance. V. 6. b. Ce que renferme
aujourd’hui le corps du droit canonique. IV. 720. a.
Index de ce corps de droit. VIII. 672. a.
D r o i t civil , droit particulier de chaque peuple. Il
s’entend aufii quelquefois par oppofition au droit canonique,
quelquefois par oppofition au droit criminel. V. 123. ¿.
Droit civil, ce droit moins eftimé que le droit canon
dans les fiecles d’ignorance. V. 6. b. Défcnfe faite par Hono-
rius III. d’enfeiener le droit civil à Paris. V. 140. b. Objets
qu’il emj>raffe. 111. 496. b. IV. 266. b. IX. 82. a. Objets qu’il
embraffoit chez les Romains. XIII. 340. a. Index du corps
de droit civil. VIIL 673. a.
D r o i t commun : fa définition. Droit commun d’un état.
Le droit romain eft aujourd’hui le droit commun en France.
Voyez V. 141. a. Drojt commun d’une province. V. 123. b.
Droit commun, celui de la France. IV. 414. b. Droit commun
& municipal d’Angleterre, ouvrage de Thomas Little-
ton. XVII. 638. b. Des chofes qui font de droit commun.
•V. 41 ç. a.
D r o i t confulaire. Sa définition. V. 123 . b. •
D r o i t coutumier, oppofé au droit écrit, fondé fur de
fimples ufages que les peuples s’étoient accoutumés à fuivre,
& qui ont infenfiblement acquis force de loi. Il eft plus
ancien que le droit écrit. Dans les pays même où il y avoit
un droit écrit, il y en avoit en même tems un coutumier
jion écrit. Il n’y a encore préfentement guère d’état qui ne
foit dans le même cas. Quel eft le droit commun coutumier
d’un pays. Celui de France eft compofé de plus de 300 coutumes
différentes rédigées par écrit vers le quinzième fiecle.
Le droit coutumier traite de plufieurs matières qui lui font
propres. V. 124. a.
Droit coutumier, voyez C o u tu m e s , IV. 411. b. & C o u t
u m i e r , 419. u»b.
D r o i t de Danemarck. V. 124. a.
D r o i t divin, de deux fortes ; l’un fondé fur quelque rai-
fon connue, l’autre fur la feule volonté de Dieu. Différence
entre le droit eccléfiaftique ou canonique & le divin. V. 124. b.
Droit divin qu’admettoit Grotius. IX. 659. a.
D r o i t écrit, oppofé au çoutumier non écrit, En France,
le droit romain eft fouvent appellé le droit écrit. V . 124. b.
Droit écrit, en quel tems les commentaires des jurifeon-
fultes romains commencèrent à faire partie du droit écrit.
IX. 70. b. III. 71. a.
D r o i t d'Efjoagne b de Portugal. Ce qu’il ¿toit avant
l’invafion des Romains. Etat de ce droit fous les Romains,
i'oùs les Goths, fous les Maures & les Sarrafins. Alphonfe
IX & Alphonfe X adoptèrent enfuitc les loix de Juftinien
dans leur royaume d’Aragon. V. 124. b. Le droit gothique
abandonné après l’expulfion des Maures. Droit royal qui
lui fuccéda ; le droit romain en fait partie. On fuit les mêmes
loix dans les Indes, qui appartiennent aux Efpagnols. Jurif-
confultes à confulter. Ibid. îzq. a.
D r o i t étroit. La loi même ordonne qu’on préfère au
droit étroit la juftice & l’équité. Il y avoit chez les Romains
des contrats de bonne foi, & des contrats de droit étroit. 11 y avoit aufii plufieurs fortes d’nitions, lcs unes appellées de
bonne foi, d’autres arbitraires, d’autres de droit étroit. En
France, tous les contrats & les aâions font cenfés de bonne
foi. V. x 23.. a.
D r o i t Flavien. Formulés rédigées par le déccmVir Ap-
pius Claudius. Outre ces formules, il y avoit aufii le livre
des fartes. Les pontifes & patriciens faifoient des unes &
des autres un myftere au peuple; mais CneusFlavius les rendit
publiques. V. izj.b.
Droit Flavien. Sori origine. IV. 991. b. Formules dont le
recueil compofé le droit Flavien. VII. 184! a, b.
D r o i t François, diftingué en ancien 8c nouveau. Quel
étoit le plus ancien. Nous en tenons encore plufieurs coutumes
& ufages. Comment les Gaulois fe. fournirent infen-
fiblemcnt aux loix romaines. Quel fut le premier droit romain
obfervé dans les Gaules.. V.'ia'ç. b. Les peuples qui s’emparèrent
.chacun d’une partie des Gaules,y apportèrent leurs
loix ou ufages qui étoient fort, fimples. Mais ne contraignant
point les Gaulois de les fuivre, Feinbarras que caufa
cette (Uvcrfijté de loix , engagea a les faire" rédiger par écrit
dans un volume intitulé codex legum dhtiquarum. Loix qui
fuccédercnt. Les Gaulois & les Romains établis dans les-Gau-
lcs, fuivoient la loi romaine. Les provinces méridionales
l’ont cbnfervé comme leur droit municipal, au lieu que dans
les fcptentrionalcs, ïcs coutumes ont prévalu. Ibid. 126. a.
Le droit françois fe divife en droit public 8c droit privé ; en
civil 8c canonique. Hiftoirc (lu droit françbis;par l’aboé Fleuri.
Auteurs qui en ont traité. L’étude du droit françois n|a été
établie qu en 1680. Ibid. b.
D r o i t ^ des gens, différence entre droit naturel 8c droit
des gens. On djrtinguoit le droit des gens’ chez les Romains
en primitif 8c féconda ire. Effets du droit des gens par rapport
aux biens. Le droit privé en fait partie comme le droit
public. Fondement &.pérennité du droit primitif ; V. 127. a.
origine du fecondairë. Droit des gens confidéré de peuple
à peuple. Les nations policées ont plus pu moins de droits
communs avec certains peuples qu’avec d’autres, félon que
ces peuples font plus ou moins civiüfés. Comment s’eft formé
le droit des gens obfervé aujourd’hui en Europe. Les Germains
ne connoiffoicnt prefqu’aucun droit des gens. Ibid. b.
Les loix & les moeurs de la France s’étendirent depuis
Charlemagne dans toute l’Europe. Rapports qu’elles y ont
établis dans plufieurs ufages. Ceft donc à l’époque de Charr
lemagne que remonte notre droit des gèiis- D’autres ne le
font remonter qu’à l’époque de Maximilien I. Traité de
Grotius * jure bclli b pdeis. Ibid. 128. a. Analyfe de celui dé
Puffendorf* droit de la nature b des gens. Dans le premier
livre, il cherche la fource du droit naturel 8c des gens
dans l’effence des êtres moraux, dont il, examine l’origine
8c les différentes fortes. Dans le fécond, il traite de l’état de
nature, 8c des fondemens généraux de la loi naturelle. Dans
le troifieme, il examine les devoirs abfolus des hommés les
uns envers les autres, 8c les promeffes ou les conventions
en général. Dans le quatrième, ¡1 traite de l’obligation qui
concerne l’ufage de la parole 8c du ferment, dumenfonge,
8c enfin du droit de propriété. Ibid. b. Dans le cinquième
livre il traite du prix des chofes 8c des contrats en général.
Le fixicmc livre concerne le mariage, le pouvoir paternel
8c le pouvoir des maîtres fur les ferviteurs. Le feptieme a
pour objet l’origine 8c les fondemens de la fouverameté.
Dans le huitième l’auteur explique le pouvoir lègiftatif, le
droit de lajguerre, bc. Enfin il traite des çhangemens 8c de
la dertruéfion des états. Principes du droit naturel de Burlamaqui.
Autre ouvrage à confulter. Ibid. 129.
Droit des gens. Obfetyations fur 1 ouvrage de Puffendorf,
. intitulé, droit de la nature b des gens. X. 577. a. 70a. a.
Droit de la guerre, par rapport à la perfonne d’un ennemi, V.
692. b. par rapport à fes biens. IV. 751. b.bc. . .
D r o i t humain, confidéré par oppofition au droit divin.
V. 129. b.
D r o i t d’Italie. V. 129. ¿.
D r o i t de Lorraine b Barrois. Diverfes dominations fous
lefquellss oiit paffé ces pays, jufqu’aux ducs de Lorraine.