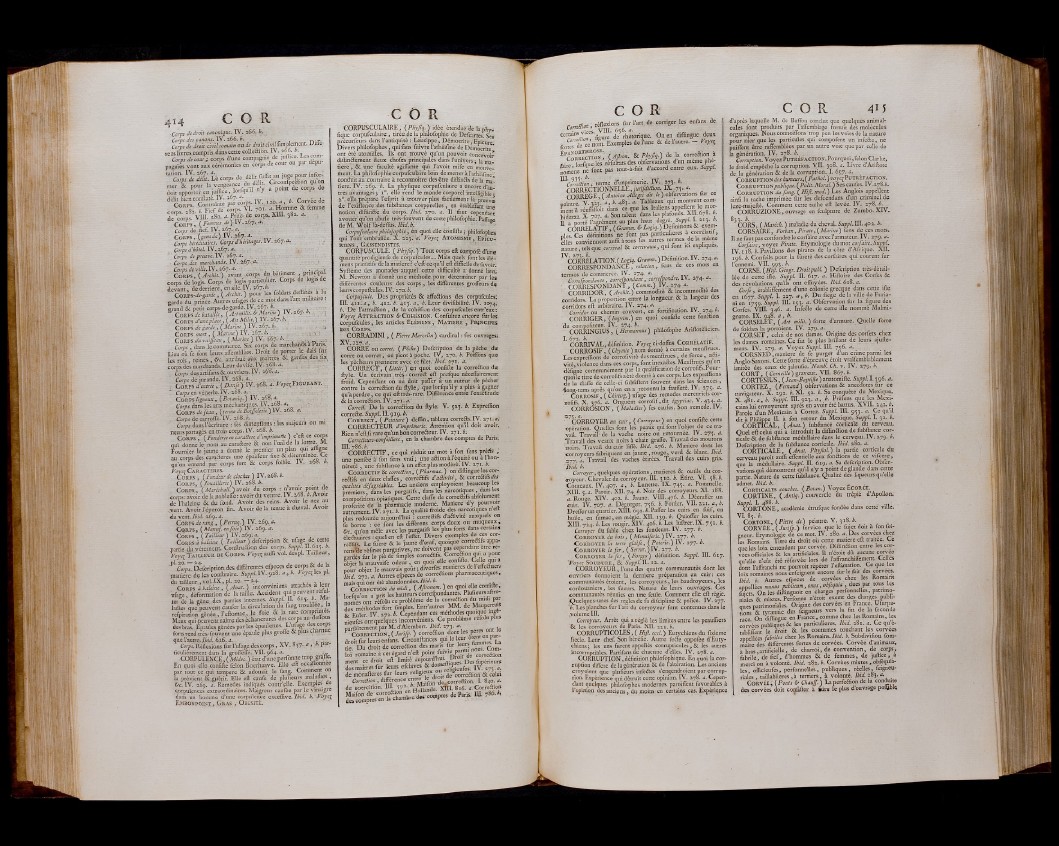
4 * 4 COR •Corps de droit canonique. XV. *66. b.
Corps des canons. XV. *66. b.
Corps de droit civil romain ou de droit civil Amplement. L>itte:
rens livres compris dans cette coÜeftiôn. IV. *66. b.
" % ) l $ t Lé c o n f ie M ”’y “ P°int ■■S délit bienconflaté.;y-^ 7-^ i y JJ0 | Corvée de
¿ “ LTdé' fbrps VI. fo i a. “Homme & femme
C o rp s , (Fmmes * ) lV . i 6 7, e „
Corps de.hef. IV, 167.11.
if'oRPS ( eensdey IV.,267. a.
C^rpshérhitàires. Corps d'héritages. IV. *67.a. .
... Corpsd’kôteL IV..2.6,7. “ •
Corpj de preuve. XV. *67. a. .
■ Corps des marchands. IV. 267.0.
Corps de ville. XV .*67. a. ■ » . : - ' ■ ^-.y
: C o rp s , (¿rckit.;) avant .corps du bâtiment , n w ÿ
corps de logis. Corps de logis particulier. Corps de loais de
devant, de derrière, en aile. IV. *67. b. ' I v; , § ÿ ..
Cou.vs~de-garde, (: Archit. 3) pour les foldats deftmês k la
garde du prince. Autres ufages dé ce mot dan; 1 art militaire.
grand & petit corps-de-garde. IV, ifa , (■
CORPS de bataille, r a m m B a p ggS M B K ■ 1
Corps d'uncpLice, ( An M’iti.)
C O R P S dé garde,(Marine )W .267.0. . ;
Corps mort, (Marine) IV.• -°7- e }\ , r.£
C O R P S d u v a ijfeà u , (M a n n e ) I V . 20 7 . *>• „ . J • fc& s sg
C om î, dans le commerce. Six corps de marchands^ Paris.
Lieu ou fe font lèursiailemblées. Droit de porter le dais fur
les rois, reines ,> c . ‘attribué.au* mairies & .gar^des^jx
corps des marchandsJ-eur devife. IV’. 26$. a. - .
Corps des amfans& ouvriecs. IV. 2&8r.4. •
Corps dé jurande. IV. 268. a. . . . . . . _ . - .
- C o r p s d'ekriifÙ>anfe)’XV. ? 6 8 .4 . . ^ F i o v r a n t .
7' Corps en vénerie. iV.'268.4.' :r _
Corps ligneux., (;Botaniq.) IV. a_68. a.
Corps, dans Jes arts mécliahiqu^.-lV. 200. a. -
CORPS defe.au,. (terme de Botjfelerie) IV. 268. a.
Corps de carroffe. IV. *6%. b. .• • . :. i . .
Corps dansï&riture : fes dimepfions : les majeurs ou mineurs
partages en trois corps. IV. 268. b. . . , „
CORPS , (Fonderie en caraEiere d'imprime fie ) c eft ce c°rps
qui donne le nom au caraftere & non l’oeil de la lettre. M.
Fournier le jeune a donné le premier un plan qui aliigne
au corps des carafteres une épaiffeur fixe & déterminée. Ce
qu’on entend par corps fort & corps foible. IV. 268. b.
Voyei C a r a c tè r e s .
-CORPS , (Fondeurde cloches ) IV. 268. b.
CoRP.S, (Jouaillerie) IV. 268. b. # ,
Corp^, ( Maréchall.) avoir du corps :■ n’avoir point de
•corps: avoir de ia jiobleffe : avoir du ventre. IV. 268. b. Avoir
de l’haleme. & du fond.' Avoir des reins. Avoir le nez au
xvent. Avoir l’éperon fin. Avoir de la ténue a cheval. Avoir
du venulbid. 269. a. . ;
Corps de rang , (Pemtq.) IV. 269.4.
■CqrpS* (Manuf.enfoie) IV. 269. a.
Corps , ( Tailleur ) IV. 269; a . r - j
Cor PS'd baleine, ( Tailleur ) defeription & ufage: de cette
partie du .vêtement. Conftruftion des corps. Suppl. IL 615. b.
jP'o^Tailxeur DE CORPS. Fô/fî auffi vol. des pl. Tailleur-
^.Corps. Defeription. des différentes efpeccs de corps & de la
jnaniere de .les conftruire. Suppl. IV. 9*8. a , b. Vuyc^us pl.
du tailleur., vol. IX , pl. 20. —■24- . v .
Corps â baleine , (Anat.) inconyémens attachés à leur
ufage, déformation de la taille. Accident qui peuvent re
ter de la gêne, des parties internes. Suppl. II. 615. Maladies
que peuvent caufer la circulation du fang troubléet, g
refpirarion gênée, i ’eûomaCj, ) e foie & la. rate comjXW*-
Maux qui peuvent naître dcs échancrures des corps au
des bras. Epaules gênées par lés épaulettes. L uiage es ^ tp
forts rend tr.ès-fouvent une épaule plus grofle & plus ch U .
que Vzutx(L JJnd,.6j.6. a. t- C-wV
Corps.Réflexions fur rurage,descoips, XV. 857. a , b. p
ticulierement dans la groflëlïe. VII. 9^4- ff; •
CORPULENCE,(Médec. ) état d’uneperfônne tropf gralie.
En quoi elle cônfifte félon Boerhaave. Elle eft occaponnep
par tout ce qui tempere & adoucit le fane. Cornment on
la prévient Sf;gpérit. Elle eff caufe de plufieurs maladies ,
6*c. IV. 269. a. Rêmedes indiqués contr’plle. Exemples de
corpulences extraordinaires. Maigreur caufée par le vinaigre
dans un homme d’une corpulence exceflive. Ibid. b., ' Koye£
Embonpoint , Gras ., Obésité.
C O R
CORPUSCULAIRE, (Phyjiq.) idée étendue de la phy,-
fique corpufculaire, tirée delà phiiofophie de Defcartes. Ses
irécurfeurs dans l’antiquité : Leucippe, Dèmocrité, Epicure.
Divers philofophes, qui fans fuivre Î’athéifmê de Démocrite *
ont été atomiltes. Ils ont trouvé qu’on .pouvoit concevoir
diftinéïement fieux chofes principales dans l’univers ; lania-
tiere , & une faculté agilfante qui l’avoit mife en mouve-
ment.La phiiofophie corpufculaire loin de mener à l’athèifme '
conduit au .contraire à reconnoître des être diftin&s de la matière.
IV.'. 209. b. La phyfique corpufculaire a éncorèd’àü-
tres avantages ; i°. elle rend le monde corporel intelligible *
20. eUe.prèp'dre l’efprit à tréuver plus facilement là’-'preuv®
de rèjailèncc .des fubftancgs corporelles , en établiiTant une
nodon,' diftirift'e du corps. Ibid. 270. a. Il faut cependant
àvoiiér’qu’on abufe très-foiivent de cette phiiofophie. Paffa°e
dé M. Wplf iR'défius. Ibid. b,
Corpufcùlairè philofophîé, én quoi elle confiile ; philofophes
qiii l’dHt’ertibfaffée. X: dif:d: Voye[ A tom ism e ', E picur
ie n s , G Àssen diste s. ;
CORPUSCULE. ( Phÿjîq- ) Tout corps eft conipôfé d’ime
ijuafititè'prodigïèùfe de corbufcules.... Mais quels font les élé-
mens priihittiV de la matière? c*eil'ce qu’il eft difficile de favoir.
Syftême des monades auquel: cette difficulté a'donné lieu j
M. Newton a: donné une méthode, pour déterminer par' les
différentes couleurs' des corps, les différentes groffeurs de
leurs corpuifculés. iy . 270. b.
Çàrpujcule. Des propriétés & affeâions des corpüfcules.’
III. 4ir::4,^. 412.'b: Mf'h't'b'. L e ù r divifibilité. IV. 1074.'
ù. De l’attraftion, de la cohéfion des corpufcules entr’eux :
Voye{ A t t r a c t i o n 6*C o h é s io n . Confultez encore furies
corpufcules , les articles Élémens , MATiEhÉ » P r in c ip es
Des C o r p s . '
CORRADINI, ( Pierre Marcelin) cardinal : fes ouvrages*
X V .J 1 7 .4 .1 :
COrRE o u corret. (Peckc) Defeription’ d e la pêche d u
corre o.u corret ,. ou piçot à poche. ÏV, 270. b. Poiffons que
les pêchëurs prennent avec ce filet. Ib id . 271. a.
CORRECT, ( LUtér.) èn qnor confîfte la correftion du
ftyle. Un écrivmn ,très - côrreft eft prefque néceffairement
fi-oïd. Cependant on rie, doit pàffer h- un auteur, de pécher
contre la correélion du ftyle, quelorfqu’ily a plus àgagner
qu’à perdre, ce qui eft très-rare: Différence entre l’exaélitude
& la correélion. IV. 271.4.'
Comf1. De la correétion du ftyle. V. 523. E Expreffion
correfte.Suppl. II. 919. b.
C o r r e c t , (Peinture) deffîn,tableaucorrefts.IV.271.4;
CORRECTEUR d'imprimerie. Attention qu’il doit avoir.
Rien n’eft fi rare qu’un bon correâeur. IV. 271. bi
Comfle'urs-con¡¿Hiers, en la chambré des comptes de Paris.
w Ê m Ê Ê ' , . . .
CORRECTIF, ce qui réduit un mot à Ton fens. précis ,
une penfée à fon fens vrai ; une a&ion à l’équité ou à l’honnêteté
une fubftance à un effet plus modéré. IV. 271. b.
C o r r e c t i f & comflion, (Pharmac. ) on diftingue ¡es cor-,
reftifs en deux claffes , correftifs d'aflivitê, & correâifs des
qualités défagréables. Les anciens employoient beaucoup les
premiers , dans les purgatifs, dans les narcotiques, dans les
compofitionsopiariques. Cette claffe de correftifs abfolu ment
proferite de' la pharmacie moderne. Maniéré d y pourvoir
autrement IV. *71. b. La quaUté froide des narcouqiies n eft
plus redoutée aujourd’hui : correftifs d’aftivité auxquels ou
fe borne ; ce font les différens corps doux ou muqueux,
&c. qu’on mêle avec les purgatifs les plus forts dans certains
éleftuaires : quel en eft l’effet. Divers exemples de ces correftifs.
Le fucre & le jaune d’oeuf, quoique correftifs appa-
réâffé réfines purgatives, ne doivent pas cependant etre regardés
fur le pié de fimples correftifs. Correftion qui a pour
Ibiet la mauvaife odeur, en quoi elle
pour objet le mauvais gout j diverfes manières de 1 eff®^“er
Ibid. 272. 4. Autres efpeces.de correftions pharmaceuuques,
mais qui ont été abandonnées.?^- b. . ■
C o r r e c t i o n du midi t ( A f l r o n o m . ) e n
lorfqu’on a pris les hauteurs correfpondantes. Plufieurs aftro
noriies ont rtfolu ce problème de la correftion du midi par
des méthodes fort fimples. Entr’autres MM. de MauPe.rt“îs
& Euler. IV. 272. b. Cependant ces méthodes quoique ingé
nieufes ont quelques inconvèniens. Ce problème réfolup
droit fur leurs en&ns. Orconftances qui le leur «m en^ ^
rie. Du droit de corre&ondeS maris fur 1« . , g g
loi romrine à cet égard n eft point fuib-iep^ ^
ment ce droit eft lnrnté aujourd ta . Des fupérieurs
des maîtres fur leurs
de monafferes fur leurs j/oerreaioq & celui
Comftiôn, différence entre de-correftio’n. L 840. a.
de coercition. I!J:. ^^nHoiiaride. xfll. 816. a. Correftion
COR COR CorrtSïon \ réflexions fur l’art de corriger les enfens de
On en difflngne demi
forrés de cenonf Exemples de l ’u n e & de l’antre. - gffiÇE
m r o n. W Ê S A dè .la correfllon à '
fùre lorfquedés réfifftats des obfervations dunmême phe-
| S font pas tout-à-felt d’aceord entre eux. Suppl.
Conehion, terme d’imprimerie. IV. 173. i.
CORRECTIONNELLE,jitri/dïfftM. IX...73. f
CORREGE C Antoine Allegn dit le ) obfervations lur ce
• y » a . b. 483. 4. Tableaux qui montrent comm
en t i f réufliffoit dans ce que les Italiens appellent 1® ^of*
hidezza. X. 707. a. Son talent dans les plafonds. XII. 678. b.
Il a porté l'agrément au plus haut degré. Suppl. I. 113. A
CORRELATIF, ( Gramm. & Logij. ) Définitions & exemples.
Ces définitions ne font pas particulières à corrélatif,
elles conviennent auffi à tous les autres termes de la même
nature, tels que arrivai & tomvaux, qui font ici expliqués,
^CORRÉLATION. (Zaei?. Gramm. ) Définition. I^v ^74-n-
CORRESPONDANCE, relation, fens de ces mots en
termes de commerce. IV. Ç74- “■ nr
Correfvondance, comfvoniant, com/poudrc. IV. Z74.1t.
' CORRESPONDANT, (Comm.) IV. Z74. a.
: CORRIDOR, (Archit.) commodité & incommodité aes
corridors. La proportion entre la longueur & la largeur des
corridors eft arbitraire. IV. 274.. a. .
Corridor ou chemin couvert, en fortification. IV . 274. 0.
' CORRIGER, (Imprim.) en quoi confîfte cette fonction
^UCOR^INGÎuS^( Flcrmannus') pltilofophe AriftotéUcien.
" CORRIVAL, définition. Voye^ ci-deifus C o r r é l a t i f .
CORROSIF, (Chymie ) nom donné à certains menftrues.
Les expreffions de c’orrofivité des menftrues, de force, activité,
violence dans ces corps, font inexaftes. Menftrues qu on
défiene communément par la qualification de corrolits. rour-
quoile titre de corrofifsaètè donné à ces corps.Les expreffions
de la claffe de celle-ci fubfiftent fouvent dàns les fciences,
4ong-tcms après qu’on en a reconnu la fauffeté. IV. 275. a.
C o r r o s i f , ( Chirurg.) ufage des remedes mercuriels cor-
rofifs. X. 376. 4. Onguent corrofif,dit égyptiac. V. 434-/-
CORROSION , (Maladies) fes caufes. Son remede. IV.
•?7CORROYER un cuir, (Corroyeur) en quoi confîfte cette
opération. Quelles font les peaux qui font l’objet de ce travail.
Travail-de la vache noire ou retournée. IV. 275. a.
Travail des veaux noirs à chair graffe. Travail des moutons
noirs. Travail du cuir liffé. Ibid. 276. b. Maniéré dont les
corroyeurs fabriquent en jaune, rouge, verd & blanc. Ibid.
3.77. 0. Travail des vaches étirées. Travail des cuirs gris.
Cor*r• oyer,que-l ques opé, rat.i ons, mat.i ères ioc ouWtilsB hau 2c-or-
aoyeur. Chevalet du corroyeur. III. 310. b. Étire. VI. 58 .b.
Couteaux. IV. 407. 4 , b. Lunette. IX. 745. a. Pommelle.
XIII. 5.4. Paroir. XII. 74. b. Noir des corroyeurs. XI. 188.
a. Rouge. XIV. 402. b. Jaune. VIII. 476. b. Décraffer un
cuir. l v . 707. 4. Dégorger. 756. b. Fouler. VII. 221. a, b.
Dreffer un quartier. XUI. 692. b. Paffer les cuirs en fuif, en
huile, en fumac,en mégie. XII. 119. b. Quioffer les cuirs.
XIII. 724. b. Les rougir. XIV. 406. b. Les luftrer. IX. 751. b.
Corroyer du fable chez les fondeurs. IV. 277. b.
C o r r o y e r du bois, (Menuiferie.)lV. 277. b.
CORROYER la terre glaife, ( Poterie. ) IV. 277. b.
C o r r o y e r le fer, (Scrrur.) IV. 277. b.
C o r r o y e r le fer, (Forges) définition. Suppl. III. 617.
"Voyci S o u d u r e , & Suppl. II. 12. a.
CORROYEUR, l’une des quatre communautés dont les
ouvriers donnoient la derniere préparation au cuir : ces
communautés étoient, les corroyeurs, les baudroyeurs, les
cordouaniers, les fueurs. Nature de leurs ouvrages. Ces
communautés réunies en une feule. Comment elle eft régie.
^Quelques-unes des réglés de fa difcipline & police. IV. 277.
H? Les planches fur l’art du corroyeur font contenues dans ie
.volume III.
Corroyeur. Arrêt qui a réglé les limites entre les peauffiers
& les corroyeurs de Paris. XII. 221 .b.
CORRUPTICOLES, ( Hift. eccl. ) Eutychiens du fixieme
fiecle. Leur chef. Son héréfie. Autre fefte oppofée d’Euty-
chiens ; les uns furent appellés corrupticoles, & les autres
incorruptibles. Partifans de chacune d’elles. IV. 278. a.
CORRUPTION, définition philofopliique. En quoi la corruption
diffère de la génération & de l’altération. Les anciens
croyoient que plufieurs infeftes s’engendroient par corruption.
Expérience qui détruit cette opinion. IV. 278. a. Cependant
quelques philofophes modernes paroiffent favorables à
l’opinion des anciens, du moins en certains cas. Expérience
•d’après laquelle M. de Buffon conclut que quelques animalcules
font produits par l’affemblage fortuit des molécules
organiques. Nous connoiffons trop peu les voies de la nature
pour nier que les particules qui compofent un infefte, ne
puiffent être raffemblées par un autre voie que par celle de
la génération. IV. 278. b.
Corruption. Voyez P u t r é f a c t io n . Pourquoi,lelon Clarke,
le froid empêche la corruption. VII. 308. a. Livre d’Ariftote
de la génération & de la corruption. I. 657. a.
CORRUPTION des humeurs,(Pathol.) yoyi^PuTREFACTION.
C o r r u p t io n publique. (Polit. Moral.) Ses caufes. IV.278.6.
C o r r u p t io n du fang. ( Hift. mod. ) Les Anglois appellent
ainfi la tache imprimée fur les defeendans d’un criminel de
leze-majefté. Comment cette tache eft levée. IV. 278. b.
COKRÜZIONE, ouvrage en fculpture de Zumbo. XIV.
8? 3. b. '
CORS, (Maréch. ) maladie du cheval. Suppl.III. 402. b.
CORSAIRE, Forban, Pirate , ( Marine ) fens de ces mots.
Il ne faut pas confondre le corfaire avec l’armateur. IV. 279. a. ’
Corfaire, voyez Pirate. Etymologie du mot corfaire. Suppl.
IV. 118. b. Pavillons des pirates de la côte d’Afrique. XII.
196. | Confeils pour la fureté des corfaires qui courent fur
l’ennemi. VII. 993. b. . 1
CORSE. (Hift. Géogr. Droitpubl. ) Defeription tres-derail-
lée de cette ifle. Suppl. II. 617. a. Hiftoire des Corfes &
des révolutions, qu’ils ont effuyées. Ibid. 618. a.
Corfe, établiffement d’une colonie grecque daiis cette ifle
en 1677. Suppl. I. 227. a , b. Du fiege de la ville de Furia-
nien 1759. Suppl. III. 153. a. Obfervation fur la figure des
Corfes. Vffl. 346. a. Infefte de cette ifle nommé Malmi-
gnatto. IX. 940. a , b.
CORSELET, (Art milit.) forte d’armure. Quelle forte
de foldats ia portoient. IV. 279. 4. .
CORSET, celui de nos dames. Origine des corfets chez
les dames romaines. Ce fut le plus brillant de leurs ajufte-
mens. IV. 279. a. Voyez Suppl. III. 756. a. . ■
CORSNED, maniéré de fe purget dun crime parmi les
Anglo-Saxons. Cette forte d’épreuv^ étoit vraifemblablement
imitée des eaux de jaloufie. Nomb. Ch. v. IV. 279. b.
CORT, ( Corneille ) graveur. VII. 867.6.
CORTESIUS, (Jean-Baptifte ) anatomifte. Suppl. 1. 396. a.
CORTEZ, (Femand) obfervations & anecdotes fur ce
navigateur. X. 292. ¿.XI. 52. b. Sa conquête du Mexique.
X. 481.4, b. Suppl. III. 923. 4 , b. Préfens que les Mexicains
lui envoyèrent après en avoir été battus. XVII. 242. b.
Parole d’un Mexicain à Cortez. Suppl. HI. 953. a. Ce qu’il
dit à Philippe II. à fon retour du Mexique. Suppl. I. 32. b.
CORTICAL, (Anat.) fubftance corticale du cerveau.
Quel eft celui qui a introduit la diftmftion de fubftance corticale
& de fubftance médullaire dans le cerveau. IV. 279. b.
Defeription de la fubftance corticale. Ibid. 280. a.
CORTICALE, (Anat. Phyftol.) la partie corticale du
cerveau paroît auffi eflentielle aux fbnftions de ce vifeere,
que la médullaire. Suppl. II. 619. a. Sa defeription. Obfervations'
qui démontrent qu’il n’y a point de glande dans cette
partie. Nature de cette fubftance. Qualité des liqueurs qu’elle
admet. Ibid. b. ■ v _r ■.
C o r t i c a l e s couches. (Botan.) Voyez E c o r c e .
CORTINE, (Antiq.) couyerde du trépié d Apollon.
^ SoR TO N E , académie étrufque fondée dans cette’ ville.
VI. 8ç.vè.
C o r t o n e , (Piètre de) peintre. V. 318.b.
CORVÉE, (Jurifp.) fervice que le fujet doit à fon fei-
’ gneur. Etymologie de ce mot. IV. 280. a. Des corvées chez
fes Romains. Titre du droit où cette matière eft traitée. Ce
que les loix èntendent par corvée. Diftmftion entre les corvées
officiales & les artificiales. Il n’étoit du aucune corvée
qu’elle n’eût été réfervée lors de l’affranchiffement. Celles
dont l’affranchi ne pouvoit répéter l’eftimation. Ce que les
loix romaines nous enfeignent encore fur le fait des corvees.
Ibid. b. Autres efpeces de corvées chez les Romains
appellées munus publicum , onus, obfequia , duespar tous les
fuiets. On les diftinguoit en charges perfqnnelles, patrimoniales
& mixtes. Perfonne n’étoit exemt des charges jnibli-
ques patrimoniales. Origine des corvées en France. Ufurpa-
tions & tyrannie des fôgneurs vers la fin de la fécondé
race On diftingue en France, comme chez les Romains, les
corvées publiques & les particulières. Ibid. *2 i. a. Ce qu’é-
tabliffent le droit & les coutumes touchant les corvées
appellées fabriles chez les Romains. Ibid. b, Subdivifion fom-
maire des différentes fortes de corvées. Corvée d’animaux,
à bras,artificielle, de charroi, de convention, de corps,
fàbrile, de fief, d’hommes & de femmes, de juftice, à
merci ou à volonté. Ibid. 282. b. Corvées mixtes , obféquia-
les, officieufes, perfonnelles, publiques, réelles, feigneu-
riales, taillablieres, à terriers, à volonté. Ibid. 283.4.
C o r v é e ; (Ponts & Chauff.) Laperfeftioh de la con^ e
des corvées doit cooiifter à wire le plus d’ouvrage pofljblc