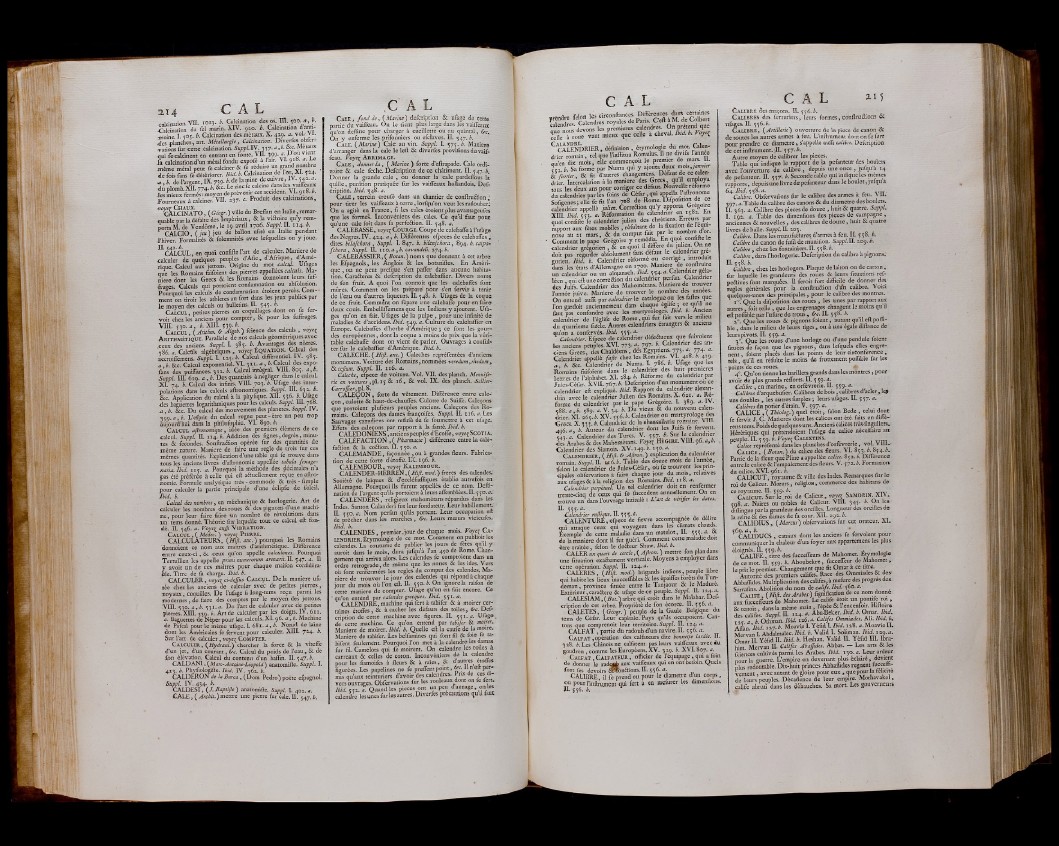
2 . 1 4 CAL C A L
-calcination. VU. ioa> 4. Calcination j g S t l Ê Ê Ê S Ê
•Calcination du M mann; 9*°- ¿- Calcination danuanoine.
I. 303. b. Calcination des métaux. X. 42p. a..vol/ VI.
.des -planches, art. Métallurgie , Calcination. Diverfes obier-
vations fur cette calcination.SuppLÏY. 337. a,b. 8cc. Méranx
-qui fe calcinent en entrant en fonte. VII. 399- °i* V lj
Ja calcination-d’un métal fondu expofé a 1 air. Y .91 ■
même métal peut fe calciner & fe réduire un grand nombre g
de fois fans fedétériorer, lbid. b Calcination de 1 or, XI..ça 4-
*z b del’areent, IX. 739. b. de la mine de cuivre, IV. 542. a.
du plomb. jSl. 774- ¿- Lc™c{e.■les mieux fermés: moyen de préveni rC cdeCt‘ "a^ccdideenntt . VVIi.a io9^1e88.l ?4.
fourneaux à cakmer. VH. 037. c- Produit des calcuianons,
’ ‘’'ckLCINATO ( Glogr. ) ville du Breffan en Italie, remarquable
p a r la défaite des Impériaux, & la viftoire qu’y remporta
M. de Vendôme, le 19 avril 1706. Suppl II. 1 x4. 4.
CALCIO ( ¡tu ) jeu de ballon ufité en Italie pendant
l’hiver. Formalités & folemnités avec lefquelles on y joue.
^¿A LCU L , en quoi confifte l’art de calculer. Maniéré de
calculer de quelques peuples d’Afie, d’Afrique, dAmérique.
Calcul aux jetions. Origine du mot calcul. Ufages
qiîe les Romains frifoient des pierres appelléescaïeuls. Maniéré
dont les Grecs & les Romains donnoient leurs fuf-
■fraees. Calculs qui portoient condamnauon ou abfolution.
Pourquoi les calculs de condamnation étoient percés Corn--
ment on droit les athletes au fort dans les jeux publics par
le moyen des calculs ou bulletins. II. 545. b.
C a lcu l , petites pierres ou coquillages dont on fe 1er-
voit chez les anciens pour compter, 8c pour les fuftrages.
vm . 530.4*, b. XIII. 539. b.
C a l c u l , (Aritkm. & Algeb.) fcience des calculs , W fâ
A r i t h m é t i q u e . Parallèle de nos calculs géométriques avec
.ceux des anciens. Suppl. I. 385. b. Avantages des nôtres.
386.«. Calculs algébriques, vqm’É q u a t i o n . Calcul des
accroiffemens. Suppl I. 125. ¿. Calcul différentiel. IV. 985.
a . b. &c. Calcul exponentiel. VI. 311. a , b.Calcul des expo-
fans des puiffances. 312. b. Calcul intégral. VIII. 805. a,b.
Suppl. III. 619. « , b. Des quantités à négliger^dans le calcul.
XL 74. b. Calcul des infinis. VIII. 703. b. Ufage des interpolations
dans les calculs aftronomiques. Suppl UL 63 a. b.
&c. Application du calcul à la phyfique. XII. 336« ¿.Ufage
■des baguettes logarithmiques pour les calculs. Suppl. 111.760.
a b. 8cc. Du calcul des mouvemens des planetes. Suppl. IV.
399.a , b. L’efprit dn calcul regne peut-être un peu trop
aujourd’hui dans la philofophie. VL 890. b.
C alcul aftronomique, idée des premiers élemens de ce
calcul. Suppl. II. 114. b. Addition des fignes,degrés, minutes
8c fécondés. Souftraétion opérée fur des quantités de
même nature. Maniéré de faire une réglé de trois fur ces
mêmes quantités. Explication d’une table qui fe trouve dans
tous les anciens livres d’aitronomie appellee tabula, fexage-
naria. ïbid. 113. a. Pourquoi la méthode des décimales n’a
pas été préférée à celle qui eft a&uellcment reçue en agronomie.
Formule analytique très - commode & très - hmple
pour calculer la partie principale d’une éclipfe de ioleil.
lbid. b. , , . A J
Calcul des nombres, en méchanique 8c horlogerie. Art de
calculer les nombres des roues & des pignons d’une machine,
pour leur faire faire un nombre de révolutions dans
un tems donné. Théorie fur laquelle tout ce calcul eft fondé.
.II. 346. a. Voye^ aujji VIBRATION.
C alcul , Q Médec. ) voye^ Pierre.
CALCULATEURS, (Hîfi. anc.) pourquoi les Romains
donnoient ce nom aux maîtres d’arithmétique. Différence
entre ceux-ci, & ceux qu’on appelle calculones. Pourquoi
TertuUien les appelle primi numerorum arenarii. II. 347. a. Il
y avoit un de ces maîtres pour chaque maifon confidéra-
ble. Titre de fa charge, lbid. b.
CALCULER, voye^ ci-deffus Calcul. De la mamere uü-
tée chez les anciens de calculer avec de petites pierres,
noyaux, coquilles. De l’ufage li long-tems reçu parmi les
modernes, de faire des comptes par le moyen des jettons.
VlIT »0. a*b. 331.«. De l’art de calculer avec de petites
pierres. XIII. 539. b. Art de calculer par les doigts. IV. 6x1.
a. Baguettes de Néper pour les calculs. XI. 96. a, b. Machine
de Pafcal pour le même ufage. 1. 681. a, b. Noeud de laine
dont les Américains fe fervent pour calculer. XIII. 724. b.
Sur l’art de calculer, voye{ COMPTER.
C alculer, (Hydraul.) chercher la force & la vîteffe
d’un jet, d’un courant, &c. Calcul du poids de l’eau, & de
Ü>n élévation. Calcul du contenu d’un baffin. II. 547. b.
CALDANI .{Marc-Antoine-Leopold) anatomifle. Suppl. I.
413. b. Phyfiologifte. lbid. IV. 362. b.
CALDERON de la Burca, ( Dom Pedro") poëte efpagnol.
Suppl. IV. 434. b.
CALDESI, ( J. Baptifle ) anatomifte. Suppl. I. 402.«.
CALE, ( Arçh'u.) mettre une pierre fur cale. II. 347. b.
C ale , fond der{Marine) dcfcription & ufage de cette
partie du vaiffeau. On le tient plus large dans les vaiffeaux
qu’on deftine pour charger à cueillette ou au quintal, 6*c.
On y enferme les prifonniers ou efclaves. II. 347. b.
C ale. ( Marine) Cale au vin. Suppl I. 373. b. Maniéré
d’arranger dans la cale le left 8c diverfes provifions du vaiffeau.
Voye[ A rrim age.
C a l e , donner la , ( Marine) forte d’eftrapade. Cale ordinaire
& cale feche. Defeription de ce châtiment. II. 347. b.
Donner la grande cale , ou donner la cale pardeflous la
quille, punition pratiquée fur les vaiffeaux hollandois. Description.
Ibid. 348. a.
C ale , terrein creufé dans un chantier de conftru&ion ;
pour tirer les vaiffeaux à terre, lorfqu’on veut les radouber;
On a agité en France, fi les cales étoient plus avantageufes
que les formes. Inconvéniens des .cales. Ce qu’il faut pour,
qu’une cale foit dans fa perfection. II. 348. a.
CALEBASSE, voye{ C ourge. Coupe de calebaffe à l’ufagé
des Negres. IV. 424. a , b. Différentes efpeces de calebaffes
dites belafchorà , Suppl. I. 847. b. bilènjchora, 894. b. caipar
fchora , Suppl. IL 110. a , b. cavandeli. 274. b.
CALEBASSIER, ( Botan.) noms que donnent à cet arbre
les Efpagnols, les Anglois 8c les botaniftes. En Amérique,
on ne peut prefque s’en paffer dans aucune habitation.
Caraâeres 8c defeription du calébaflier. Divers noms:
de fon fruit. A quoi l’on connoit que les calebaffes font
mûres. Comment on les prépare pour s’en fervir à tenir-
de l’eau ou d’autres liqueurs. II. 348. b. Ufages de la coque
de ce fruit. Comment on fépare une calebaffe pour en faire
deux couis. Embelliffemens que les Indiens y ajoutent. Ufages
qu’on en feit. Ufages de la pulpe , pour une infinité de
maladies & d’accidens. Ibid. 349. a. Culture du calebaflier en
Europe. Calebaffes d’herbe d’Amérique ; ce font les gour--
des européennes, dont la coque a moins de prix que la véri-,
table calebaffe dont on vient de parler. Ouvrages à conful-
ter fur le calebaflier d’Amérique. Ibid. b.
CALECHE. ( Hiß. anc. ) Caleches repréfentées d’anciensi
monumens. Voiture des Romains,nommées veredum, rheduma
& ccfium. Suppl. II. 116. a.
Calèche, efpece de voiture. Vol. VU. desplanch. Menuiférié
en voitures, pl.15 & 16 , & vol. IX. des planch. Sellier\
Carrofficr,vA. 8.
CALEÇON, forte de vêtement. Différence entre caleçon,
culotte & haut-de-chauffes. Culotte de Suiffe. Caleçons
que portoient plufieurs peuples anciens. Caleçons des Romains.
Caleçons des dames françoifes. Suppl. II. i i 6. <i.L cs
Sauvages canadiens ont refufé de fe foumettre à cet ufage.
Effets des .caleçons par rapport à la fenté. Ibid. b.
CALEDONIENS, ancienspeuples d’Ecoffe, voye{ Sco t ia .
CALÉFACTION , (Pharmacie ) différence entre la calé-r
feétion & la coftion. lï. 330.0.
CALEMANDE, façonnée , ou à grandes fleurs. Fabrication
de cette forte d’étoffe. IX. 196. b.
CALEMBOUR, voyez K alembour.
CALENDER-HERkEN , ( Hiß. mod. ) fireres des calendes.'
Société de laïques & d’eccléfiaftiques établie autrefois en
Allemagne. Pourquoi ils furent appellés de ce nom. Defti-
nation de l’argent qu’ils portoient à leurs affemblées. II. 3 3a. a.
CALENDERS, rehgieux mahométans répandus dans les
Indes. Santon Calanderi fut leur fondateur. Leur habillement.
IL 3 30. a. Nom perfan qu’ils portent. Leur occupation eft
de prêcher dans les marches, &c. Leurs moeurs vicieufes.
Ibid. b. ' . "* . r
CALENDES, premier .jour de chaque mois. Voyej C alendrier.
Étymologie de ce mot. Comment on publioit les
calendes. La coutume de publier les jours de ßtes qu’il y
auroit dans le mois, dura jufqu’à l’an 430 de Rome. Changement
qui arriva alors. Les calendes fe comptoient dans un
ordre retrograde, de même que les nones & les ides. Vers
où font renfermées les réglés du comput des calendes. Maniéré
de trouver le jour des calendes qui répond à chaque
jour du mois où l’on eft. II. 330. b. On ignore la raifon de
cette maniéré de compter. Ufage qu’on en feit encore. Ce
• qu’on enténd par calendes grecques. Ibid. 3 31. a.
CALENDRE, machine qui fert à tabuer & a moirer certaines
étoffes, 8c à cacher les défauts des toiles, &c. Def-
cription de cette machine avec figures. IL 331. a. Ufage,
dé cette machine. Ce qu’on entend par tabifer 8c moirer.
Maniéré de moirer. lbid. b. Quelle eft la caufe de la moire.
Maniéré de tabifer. Les belfamines qui font fil 8c foie fe ta-
bifent feulement. Pourquoi l’on met à la calendre les damas
fur fil. Camelots qui fe moirent. On calendre les toiles à
carreaux 8c celles de coton. Inconvéniens de la calendre
pour les fiamoifes à fleurs 8c à raies, 8c dautr« étoffes
figurées. Les papelines ne fe preffentpoint, &c. Il neft permis
qu’aux teinturiers d’avoir des calendres. Prix de ces di-
vers ouvrages. Obfervaùom furies rouleaux dont on fe fert.
Ibid. r,2.e. Quand les pleces ont un peu d aunage, on les
calendre les lie s fur les autres. D.verfcs précautions qudfauc
CAL CAL 1 iÀc circonftances. Différences dairt certaines
de.Parls. C'eft à M. de Colbert
calendres. premières calendres. On prétend que
ceUe" à' roue vaut mieux que celle à cheval, lbid. 4. Voyn
C'cÂl.ENDRIER, définition, étymologie du mot. Calendrier
romain, tel que l’inllitua Romulüs. Il ne drnfa 1 année
au’en dix mois, elle commençott le premier de mars. II.
b. Sa forme par Numa qui y a|oma deux mots,¡anvicr
& février-, & fit d’autres changement Défaut de ce calendrier.
Intercalation à la maniéré des Grecs, qutl employa
tous les deux ans pour corriger ce défaut. NouveUeréforme
du calendrier par les foins de Céfar ,qut
Sofigcnes; elle fe fit l’an 7*8 de Rome. Difpofmon de ce
calendrier appellè ¡ ¡ ¡ ¡ g Correfrion qu'y/PP“™
XIII lbid. „ 1 . Réformation du calendner en 1582. tn
quoi confifte le calendrier julien des .:hréne„s.^
rapport aux fêtes mobiles , réfutant de la fifinondel éqm-
noxe au 21 mars, & du comput frit par e n •
• Comment le pape Grégoire y remédia. En quoi confifte le
calendrier grégorien , & en quoi il différé du |uhen.On ne
doit pas regarder abfolument fans défaut le c g
gorien. lbid, 4. Calendrier réformé ou corrigé , introduit
dans les états d’Allemagne en 1700. Mamere de conftru.re
un calendrier ou un a lm a n a c h ./4id. ïï4-v.Calentaier gélaléen
, qui eft unecorreftion du calendrier perfan. Calendner
des Juifs. Calendrier des Mahométans. Maniéré de trouver
l’année juive. Mamere de trouver le nombre des années.
On entend aufii par calendrier le catalogue ou lesfeftes que
l’on gardoit anciennement dans chaque égufe ; ce quil ne
faut pas confondre avec les martyrologes, lbid. b. Ancien
calendrier de l’égUfe de Rome,aiu fut fe.t vers le milieu
du quatrième fiêcle. Autres calendriers étrangers & anciens
qu’-on a confervés. lbid. 353- . . .
Calendrier. Efpece de calendrier défeaueux que fmvoient
les anciens peuples. XVI. 773- ■>; 797- Calendrier des anciens
Grecs, des Chaldéens, des Egyptiens. 773- 774- «■
Calendrier appellé fa ft chez les Romains. VL 418. 4. 419-
.1 4. &c. Calendrier de Numa. L 786. 4. Ufage que les
Romains ftifment dans le calendrier des huit premières
lettres de l’alphabet. XI. 284- 4. Réforme du calendrier par
Jules-Célar XVII. 767.4. Defcripuon d’un monument ou ce
calendrier eft expliqué, lbid. Rapport du calendrier alexan-
drin avec le calendrier Julien des Romains. X. 621. a. Reforme
du calendrier par le pape Grégoire. 1. $89. a. l\ .
c88. a ,-é. 389. a. Y. 34- ¿- Du vieux & du nouveau calendrier.
XI. 263.b. XV. 356. b. Calendrier ou martyrologe des
Grecs. X. 333.-*. Calendrier de la chancellerie romaine. V1U.
4o6.cz, ¿. Auteur du calendrier dont les Juifs fe fervent.
343. iz. Calendrier des Turcs. V. 337./- Sur le caiendner
des Arabes & des Mahométans. Voye[ Hégire. VIII. 96. a, b. ,
Calendrier des Siamois. XV. 149. ¿. 130* «•,
Calendrier, ( Hi(l. & Ajlron.) exphcation du calendner
romain. Suppl. IL W6.b. Table des douze mois de 1 année,
félon le calendrier de Jxdes-Céfar, oufe trouvent les principales
obfervations à faire chaque jour du mois, relauves
aux ufages 8c à la religion des Romains. lbid. 118. a.
Calendrier perpétuel Un tel calendrier doit en renfermer
trente-cinq de ceux qui fe fuccedent annuellement. On en
trouve un dans l’ouvrage intitulé : L’art de venfier les dates.
II. 333. a.
Calendrier ruflique. IL 333.1*. •" ., ....
CALENTURE,efpece de fievre accompagnée de délire
qui attaque ceux qui voyagent dans les climats chauds.
Exemple de cette maladie dans un matelot, 11. 333. «. oc
de la maniéré dont il fut guéri. Comment cette maladie doit
être traitée, félon le doaeur Shaw. lbid. ¿* ,
CALER un quart de cercle , ( Ajlron. ) mettre fon plan dans
une fituation exactement verticale. Moyens à employer dans
cette opération. Suppl 11. 124.it. . . . . , ...
CALERES, (Hift. mod.) brigands indiens, peuple libre
qui habite les lieux macceflibles 8c les épaiffes forêts du Tun-
deman, province fituée entre le Tanjaour Sc le Madure.
Extérieur, caraftere 8c ufage de ce peuple. Suppl. ^ II. 124. a.
CALESIAM, ( Bot. ) arbre qui croît dans le Malabar. Defeription
de cet arbre. Propriété de fon écorce. II. 3 36. a.
CALETES, (Géogr.) peuple de la Gaule Belgique du
tems de Céfar. Leur capitale. Pays qu’ils occupoient. Cantons
que comprenoit leur territoire. Suppl. II. 124. a.
CALFAT, partie du radoub d’un navire. II. 33 6. a.
CALFAT, opération des calfeteurs dite bonnette lardée. II.
328. ¿.Les Chinois ne calfatent pas leurs vaiffeaux avec du
goudron, comme les Européens, XV. 329. b. XVI. 807. a. y
Calfat C alfateüR , officier de l’équipage, qui a foin
de donner le radegb aux vîùffeaux qui en ontbefoin. Quels
font fes devoirs fiffon&ions. II. 336. a.
CALIBRE, il fe prend ou pour le diametre dun corps,
ou pour l’inftrurnent qui fert à en iucfurer les dimenfions.
IL 536. b.
C alibre des maçons. II. 33 6.b.
C alibres des terruriers, leurs formes, conftfuélions Sc
ufages. H. 336. b.
C a l ib r e , ( Artillerie) ouverture de la piece de canon 8t
de toutes les autres armes à feu. L’inftrument dont on fe ferc
pour prendre ce diametre, s’appelle aufli calibre. Defeription
de cet infiniment. ;IL 3 57. b.
Autre moyen de calibrer les pièces. , , ,
Table qui indique le rapport de la pefanteur des boulets
avec l’ouverture du calibre , depuis une once , jufqu’à 14
de pefanteur. H. 337. ¿.Seconde table qui indique les memes
rapports, depuis une livre de pefanteur dans le boulet, j ut qu a
64. Ibid.ee&a.
Calibre. Obfervations fur le calibre des armes a feu. VU*
397. a.Table du calibre des canons 8c du diametre des boulets.
IL 363. a. Calibre des pièces de douze, huit 8c quatre. Suppl
I. 192. a. Table des dimenfions des pièces de campagne,
anciennes 8c nouvelles, des calibres de douze, huit 8c quatre
livres de balle. Suppl II. 203 .
- Calibre. Dans les manufedures. d’armes à feu. II. 338. b.
Calibre du canon de fufil de munition. Suppl II. 209. b.
Calibre , chez les fontainiers. II. 3 38. b.
Calibre, dans l’horlogerie. Defeription du calibre à pignons:
D-338.^
Calibre , chez les horlogers. Plaque de laiton ou de carton ,
fur laquelle les grandeurs des roues 8c leurs fituations ref-
pedives font marquées. U feroit fort difficile de donner des
réglés générales pour la conftrudion d’ifh calibre. Voici
quelques-unes des principales, pour le calibre des montres.
i°. Que la difpoürion des roues, les unes par rapport aux
autres, foit telle, que les engrenages changent te moins qu il
eft poflible par l’ufure de trous, &c. II. 538. b.
20. Que les roues 8c pignons foient, autant qu il eft poflï-
ble, dans le milieu de leurs tiges, ou à une égale diftance de
leurs pivots. II. 339. <2. ' .
3°. Que les roues d’une horloge ou d une pendule foient
fituées de façon que les pignons, dans lefquels elles engrènent
, foient placés dans les points de leur circonférence ,
tels, qu’il en réfulte le moins de frottement poflible fur les
• points de ces roues. ^
40. Qu’on tienne les barillets grands dans les montres, pour
avoir de plus grands refforts. II. 3 39. a.
Calibre, en marine, en orfèvrerie. II. 339. a. ^
Calibres d’arquebufier. Calibres de bois, calibres d acier, les
* uns doubles , les autres fimples ; leurs ufages. II. 3 37. a.
Calibres du potier d’étain. V. 397. a.
CALICE, ( Théolog.) quel étoit, félon Bede , celui dont
fe fervit J. C. Matières dont les calices ont été faits en diffé-
rens tems. Poids de quelques-uns. Anciens calices très-finguliers.
Hérétiques qui pretendoient l’ufege du calice néceflaire au
peuple, n . 339. b. Voyei C alixtins.
Calice repréfenté dans les planchesd’orfévrene, vol. V III-
C a liC e , ( Botan. ) du calice des fleurs. VI. 833. ¿.834. b.
Partie de la fleur que Pline a appellée calice. 832. b. Différence
entre le calice 8c l’empalement des fleurs. V. qyi.b. Formation
du calice. XVI. 961. b. , _ , _ r i
CALICUT, royaume 8c ville des Indes. Remarques fur le
roi de Calicut. Moeurs, religion, commerce des habitans de
ce royaume. II. 359. b. _ vrtr
C alicut. Sur le.roi de Calicut, voyez bamorin. A iv .
398. a. Naires ou nobles de Calicut. VIII. 343. b. On les
diftingue parla grandeur des oreilles. Longueur des oreilles de
la reine 8c des dames de fa cour. XII. 292. b.
CALIDIUS, (Marcus) obfervations fur cet orateur. XI*
* &ALIDUCS , canaux dont les anciens fe fervoient pour
communiquer la chaleur d’un foyer aux appartemens les plus
éloignés. 11.339. b. . w , j. . .
CALIFE, titre des fucceffeurs de Mahomet. Etymologie
de ce mot. II. 559. 4. Aboubekre, fucceffeur de Mahomet,
le prit le premier. Changement que fit Omar à « ''tre.
Autorité des premiers califes. Race des Ommiades & des
Abbafiides. Multiplication des califes, à mefure des progrès des
Sarrafins. Abolition du nom de calife, lbid. roo. a.
C alife , (Hill. dis Arabes) lignification de ce nom donné
aux fucceffeurs fie Mahomet. Le calife éeott un P?nufe ro.,
& tenoit, dans la même main l’épée & 1 encenfmr Hiftoite
des calife. Su,pl. II. x » Ç ^ u ^ = ! f i:r .J 4iiW,Omar 7é.^
, « a 4 Othrnan. lbid. 126. a. Califes Ommiades. Ah. lbid. Is
Aliàn ’lbid 127.4. Moavie I. YcfidI.lbid. 128. a.MoavieII.
Mervan I. Abdalmalec. lbid. b. Valid I. Soliman. lbid. 120.a.
Omar H. Yéfid II. lbid. b. Heshan. Valid II. Yéfid III. Ibrahim.
Mervan II. Califes Abaffides. Abbas. — Les arts 8c les
feiences cultivés parmi les Arabes, lbid. 130. «. Leur ardeur
pour la guerre. L’empire en devenant plus éclairé, devient
plus redoutable. Dix-nuit princes Abbafndes régnent fuccelh-
vement, avec autant de gloire pour eux, que pour la félicité
de leurs peuples. Décadence de leur empire. Mothavakel,
calife abruti dans les débauches. Sa mort. Les gouverneurs