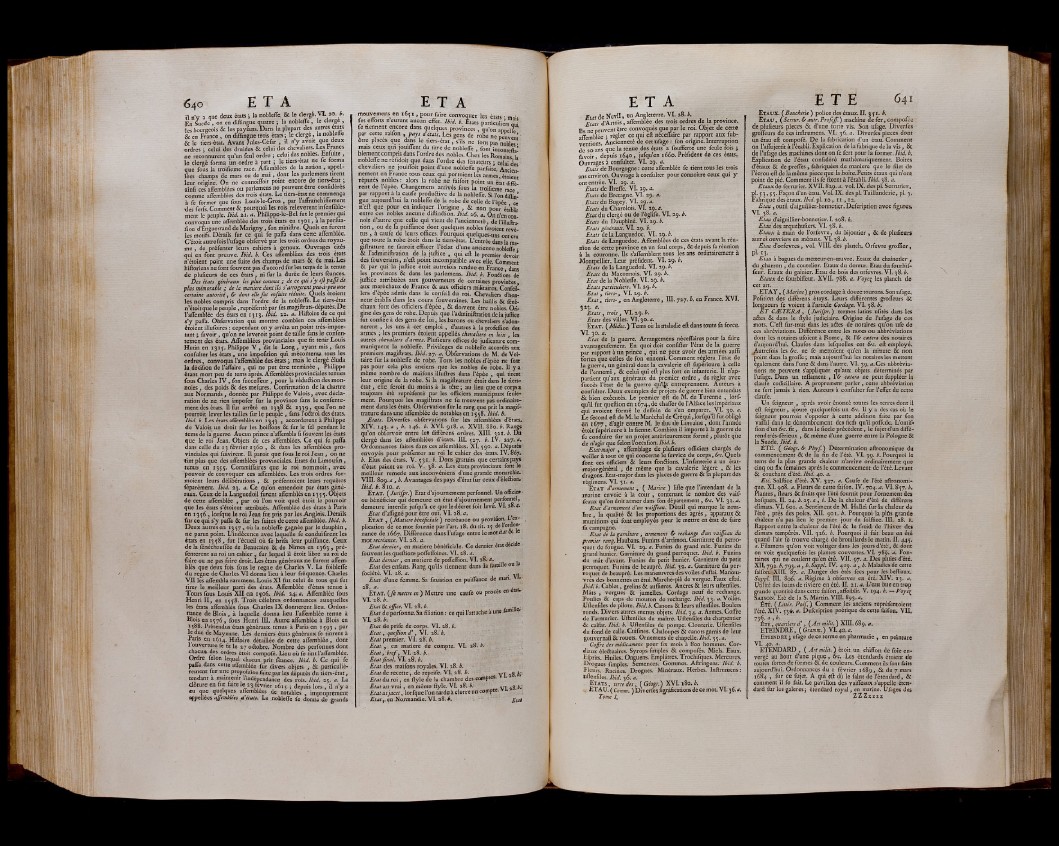
(>40 E T A E T A
il rfy a qw d«“* ia a i & nobwfe & le c W . V I »0. i.
En Sucdc , on en diftingue quatre ; la nobleffe, le cierge,
les bourgeois & les pay fans. Dans la plupart des autres états
8c en France , on diftingue trois états ; le cierge, la nomeiie
& le tiers-état. Avant Jules-Céfar , il n’y avoit que deux
■ordres ; celui des druides & celui des chevaliers. Les Francs
ne reconnurent qu’un feul ordre ; celui des nobles, Enfuite,
le clergé forma un ordre à part J le tiers-état ne le forma
que fous la troifieme race. Affemblées de la nation, appelle
s champs de mars ou de mai, dont les parlemens tirent
leur origine. On ne connoiffoit point encore de tiers-état: ;
ainfi ces affemblées ou parlemens ne peuvent être conüdéres
comme affemblées des trois états. Le ners-état ne commença
à fe former que fous Louis-le-Gros , par 1 affranchiffement
ries ferfs. Comment 8c pourquoi les rois releverent infenfible-
ment le peuple. Ibid. n . a. Philippe-le-Bel fut le premier qui
convoqua une affemblée des trois états en 1301, à la perfua-
Jion d’Enguerrand de Marigny, fon miniftre. Quels en furent
les motifs. Détails fur ce qui fe paffa dans cette affemblée.
C’étoit autrefois l’ufage obfervé par les trois ordres du royaume
, de préfenter leurs cahiers à genoux. Ouvrages cités
■qui en font preuve. Ibid. b. Ces aflemblées des trois états
n’étoient point une fuite des champs de mars 8c de mai. Les
hiftoriens ne font fouvent pas d’accord fur les teips de la tenue
de plusieurs de ces états, ni fur la durée de leurs féances.
Des états généraux les plus connus i de ce qui s'y efi paffié de
plus mémorable ; de la maniéré dont ils s'arrogèrent peu-à-peuune
certaine autorité, b dont elle fut enfuite réduite. Quek étoient
les nobles compris dans l’ordre de la nobleffe. Le tiers-état
n’étoitque le peuple, repréfenté par fes magiftrats-députés. De
l ’affemblée des états en 1313. Ibid. 22. a.Hiftoire de ce qui
s'y paffa. Obfervation qui montre combien ces affemblees
étoient illufoires : cependant on y arrêta un point très-important
; lavoir, qu’on ne leveroit point de taille fans le confen-
tement des états. Affemblées provinciales que fit tenir Louis
Hutin en 1315. Philippe V , dit le Long, ayant mis , fans
confulter les états, une impofidon qui mécontenta tous les
ordres, convoqua l’affemblèe des états ; mais le clergé éluda
la décifion de l’affaire , qui ne put être terminée , Philippe
étant mort peu de tems après. Affemblées provinciales tenues
fous Charles I V , fon fucceffeur, pour la réduâion des mon-
noies , des poids 8c des mefures. Confirmation de la chartre
aux Normands, donnée par Philippe de Valois, avec décla-
radon de ne. rien impofer fur la province fans le confente-
ment des états. 11 fut arrêté en 1338 8c 1339» que l’on ne
pourroit lever les tailles furie peuple , fans l’oaroi des états.
Ibid. b. Les états affemblés en 1343 , accordèrent à Philippe
de Valois un droit fur les boiffons & fur le fel pendant le
tems de la' guerre* Aucun prince n’affembla fi fouvent les états
3ue le roi Jean. Objets de ces affemblées. Ce qui fe paffa
ans celle du 13 février 1360 , 8c dans les affemblées provinciales
qui fuivirent. Il paroit que fous le roi Jean, on ne
tint plus que des affemblées provinciales. Etats du Limoufin ,
tenus, en 1355. Commiffaires que le roi nommoit, avec
pouvoir de convoquer ces affemblées. Les trois ordres for-
moient leurs délibérations , & préfentoient leurs requêtes
féparément. Ibid. 23. a. Ce qu’on entendoit par états généraux.
Ceux de la Languedoil furent affemblés en 1355. Objets
de cette affemblée , par où l’on voit quel étoit le pouvoir
que les états s’étoient attribués. Affemblée des états à Paris
en 1356, lorfque le roi Jean fut pris par les Anglois. Détails
fur ce qui s’y paflà 8c fur les fuites de cette affemblée. Ibid. b.
Deux autres en 1357* où la nobleffe gagnée par le dauphin,
ne parut point. L indécence avec laquelle fe conduifirent les
états en 1358, fut l’écueil où fe brifa leur puiffance. Ceux
de la fénéchauffée de Beaucaire 8c de Nîmes en 1363 , pré-
fenterent au roi un cahier , fur lequel il étoit libre au roi de
faire ou ne pas faire droit. Les.états généraux ne furent affemblés
que deux fois fous le regne de Charles V. La foibleffe
du regne de Charles V I donna lieu à leur fréquence. Charles
VU les affembla rarement. Louis XI fut .celui de tous qui fut
tirer le meilleur parti des états. Affemblée d’états tenue à
Tours fous Louis XII en z 506, Ibid. 24. a. Affemblée fous
Henri I I , en 1558. Trois, célébrés ordonnances auxquelles
les états affemblés fous Charles IX donnèrent lieu. Ordonnance
de Blois, à laquelle donna lieu l’affemblée tenue à
Blois en 1576, fous Henri III. Autre affemblée à Blois en
*388. Prétendus états généraux tenus à Paris en 1593 , par
« duc de Mayenne. Les derniers états généraux fe tinrent à
Paris en 1614. Hiftoire détaillée de cette affemblée, dont
1 ouverture fc fit le 27 oétobre. Nombre des perfonues dont
chacun, des ordres étoit compofé.. lieu où fe tint l’affemblée.
/ r j lequel chacun prit féance. Ibid. b. Ce qui fe
paffa dans cette affemblée fur divers objets , & particulièrement
lur une propofuionfaite par les députés du tiers-état,
tendant a maintenir 1 indépendance des rois. Ibid. 23. a. La
clôture en fut faite le 23 février X613 ; depuis lors, il n’y a
eu que quelques affemblées de notables , improprement
appellécs affiemblees fiétats. La nobleffe fc donna de grands
mouvemens en 1631 , pour faire convoquer les états • m™
fes efforts n eurent aucun effet. Ibid. b. États particuliers „ni
fe tiennent encore dans quelques provinces , qu’on anoeÆ
par cette raifon , pays d états. Les gens de robe ne peùvenî
mats ceux qut jouiffent du titre de nobleffe , font inconteSî
blement compris dans l’ordre des nobles. Chez les Romains E
nobleffe ne réftdoit que dans l’ordre des fénateurs ; celui de«
chevaliers ne jouiffoit point d’une nobleffe parfaite. Ancien
nement en France tous ceux qui portoient les armes étoient
réputés nobles : alors la robe ne faifoit point un état différent
de l’épée. Changemens arrivés fous la troifieme race
par rapport à la caufe produôive de la nobleffe. Si l’on diftingue
aujourd’hui la nobleffe de la robe de celle de l’épée ce
n’eft que pour en indiquer l’origine , & non pour établir
entre ces nobles aucune diftinâion. Ibid. 26. a. On n’en con-
noît d’autre que celle qui vient de l’ancienneté, de l’illuAra-
tion, ou de la puiffance dont quelques nobles feroient revêtus
, à caufe de leurs offices. Pourquoi quelques-uns ont cru
que toute la robe étoit dans le tiers-état. L’entrée dans la ma-
giftrature ne fauroit effacer l’éclat d’une ancienne nobleffe •
& l’adminiftration de la juftice , qui eft le premier devoir
des fouverains, n’eft point incompatible avec elle. Comment
8c par qui la juftice étoit autrefois rendue en France, dans
les provinces & dans les parlemens. Ibid. b. Fondions de
juftice attribuées aux gouverneurs de certaines provîntes
aux maréchaux de France & aux officiers militaires. Confeik
lers d’épée admis dans le confeil du roi. Chevaliers d’honneur
établis dans les cours fouveraines. Les baillis & fênê-
chaux font des officiers d’épée, & doivent être nobles. Origine
des gens de robe. Depuis que l’adminiftration de la juftice
fut confiée à des gens de loi, les barons ou chevaliers s’adonnèrent
, les uns à cet emploi , d’autres à la profeffion des
armes ; les premiers étoient appellés chevaliers en loix , les
autres chevaliers d armes. Plufieurs offices de judicature communiquent
la nobleffe. Privilèges de nobleffe accordés aux
premiers magiftrats. Ibid. 27. a. ObferVations de M. de Voltaire
fur la nobleffe de robe. Tous les nobles d’épée ne font
pas pour cela plus anciens que les nobles de robe. 11 y a
même nombre de maifons illuftres dans l’épée , qui tirent
leur origine de la robe. Si la magiftrature étoit dans le tiers-
état , elle feroit du. moins à la tête; au lieu que ce corps a
toujours été repréfenté par les officiers municipaux feulement.
Pourquoi les magiftrats ne fe trouvent pas ordinairement
dans les états. Obfervation fur le rang que prit la magistrature
dans une affemblée de notables en 1558. Ibid. b.
Etats. Diverfes obfervations fur les affemblées d’états.
XIV. 143. a , b. 146. b. XVI. 918. a. XVII. 880. b. Rangs
qu’on obfcrvoit entre les différens ordres. XIII. 321. b. Du
clergé dans les affemblées d’états. III. 527. b. IV. 227, a.
Ordonnances faites dans ces affemblées. A l . 390. a. Députés'
envoyés pour préfenter au roi le cahier des états. IV. 867.
b. Elus des états. V. 531. ¿. Dons"gratuits que certains pays
d’état paient ■au roi. V. 38. a. Les états provinciaux font le
meilleur remede aux inconvéniens d’une grande monarchie. ;
VIII. 800. a , b. Avantages, des pays d’état fur ceux d’éleâion#
Ibid. b. 810. a.
Et a t . ( Jurifpr.) Etat d’ajournement perfonnel. Un officie»*
ou bénéficier qui demeure en état d’ajournement perfonnel,
demeure interdit jufqu’à ce que le décret foit levé. VI. 28.4.
Etat d’affigné pour être ouï. VI. 28. a. , ' f
E t a t , (Matièrebénéficiait') recréance ou proviûon. Lex- _
plication de ce mot fournie par l’art. 18. du tit. 15 delordon*
nance de 1667. Différence dans l’ufage entre le mot état 8c le
mot recréance. VL 28. a. . a i *«u
Etat dernier, en matière bénéficiale. Ce dernier état décide
fouvent les queftion» poffeffoires. VI. 28. a.
Etat dernier, en matière de poffeffion. VI. 2o.a. _
Etat des enfans. Rang qu’ils tiennent dans là famille ou **
foejété. VI. 28.a.
Etat d’une femme. Sa fituation en puiffance de man.
28. a. ■ ,
Et a t . ( fe mettre en ) Mettre une caufe ou procès en e
VI/28. b.
Etat office. VI. 28. b. èiÂtkài
Etat de perfonne. Sa filiation : ce qui l’attache a une «ami ,
VI. 28. b.
Etat dè prife de corps. VI. 28. b.
Etat, quefiion d' , VI. 28. b.
Etat premier. VI. 28. b.
Etat. ,. en matière de compte. VI. 28. b.
Etat, bref, VI. 28. b.
Etat final. VI. 28. b.
Etat des maifons royales. VI. 28. b.
Etat de recette, de reprife. VI, 28. b. y» ag y.
Etat dit roi, en ftyle de la chambre desco#nptes-
Etat au- vrai, en même ftyle. VI. 28.- b; y - a ¡l-
Etat ut jacet, lorfque l’on tarde à clorre-nn compte*
Etat, en Normandie. VI. 28. b. £iai
E T A E T E 641
Eut de Nevlî, en Angleterre. VI. 2$. I.
Etats d’Artois, affemblée des trois ordres de la province.
Us ne p e u v e n t être convoqués que par le roi. Objet de cette
affemblée î régler ce qui eft néceffaire par rapport aux fub-
ventions. Ancienneté de cetufage : fon origine. Interruption
de 20 ans que la tenue des états a foufferte une feule fois ;
favoir, depuis 1640, jufqu’en 1660.Préfident de ces états.
Ouvrages à confulter. VL 29. a. ^
Etats de Bourgogne: cette affemblée fe tient tous les trois
ans environ. Ouvrage à confulter pour connoître ceux qui y
ont entrée. VI. 29. a.
Etats de Breffe. VI. 29. a.
Etats de Bretagne. VI. 29. a.
¡j Etats du Bugey. VI. 29. a.
Etats du Charolois. VI. 20. a.
Etat du clergé ou de l’éghfe. V I. 29. b.
Etats du Dauphiné. VI. 29. b.
Etats généraux. VI. 29. b.
Etats de la Languedoc. VI. 29. b.
Etats de Languedoc. Affemblées de ces états avant la réunion
de cette province en un feul corps, & depuis fa réunion
à la couronne. Us s’affemblent tous les ans ordinairement à
Montpellier. Leur préfident. VI. 29. b.
États de la Languedoil. VI. 29. b.
Etats du Maconnois. VI. 29. b.
Etat de la Nobleffe. VI. 29. b.
Etats particuliers. VI. 29. b.
Etat , tiers-1 VL 29. b.
Etat, tiers- , en Angleterre, III. 727. b. eu France. XVI.
323. a.
Etats, trois, VI. 29» b.
Etats des villes. VI. 3 o. a.
E t a t . ( Médec. ) Tems où la maladie eft dans toute fa force.
VI. 30. a.
Etat de la guerre. Arrangemens néceffaires pour la faire
avantageufement. En quoi doit confifter l’état de la guerre
par rapport à un prince , qui ne peut avoir des armées auffi
fortes que celles de fon ennemi. Comment réglera l’état de
la guerre, un général dont la cavalerie eft Supérieure à celle
de l’ennemi, & celui qui eft plus fort en infanterie. 11 n’appartient
qu’aux généraux du premier ordre , de régler avec
fuccès l’état de la guerre qu’ils entreprennent. Auteurs à
confulter. Deux exemples de projets de guerre bien entendus
& bien exécutés. Le premier eft de M. de Turenne , lorf-
qu’il fut queftion ert 1674, de chaffer de l’Alface les impériaux
qui avoient formé le deffein de s’en emparer. VI. 30. a.
Le fécond eft de M. le Maréchal de Créqui,lorfqu’il fut obligé
en 1677 » d’agir contre M. le duc de Lorraine, dont l’armée
étoit Supérieure à la fienne. Combien il importe à la guerre de
fe conduire fur un projet antérieurement formé, plutôt que
de n’agir que félon l occafion. Ibid. b.
Etat-major , affemblage de plufieurs officiers chargés de
veiller à tout ce qui concerne le Service du corps, &c. Quels
font ces officiers & leurs fondions. L’infanterie a un état-
major-général , de même que la cavalerie légère , 8c les
dragons. Etat-major dans les places de guerre & la plupart dès
régimens. VI, 31. a.
E t a t <farmement, ( Marine ) lifte que l’intendant de la
marine envoie à la cour , contenant le nombre des vaif-
feaux qu’on doit armer dans fon département, &c. VI. 3 z. a.
Etat d’armement d’un vaiffieau. Détail qui marque le nombre
, la qualité & les proportions des agrès, apparaux &
munitions qui font employés pour le mettre en état de faire
fa campagne.
Etat de la garniture , armement 6* rechange <Tun vaiffieau du
premier rang. Haubans. Funins d’artimon. Garniture du perroquet
de fougue. VI. 29. a. Funins du grand mât. Funins du
grand hunier. Garniture du grand perroquet. Ibid. b. Funins
du mât d’avant. Funins du petit hunier. Garniture du petit
perroquet. Funins de beaupré. Ibid. 32. a. Garniture du perroquet
de beaupré. Les manoeuvres des voiles d’eftai. Manoeuvres
des bonnettes en étui. Marche-pié de vereue. Faux eftai.
Ibidlb. Cables, grelins & auffieres. Ancres & leurs uftenfiles.
Mâts , vergues & jumelles. Cordage neuf de rechange.
Poulies & caps de mouton de rechange. Ibid. 33. a. Voiles.
Uftenfiles de pilote, lbid.b. Canons & leurs ufteniues. Boulets
'ronds. Divers autres menus objets. Ibid. 34. a. Armes. Coffre
de l’armurier. Uftenfiles du maître. Uftenfiles du charpentier
& calfat. Ibid. b. Uftenfiles de pompe. Clouterie. Uftenfiles
du fond de calle. Cuifines. Chaloupes & canots garnis de leur
gouvernail 8c rouets. Ornemens de chapelle. Ibid. 35. a.
Coffre des médicamens pour fix mois à 800 hommes. Cordiaux
éleâuaires. Syrops fuhples & compofés. Miels. Eaux.
Efprits.. Huiles. Onguens. Emplâtres. Trochifques. Mercures.
Drogues fimples. Semences. Gommes. Aftringens. Ibid: b.
Fleurs. Racines. Drogues. Minéraux. Herbes. Inftruraens:
uftenfiles. Ibid. 36. a.
E t a t s , terre des, ( Géogr. ) XVI. 180. b.
. ETAU. ( Comm. ) Diverfes lignifications de ce mot. VI. 3 6.a.
Tqmc I%
Etaux. ( Boucherie ) police des étaux. II. 3 j 1. b.
Et a u , ( Serrur. 6* autr. Profeffi. ) machine de fer, compoféc
de plufieurs pièces & d'une forte vis. Son ufage. Diverfes
groffeurs de ces inftrumcns. VI. 36. a. Diverfes pièces dont
un étau eft compofé. De la fabrication d’un étau. Comment
On l’affujettit à 1 établi. Explication de la fabrique de la vis , 8c
de l’ufage des machines dont on fe fert pour la former. Ibid. b.
Explication de l’étau confidéré mathématiquement. Boîtes
d’étaux & de preffes, fabriquées de manière que le filet do
l’écrou eft de la même piece que la boîte. Petits étaux qui n’ont
point de pié. Comment ils fe fixent à l’établi. Ibid. 38. a.
Etaux de ferrurier. XVII. 829. a. vol. IX. des pl. Serrurier,
pl. 33,53. Façon d’un étau. Vol. IX. des pl. Taillanderie, pl. 3,
Fabrique des étaux. Ibid. pl. 10, 11 ,12.
Etau. outil d’aiguillier-bonnetier. Defcription avec figures.
VI. 38. *.
Etau d’aiguillier-bonnetier. 1. 208. b.
Etau des arquebufiers. Vl. 38. b.
Etaux à main de l’orfevre, du bijoutier , 8c de plufieurs
autrei ouvriers en métaux. VI. 38. b.
Etau d’orfevres, vol, VIII. des plaqch, Orfevre groffier,
pi. ¡ g
Etau à bagues du metteur-en-oeuvre. Etaux du chainetier ,
du charron, du coutelier. Etaux du doreur. Etau du fourbif-
feur. Etaux du gainier. Etau de bois des orfevres. VI. 38. b.
Etaux de fourbiffeur. XVII. 788. a. Voye[ les planch. de
cet art.
E T A Y , ( Marine') gros cordage à douze tourons. Son ufage,
Pofition des différens étays. Leurs différentes groffeurs 8c.
longueurs fe voient à l’article Cordage. VI. 38. b.
ET CÆTERA, ( Jurifpr. j termes latins ufités dans les
aétes & dans le ftyle judiciaire. Origine de l’ufage de ces
mots. C’eft fur-tout dans les aétes de notaires qu’on ufe de
ces abréviations. Différence entre les notes ou abbréviations
dont les notaires ufoient à Rome, & V& calera des notaires
d’aujourd’hui. Claufes dans lefquelles cet bc. eft employé.
Autrefois les bc. ne fe mettoient qu’en la minute 8c non
point dans la groffe ; mais aujourd'hui les notaires les mettent
également dans l’une & dans l’autre. VI. 29. a. Ces abbréviations
ne peuvent s’appliquèr qu’aux objets déterminés par
l’ufage. Dans un teftament , 16* catera ne peut fuppléer la
claule codicillaire. A proprement parler, cette abbréviation
ne fert jamais à rien. Auteurs à confulter fur l’effet de cette
claufe.
Un feigneur , après avoir énoncé toutes les terres dont il
eft feigneur , ajoute quelquefois un bc. Il y a des cas où le
feigneur pourroit s’oppofer à cette addition faite par fon
vaiial dans le dénombrement des fiefs qu’il poffede. L’omif-
fion d’un bc. fit, dans le fiecle précédent, le fujet d’un différend
très-ferieux , 8c même d’une guerre entre la Pologne &
la Suede. Ibid. b.
ÉTÉ. ( Géogr. b Phyf. ) Détermination aftronomique du
commencement & de la fin de l’été. VI. 39. b. Pourquoi le
tems de la plus grande chaleur n’arrive ordinairement que
cinq ou fix lemaines après le commencement de l’été. Levant
& couchant d’été. Ibid. 40. a.
Eté. Solftice d’été. XV. 327. a. Caufe de l’été aftronomi--
que. XI. 908. a. Fleurs de cette faifon. IV. 704. a. VI. 837. b.
Plantes, fleurs 8c fruits que l’été fournit pour l’ornement des
bofquets. II. 24. b. 25. a , b. De la chaleur d’été de différens
climats. VL 601. a. Sentiment de M. Hallei fur la chaleur de
l’été , prés des pôles. XII. 901. b. Pourquoi la plùs grande
chaleur n’a pas lieu le premier jour du folftice. III. 28. b.
Rapport entre la chaleur de l’été 8c le froid de l’hiver des
climats tempérés. VII. 326. b. Pourquoi il fait beau en été
quand l’air fe trouve chargé de brouillards le matin. II. 443.
a. Filamens qu’on voit voltiger dans les jours d’été, 8c dont
on voit quelquefois les plantes couvertes,'VI. 789. a. Fontaines
qui ne coulent qu’en été. VII. 97. a. Des pluies d’été.
XII, 792. b. 703. a , b. Suppl. IV. 410. a , b. Maladies de cette
faifoniçXIH* 87. a. Danger des étés fecs pour les beftiaux.
Suppl. III. 806. a. Régime à obferver en été. XIV. 13. a.
Utilité des bains de riviere en été. II, 21. a. L’eau bue en trop
rande quantité dans cette faifon, affoiblit. V. 194. b. —- Voye^
AISON. Eté de la S. Martin. VIII. 893.a.
' Ét é . ( Littér. Poéf, ) Comment les anciens repréfentoient
l’été. XIV. 330, a. Defcription poétique de cette faifon. VII.
736. a , b.
Été , quartiers d’ , ( Art milit. ) XIII. 689. a.
ETEINDRE, ( Gramm. ) VI.40,a.
Et e in d r e ; ufage de ce terme en pharmacie , en peinture
VI. 40. a.
ETENDARD , ( Art milit. ) étoit un chiffon de foie en-
vergé au bout d’une pique, bc. Les étendards étoient de
toutes fortes de formes 8c.de. couleurs. Comment ils font faits
aujourd’hui. Ordonnances du 1 février 1689, 8c du 7 mars
1684 , fur ce fujet. A qui eft dû le falut de l’étendard, 8c
comment il fe fait. Le pavillon des Yaiffeaux s’appelle étendard
fur les galeres; étendard royal, en marine. Ufages des