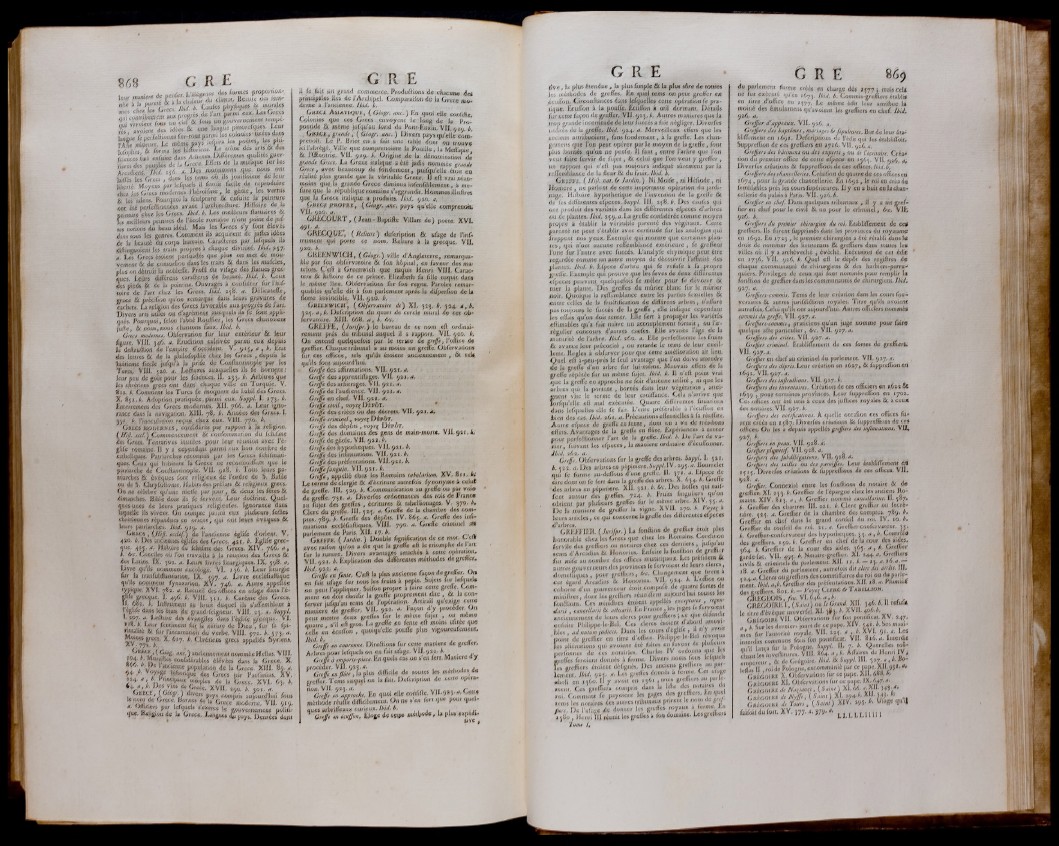
GRE , , I ’¿ lé iu ii« «te formes proportion- .
£ ' S * » S * i > j ^ * u »
Ligue fe perfeiriotte» <ùr-fOW p?r,,u Iss tfote
l’A f e m iilm s, Le m fm W sm wM- fè? t i '
t e te b " & forma t e b /om u s . f a : P / t e t e arts & t e
g ” V i f i g t f dan« M t e m j r t â r w m q u fo te g u e r -
I f s t e f | t § y la Crc .«. g fe î? d f la oteirque for t e
A rca d ite , « t e f e * , } « J W B W que nous a t
la i t e t e Grecs , dw s t e 1 1 1 Fffffotent
liberté Moyens par fefquels il ferai* Ui.il« <1? reproduire
a t e t e Grecs modernes f ’b é ro ilm e , te g én ie , t e . ven u s
& t e ialen.s, P o m m b foulpwrs & ««fuite la psmmre
ont été nsrfcftinnnées ayant J'arihifeSure, U m m de la
peinture s t e t e Grecs, p i E, t e s meilleurs iktuarres &
C meilleurs peintres de 1’écote romane « o n t point de jim
X notions du beau ¡dial, Mais les Grecs s'y font ile v t e
dans tous les genres. Comment ils aeanirent de iu f t e idées
de la beaufo dn eorps Iwmain. Ca railsrss par teq u e ls ris
diffinguoicnt les trait* propres à éjîsjjué diyinKé, Ibid, W Jt
fi. G re c sê m m WtmÊfc. <IHSM >iu* on n m * * W f c
veinent 6t de contorfion dans fee traits fit dans tes mu feles f
pjuson détruit la p p l g l M i dH y j f a p des g a f i p g r #
Lgûrs différées carafterèS 4§ p | * M M A- V f»#
des pieds & de la poitrine. O u v r a i s à çonûdtèr fw im Ç
toi ru d e l’art chez Les Grecs, Ibtd, 458, a, Deliçat£(fe?
grâce & précifion qu’on remarqué dans leurs gravures d e
cachets, ù religion des Grecs favorable aux progrès d e Lan,
Oiyers arts m e s ou d’agrément auxquels Ils Ce font appliqués,
Pourquoi, félon l’abbé Rouffier, Les Grecs c lw m ien t
jU(lç , ¿¿ nous, nous chantons faux, Ibid, b,
Grecs modernes, Qbfervatfon fur Leur extérieur & teur
figure, v i l l , 346, a, Erudition cultivée parmi eux depuis
h d ed ru éon de l’empire d’occident, V , 913, 4 , b, Etat
des lettres & de la pfiilofbfdne d m les G r e c s , depuis Le
huitième fm t e jufqu’à l a p r i f c d e GonfmmnOpie par les
Turcs» VIII, 379, a, i e ê u r è s auxquelles ils Ce bornant;
leur peu de goût pour les (d en ses. H, 433» b, Arbitres que
les chrétiens grecs ont dans clioque vilic en Turquie, V,
$%%, % Comment les T urc s Ce moquent du babil des Grecs,
X, W $ M Adoption pratiquée, parmi eux , Suppl, l- *73, b,
Enterremens des G r e c s modernes, X I I , y&è, 4, L eu r igno rance
dans la navigation- XIII- 7 $ , b, A n n é e s des G r e c s , l,
|Jp; b, l'inoculation r e çu e d m e u x , V lll, 7 7 9 , b,
Grjxs b iQ m n n r s , considérés par rapport a la religion,
( ff ijh fÇ f/ S C om m en c em en t de confommatfon du fd u fm e
des Grecs, T en ta t iv e s inutiles p çu r leur réunion a v e c i ’é f
gljfe romaine, I l y a cepfndai}t parmi eux bon nombre 4e
ç?.t|rohques, Patriardtes reconnus par les G r e c s fclùfmati-
ques. C eu x oui hdbitcnt Ja G r e c e n e r eco n n o iiRm q u e Iç
pÿtrfcrcb^ 4« C onfianûnople , V U , ()t%, b, Tpms leurs patriarches
M é vêqu es font r d ig ieu * de l’ordre de §f Paille
ou de S, O iry foh om e , Habits des prélats & religieux grecs.
On ne c4lebre qu’une nielle par p u r ? de d eu x l ^ fe te s &
(dimanches, Bibl§ 4ont ils IV fe r v en t , L eu r do&rine, Q u e L
^ye^-nnes 4e leurs pratiques reljgieyies, Ignorance dans
laquelle ils vivent. On compte pat (ni e u x plufteurs (ed e s
çhrtÿeooes répandues en orient y q u i o n t leurs év êq u e s Se
leyrs paxriwil^s, Ibïd, o to * 4,
G r ï ç s , fff/fl, fcçUf,) de l’ancienne .églife d’orient, V .
43-0, b, Des anciennes éghfes 4^s Grecs, 4x1, b■ Eglife grecque
4M, 4, HiAniredy fdûftned es Grecs, X IV , non, 4 }
p, ê'Ci Conciles oy l’on travailla à la réunion des Grecs Sx
des Ladns- IX, p a , 4. Leurs livrés liturgiques, IX, 59?- 4,
Livre rp/ils nomment éueologe, V I , ?m . b, Leur lity r^e
lyr la tranfubRmûaûon, IX, son, 4, L iv re ecdéhaPâque
qn’ils nomment fymxmôn, X v , 746, 4, Autre, appellée
typique; X V I . 78?, 4. Reçycil dés owees en ufage dans Yé-
* grecque, L 49G b, VIII. y u , b, Carême des Grecs,
n, 09%, b, In firm en t au bruit duquel ils s’afiemhlent à
l’éghie dans les états jiu grand-feigneur, VIII, %%, 4, S tm l,
h # 4, Leôure des éygngiles dans YédiCe grecque, V I,
%t§, b, Leur fentiment fût, la nature 4e Dieu > fur fa fpi-
runalité & fur l’incarnation du yerbe, VIII. k o a. h, 5 7 3 ,4,
mornes grecs. X, 4*7, b, Chrétiens grecs appel lés Syriens,
l £ * 9 I fyog, (tm, ) anciennement nommée Hellas. V III,
Ü
l ° A ' 7 M u rÿte conhdéraldes éle'vées dans la G r e c e , X
Ï500. b..Me lancienne population 4 e la G re c e . XUI- 09, 4,
9 4 - b. voya ge lyfiorique des Grecs par ' Paufanias, XV,
p t * • M ê l m ^ M i l de la G re c e . X V L 6 3 , b, H *é’ xvii, « b , \ o t , 4.
Gn iç jL , (G io p r ,) divers piy§ compris aujourd’hui fous
l* nom de G r« u liorn« H H I H
i æ f l p‘[ Y T 1* 16 gmiyernement polirl
f f ^ f b Crsç«, Lmgu« i , pa y l. ü tn r i( i iw c
G R E
il fe J 4 1 un grand commerce. Produirions d e chacune des
principales lies de l ’Archipel, Conqm aifon de la Grece moderne
à l’ancienne, lbid> h.
G n tC g A s tA t iQUP, ( Géofcr, nm. ) En quoi elle coniifte.
Colonies que ces Grecs envoyent le long de la Pro*
pontide §c même jufqu’au fond du Pont-Euxin, V II, o to , b,
, GxtGï, t grand*, ( Gtigr. am, ) Divers pays qu’e lle eotm
premnt. L e P, Bries en .0 fait une table dont on trouve
ici l’abrégé. V ille que çompremient la Pou iile , J* Meiàpie
& l ’^ n o tr ie , V IL 919, b, Origine Ae la dénomination dé
grandi W dm P&. Grece italique a été jadis nommée grands
Grtcç, a v ec beaucoup de fondement, pui%u’«lU étoit en
réalité plus grande que la véritable Grece, IJ eft yrai néanmoins
que. la grande G r e c e diminua in fen fé km e n t , à me-
fure que la république romaine s’aggrandit. Hommesilluûres
que la G re ce italique a produits, ibïd., pvo, a, ‘
_,GnPC^ p n a p B .ç , ( Giagr, am, pays qu’e lle comprenais,
Yll.QjtQ,, il, I ; : ..,,: . , .
G ï lE Ç Q U R T , ( /ean - Baptifte Villan d e ) poète, X V L
49*' 4, ;
G R E C Q U E , {M u r * ) deferip tlon $c ufage de i’inG*
trument qui porte c e nom. Reliure à la grecque, V I I ,
9%o„ b,
G llE E N W IC H , ( Gévgr, ) v ille d’A ngleterre, remarquab
le par fou obfervatoire & fon hôpital, en faveur des ma»
telots, C ’eft à Greenwich que naquit Henri VUE Caractère
Si liiftoire de c e prince, Elisabeth fa bile naquit dans
le même' lieu. Qbfervations fur fon regne, Paroles remartuables
qu’elle dit à fon parlement après la difperfton de la
otte inyincible, V IL 930, b,
G&î îu w ic h | Objervatoire de) XI, 343» b, 344, * , b,
3 4 4 ,4 t b, Description dn quart de cercle mural de cet o b servatoire,
XIII- (/&, a , b, Pè,
G R E F F E , U m fv r ,) le bureau de c e nom eA ordinairement
près du tribunal auquel il a rapport, VU. o%o, b,
O n entend quelque Ibis par le terme d e greffe, l’omce de
gredier, Chaque tribunal a au moins un greffe. Observations
hjr ces o ffice s , tels qu’ils étoient anciennement, &. tels,
qu’ils font aujourd'hui,
Greffe des affirmations, V IL o%i.a,
Grejj) des apprentiffages, V il, 9 4 1 ,4,
Greffe des arbitrages, VU, 9 4 ) , 4,
s m do l’oudinBon. V I I . ‘j ü ' a.
Grfjfç eu ejîgf. V II, 9 y t . a,
Grtfff çw ïl. voyfç UbvôT.
Greffe des e r i lte ou des dderets. V I I . 9 * 1 , u.
Greffe criminel 1 voyer. D é p ô t .
Greffe des d é j,6 ïs , voye^ D é p ô t ,
G /iÿ l des domaines des gens de main-morte. V I I , 9 1 1 . Si
Greffe Art géote. V i l , 9m , b,
G reffeisi liypotliet(ues, V I I , 9*», h,
Greffe des inftnuatfons, V I I , 9 * t . S.
Greffe 4est>réfeütafo>ns, V I I , 9 * * , S.
Greffefmmm, V l l . ÿ i t , b,
Greffe, l ip e i lê ebe* les Romsms tabularium. a v . » 1 1 . ,*
L e terme de elergie & d ’dcriture »utrefois fynonymn à celui
de greffé; III, ton , b. Communication an greffe ou par v o is
de greffe. 79 * , », Diverfes ordonnances des rois de France
au foier des greffes , Écritures S* tabellionages, V , ,7 9 , b.
C le rc du greffe, III, 5®; «, Greffe de la chambre des comptes
789, h, Greffe des dÉnôts, IV , StSj, », Greffe des but-
nimbons ecçIÉfialfomes, VIII, 799, », Greffe criminel an
parlement de Paris, X II, 17, S, U, a
C a r r e r . ( /erdi». ) Double lignification de c e mot, C en
avec raifon qu'on a dit que la greffe eft le triomphe de l’art
for la nature. Divers avantages attachÉs à cette opération.
V I I , p a t , b, Explication des différentes méthodes de greffe/.
w M ï Ê É Ê m C ’e ft la plus ancienne façon de greffer, O n
en fait ufage fe r rom les fruits à pen te Sujets for lefouel*
on peut l’appliquer, Salfou propre 3 faire cene greffe. Comment
on don eboifir la greffe proprement dite , & la cou-
ferver iufon’au teins de l'opÉration, Attirail qu exige c e t«
maniéré de greffer, V I I , <)%%■ »■ Façon d’y procéder. On
petit mettre deux greffes fur le m im e fujet , ou m im e
q u a tre , s’il eft gros, La greffe en fente eft moins ufifee que
celle eu écuffon , quoiqu’e lle pouffe plus vigopreuiement.
^G r e ffe en cnvrnnne, Direftions fur cette maniéré de greffer.
Arbres pour lelquels on en fait ufage, V IL qaa.É,
Greffe » empnneffuçe- En quels cas on s en fort. Maniéré u y
Greffe en lapin s dilficile de toutes les méthodes de
greffer, Tems auquel on la fait, Defeription de cette opéra»
^ G r e f fe e T n pm e l ie , En quoi elle eoAf/fte, VU, ÿ*3, e, Cette
méthode W m , dftteifemeut, On n e s’en fort que pour quel-
ques arlM cau x curieux, lb\4, b, , , ,
f f f ! P EM » « 4e w w ^ 4« , h» p lu s e x p é 4lt
GRE t iv ç , la plus é ten d ue, la plus (impie & la plus sûre de toutes
jç s méthodes de grelfes. En quel tems on peut greffer en
écuffon, Circonftaitces dans lefquelles cette opération fe pratique,
Eeuffon à la pouffé, Ecuffon à mil dormant, Détails
fur cette façon 4c greffer, VU, 943. b, Autres manieres que la
trop grande incertitude d e leur fu c c è sa fa it négliger, Diyerfes
utilités d e U greffe, Ibtd, 944. 4, Merveilleux effets que les
anciens attribuoient « fans fon dement, à la greife. Les cham-
gemeus que l’on peut opérer par le moyen de la g r e ffe , font
plus bornés qu’on ne penfe, Il fa u t , entre l’arbre que l'on
y eut faire (ervir de fu je t, & celui que l’on veut y g r e ffe r,
un rapport qui n’eft pas toujours indiqué sûrement par la
reflemblance de la fieurße du fruit, Ibid, b,
Gnt-FFc, ( Hiß, nah & Jardin, ) Ni M o jfe , ni Héftode, ni
H om e r e , ne parlent de cette importante opération du jardi*
nage, Hiiloire hypothétique de l’invention de la grelle &
d e fes différentes efpeces, $uppf, IIL b, Des caufls qui
ont produit des variétés dans Les différentes efpeces d’arbres
ou de plantes, Ibid, 9.39,4, La greife eonfAérée comme moyen
propre à établir la yérhable parenté des végétaux. C ette
parenté ne peut s’établir avec certitude fur les analogies qui
frappent nos yeux, Exemple qui montre que certaines pjan»
tes » qui n’ont aucune refiemblance extérieure t fe greffent
l ’une fur l'autre avec fuccès, L’analy fe cbyinique peut être
regardée comme un autre moyen de découvrir l’amniré des
plantes, Ibid, b, Efpeee d’arbre qui fe refufe à fa propre
greffe, Exemple qui prouve que les fev es de deux différentes
e fp ec es peuvent quelquefois fe mêler pour fe dévorer oc
tuer la plante, Des grelfes du mûrier blanc fur le mûrier
noir, Qu oiqu e ta reffcmblance entre les parties fexuelles 6c
en tre celles d e la (ru&tikafion 4e diJfércns a rbres, n’affure
pas toujours le fuccès 4e la greife , elle indiqué cependant
Jes effais qu’on doit tenter, Elle fert à propager les variétés
cltimables qu’a fait naître un accouplement fortuit, ou l’irrégulier
concours d’autres caufes. Elle avance l’âge de la
maturité d e l’arbre, Ibid; 4<io, a, Elle perfectionne Tes fruits
& avance leur précocité , ou retarde le tems de leur cueillette,
Règles à ob ferv er pour que cette amélioration ait lieu.
Q u e l eA à-peu^près le feul avantage que l’on doive attendre
d e la greffe d’un arbre fur lui-même. Mauvais effets de la
g reffe répétée fur un même fujet, Ibid, b. Il n’eA point vrai
que la greife en approche ne (bit d’aucune utilité » ni que les
«arbres qui la portent , bornés dans leur végétation ♦ atteignent
vite le terme de leur çroilfanee. Cela n’arrive que
lorfqu’elle eA mal exécutée. Quatre différentes fituatious
dans lefquelles elle fe fait. L ’ente préférable à l’écufloii1 en
bien des cas, Ibid, a ô t , a, Précautionselfentiellesà fa réuibte.
A u tre efpeee de greffe en fen te , dont on a vu 4e tressons
effets, Avantages de la greffe en flûte. Expérience* à tenter
pour perfeftionner l’art de la greffe, Ibtd, b, De l a n d e varier
» fuiyant les efpeces p la maniere ordinaire d eculionner,
Jbid, %&%, 0, . . .y
Gniff, Obfervilinns for la greffe des arbres, Suppl, l m i
t , <ex, », Des arbres en | iéplmere,ôw'telV, *95,«, Bourrelet
qui fe forme au-deffws d’uns greffe, »■ 1 7 ». ». E feu » de
cire (font 00 fe ferî dans la greffe des arbres. X 614, b, Greffe
des arbres en néumiere* XII, ) * ( , b, f a , Des bolles (jutnail-
fent amour des greffes, 7 M- fc Frute finguliers qu on
obtient par plufieurs grelfes for lentém e a rb re ,X IV ; , 5.4,
D e la maniere de greffer la vigne, X VII, *7.0, b, P « ( a
leurs articles p ce qui concerne la g refie des différentes elpeces
d ’arbres, ^ -, , , < „
GREFFIER, W iiÉ fím E» fonéfion de greffier étolt pius
honorable d m lés G rm a w ebex les Romains, Condition
forvile des greffiers ou notaires cltet ces dernier», julqu au
tems d’A r c a d iu s ¿ Hottorius, Ënfoiteria fouÉbon deigrentte
for ntife au nombre des offices municipaux, Les prifidens «
autres gouverneurs des provinces fe fervoietit de leurs clercs,
d o m e & e s , pour greffiers, f a , atangemeni que firent a
ce t Égard Areadius % Hottorius, V IL 9 * 4 . b, L office ou
cohorte d’un gouverneur Étoit compofe de quatre fo r« s de
niittiffres, dont les greffiers réuniffetu amourd but mutes les
fondrions. Ces miniflres Étoient aiqtelte iK iip u r u , f fS e f
M i , c»nt,u»rii & »(lu»rii, En France .le s piges fe feryeleui
anciennemeni de leurs efercs pour greffiers 1 te qbe difendit
eufoite Pliilippe-le-lfe), C e s clercs Étoient d abofo amovib
le s , » d /iu lm mdieil, Dans les cours d Égide , ’l o X ,VDIt
■point de greffier en titre d'office, Pbilippe-le-Bel révoqua
les aliÉnatfons qui avoient été laites en laveur de pbiltcurs
perfonnes de ces notairies. Châties IV ordonna que les
greffes fcroiem donnés à ferme, Divers noms fons lelqnels
Fes greffiers Étoient dÉfignÉs, Des anciens greffiers au parlement
, Ibid. m , », t e s greffes donnÉs a ferme. Ce t triage
aboli en t tô o . Il y avoit en i i f i t , trois greffiers au parle
ment. Ces greffiers compris dans la lifte des notaires du
roi, Comment fe psyoienr les gages des greà s f i ,^Cfl ff «
tetns les notaires des antres tribunaux prirent le
■Mrs, D e l’ufiage d e donner les greffes royaux a
j 58 0 , Henri III réunit t e greffes i fol) domaine, t e s greffiers
Tarn* /#
Gre 869
E
du parlement furent créés en charge dès 1377 i mais cela
ne fut exécuté qu’en tGj3, Ibid, b, Commis-greffiers établi*
en ,0 £$§ 4 ulhce en » 577, Le même édit leur attribue la
moitié des emolumens qu’avoient les greHiers en chef, Ibid,
97/), 4,
Greffier d ’appeaux, V IL 99A, a,
. G rsffm d u bapUrns, n/a/iagu & fipultures. But de leur éta-
bliAement en 1(191, Deferiptions de l'êdit qui les étahliUbit.
Supureffion d e ces greffiers en 1716, V i l . 996,4,
Greffiers des bâomens ou d u tx p irls, ou 4* l'éçrUotrt, Créaa
tion dn premier office de cette e fp e e e en 1363. V i l , 9x6, a,
Diverfes créât fons 6t fuppreffion* de ces offices, Ibid, b.
Greffiers des ç/ta/içe/Uriu, Création de quatre de ces olhççs en
1(174 9 pour la grande chancellerie, En 169% t le roi en créa de
fembbmles prés les cours fupérieures. Il y en a huit en la chancellerie
du palais à Fa ris, V IL ij%6, b,
Greffier eu chef, Dans quelques tribunaux , H y a un greffier
en ch e f pour le civil 6c un pour le criminel, Pe, V i l ,
9%f>, b,
Greffiers du premier chirurgien du rot, Etablilfement de c es
greffiers, Ils furent fupprimés dans les provinces du royaume
en 169%, En ¿ 7 4 3 , le premier chirurgien a été rétabli dans le
droit ae nommer des lieutenans 6c greffiers dans toutes les
villes où il y a archéveché 7 évéché. Exécution de cet édit
en 1736, V il, 9%d, b, Q u e l eA le dépôt des regiAres de
chaque communauté de chirurgiens & des barhiers-perruJ
quiers. Privilèges de ceux qui font nommés pour remplir la
fonction de greffier dans les communautés de chirurgiens, Ibid»
9VJ> 4 ,
Grefferf-conmis, Tems d e leur création dans les cours fou~
veraines 6c autres jurifdUlfons royales, Titre qu’ils avoient
autrefois, Celui qu’ils ont aujourd'hui- Autres ofiiefers nommés
Commis du greffe, VU, 9 4 7 ,4,
Grtffcrsrçommis, praticiens qu’un juge nomme pour faire
quelque aéfe particulier « êrc, V il, 97/7,4»
Greffiers des criées, V II, 9 4 7 ,4,
Greffier criminel, Etablifiemcot 4 e ces fortes 4 e greffiers»
V i l 977,4, ,
Greffier en ch ef au criminel du parlement, VII, 977,4,
Greffiers des dipris, Leur création en tti»7» & fuppreffion en
169%, VÎL 9 4 7 ,4,
Greffiers des inflruflions, V IL 947, b, ■
Greffiers des inventaires, Création de ces oificiers en 1644 «
*¿39 , pour certaines provinces, Leur luppreifion en 170%.
Ce» offices ont été unis à ceux des juAfees royales & à ceux
des notaires, V IL 947, h
Greffiers des notifications. A quelle occafion ces offices furent
créés en 1M7, Diverfes créations Ce fujiprelfions de ces
offices; On les a depuis appellés greffiers des infinuations, V IL
97/}% b, . ;/
Greffiers en peau, V IL 970, à.
Greffierpltunttif, V IL 948, a,
Greffiers des Jubdllégâtions, VU» 9%%, fi, .
Greffiers des tailles bu des paroiffes, Leur établiffement ert
1313, Diverfes créations & fuppreifious de ces offices, V I I .
%Greffier, Connexité entre les fondions de notaire & de
creifier, XI, 433, b. Greffier de l’épargne met, Us anciens Romains,
X IV , 813, a , b, Greffier nommé eaneellorius, IL 307»
b, Greffier des Chartres ÏIL 4 4 1, b, Clerc greffier on Ibcré-
taire, 373, a, Greffier de la chambre des comptes, 789, b»
Greffier en chef dans le grand confejl du roi, IV , 10, b.
Greffier du sbtjfeil du roi, %t, a, Gteffier confervatgur, 33.
h, Grefffenconfervateur des hypothéqués, 33, a , b , Contrôle
des greffiers, 130, b, Greffier en c h e f de la cour des aides.
*64, b, Greffier 4e la conr des aides, 363, a , b, Greffier
ÎW m è i V U , 495, b, Notaire-greffier, XL %44'fo Greffiers
civils & criminels ou parlement. XII, 11, b,*~ i j . a , to, a.~~
tff a, Greffier du parlement, autrefois du clerc des m u s , n i.
a a C le r c s ou greffiers des commiffaires du1 roi ou Ou parlem
en tJb id ,a J> , Greffier des préfeutartons, X II, 18, a, PJummf
des greffiers, 801, b, - Voyez G m û ê (e T kn ru io u ,
G llE G E O IS . feu, VLô.40, a 9b, , j . ■; > >
GRÉGOIRE I , {Saint) ou le Grand. XII- 346, b, î{ refufx
fe titre ff’Évéque nniverfel, XI. 1 Ï ) , i , XVII, XW-E
GnÉGOiRt v i l , Obfervtnnn# for fon p o n ii te i. X V , 147.
x , h, Sur les dentier, jours tfe « |>»pe- XIV.
mes fur l’atitoritA royale, VII, W , » . 4' X V I . 9 1 ,* , Les
interdits cnnununs fous fon pontifie»!, V I , B l B I
nii-il lanea for I» Pologne, êlippi, D) 7 - M Querelles to i-
’FUI. OE 1 1 Affrires de Henri IV ,
empereur. & de Grégoire, ¡M . U S»ppl, III, 7 *7 .t e g f i ”
3 1 I I , roi de Pologne, excommunié p»r ce W P S , XII, 9 J «• "•
GRÉGOinf X, Obfervxtions for ce p»pe, XII, 68». »»
G r é g o ik e XI, Obferverions fur ce pape, IX.fM,»\
iflnÉGOlÜB4‘ f f l jm m è > ( fo r in ij X L ô d , * X I f M l ’ ’'.
GtiÉGOiae ,/r W à m È M W M W M Ê m
G » é g o ib e * Tours, (S am i) XIV, »97, wfogs qutj
fitifoit du fort, X V , J 77, », )7p, »• l l l L L I I H I