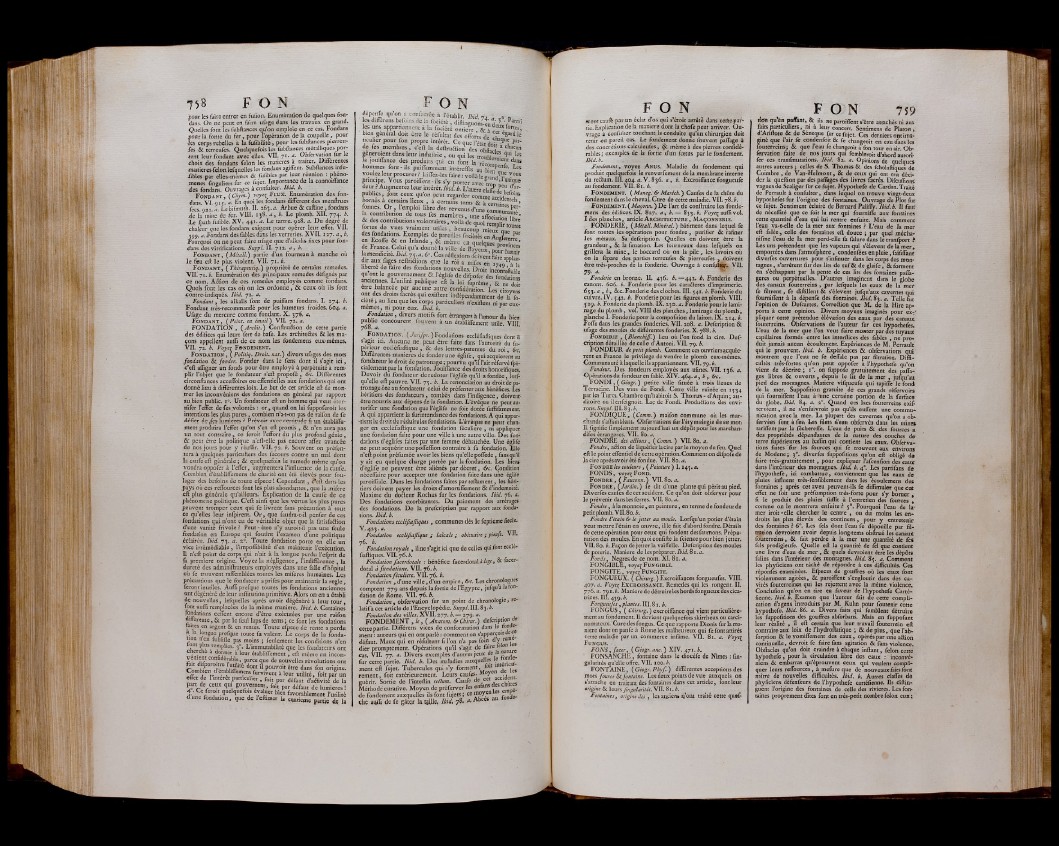
7V8 F O N F O N
pour les faire entrer en fufion. Enumération de quelques fort-
dans. On ne peut en faire ufage dans les travaux en grand.
Quelles font les fubftances qu'on emploie en ce cas. Fondans
pour la fonte du fe r , pour l’opération de la coupelle, pouf
les corps •rebelles à la fùfibilite, pour les fubftances pierrèu-
fes 8c terreufcs. Quelquefois les fubftances métalliques portent
leur fondant avec elles. VU. 71. Obfervation fur le
choix des fondans félon les matières à traiter. Différentes
manieres-felón lefquelles les fondans agiffent. Subftancesinf rtib
le s par elles-mêmes & fufibles par leur reunion : phénomènes
finguliers fur ce fujet. Importance de la connoiffance
des fondans. Ouvrages à confuker. Ibid. b.
F o n d a n t , ( Chym.) voye{ F lu x , ¿.numération des fondans.
VI. à t f i a. En quoi les fondans différent des inenftrues
focs. 922! a. Le bifmuth. II. 263. a. Arbue 8c caftine, fondans
d e la mine de fer. VIII. 138. a , b. Le plomb. XU. 774. b.
Le fpath fufible. XV . 441. Le tartre. 928. a. Du degré de
chaleur que les fondans exigent pour opérer leur effet. V IL
399. a. Fondans des fables dans les verreries. XVIL 127. a , b.
Pourquoi on ne peut faire ufage que d’alkalis fixes pour fondans
des vitrifications. SuppL II. 712. a , b.
F o n d a n t , ( MétalL) partie d’un fourneau à manche où
le feu eft le plus violent. VII. 7 1 . b.
F o n d an t, ( Thérapeutiq. ) propriété de certains remedes.
V I I . 71. b. Enumération des principaux remedes défignés par
c e nom. Aétion de ces remedes employés comme fondans.
Quels font les cas où on les ordonne, 8c ceux où ils font
contre-indiqués. Ibid. 72. a.
Fondant, les alkalis font de puiffans fondans. I. 274. b.
Fondant très-recommandé pour les humeurs froides. 604. a.
Ufage du mercure comme fondant. X. 376. a.
F o n d a n t , {Peint, en émail) VII. 72. a.
FO N D A T IO N , ( Archït. ) Conftruélion de cette partie
des édifices qui leurt fert de bafe. Les architeéles 8c les maçons
appellent aufii de ce nom les fondemens eux-mêmes.
VIL 72. b. Voyez Fondement.
F o n d a t io n , ( Politiq. Droit, nat. ) divers ufages des mots
fondation 8c fonder. Fonder dans le fens dont il s'agit i c i ,
c'eft afiigner un fonds pour être employé à perpétuité à remplir
l’objet que le fondateur s’eft propofé , &c. Différentes
circonftances accéffoires ou effentieiles aux fondations qui ont
donné lieu à différentes loix. Le but de cet article eft de montrer
les inconvéniens des fondations en général par rapport
au bien public. z°. Un fondateur eft un homme qui veut éter-
nifer l’effet de fes .volontés : o r , quand on lui fuppoferoit les
intentions les plus pures, combien n’a-t-on pas de raifon de fe
défier de /es lumières i Prévoir avec certitude fi un établiffe-
ment produira l’effet qu’on s’cn eft promis , 8c n’en aura pas
un tout contraire, ce feroit l’effort du plus profond génie,
8c peut être la politique n'eft-elle pas encore affez avancée
de nos jours pour y réuflir. VII. 72. b. Souvent on préfon-
tera à quelques particuliers des fecours contre un mal dont
la caufe eft générale ; 8c quelquefois le remede même qu’on
voudra oppofer à l’effet , augmentera l’influence de la caufe.
,Combien d’établiffemens de charité ont été élevés pour fou-
Iager des befoins de toute efpece ! Cependant, ?eft dans les
.pays où ces reffources font les plus abondantes, que la mifere
eft plus générale qu’ailleurs. Explication de la caufe de ce
phénomène politique. C ’eft ainfi que les vertus les plus pures
peuvent tromper ceux qui fe livrent fans précaution à tout
ce qu’elles leur infpirent. O r , que faudra-t-il penfer de ces
fondations qui n'ont eu de véritable objet que la fatisfaâion
d’une vanité frivole ? Peut - être n’y auroit-il pas une feule
fondation en Europe qui foutint 1 examen d’une politique
.éclairée. Ibid. 73. a. 20. Toute fondation porte en elle un
vice irrémédiable, l’impoftibilité d’en maintenir l’exécution.
11 n’eft point de corps qui n’ait à la longue perdu l’efprit de
fa première origine. V o y e z la négligence, l’indifférence , la
dureté des adminiftrateurs employés dans une falle d’hôpital
où fe trouvent raffemblées toutes les miferes humaines. Les
précautions que le fondateur a prifes pour maintenir la regle,
feront inutiles. Auffi prcfquc toutes les fondations anciennes
,ont dégénéré de leur inftiturion primitive. A lors on en a établi
de nouvelles, lefquelles après avoir dégénéré à leur tou r,
font auffi remplacées de la même maniere. Ibid. b. Certaines
fondations ceffent encore d’être exécutées par une raifon
différente, 8c par le feul laps de tems ; ce font les fondations
«ites en argent 8c en rentes. Toute efoecc de rente a perdu
a la longue prefque toute fa valeur. Le corps de la fondation
n en fubfifle pas moins ; feulement les conditions n’en
/.K^l?¿AS>rej nplles' 1°* L’immutabilité que les fondateurs ont
leur établiffement, eft même un incon-
ftue <■« nouvelles révolutions ont
J Z h r l r Upouvoit être dans fon origine.
Combien détabldTeu.e.ufoprivent à leur utilité, folt par un
effet de 1 intérêt pameul,er , f „ it par défam d-aa ¡v ¡t¿ de la
part de eeux qui gouvernent, fou par défaut de lu - c ré s ,
d W f ? -V , l a T S F b' î " «"’orablement l'utilité
dune fondation, que de lelhmer 1» cwticme partie de la
dépenfe qu on a confacrée à l’établir, m l , , „ f i „
les différens befoms de la foelété , diflinguon^n d i f o “™’
les
je . uns appartiennent eut à la foelété loelété entière , & J
f — 1 "™ * .
bien général doit être le réfultat des efforts dl §H 8Jri1 “
tieuber pour fon propre intérêt. Ce que l’éta, K I®-
de fes membres, c’eft la deftmé&m des ?cun
efforts de cla q!
l'd e s 0''
gêneroient dans leur indullrie , ou qui les’ t t^ n u ^ ^u‘ *es
¡a jouiffance des produits qui en font la r i'o da” !
hommes font-Ils puiffamment intéreffés au lS "P ’ *•“
voulez leur procurer? hiffez-les faire: voilà le I s S P Vous
principe. Vous parolffent-ils s’y porter avec trr" „ " “ IS“6
deur ? Augmentez leur intérêt. Ibid. b. L’autre claflLP J1 î ®
mih « font utreclal|edebefo nt
pu b lie s , font c eu x qu’on ^ u t r e g ^ d e rT O m m e \i 0 'n6
bornés à certains lieux , f , ^ ¡ § ¡ ¡ 1 & S l l p i
fohnés. O r , l’emploi libre des revem^d’u n e I I P ? P < f
la o contribution , n ae de tous tous lfcess mmeemmbbrree-s , un- e af-fo c”iarnin,urn, iil-ult. é*’
& des contributions volontaires .vo ilà de quoi remnbV J
fortes de vues vraiment utiles, beaueoim S a “ ù“
des fondanons. Exemples de pareilles foeiétés en Anzîettrrc
en Ecoffe & en Irlande, & même en quelques ’
de France. Celui qu’a donné la ville de Baveux “
ln n .« n d itó / i/4 ,.m « ..C e .réréflexions « e x ion7& doivent & fàii
^
dir aux Pages reftriâions
en 1749 , 'à la
liberté de ïaire des fondations nouvelles. Droit i S j à f e
qu ont le gouvernement & l'églife de difoofer des fondldoÜ
anciennes. L utilité pubbque eft la loi fàprême, & ne dob
être balancée par aucune autre çonfidération. Les citoyens
ont des droits facrés qui exiftent indépendamment de la fo-
ciété ; au lieu que les corps particuliers n’exiftem ni par eux-
mêmes, ni pour eux. Ibid. b.
Fondation, divers motifs fort étrangers à l’amour du bien
public concourent fouvent à un établiffement utile. VIII
760. <1.
, F o n d a t io n . ( Jurifpr. ) Fondations eccléfiaftiques dont il
s agit ici. Aucune ne peut être faite fans l’autorité du fu-
périeur eccléfiaftique, 8c des lettres-patentes du ro i, &c.
Différentes maniérés de fonder une églifo, qui acquièrent au
fondateur le droit de patronage ; pourvu qu’il l’ait réfervé fpé-
cialemcnt par la fondation. Jouiiiancc des droits honorifiques.
Devoir du fondateur de redoter l’églife qu’il a fondée, lorf-
qu’ellc e ftp au v re .V n .73 . b. La renonciation au droit de patronage
ôte au fondateur celui de préfenter aux bénéfices. Les
héritiers des fondateurs, tombés dans l’indigence, doivent
être nourris aux dépens de la fondation. L ’évêque ne peut au-
torifer une fondation que l’églife ne foit dotée fuffifamment.
A qui appartient la funntendance des fondations. A qui appartient
le droit de réduire les fondations. L’évéquene peut changer
en eccléfiaftique une fondation féculiere , ni appliquer
une fondation faite pour une ville à une autre ville. Des fon-1
dations d’églifes faites par une femme débauchée. Une églife
ne peut acquérir une-poffeffion contraire à fa fondation. Elle
n’eft point préfumée, avoir les biens qu’elle poffede, fans qu’il
y ait eu quelque charge portée par la fondation. Les biens
d’églife ne peuvent être aliénés par décret, &c. Condition
néceflaire pour accepter une fondation faite dans une églife
paroiffiale. Dans les fondations faites par teftament, les héritiers
doivent payer les droits d’amortiffement 8c d’indemnité.
Maxime du docleur Rochus fur les fondations. Ibid. 76. a.
Des fondations exorbitantes. Du paiement des arrérages
des fondations. D e la preferiptien par rapport aux fondations.
Ibid. b.
Fondations eccUJiaftiques, communes dés le feptieme fiecle.
V . 423. a.
Fondation eccléfiaftique ; laie aie ; obituaire ; pieufe. VII.
7 6 . b.
Fondation royale , ilne s’agit ici que de celles qutfont eccier
fiaftiques. V II. 76. b.
Fondation facerdotale : bénéfice facerdotali/qp» ocfacer-
dotal à fundatione. V IL 76. b.
Fondation féculiere. VII. 76. b.
fon d a t io n , d’une v ille , d’un empire, &c. Leschronologues
comptent 779 ans depuis la fortie de l’E gypte, jufqu’à la fondation
de Rome. V II. 76. b.
Fondation, obfervation fur un point de chronologie, relatif
à cet article de l’Encyclopédie. Suppl. III. 83. b.
Fondation des villes. X V lI . 277. b. — 279. a.
FONDEMENT , l e , ( Anatom. & Chirur.) deferipnon de
cette partie. Différens vices de conformation dans le _fondc'
ment: auteurs qui en ont parlé: comment on s’apperçoit de
défaut. Maux qui en réfultent f i l’on n’a pas foin it y . r inje s
dier promptement. Opérations qu’il s’agit de faire teloa
cas. V II. 77. a. Divers exemples d ’a u t re s jeux de »
fur cette partie. Ibid. b. Des maladies auxquelles
ment eft fujet. Tubercules qui s’y forment Æ g jg j , jef
rement, foit extérieurement. Leurs caufes. M°y
guérir. Sortie de l’inteftin reflum. Caufe de c •
Méthode curative. Moyen de préferver les enfon
de fondement auxquelles ils font fujets ; ce fonder
che auffi de fe gâter la taille. Ibid. 78. d. Abcès au fonde
F O N
menteauft par un éclat d’os qui s’étoit arrêté dans cette partie.
Explication de la maniéré dont la chofe peut arriver. Ou vrage
à confuher touchant la conduire qu’un chirurgien doit
tenir en pareil cas. Le fondement donne fouvent paffage à
des concrétions calculeufes, & même à des pierres conudè-
rables; exemples de la fortie d’un foetus par le fondement.
Ibid.b. •
Fondement, voyez A n u s . Maladie du fondement qui
produit quelquefois le renverfement de la membrane interne
du reâum. IIl. 404. a. V . 836. a , b. Excroiffance fongueufe
au fondement. VII. 81. b.
F ondement. ( Maneg.'& Maréch.) Caufes de la chûte du
fondement dans le cheval. Cure de cette maladie. V IL 78. b.
F ondement. (Maçonn. ) De l’art de conftruire les fondemens
des édifices. IX. 827. a , b. — 833. b. Voye% auffi voL
I des planches, article A rchitecture , Maçonnerie.
FONDERIE, ( Métall. Minéral. ) bâtiment dans lequel fe
font toutes les opérations pour fondre, purifier 8c rafiner
les métaux. Sa defeription. Quelles en doivent être la
grandeur, 8c la fituation. Les fourneaux dans lefquels on
grillera la mine, le boccard où on la pile, les lavoirs où
on la fépare des parties terreufes 8c pierreufes , doivent
être très-proches de la fonderie. Ouvrage à coniùltCf. VIL
79 . a. ^
Fonderie en bronze. II. 436. ¿ .— 442. b. Fonderie des
Canons. 606. b. Fonderie pour les caraâeres d’imprimerie.
653. a , b , 8cc. Fonderie des cloches. III. 341. b. Fonderie du
cuivre. IV. 342. b. Fonderie pour les figures en plomb. VIII.
3 29. b. Fonderie du plomb. IX. 230. a. Fonderie pour le laminage
du plomb, vol. VIII des planches, laminage du plomb,
lanche I. Fonderie pour la compofition du laiton. IX. 214. b.
offe dans les grandes fonderies. VIL 208. a. Defeription 8c
ufage des moules de différentes fonderies. X. 788. b.
F onderie , ('Blanchiff.') lieu où l’on fond la cire. Defeription
détaillée de celle d’Antoni. V IL 79. b.
FONDEUR de petit plomb. Comment ces ouvriers acquièrent
en France le privilège de vendre le plomb eux-mêmes.
Communauté à laquelle ils appartiennent. V lL 79. b.
Fondeur. Des fondeurs employés aux ufines. V IL 136. a.
Opérations du fondeur en fable. XIV. 464. a , b , &c.
F O N D I , ( Géogr. ) petite ville fttuée à trois lieues de
Terracine. Des vins de Fondi. Cette ville ruinée eu 1334
parles Turcs. Chambre qu’habitoit S. Thomas - d’Aquin; auditoire
où il enfeignoit. Lac de Fondi. Produirions des environs.
Suppl. IIL 83. b.
FON D IQU E , {Comm. ) maifon commune où les marchands
s’affcmblcnt. Obfcrvalions fur l’étymologie de ce mot.
II fignifie fimplemént aujourd’hui un dépôt pour les marchan-
difes étrangères. VII. 80. a.
FONDRE des allions, ( Comm. ) V IL 80. a.
Fondre, aélion de liquéfier la cire par le moyen du feu. Quel
eft le point effentiel de cette opération. Comment on diipofe de
la cire aprësavoir été fondue. V i l . 80. a.
F ondre les couleurs, ( Peinture ) 1. 143. a.
FON D S , voyc{ Fond.
F ondre , ( Fauconn. ) VIL 80. a.
Fondre, (Jardin.) le dit d’une plante qui périt au pied.
Diverfes caufes de cet accident. Ce qu’on doit obferver pour
le prévenir dans les ferres. VIL 80. a.
Fondre, à la monnoie, en peinture, en terme de fondeur de
petit plomb. VII.80. b.
Fondre l'étain & le jetter au moule. Lorfqu’un potier d’étain
veut mettre l’étain en oeuvre, il le fait d’abord fondre. Détails
de cette opération pour ceux qui fondent desfaumons. Préparation
des moules.En quoi confifte la fcicnce pour bien jetter.
V IL 80. b. Façon dé jetter la vaiffelle. Defeription des moules
de poterie. Maniéré de les préparer. Ibid. 8 i.a .
Fonds.t Nègres de ce nom. XI. 81. a.
FONGIBLE, voye{ Fungible.
FO N G IT E , voyez Fungite.
FONGUEUX. ( Chirurg.) Excroiffaoces fongueufes. VIII.
407. a. Voyc{ Excroissance. Rcmedes qui les rongent. II.
776. a. 791. b. Maniéré de détruire les bords fongueux des cicatrices.
IIl. 439. b.
Fongueufes, plantes. III. 81. b.
FONGUS, ( Chirurg. ) excroiffance qui vient particulièrement
au fondement. D devient quelquefois skirrheuxou carci-
nomateux. Cure des fongus. C e que rapporte Dionis fur la maniéré
dontonpanfe à Rome les malheureux qui fe font attirés
cette maladie par un commerce infâme. VU. S i . a. Voye{
Fun gu s. M
F O N S , facer, ( Géogr. anc. ) XIV. 471. b.
FONSANCHE, fontaine dans le diocèfe de Nîmes : Angularités
qu’elle offre. V IL 100. b.
FON TAIN E, ( Géogr. Phyf. ) différentes acceptions des
mots fource 8c fontaine. Les deux points de vue auxquels on
s’attache en traitant des fontaines dans cet article, font leur
origine 8c leurs fingularilis. VII. 81. b.
Fontaines, origine des , les aQiien* tfoitt traité cette quof-
F O N 759
«Oh qu*ên paffant, & ils ne paroiffent s’être attachés ni aux
faitspartieuhers, ni a leur concert. Sentimens de Platon»
d Anftote 8c de Seneque fur ce fujet. Ces derniers ont imaginé
que I air f t cOndenfoit 8c fe changeoit en eau dans les
foutefrems; 8c que leau fe changeoit à fon tour en air. Ob-
fcrvation faite de nos jours qui fembleroit d’abord autori*
fer ces tranfmutations. Ibid. '82. a. Opinions de quelques
autres auteurs ; celles de S. Thomas 8c des fcholaftiques de
Coïmbre, de Van-Helmont, 8c de ceux qui ont cru déci»
der la queftion par des pafiàges des livres facrés. Difcuflions
vagues de Scaliger fur ce fujet. Hyporhefé de Cardan. Traité
de Perrault à confulter » dans lequel on trouve vingt-deux
hypothefes fur l’origine des fontaines. Ouvrage de Plot fur
ce fujet. Sentiment éclairé de Bernard Palifly. Ibid. b. Il faut
de néceffité que ce fou la mer qpi fourniffe aux fontaines
cette quantité d’eau qui lui rentre enfuite. Mais comment
l’eau va-t-elle de la mer aux fontaines ? L’eau de ia mer
eft falée, celle des fontaines eft douce ; par quel mécha-
nifme l’eau de la mer perd-elle fa falure dans le tranfport t
Les iins prétendent que les vapeurs qui s’élèvent de la mer»
emportées dans l’atmofphere, condenfées en pluie, faififfant
diverfes ouvertures pour s’infinuer dans les corps des montagnes
, s’arrêtent fur des lits de tuf 8c de glaife, 8c forment
en s’échappant par la pente de ces lits des fontaines paffa-
geres ou perpétuelles. D ’autres imaginent dans le globe
des canaux fouterreins , par lefquels les eaux de la m e t
fe filtrent, fe diftillent 8c s’élèvent jufou’aux cavernes qui
fourniffent à la dépenfe des fontaines. Ibid. 83. a. Telle fut
l’opinion de Defcartes. Correôion que M. de la Hire apporta
à cette opinion. Divers moyens imaginés pour ex-'
pliquer cette prétendue élévation des eaux par des canaux
fouterreins. Obfervations de l’auteur fur ces hypothefes»
L ’eau de la mer que l’on veut faire monter par acs tuyaux
capillaires formés entre les interftices des fables , ne pro*
duit jamais aucun écoulement. Expériences de M. Perrault
qui le prouvent. Ibid. b. Expériences 8c obfervations qui
montrent que l’eau ne fe deffale pas par filtration. Difficultés
très-fortes qu’on peut oppofer à l’hypothefe qu’on
vient de décrire ; i° . on fuppole gratuitement des paffa-
ges libres 8c ouverts, depuis le lit de la mer , jufqu’au
pied des montagnes. Matière vifqueufe qui tapiffe le fond
de la mer. Suppofition gratuite de ces grands réfervoirs
qui fourniffent leau à line certaine portion de la furface
du globe. Ibid. 84. a. 20. Quand ces lacs fouterreins exif*
teroient, il ne s’enfuivroit pas qu’ils euffent une communication
avec la mer. La plupart des cavernes qu’on a ob*
fervées font à fec. Les filets d’eau obfcrvés dans les mines
tariffent par la fêchereffe. L ’eau de puits 8c des fources a
des propriétés dépendantes de la nature des couches de
terre fupérieures au baffin qui contient les eaux. Obfervations
faites 'fu r les fources qui fe trouvent aux environs
de Modene; 30. diverfes fuppôfitions qu’on eft obligé de
faire très-gratuitement, pour expliquer l’afcenfion des eaux
dans l’intérieur des montagnes. Ibid. b. 40. Les partifans de
l’hypothefe, ici combattue, conviennent que les eaux de
pluies influent trés-fenfiblement dans les écoulemens des
fontaines ; après cet aveu peuvent-ils fe diffimuler que cet
effet ne foit une préfomption très-forte pour s’y borner »
fi le produit des pluies fuffit à l’entretien des fources »
comme on le montrera enfuite ? 50. Pourquoi l’eau de la*
mer iroit-elle chercher le centre , ou du moins les endroits
les plus élevés des continens, pour y entretenir
des fontaines i 6°. Les fels dont l’eau fe dépouille par filtration
devraient avoir depuis long-tems obftrué les canaux
fouterreins, 8c fait perdre à la mer une quantité de les
fols prodigieufe. Quelle eft la quantité de fol que contient
une livre d’eau de mer , 8c quels devraient être les dépôts
falins dans l’intérieur des montagnes. Ibid. 83. a. Comment
les phyficiens ont tâché de répondre à ces difficultés. Ces
réponfes examinées. Efpeces de gouftres où les eaux font
violemment agitées, 8c paroiffent s’engloutir dans des cavités
fouterreines qui les rejettent avec la même violence.
Condufion qu’on en tire en faveur de l’hypothefe Carté-
fienne. Ibid. b. Examen que l’auteur fait de cette complication
d’agens introduits par M. Kuhn pour foutenir cette
hypothefo. Ibid. 86. a. Divers faits qui femblent détruire
les fuppofitions des gouftres abforbans. Mais en fuppofant
leur réalité , il eft certain que leur travail fouterrein eft
contraire aux loix de l’hydroftatique ; 8c de plus, que l’ab»
forption 8c le yomiffement des eaux, opérés par une aàion
continuelle, devrait fe faire fans agitation 8t fans violence.
Obftades qu’on doit craindre à chaque inftant, félon cette
hypothefo, pour la circuladon libre des eaux : inconvéniens
8c embarras qu’éprouvent ceux qui veulent compliquer
leurs reffources, à mefureque de nouveaux faits font
naître de nouvelles difficultés. Ibid. b. Autres cloffes de
phyficiens défenfeurs de l’hypothefo cartéfienne. Ils diftin-
guent l’origine des fontaines de celle des rivieres. Les fontaines
proprement dites font en très-petit nombre félon eu x;