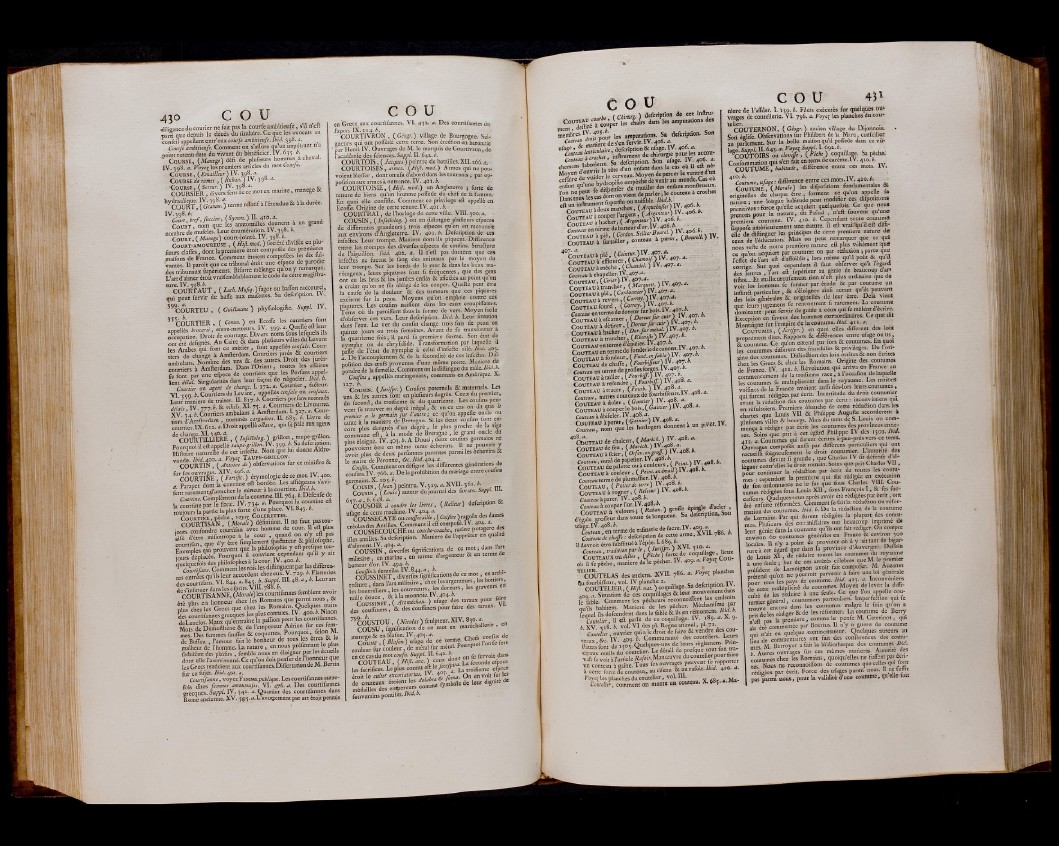
430 C O U COU •diligence du courier ne fait pas la courfe ambitieufe, s il n eft
.paru que depuis le décès du titulaire. Ce que les avocats au
■confeii appellent entr’eux courfe ambitieufe. Ibid. 398. a. 5
en Grece aux courtifannes. VI. 432. a. Des courtifannes üù
Japon. IX. 114. by
COURTIVRON , (Géogr.) village de Bourgogne. Seigneurs
Courfe ambitieufe. Comment on s’affure (m’un impétrant n a . (
point retenu date du vivant du bénéficier. IV. 03 3 ■ b.
C o u r s e , (Manege) défi de ,plufieurs hommes a cheval.
IV . 398. a. Voyez les premiers articles du mot Lourje.
C o u r s e , (Emailleur) IV. 398.«.
COURSE de rames , ( Ruban.) IV. 390. a.
C O U M i E ^ Z i ’ f a Æ « mot en marine, manege &
Court bref, Cuccint. (Synon.) II. 410-«-
C o u r t , nom q u e les anatomifles donnent à nn grand
nombre de muftles. Leur énumération. IV. 398. 4.
C o u r t ,(Mantgc) court-jouité. IV. 398..4.
C o u r t - a m o u r e u s e , (Hift.mod.) fociétê dmfée en plu-
Jieurs dalles, dont la première étoit compofèe despreimteres
maifons de France. Comment étrnent composes les dot fut
'vantes 11 paroît que ce tribunal étoit une efpece de parodie
.des tribunaux fupérieurs. Bifarre mélange qu on y rem” T=-
L’artd’aimer étoit vraifemblablement le code de cette magiitratU
COUI^TAUT , ( Luth. Muftq. ) fagot ou ballon raccourci,
qui peut fervir de baffe aux mufettes. Sa defcription. IV.
39Ï o ü R T E U , ( Guillaume ) phyftologifte. Suppl. IV.
35 SCOURTIER , ( Comm. ) en Ecoffe les coumers font
appellés brocarii, entre-metteurs. IV. 3 9 9 . « . Quelle eft leur
occupation. Droit de courtage. Divers noms fous lefqiiels ils
ont été défignés. Au Caire 8c dans plufieurs villes dnXevant
les Arabes mai font ce mêder, font appellés eenfals. Coun
liersde change à Amfterdam. Courriers jurés 8c cournere
ambulans. Nombre des uns 8c. des antres. Droit des inres-
Murrims à Amfterdam. Dans l’Orient, toutes les affaires
fe fom par une efpece de courriers que les Perfans appellent
*'b.V. Singularités dans leur façon de négocier. Ibtdh
Courtier ou agent de change. I. 17b. a Couruer , faiteur.
V I s ro 4. Courriers du Levant, appeUés crn/«fc ou ceuftux.
Leur maniéré detraiter. H. 8 .7 .4. Coumersperfans nommés
«SrirTlV. n i . * & « *■ XI- 7Î; «• Courue« de Livonrne.
XV 34. b. Courtiers ambulant à Amfterdam. 1. 327* C°ur
riers d’Amfterdam , nommés cargadors. II. 68}. 4. Livre de
courrier.lX.6ta. «.Droit appellé oBave, qui fe paie aux agens
d' r o î S l ;nLLÎERË , ( InfcBolog.) grillon , taupe-grillon.'
P o S . S S t V î ' f c î f v V ^ S a d e f e r f o r i o n .
Hiftome naturelle de cet infeéle. Nom que lui donne Aldro-
" » ( Æ I ” a l T f o r ce miniftre 8c
fU C O Ü R Ï lfE . C ^ .'f 'é i ym o lo g ie de ce mor. IV. 400.
n. Parapet dont l’a courtine eft bordée. Les affiégeans s av.-
fent rarementi’attacher le mineur a la coumne.
Courtine. Complément de la courtine. IU. 764. b. Défenfe de
1, conrrine par ie flanc. IV. 734. «• Pourqn“j la courtine eft
toujours la partie la plus 8-*3 -
C ourtine , peche , voyez LaOlerettes.
COURTISAN, (Morale) définition. Il ne fent pas toujours
confondre courrifan avec homme de cour. Il eft plus
aifé d’ètre mifantrope à la cour .quand on n y eft pas
•f „ m.i- d’v être fimplement fpeftateur 8c philofophe.
Exemples’ mffprouvent que'la phdoÆphie y eft prafmte tou-
S é p U c é e ? P o u rq u o i d convient cependant quri y ait
CmoTi^an^omtucu^le^rois b«diftinguent par les différeil-
iG ^ u inç Crées aue chez les Romains. Quelques traits
m o E * de Buffon , l’amour feit le bonheur de tous les êtresSele
malheur de l’homme. La nature , en nous préfentant le plus
féduifam des plaifirs , femble nous en éloigner par les ecuens
dont elle l’a environné. Ce qu’on doit penfer de 1 ^
les Grecs rendoient aux courtifannes.DiffertationdeM. oernn
fur ce fujet. Ibid. 401. a.
Courttfanne, voyez Femme publique. Les courtifannes autrefois
dites femmes amoureufes. VI. 476. a. Des courtifannes
grecques. Suppl. IV. 342. a. Quartier des courtifannes dans
Rome ancienne.XV. 503.«.L’avotfement par art éto.itperinis
qui ont poffédé cette terre. Son éreôion en baronnie
par Henri IV. Ouvrages de M. le marquis de Courtivron, de
l’académie des fciences. Suppl. II. 642. b.
COURTOIS, ( Jacques ) peintre de batailles. XII. 266. a.
COURTOISES , aimes-, (Hifi. mod.) Armes qui ne pou-
voient bleffer , dont onufa d’abord dans les tournois, par opposition
aux armes à outrance. IV. 401. b.
COURTOISIE, ( Hifi. mod.) en Angleterre ; forte do
tenure de biens qu’un homme poflède du chef de fa femme..
Ën quoi elle confifte. Comment ce privilège eft appellé en
Ecoüe. Origine de cette tenure. IV. 401. b.
ÇOURTKAI , de l’horloge de cette ville. VIII. 300. a.
COUSIN, ( InfcBolog. ) on en diftingue plufieurs efpeces
de différentes grandeurs; trois efpeces qu’on en reconnoît
aux environs d’Angleterre. IV. 401. b. Defcription de ces
infe&es. Leur trompe. Maniéré dont ils piquenu Différence
entre les trompes des diverfes efpeces de coufins. Struéiure
de l’aiguillon. Ibid. 402. a. Il n’eft pas douteux que ces
infeftes ne fucent le fang des animaux par le moyen de
leur trompe. Sur les bords de la mer & dans les lieux ma-
I récageux, leurs piquures font fi fréquentes, que des gens
ont eu les bras & les jambes enflés & affeftés au point qu’on
a craint qu’on ne fut obligé de les couper. Quelle peut être
la caufe de la douleur 8c des tumeurs que ces piquures
excitent fur la peau. Moyens qu’on emploie contre ces
piquures. Les coufins naifl’ent dans les eaux croupiflantçs*
Tems où ils paroiffent fous la forme de vers. Moyen facile
d’obferver ces vers. Leur defcription. Ibid. b. Leur fituation
dans l’eau. Le ver du coufin change trois fois de peau en
quinze jours ou trois femaines. Avant de fe transformer à
la quatrième fois, il perd fa première forme. Son état de
nymphe ou de chryfalide. Transformation par laquelle u
paffe de l’état de nymphe à celui d’infefte ailc. Ibid. 403.
a De l’accouplement 8c de . la fécondité de ces infeâes. LJif-
pofition des oeufs provenus d’une même ponte. Maniéré de
pondre de la femelle. Comment on la diftingue du maie. Ibid.b.
Coufins, appellés maringouins, communs en Amérique. A.
Cousin. (Jurifpr.) Coufins paternels 8c maternels. Les
uns 8c les autres font en plufieurs degrés. Ceux du premier,
du fécond, du troifieme & du quatrième. Les coufins peuvent
fe trouver en .degré inégal, 8c en ce cas on dit que U
premier a le germain fur l'autre} ce quoaappelleoncleou
tante à la maniéré de Bretagne. Si les deux coufins font encore
plus éloignés d’un degré , le plus proche de la tige
commune eft, à la mode de Bretagne, le grand oncle du
plus éloigné. IV. 403. b. A Douai, deux coufins germains ne
pouvoient être en même tems échevins. U ne pouvoir y
, avoir plus de deux perfonnes parentes parmi les échevins oc
le maire dePéronne, &c. Ibid. 404. a. . . .
Coufin. Comment on défigne les différentes générations de
coufins. IV. 766. a. De la prohibition du mariage entre coufins
^ C o u s in , (Jean) peintre. V.319. a. XVII. 361. b.
Cousin , ( Louis) auteur du journal des favans. Suppl. IIL
^ * COÜSOlk' à ' coudre les livres , ( Relieur ) defcription 8c
ufaee de cette machine. IV. 404. a. § , Attiae-
COUSSECAYE ou coujfecailU, (Cutfine) ragoût des dames
renies des Antilles. Comment il eft compofé. IV. 4°4- a-
COUSSECOUCHE ou couche-couche, racine potagere des
iflesantillesiSadefcription. Maniéré de l’apprêter en qualité
d ^OUSSW ? diverfes fignifications de ce mot; dans
m M re 7 en marine, en terme d’argenteur 8c en terme de
batteur d'or. IV. 494 t
COUSSINET ^iverfiaViguifications, detee mot, enarchi-
teâure dans l’ar’t militaire, chez lesargenteurs, les bottiers,
les bourreliers, les couvreurs, les doreurs, les graveur.
des couffinets I \ des eouflmetspour feire des mraux. VI.
79ÏoU STO U , (Nicolas) fculpteur.XIV. 8|0.«. m
COUSU, figniucanon de ce mot en maréchal
manege 8c en blafon. IV. 403. «. Gheft coufus de
Cousu , {Blafon) ufage de ce teOT^, . p0„fe fera
couleur fur couleur, de métal fur métal. Pourqu
en ce cas du mot coufu. Suppl. il. 64a- «■ • ( ferivoit dans
COUTEAU | ( Hift. une. ) ceux ¿ont « f ~ n
les facrifices. Le plus connu eft le /rcuF La tro;rieme efpece
étoit le cuUer excoriatonus On en voit fur 1«
de couteaux étoient les dolabra J de leur d| ti de
médailles des 7
fouverains pontifes.«!«, o.
c o u
membres. IV. 40b E amputad0„ 5. Sa deferiptiori. Sot»
Couteau droit pour f , „ i r . lV . 406. a.
ufege, defcription & ufage. IV. 406. «.
Couttaulemtcyatr i f1 de chirurgie pour les aceou-
C^ “ “,.Z r ie u x ’ Sa WeriSrion. Son ufage. IV b f «.
ehemens fe b o o eu . t ^ 4 n ftn t dan s fe CÏS ou i l eft né-
Moyen d ouvnr 1 u Moyen de percer le ventre d on
ceflaire de ™ d e r 1. empêche de venir au mondeXas ou
C o u te a u àdeuxmanenw, v ~ % J A r v . 4o6. b.
G o u te a u à couper 1 argent, \ . 4L . A .
C o u t e a u à hacher,^ .....
' Couteau en terme debatteur dor l -40 ' j y 6 t.
4°:iouTEAU i p ic , (Lrin!“''; ) I3f- 407. «•
C o u te a u à mèche A C h a n it l. ) 1 4 7
C«M<«li à Chapelier.TV.407-«’
COUTEAU àp ié, ( J
C o u te a u à trancher, (EimiJ*') ! -4 7
C o u t e a u d e °d i^ ib i {rTurUffeurA.a^b.
cZ ^ e S te rm ed e ç ro f fe s fo re edVW - i.
Couteau à èbtfeler. IV. 408.«.
S Æ L s X ^ n , b un pivor. IV.
^COUTEAU de chaleur, ( ) IV. 4o8. a.
. C o u t e a u de feu , ( Marech. ) I V . 408 .« .
COUTEAU àfeier, ( Or/ev. r « r # ) IV-408-*-
Couteau, outil de papetier. IV. 408. t .
C o u t e a u d e p a le tte o u à c o e lc i it s , t T g
C o u t e a u à c o u le u r , | M H I V ’
Couteau terme de plumaffiet. lV . 408. *.
C o u t e a u , ( Potier de terre) 1 S L 4 o 8 . A
C o u t e a u à rogner, (R elieu r ) Vf. 40 ■
Conte«« b parer- IV. 40»-*•
cou hierè de l'affiler. ï. ï tà i b. Filets exécutés fur qùelqiiès oïl*
vrages de coutellerie. VI. 796. a. Voyez vfages les planches du cou*
COUTERNON, ( Géogr. ) ancien village du Dijonnois-.
Son églife. Obfervations fur Philibert de la Mare, concilier
parlement. Sur la belle maifon qu’il poffede dans ce vil*
" I II C.A « VdVMtr SudbI. 1. 602. b.
au parlement, sur ia w «
laeC¿SOuÜpTplO. IIIR- S64 o3i.t clmovSifck ST J : ï - ?9a‘ S „ , (Peche) coquillage.
‘ s’en fait en.tems decareme.1V.
Couteau de cnajjc ; u i r ” „ .
il devroit être fubftitué à 1 épée. 1.689. o. ^ ^
Coule««, ireditionparfr d coquillage, lieux
C o u t e a u x o u dtlles, (Peclte ) » Couoh
il fe pêche, maniéré dele pêcher. IV. 409- «■ f W LOU
^COUTELAS des anciens. XVII. 786. «• Voyeq planches
Su fourbiffeur, vol. IV planche z. deferintion. IV.
W,Uel ils defeendent dans le fable «. ils pn remontent. / • •
S te f ie r , n eft parié de ceçoquillage. IV. .89 « .X .9-
l XV Îi8. b. vol. VI des pl. Regne animal, pl..71.
Coutelier , ouvrier qui a le droit 3e faire & vendre des couteaux
6-c IV. 409. b. Communauté des couteliers. Leurs
W s fo n t de i t o l Quelques-uns de leurs réglemens. Prm-
?î°; I
Voyez les planches du coutelier, vol. lil. xq- - Ma-
Sa pêche.'
Confommation qui feit en de carême. IV. 410. b.
COUTUME, habitude, différence entre ces mots. IV»
^'coutume, ufage : différence entre ces motsTV. 410. b. .
C O U T U M E , (Morate) les difpofmons fondamentales &
orizinelles de chaque être , forment ce quon appelle la
nature i une longue habitude peut modifer ces «hfpofinons
primitives :■ force qu’elle acquiert quelquefois. Ce que nou»
prenons pour la nature, dit Pafcal , n’eft fonvent qu’une
première toutume. IV. 4.0. *■ Cependant toute coutume
ïuppofe antérieurement une nature. 11 eft vrax^u ‘left
«ife de diftinguer les principes de cette première nature de
ceux de l’éducation. Mais on peut remarquer que ce qor
nous relie de notre première nature eft plus véhément que
ce qu’on acquiert par coutume ou par réflexion ; parce qnê
l’effet de l’art eft tfaffoiblir, lors meme qud polit Sç quil
corrize. Sur quoi cependant il feut- obfetver qub lézard
des fenres , l’art eft fupérienr au génie de beaucoup dar*
filles. Et malheurenfement rien n’eft plus ordinaire que de
voir les hommes fe former par étude 8c par coutume un
inflinâ-particulier, Sc s’éloigner attrii autant qnds peuvent
des loix générales 8c onginelles de leur être. -.Delà vient
nue leurs jugemens fe rencontrent fi rarement, La coutume
dominante peut fervir de guide b ceux qinfe mêlent d écrire.
Exception en feveur des hommes extraordinaires, Ce que dit
Monïaigne fur l’empire de la coutume. Ibid. 411. «»
CoutÛmes , (Jurifpr.) en quoi elfes différent des loi*
proprement dites. Rapports 6ç différence entre ufage ou us ,
8c coutume. Ce qu’on entend par fors 8c coutumes. En quoi
fes coutumes différent d e fianchifcs 8c privilèges. De 1 on*
zine des coutumes. Diffinâiori des loix écrites 8c non écrites
chez fes Grecs 8c chez les Romains. Origine d e coutumes
de France. IV, 411. i. Révolution qui arnva_en France au
commencement de la troifieme race, b l'occafion de laquelle
les coutumes fe multiplièrent dans le royaume. Les nations
voifines de la France avoient aulfi des-lors leurs coutumes ,
cui furent rédigées par écrit. Incertitude du droit coutumier
avant la réda&on des coutumes par écrit : mconyéntens qui
en réfultoiem. Première ébauche de cette rêdaftion dans les
chartes que Louis VII 8c Philippe Augufte accordèrent b
plufieurs villes 8c bourgs. Mais du tems de S. Louis ou commença
b rédiger par écrit fes continues des provinces entie-
res Soins que prit à cet egbrd Philippe IV dés 1302. Ibut
a n u Coutumes qui forent écrites à-peu-pres vers ce temS.
Ouvrages compofés aulfi par différens particuliers quiont
recueilli foigneufement le droit coutumier. Lamenté des
coutumes devint fi grande , que Charles IV fit défenfe dol
léguer contr’eUes le droit romain, boins que prit. Charles V U ,
pour continuer la rédaftiou par émt tfe toutes les courue
mes : cependant la première qui fin « g M M i
de fon ordonnance ne le fut que fous Charles VIII, Coutumes
rédigées fous Louis X II, fous François 1, 8c fes foc
ceffeurs. Quelques-unes aptes avoir été rédigées par écrit, ont
été enfuite réformées. Commentfefait la réda&on ou réformation
des coutumes. Ibid. b. De la rèdaftion de la coutume
de Lorraine. Par qui forent rédigées la plupart, des coutumes
Plufieurs des commiffaires ont beaucoup imprimé de
leur génie dans la coutume qu’ils ont feu rédiger. On compte
environ 60 coutumes générales en France 8c environ 300
locales II n’y a point de province où il y autant dehigar-
rore b cet égard que dans fa province d’Auvergne. Deffe.0
de Louis M , de réduire toutes les coutumes du royaume
b unifeule ; but de ces arrêtés célèbres que M. ie premter
I uréfident de’ Lamoiguon avoit fait çompofer. M. Auzanm
urétend qu’on ne pourrait parvenir b feue une lo, générale
S S les pays de coutume. Ibid 413- «■ .I" c<>n^ n,.e"s
Re cette muldplicné de coutumes. Moyeu de lever a difficulté
de les réduire b une feule. Ce que 1 ou appelle cour
e u r général, coutumiers partieuhers. Imperfeihon qutfe
ttouve encore dans les coutumes malgré 1e foin qu on a
m i s d e les rédiger 6c de les réformer, La coutume de Berry
S uas la première, comme fe penfe M. Catennot, qui
Ü étl commentée par Boërius. 11 n’y a guère de coutume
nui n’ait eu quelque .commentateur. Quelques auteurs au
Ueu de commentaires ont fait des conférences des coutumes
M. Betroyer a fait la bibliothèque des coutumes Ibid.
b Autres ouvrages fur ces mêmes marieras. Autonté des
coutumes chez fes Romains, quoiqu’elles ne ftiffînt pas êcn-
res Nous ne reconnoiffons de coutumes que celles qui font
rédigées par écrit. Force des ufages parmi nous. Il ne fuffit