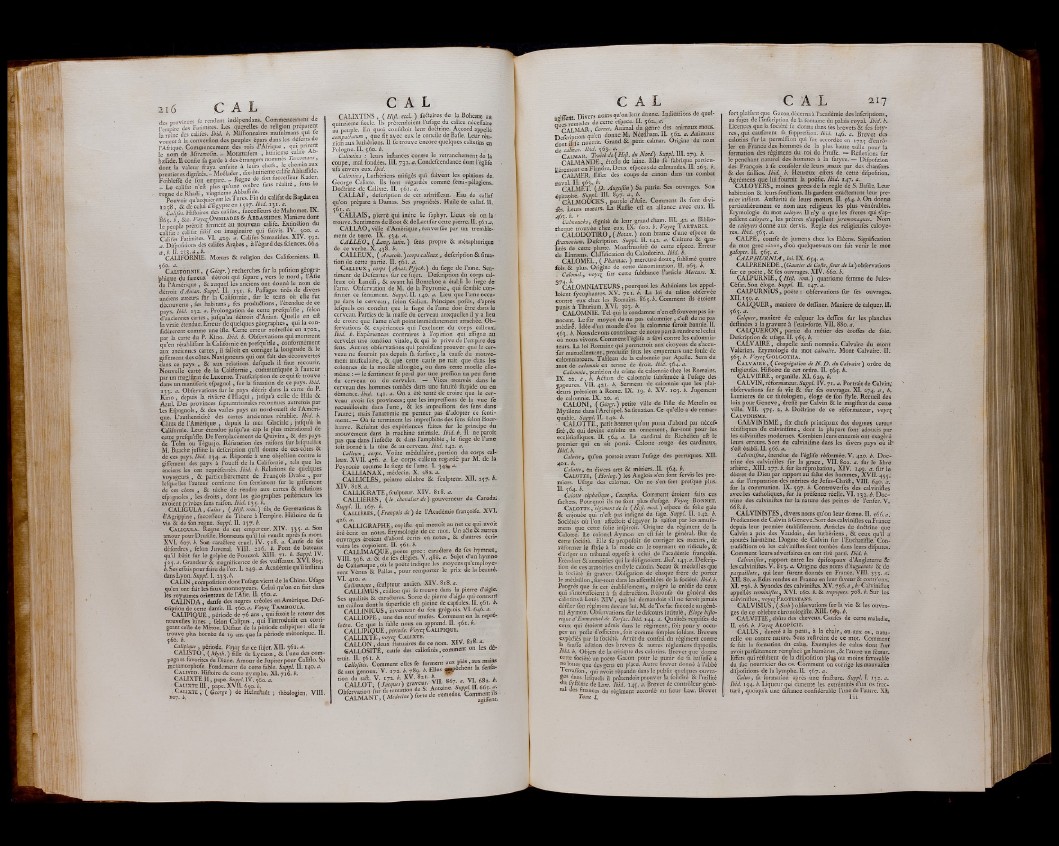
216 CAL CAL
des provinces fe rendent indépendant Commencement de
l’empire des Fatimites. Les querelles de . religion préparent
la ruine des califes. Ibid. b. Miflionnaires mufulmans qui le
vouent à la converfton des peuples épars dans les défcrts de
l'Afrique. Commencement des rois d’Afrique , qui prirent
le nom de Miramolin. - Motamafem , huitième calife Ab-
baffide. U confie fa garde à des étrangers nommés Turcomans,
dont la valeur fraya enfuite à leurs chefs, le clutmm amt
premières dignités. - Moâader, dhc-humeme calife Abbaffide
Foibleire de fon empire. - Regne de fon fucceffeür Kader
- Le califat n’eft plus qu’une ombre fans réalité, fous le
regne de Rhadi, vingtième Ahbaffide. R ,
Pouvoir qu’acquierenr les Turcs. Fin du califat de Bagdaten
Ï2.?8, 8c de celui d’Égypre en 1317. Ibid.
Califes Hifloires des califes, fucceffeurs de Mahomet. IX.
863 b &c. Voye{ Ommiades & A bbassides. Maniéré dont
le peuple prêtoit ferment au nouveau calife. Extin&ion du
califat : califat fiétif ou imaginaire qui fuivit. IV. 300. a.
Califes Fatimites. VI. 429. a. Califes Samanides. XIV. 592.
a. Diipofitions des califes Arabes, à l’égard des fciences. 664.
a b. 11. 233*a y A
’CALIFORNIE. Moeurs & religion des Californiens. IL
360. a.
C alifornie , ( Géogr.) recherches fur la pofition géographique
du fameux détroit qui fépare, vers le nord, l’Àfie
de l’Amérique, & auquel les anciens ont donné le nom de
détroit A'Aman. Suppi. II. 131. b. Paflages tirés de divers
anciens auteurs Ihr la Californie, fur le tems où elle fut
découverte, fes habitans, fes produôions, l’étendue de ce
pays. Ibid. 132. a. Prolongation de cette prefqu’ifle , félon
d’anciennes cartes, jufqu’au détroit d’Anian. Quelle en eft
la vraie étendue. Erreur de quelques géographes, qui la con-
fidérerent comme une iile. Cette erreur redreffée en 1702,
par la carte du P. Kino. Ibid. b. Obfervations qui montrent
qu’en rétabliifant la Californie en prefqu’ifle, conformément
aux anciennes cartes, il falloit en corriger la longitude 8c le
giflement des côtes. Navigateurs qui ont fait des découvertes
dans ce pays., 8c aux relations defquels il faut recourir.
Nouvelle carte de la Californie, communiquée à l’auteur
par un magiftrat de Lucerne. Tranfcription de ce qui fe trouve •
dans un manûfcrit efpagnol, fur la fituation de ce pays. Ibid.
133. a. Obfervations fur le pays décrit dans la carte du P.
lüno , depuis la riviere d’Hiaqui, jufqu’à celle de Hila 8c
Azul. Des provinces feptentrionales reconnues autrefois par
les Espagnols, 8c des vafles pays au nord-oueft de l’Amérique.
L’authenticité des cartes anciennes rétablie. Ibid. b.
Côtes de l’Amérique , depuis là mer Glaciale, jufqu’à la
Californie. Leur étendue jufqu’au cap le plus méridional de
cette prefqu’ifle. De l’emplacement de Quivira, 8c des pays
de Tolm ou Téguajo. Réfutation des raifbns fur lefquelles
M. Buache juftihe la defcription qu’il donne de ces cotes 8c
de ces pays. Ibid. 134. a. Réponie à une objeétion contre le
giflement des pays à l’oueft de la Californie, tels que les
anciens les ont repréfentés. Ibid. b. Relations de quelques
voyageurs , 8c particulièrement de François Drake , par
lefquelles l’auteur confirme fon fentiment fur le giflement
de ces côtes , 8c tâche de rendre aux cartes 8c relations
efpsgnoles | les droits, dont les géographes poftérieurs les
avoient privées fans raifon. Ibid. 13 5. b.
. CALIGULA, Caius, ( Hift. rom. ) fils de Germanicus 8c
d’Agrippine, fuccefleur de Tibere à l’empire. Hifloire de fa
vie 8c de fon regne. Suppl. IL 137. b.
C aligula. Regne de cet empereur. XIV. 335. a. Son
amour pour Drufille. Honneurs qu’il lui rendit après fa mort.
XVI. 607. b. Son caraétere cruel. IV. 518. a. Caufe de fes
défordres, félon Juvcnal. VIII. 216. b. Pont de bateaux
qu’il bâtit fur le golphe de Pouzzol. XIII. 71. b. Suppl. IV.
525. a. Grandeur 8c magnificence de fes vaiffeaux. XVI. 805.
b. Ses efiais pour faire de l’or. I. 249. a. Académie qu il inftitua
dans Lyon. Suppl. I. 233. b. _ ^ .
CALIN, compofition dont l’ufage vient de la Chine. Ufage
qu’en ont fait les faux monnoyeurs. Celui qu on en fait dans
les royaumes orientaux de TÀfie. II. 360. a.
CAJLINDA , danfe des negres créoles en Amérique. Defcription
de cette danfe. IL 360. a. V?y«{ T ambo ula.
CALIPIQUE, période de 76 ans , qui fixoit le retour des
nouvelles lunes , félon Calipus , qui Tintroduifit en corrigeant
celle de Mèton. Défaut '(le la période calipicfue : elle fe
trouve plus bornée de 19 ans que la période métonique. II.
5.60. b.
Calipique, période. Voye£ fur ce fujet. XII. 361. a.
CALISTO , | Myth. I fille de Lycaon, 8c l’une des compagnes
favorites de Diane. Amour de Jupiter pour Califto. S?
metamorphofe. Fondement de cette fable. Suppl. II. 14°*a-
C alisto. Hifloire de cette nymphe. XI. 716. b.
CALIXTE II , pape. Suppl.TV. 360. a.
C alixte III, pape. XvII. 630. b.
.C a l ix te , | George ) de Helmltadt ; théologien. VIII.
*07. b.
CALIXTINS , ( Hiß., eccl. ) feftaires de la Boheme au
quinzième fiecle. Ils prétendoient l’ufage du calice néceflaire
au peuple. En quoi conflfloit leur doétrine. Accord appelle
compailatum , que fit avec eux le concile de Bafle. Leur réunion
aux luthériens. Il fe trouve encore quelques calixtins en
Pologne. II. 360. b.
Calixtins : leurs inftances contre le retranchement de la
coupe, mal fondées. III. 732.a.Condefcendance dont l’églife
ufa envers eux. Ibid.
Calixtins, Lutfiériens mitigés qui fuivent les opinions de.
George Calixte. Ils font regardés comme femi-pélagiens.
Do&rine de Calixte. II. 361. a. .
CALLAF, defcription de cet arbrifleau. Eau de callaf
qu’on prépare à Damas. Ses propriétés. Huile de callaf. II.
361. a.
CALLAÎS, pierrè qui imite le faphyr. Lieux où on la
trouve. Sentimens de Boot 8c de Laet fur cette pierre. II. 561 .a.
CALLAO, ville d’Amérique, renverfée par uu 'tremblement
de terre. IX. 534. a.
CALLEO', (Lang, latin. ) fens propre 8c métaphorique ‘
de ce verbe. X. 438. b.
CALLEUX, ( Anatoïh.) corpscàlleux, defcription 8cfituation
de cette partie. II. 361 . a.
C a lleux , corps ( Anat. Pfych. ) du fiege de l’ame. Sentiment
de Defcartes fur ce fujet. Defcription du corps cal*
leux où Lancifi, 8c avant lui Bontekoe a établi le fiege de
l’ame. Obfervation de M. de la Peyronie, qui femble confirmer
ce fentiment. Suppl. II. 140. a. Lieu que l’ame occupe
dans le cerveau, félon Galien. Principes pofés, d’après
lefquels on conclut que le fiegé de l’ame doit être dans le
cerveau. Parties de la mafle du cerveau auxquelles il y a lieu
de croire que l’ame n’efl point immédiatement attachée. Obfervations
8c expériences qui l’excluent du corps calleux.
cervelet une fonétion vitale, 8c qui le prive de 1 empire des
fens. Autres, obfervations qui paroiffent prouver que le cer-
veau ne fournit pas depuis fa iùrface , la caufe du mouvement
inufculaire, 8c que cette caufe ne naît que dans les
colonnes de la moelle allongée, ou dans cette moelle elle*
même : — le fentiment fe perd par une preffion un peu forte
du cerveau ou du cervelet. — Vices trouvés dans le
cerveau des hommes tombés dans une fatuité flupide ou en
démence. Ibid. 141. a. On a été tenté de croire que le cerveau
avoir fes provinces ; que les impreflions de la vue fe
recueillrôe'ht dans Tune, oc les impreflions des fens dans
l’autre 5 mais l’anatômie ne permet pas d’adopter ce fentiment.
— Où fe terminent les impreflions des fèns félon Boer-
haave. Réfultat des expériences faites fur le principe du
mouvement dans la machine animale. Ibid. b. 11 ne paroît
pas que dans l’infeéle 8c dans l’amphibie , le fiege de l’ame
loit borné à la tête 8c au cerveau. Ibid. 142. a.
Calleux , corps. {Voûte médullaire, portion du corps calleux.
XVII. 476. a. Le corps calleux regardé par M. de la
Peyronie comme le fiege de l’ame. I. 34a* a. ■
CALLIANAX, médecin. X. 282. a.
CALLICLÈS, Deintre célébré 8c fculpteür. XII. 237. b.
XIV. 818 .4 .
CALLIGRATE, fculpteur. XIV. 818. a.
CALLIÈRES, ( le. chevalier de ) gouverneur du Canada;
Suppl. II. 167. b.
C allières, ( François de) de l’Académie françoife. XVI.
426. a. . ‘ . . .
CALLIGRAPHE, cop'ifte qui mettoit au net ce qui avoit
été écrit en notes. Étymologie de ce mot. Un acte 8c autres
ouvrages-étoient d’abord écrits en notes, 8c dautres écrivains
les copioient. II. 561. AC
A L L IM A Q U E ,poète grec: caractère de les hymnes,
VIII. 396. a. 8c de fes élégies. V . 488. a. Sujet d’un hymne
de Callimaque, où le poète indique les moyens qu’employe-
rent Vénus 8c Pallas, pour remporter le prix de la beauté.
Cauîmaque, fculpteur ancien. XIV. 818. a.
CALLIMUS, caillou qui fe trouve dans la pierre d aigle.
Ses qualités 8c Caraéteres. Sorte de pierre d’aigle qui contient
un caillou dont la fuperficie eft pleine de capfules. II. 361. |
CALLIN1CUS,’ inventeur du feu grégeois. VI. 646. a.
CALLIOPE, une des neuf mufes. Comment on la représ
fedte Ce que la fable nous en apprend. II. 561. b.
CÂLLIPîQU E , période. Voye^ C a lipique.
CALLIXTE, voyez C alixte.
. CALLON, deux Itatuaires de ce nom. XIV. 010. a.
CALLOSITÉ, caufe des callofités, comment on les dfittUCallojit}
s. Comment elles fe forment aux pies, aux mains
& aux genoux." V. 172. b. 789. | B ] « f tp * * “ ™ 1 S
tion du taft. V. 172. A, XV. 821. b.
CAL CAL 21.7
aeiffeut Divers noms qu’omleur donne. Indicaiions de quel-
mies remedes de cette efpece. II. 5 62., a.
fALMAR, Cornet. Animal du genre des animaux mous.
Defcription qu’en donne M. Néedhan,. H. 5 62. a. Animaux
dont.iKfe nourrit. Grand 8c peut calmar. Origine du nom
de caSnar. Ibid,» 563. 4; c . ,
CALMAR. Traité de ( Hift. du Nord) Suppl. UI. 279. b.
CALMANDE, étoffe de laine. Elle fe fabrique particulièrement
en-Flandre. Deux efpeces de calmandes. H. 263. A
CALMER. Effet des coups de canon dans un combat
naCALhiê?. ( i - Augujlin) Sa patrie: Ses ouvrages. Son
épitapbe. Suppl. III. 897. a , A
CALMOUCKS, peuple d’Afie. Comment ils font divi-
fés. Leurs moeurs. La Ruflie eft en alliance avec eux. II.
L’almoucks, dignité de leur grand cham. III. 42. a. Bibliothèque
trouyée chez eux. IX. 602. A Voye[ T artares.
CALODÔTIRO, ( Botan. ) nom brame dune efpece de
(Iramonium. Defcription. Suppl. II. 142. a. Culture 8c qualités
de cette plante. Monftruofité de cette efpece. Erreur
de Linnæus. Claînfication du Calodotiro. Ibid. A
CALOMEL, ( Pharmac. ) mercure doux, fublimé quatre
fois 8c plus. Origine de cette dénomination. II. 263. A
Calomel, voyc^ fur cette fubftance 1 article Mercure. X.
37CALOMNIATEURS, pourquoi les Athéniens les appel-
loient fycophantes. XV. 711. A La loi du talion obfervée
contre eux chez les Romains. 863. A Comment ils étoient
punis à Thurium. XVI. 303. A n .
CALOMNIE. Tel qui la condamne n’en eft fouventpas innocent.
Le fur moyen de ne pas calomnier, c’eft de ne pas
médire. Idée d’un monde d’où la calomnie feroit bannie. II.
<63. A Nousdevons contribuer de notre part à rendre tel celui
où nous vivons. Comment l’églife a févi contre les calomniateurs.
La loi Romaine qui permettoit aux citoyens de s’accu-
fer mutuellement, produifit fous les empereurs une foule de
calomniateurs. Tableau de la calomnie par Apelle. Sens du
mot de calomnie en terme de droit. Ibid. 364. a.
Calomnie, punition du crime de calomnie chez les Romains.
XX. 22. a , b. Aétion de calomnie fubftituée à l’ufage des
gageures. VII. 421. A Serment de calomnie que les plaideurs
prêtoient à Rome. IX. 19. A XV. 103. A Jugement
de calomnie. IX. 20. ài
CALONI, ( Géogr.) petite ville de lifle de Metelmou
Mytilene dans l’Archipel. Sa fituation. Ce qu’elle a de remarquable.
SuppL II. 142. A
CALOTTE, petit bonnet qu’on porta d’abord par nécef-
fité ,& qui devint enfuite un ornement, fur-tout pour les
eccléfiaftiques. II. 364. a. Le cardinal de Richelieu eft le
premier qui en ait porté. Calotte rouge des cardinaux.
Ibid. A
Calotte, qu’on portoit avant l’ufage des perruques. XII.
'401. A
Calotte y en divers arts 8c métiers. .II. 364. A
C alot te, (Horlog.) les Anglois s’en font fervis les premiers.
Ufage des calottes. On ne s’en fert prefque plus.
II. 364. A
Calotte céphalique, Cucupha. Comment étoient faits ces
fachets. Pourquoi ils ne font plus d’ufage. Voye| B onnet.
C a lo t t e , régiment de la |Hift. mod.) efpece de folie gaie
'& enjouée qui n’eft pas indigne du fage. Suppl. II. 142. A
Sociétés où Ton affeétoi: d égayer la raifon par les amufe-
mens que cette folie inipiroit. Origine du régiment de la
Calotte. Le colonel Aymon en eft fait le général. But de
cette fociété. Elle fe propofoit de corriger les moeurs , de
réformer le ftyle à la mode en le tournant en ridicule, 8c
ri’ériger un tribunal oppofé à celui de l’académie françoife.
Etendart 8c armoiries qui la défignoient. Ibid. 143. a. Defcrip-
tion de ces armoiries en ftyle calotin. Sceau 8c médailles que
la fociété fit graver. Obligation de chaque frere de porter
le médaillon ,uir-tout dans les affembjées de la fociété. Ibid. A
Progrès que fit cet établiffement, malgré le crédit de ceux
qui s’interefloient à fa deftruftion. Réponfe du général des
calotins à Louis XIV, qui lui dèmandoit s’il ne feroit jamais
défiler fon régiment devant lui. M. deTorfac fuccede au général
Aymon. Obfervations fur le difeours intitulé, Eloge hifto-
rique d'Emmanuel de Torfac.Ibid. 144. a. Qualités requifes de
ceux qui étoient admis dans le régiment, foitpour y occuper
un pofte d’officiers, foit comme fimples foldats. Brevets
expédiés par la fociété. Arrêt du confeil du régiment contre
la fàufle édition des brevets 8c autres réglemens fuppofés.
Ibid. b. Objets de la critique des calotins. Brevet que donne
cette fociété au poète Gacon pour le punir de fa baffelïe à
louer que des gens en place. Autre brevet donné à l’abbé
Terraflon, qui avoit répandu dans le public quelques ouvrages
dans lefquels il prétendoit prouver la folidité 8c futilité
du fyftême de Law. Ibid. 143. a. Brevet de contrôleur général
des finances du régiment accordé au fleur Law. Brevet
Tome I%
fort plaifant que Gacon décerna à l’académie des inferiptions,
au fujet de Tinfcription de la fontaine du palais royal. Ibid. A
Licences que la fociété fe donna dans fes brevets 8c fes faty-
res, qui cauferent fa fuppreffion. Ibid. 146. a. Brevet des
calotins fur la permiflion qui 'fut accordée en 1723 d’enrôler
en France des hommes de la plus haute taille pour la
formation des régimens du roi de Pruffe. — Réflexions fur
le penchant naturel des hommes à la fatyre. — Difpofition
des François à fe conlbler de leurs maux par des enanfons
8c des faillies. Ibid. b. Heureux effets de cette difpofition.
Agrémens que lui fournit la poéfle. Ibid. 147. a.
CALOYERS, moines grecs de la réglé dç S. Baflle,. Leur
habitation 8c leurs fondions. Ils gardent exactement leur premier
inftitut. Auftérité de leurs moeurs. II. 364. A On donne
particulièrement ce nom aux religieux les plus vénérables.
Étymologie du mot caloyer. Il n’y a que les frer.es qui s’appellent
caloyers, les prêtres s’appellent jeromonaques. Nom
de caloyers donné aux dervis. Réglé des religieufes caloye-
res. Ibid. 363. a.
CALPÉ, courfe de jumens chez les Eléens. Signification
du mot grec hû\iw, d’où quelques-uns ont fait venir le mot
galoper. IL 363. a.
CALPHURNIA , loi. IX. 634. a.
CALPRENEDE, (Gautier de Cofte^fieur delà) obfervations
fur ce poète, 8c fes ouvrages. X IV. 660. A
CALPURNIE, (Hift. rom.) quatrième femme de Jules-
Céfar. Son éloge. SuppL II. 147. a.
CALPURNlUS, poète : obfervations fur fes ouvrages,
XII. 139.4.
CALQUER, maniéré de deiflner. Maniéré de calquer. H.
t ff-a .
Calquer y mamere de calquer les deffins fur les planches
deftinees à la gravure à l’eau-forte. -VII. 880. a.
CALQUERON, partie du métier des étoffes de foie.
Defcription 8c ufage. II. 363. A
CALVAIRE, chapelle ainfi nommée. Calvaire du mont
Valérien. Etymologie du mot calvaire. Mont Calvaire. II.
363. A Voye^ GOLGOTHA.
C a lv a ir e , ( Congrégation de N. D, du Calvaire) ordre de
religieufes. Hifloire de cet ordre. II. 363. A
CALVIÉRE, organifte. XI. 629. A
CALVIN, réformateur. Suppl. TV. 7 1 .4 . Portrait de Calvin,’
obfervations fur fa vie 8c fur fes ouvrages. XI. 274. 4, A
Lumières de ce théologien, éloge de fon ftyle. Recueil des
loix pour Geneve, dreffé par Calvin 8c le magiftrat de cette
ville. VIL 373. 2. A Doârine de ce réformateur, voyeç
Ca lv in isme.
CALVINISME, fix chefs principaux des dogmes carac-
tériftiqueS ¿u calvinifme, dont la plupart font adoucis par
les calviniftes modernes. Combien leurs ennemis ont exagéré
leurs erreurs. Sort du calvinifine dans les divers pays où il*
s’eft établi. II. <66. a.
Calvinifme y étendue de l'églife réformée. V. 420. A Doctrine
des calviniftes fur la grâce, VII. 802. a. fur le libre
arbitre, XIII. 277. A fur la réprobation, XIV. 149. 4. fur le
décret de Dieu par rapport au falut des hommes, XVII. 433;
4. fur l’imputation des mérites de Jefus-Chrift, VIII. 640. 4.
fur la communion. IX. 397. A Controverfes des calviniftes
avec les catholiques, fur la préfence réelle. VI. 132. A Doctrine
des calviniftes fur la nature des peines de l’enfer. V.
668. A
CALVINISTES, divers noms qu’on leur donne. II. 366.4.'
Prédication de Calvin à Geneve. Sort des calviniftes en France
depuis leur premier établiffement. Articles de doétrine que
Calvin a pris des Vaudois, des luthériens, 8c ceux qu’il a
ajoutés lui-même. Dogme de Calvin fur l’Euchariftie. Contradictions
où les calviniftes font toriibés dans leurs diiputcs.
Comment leurs adverfaires en ont tiré parti. Ibid. b.
Calviniftes y rapport entre les épifeopaux d’Angleterre &
les calviniftes. V. 813. a. Origine des noms d’huguenots & de
parpaillots y qui leur furent donnés en France. VIII. 333. ai
XII. 80.4.Edits rendus en France en leur faveur 8c contr’eux.,
XI. 736. b. Synodes des calviniftes. XV. 756.4, A-Calviniftês
appelles terminiftes, XVI- 160. A 8c tropiques. 708. A Sur les
calviniftes, voyeç Protestans.
CALVIS1US, ( S et h ) obfervations fur la vie 8c les ouvrages
de ce célébré chronologifte. XIII. 6 f 9. A
CALVITIE, chûte des cheveux. Caufes de cette maladie.
D. 366. A Voyei A lopécie.
CALUS, dureté à la peau, à la chair, ou aux os, naturelle
ou contre nature. Sens reftreint de ce mot. Comment
fe fait la formation du calus. Exemples de calus dont Turf
avoit parfaitement remplacé yn humérus, 8c l’autre un fémur.
Effets qui réfulteiit de la difpofition plqÿ ou moins favorable
du fuc nourricier des os. Comment on corrige les mauvaifes
difpofltions de la lymphe. II. 367. 4.
Calus, fa formation après une fraéturc. Suppl. I. 132. 4.
Ibid. 194. A Liqueur qui cimente les extrémités d’un os fracturé
, quoiqu’à une diftance. confldérable Tune de l’autre. XL
I i l