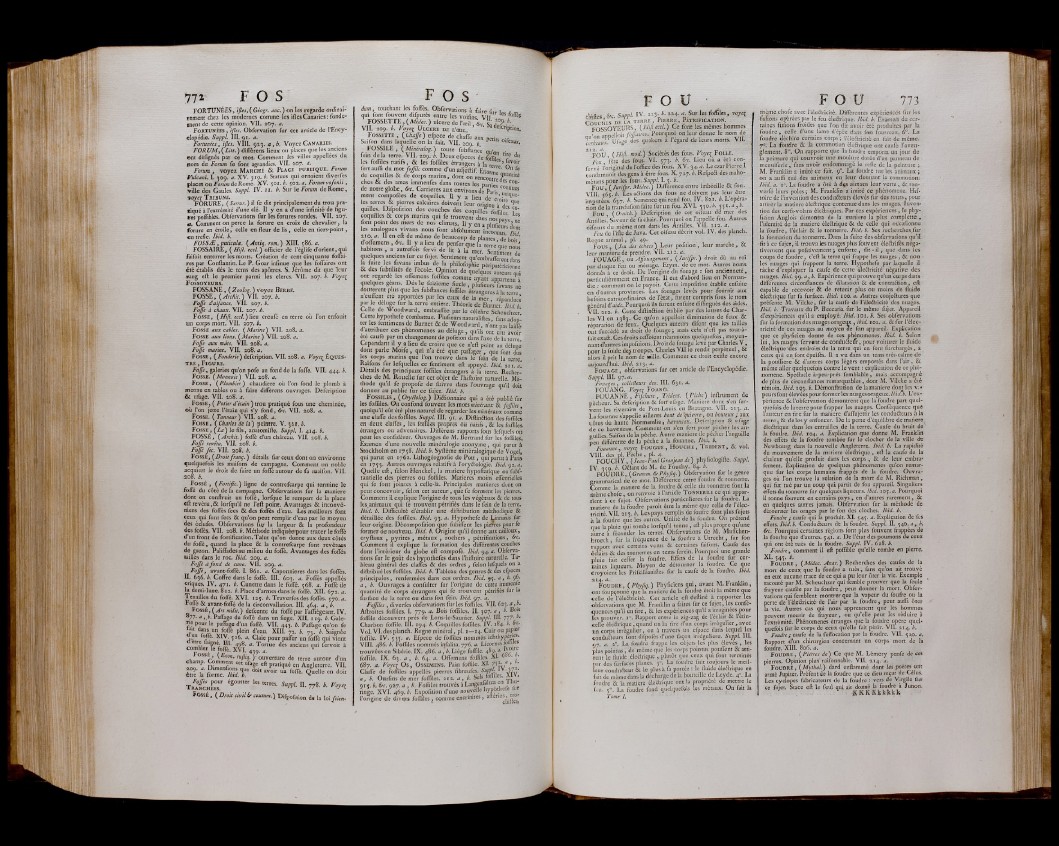
77* F O S F O S
FORTUNÉES, ifles ,( Géogr. anc.) on les regarde ordinairement
chez les modernes comme les ifles Canaries : fondement
de cette opinion. VU. 207. a.
Fortunées , ifles. Obfervation fur cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. III. 91. a.
Fortunées, ifles. VIII. 923. a , b. Voyez C anaries.
F O R U M , ( Litt. ) différens lieux ou places que les anciens
©nt défignés par ce mot. Comment les villes appellées du
nom de Forum fe font agrandies. VII. 107. a.
Forum , v o y e z M a r ch é & P la c e p u b lique. Forum
Vu lca nl I. 309. a. XV. 319. b. Statues qui ornoient diverfes
places ou Forum de Rome. XV. y 01. b. 502. a. Forum v o fo n ii,
ville des Gaules. Suppl. IV. n . b. Sur le Forum de R ome,
voyez TRIBUNE.
FORURE, ( Serrur. ) il fe dit principalement du trou p ratiqué
à l’extrémité d’une clé. Il y en a d’une infinité de figures
poflibles. Obfervations fur les forurcs rondes. VII. 207.
es. Comment on perce la forure en croix de chevalier, la
forure en étoile, celle en fleur de lis, celle en tiers-point,
en trèfle. Ibid. b.
F O S SÆ , puticulct. ( Antiq. rom.) XIII. 586. a.
FOSSAIRE, ( Hifl. e c c l.) officier de l’églifed’o rient,qui
faifoit enterrer les morts. Création de cent cinquante foliaires
par Conilantin. Le P. Goar inftnue que les fofTaires ont
été établis dés le tems des apôtres. S. Jérôme dit que leur
sang eft le premier parmi les clercs. VII. 207. b. Voye{
F ossoyeurs.
FOSSANE , ( Zoolog.) Voyez Berbe.
FOSSE, ( Archit. ) VIT.. 207.
b.
Fojfe daijancc. V il. 207. b.
F ojfe à chaux. VII. 207. b.
F osse, {H ifl. eccl. ) lieu creufé en terre où l'on enfouit
un corps mort. VII. 207. b.
F osse aux cables. ( Marine) VII. 208. a.
F osse aux lions. (M a r in e) VII. 208. a.
Fojfe aux mâts. VU. 208. a.
Fojfe marine. VII. 208. a.
F osse, {Fond er ie)defeription. V I I .208. a. Voye{ Équestr
e , Figure.
Fo jfe, galeries qu’on pofe au fond de la foiTe. VII; 444. b.
Fosse. {Monnoie) VII. 208. a.
F osse, {Plombier) chaudière où l’on fond le plomb à
mettre en tables ou à faire différons ouvrages. Defeription
& ufage. VII. 208. a.
Fosse, ( Potier d ’étain ) trou pratiqué fous une cheminée,
où l’on jette l’étain qui s’y fond, Oc. VII. 208. a.
Fosse. ( Tanneur ) VII. 208. a.
FOSSE, ( Charles de la ) peintre. V . 321. b.
F o sse, ( L a ) le fils, anatomifle. Suppl. I. 414. b.
FOSSÉ, {A r ch it.) foffè d’un château. VII. 208. b.
Fojfé revêtu. VII. 208. b.
ffé fec. VII. 208. b.
F o)sSsSeE,, ((LDroit franç. ) détails fur ceux dont on environne
quelquefois les maifons de campagne. Comment un noble
acquiert le droit de. faire un forte autour de fa raaifon. VII.
308. b.
F ossé , {Fortifie.) ligne de contrcfcarpe qui termine le
foiTé du côté de la campagne. Obfervations fur la maniéré
dont on conftruit un folié, lorfque le rempart de la place
eft revêtu,& lorfqu’il ne l’eft point. Avantages & inconvé-
niens des foliés focs & des foiTés d’eau. Les meilleurs font
ceux qui font focs & qu’on peut remplir d’eau par le moyen
des édufes. Obfervations fur la largeur & la profondeur
des foiTés. VII. 208. b. Méthode indiquécpoùr tracer le foiTé
d’un front de fortification. Talut qu’on donne aux deux côtés
du foiTé, quand la place 6c la contrefcarpe font revêtues
de gazon. Faliftades au milieu du foiTé. Avantages des foiTés
taillés dans le roc. Ibid. 209. a.
Fojfé à fo n d de cuve. V IL 209. a.
F o jfé , avant-foiTé. I. 861. a. Caponnieres dans les foiTés.
U. 636. b. Coffre dans le foiTé. III. 603. a. FoiTés appellés
criques. IV . 471. b. Cunette dans le foiTé. 568. a. FoiTé de
la demi-lune. 812. b. Place d’armes dans le foiTé. XII. 672. a.
Tenailles du foiTé. XVI. 125. b. Traverfosdes foiTés. 570. a.
FoiTé & avant-foiTé de la circonvallation. III. 464. a , b.
Fossé, (A r t milït.) defeente du foiTé par l’afliégcant. IV.
.77* a y,b. Paflage du foiTé dans un fiege. XII. 119. b. Gale-
p P°ur le pafiag« d’un foiTé. V II. 443. b. Partage qu’on fe
sut dan» un forte plein d’eau. XIIL 72. b. 73. b. Saignée
i,A” ? X; a' Ulaie Pour paiTer un foiTé qui vient
combler'fc foiTè X^/l! « £ " * “ ^ anciens ‘ ervoit 1
t ouverture de terre autour d’un
¡ § g j ¡ 1 1 1 1 cet eft pratiqué en Angleterre. VII. S t f a T t r IIivoir “ Mt- Q“110 « g
T r a n c h é e s^ ^ S H *• " n
Fossé, ( D r o i t cm l«■ comum.|Difpofiàon d « h lo if iù n -
dum, touchant les foiTés. Obfervations à faire f „ , 1 e
qui font fouvent difputés entre les voifmc v u s
FO S SE T TE , ( Médec. ) ulcerc de ■ H H M H
VII. 209. b. Voye{ U lcere de l’oeil defeription.
Fossette , (C h a jfc ) cfpcce de charte aux nc,;,c Ê
Saifon dans laquelle on la fait. VII. 209. b. oifcaux,
FO S S IL E , (Minéralog.) toute fubftance •
fein de la terre. VII. 209. b. Deux cfpcces de H du
les fofliles natifs, & les fofliles étrangers à la te n VOir
fert auifi du mo t fo jfilc comme d’un adjeélif. Enorm^' n Ü
de coquilles & de corps marins, dont on rcncontîe,?llantirô
ches & des amas immenfes dans toutes les Darti#.c cou”
de notre g lobe, Oc. Carrières aux environs de Paris C0"nues
ment compofées de coquilles. Il y a lieu de c ’ “ni(luc*
les terres 6c pierres calcaires doivent leur origine S i a P
quilles. Difpofnion des couches des coquilles foflil« f°*
coquilles & corps marins qui fe trouvent dans nos pays ne
font point des mers de nos climats. Il v en a nli.fi« y \
1« analogues vivans nous fout abfoimnem inconnus” § B
« a a. Dieu eft de même de beaucoup de plantes, de bois '
doflemens, «■„. U y al,eu de penfer que fa 3
habitons, a autrefois ferv. de lit à la uter. Scntimc, dè
quelques anciens fur ce fujet. Sentiment qu'embrafferent lant
U fuite les favans imbus de la jphllofo^le p & î & f c i S
Ê f e M de 1 École. Ou,mou de quelques anteuts qui
ont regardé les oflemens fofliles comme ayant appartenu à
quelques géans. Des le fetzteme fled e , plifieurs favans né
doutèrent plus que les fubftanccs fofliles étrangères à la terré
neuflint été apportées par les eaux de la mer, répandues’
par le déluge fur la terre entière. Théorie de Burnct. Ibid. t.
Celle de Woodward, embraflïe par le célébré Scheuchzer.
Cette Itypothefe combattue. Plufieursnaturaliftes, (ànsadoo-
ter les ientimens de Burnet 6c de Woodward, n’ont pas laiifé
d attribuer ces phénomènes au déluge, qu’ils ont cru avoir
été caufé par un changement de pofition dans l’axe de la terre.
Cependant il y a lieu de croire que ce n’eft point au déluee
dont parle M o ïfe , qui n’a été que partager, que font dus
les corps marins que l’on trouve dans le fein de la terre.
Raifons fur lefqucllcs ce fentiment eft appuyé. Ibid. m . a.
Détails des principaux fofliles étrangers à la terre. Recherches
de M. Rouelle fur cet objet de l’hiftoirc naturelle. Méthode
qu’il fe propofe de fuivre dans l’ouvrage qu’il doit
donner au public lur ce fujet. Ibid. b.
F o s s i le s , ( Oryftolog. ) Diélionnaire qui a été publié fur
les foifiles. On confond fouvent les mots minéraux oc fojflles,
quoiqu’il eût été plus naturel de regarder les minéraux comme
une «lafle des foifiles. Suppl. III. 91. a. Diftinélion des foifiles
en deux clartés, les foifiles propres ou natifs, 6c les foifiles
étrangers ou advenaires. Différens rapports fous lcfqucls on
peut les confidérer. Ouvrages de M. Bertrand fur les fofliles.
Examen d’une nouvelle minéralogie anonyme, qui parut à
Stockholm en 1758. Ibid. b. Syftême minéralogique de Vogel,
qui parut en 1762. Lithogéognofic de Pott, qui parut h Paris
en 1753. Autres ouvrages relatifs h l’oryélologie. Ibid. iji .a .
Quelle e f t , félon Henckel, la matière hypoftatique ou fubf-
tanticlle des pierres ou fofliles. Matières moins ertcnticllcs
qui fe font jointes à celle-là. Principales manières dont on
peut concevoir, félon cet auteur, que fe forment les pierres.
Comment iL explique l’origine de tous les végétaux & de tous
les.animaux qui fe trouvent pétrifiés dans le fein de la terre.
Ibid. b. Difficulté d’établir une diftribution méthodique &
détaillée des fofliles. Ibid. 93. a. Hypothefc de Linnæus fur
leur origine. Décompofition que fubiifent les pierres pour fe
former de nouveau. Ibid. b. Origine qu’il donne aux cailloux,
cryftaux , p yrites , métaux , rochers , pétrifications, Oc.
Comment il explique la formation des différentes couches
dont l’intérieur du globe eft compofé. Ibid. 94. a. Obfervations
fur le goût des hypothefes dans l’hiftoire naturelle. Tableau
général des clafies & des ordres, félon lefquels on a
diftribué les fofliles. Ibid. b. Tableau des genres & des cfpeces
principales, renfermées dans ces ordres. Ibid. 95. a , b. 96.
a , b. Ouvrages à confulter fur l’origine de cette immenfe
quantité de corps étrangers qui fe trouvent pétrifiés fur la
furface de la terre ou dans fon fein. I b id .o j . a.
Fojftles , diverfes obfervations fur les fofliles. VII. 0 » f*
Adroites fofliles. I. 779. a. Bois fofliles. II. 307. a , b. Bois
foflile découvert près de Lons-le-Saunier. Suppl. III* 777-
Charbon foflile. III. 194. b. Coquilles fofliles. IV. 184. b. Oc.
V ol. V I. des planch. Règne minéral, pl. 1— 14. Cuir ou paj?icr
foflile. IV . 555. a. Efpece de fofliles nommés ichthypertes.
VIII. 486. b. Fofliles nommés infaiita. 776. a. Licornes fo/u es
trouvées en Sibérie. IX. 486. a , b. Liège foflile; u
foflile. IX. 63. * , b. 64. a. Oflemens fofliles. XL 680. o.
687. a. Voyer O s , O ssemens. Pain foflile. XI< a » ’
Clarté de foifiles appellés pierres fibreufes. OuPpL • 37 *
a , b. Ourfins de mer fofliles. 212. a , b. Sels to 1 es. *
91 «. b. Oc. 927. a , b. Fofliles trouvés à LwngÇiualtza c
ringe. X V L 469. b. Expofition d’une nouvelle hypbthefe fur
l’origine de diyqrs fofliles 2 comme encrimtes,
F O U F O U 7 7 3
chutes, f c . Su p p l IV. « 3 - *• “ 4- 4. Sur les foifiles, v o y n
C ouches de la terre , Pierre , Pétrification.
FOSSOYEURS, (H iflc e c i.) C e font les mêmes hommes
qu’on appcllbit fojfuïrcs. Pourquoi on leur donne le nom de
corbeaux. Uftge des quakers à 1 egard de leurs morts. Y U.
2I! b U , (H ifl- mod.) Sociétés des fous. Voye^ F olle.
Fou 9 fête des fous. VI. 373. b. Oc. Lieu où a été con-
fervé l’original de l’offiee des fous. X V . 34. a. Le czar Pierre 1
condamnoit des gens à être fous. X. 727. b. Refpeél des maho-
métans pour les fous. Suppl. I. s. b.
F o u , (Jurifpr. Médec.) Différence entre imbecule & fou.
VIII. 365. b. Les aérions, des fous ne doivent pas leur être
imputées. 637. b. Semence qui rend fou. IV. 821. b. L’opération
de la transfufion faite fur un fou. X VI. 5 50 .‘b. e< ç i.a ,b .
F ou , ( Omith. ) Defeription de cet oifeau de mer des
Antilles! Saveur de fa chair. Pourquoi on l’appelle fou. Autres
oifeaux du même nom dans les Antilles. V il. 212. a.
Fou de Tille de Java. Cet oifeau décrit vol. IV. des planch.
Règne animal, pl. 49* » „ , . . , . 0
F o u s , ( leu des échecs) Leur pofition , leur marche, oc
leur maniéré de prendre. VU. 212. a. . .
FOU AG E , o u Affouagement, (Ju r ifp r .) droit dû au roi
par chaque feu ou ménage. Etym. de ce mot. Autres noms
donnés à ce droit. De l’origine du fouage : fon ancienneté,
particulièrement en France. Il eut d’abord lieu en Normandie
: comment on le payoit. Cette impofition établie enfuitc
en d’-âutres provinces. Les fouages levés pour fournir aux
befoins extraordinaires de l’état, furent compris fous le nom
général A'aide. Pourquoi ils furent enfuite diftingués des aides.
V II. 212. b. Cette diftinftion établie par des lettres de Charles
V I en 1383. Ce qu’on appelloit diminution de feux 6c
réparation de feux. Quelques auteurs difent quc les tailles
ont fuccédè au droit de fouage ; mais cda n’oft pas tout-à-
fait exaét. Ces droits ceflbicnt néanmoins quelquefois, moyennant
d’autres imp'ofuions. D roit de fouage levé par Charles V ,
pour la folde de$ troupes. Charles V II le rendit perpétuel, &
alors il prit le nom de saille. Comment ce droit exifte encore
aujourahui. Ibid. 213. a.
Fo uag e , obfervations fur cet article de 1 Encyclopédie.
Suppl. III. 97. a.
Fouages , colle fleurs des. III. 631. o.
FOUANG. Voyez Fo an g . .
FOU ANNE , Fifchure, Trident. (P ê c h e ) inftrumcnt de
pêcheur. Sa defeription 8c forf ufage. Manière dont s’en fervent
les riverains de Port-Louis en Bretagne. VII. 213 .a .
La fouanne s’appelle ailleurs bout de'quievre-, ou bouteux; aux
côtes de haute Normandie, haveneau. Defeription & ufage
de ce haveneau. Comment on s’en fert pour pécher les anguilles.
Saifon de la pêche. Autre manière de pêcher l'anguille
peu différente de la pêche à la fouanne. Ibid. b.
Fouanne, voyez F O U G U E , Ho u ch e , T r iden t, 6c vol.
VIII. des pl. Pêche , p 1. 4.
FO U CH Y , (Jean-Paul Granjean de ) phyfiologifte. Suppl.
IV . 1«9. b. Oélant de M. de Fouchy. 84. b.
FOU DRE, ( Grarnm. O Phyfiq.) Obfervation fur le genre
grammatical de ce mot. Différence entre foudre 8c tonnerre.
Comme la matière de la foudre 8c celle du tonnerre foin la
même chofe, on renvoie à l’afticle T onnerre ce qui appartient
à ce fujet. Obfervations particulières fur la foudre. La
matière de la foudre paroît être la même que celle de l’électricité.
VII. 213. b. Les pays remplis de foutre font plus fujets
à la foudre que les autres. Utilité de la foudre. On prétend
que la pluie qui tombe lorfqu’il tonne, eft plus propre qu’une
autre à féconder les terres. Obfervations de M. Muflchen-
brocck, fur la fréquence de la foudre à Utrccht, fur fon
rapport avec certains vents 8c certaines faifons. Caufe des
éclairs 8c des tonnerres en tems fcrcin. Pourquoi une grande
pluie fait ccffer la foudre. Effets de la foudre fur certaines
liqueurs. Moyen de détourner la foudre. Ce que
croyoicnt les Prifcillianiftes fur la caufe de la foudre. Ibid.
2 Fo u d r e , ( Phyfiq.) Phyficiens qui, avant M. Franklin,
ont foupçotinc que la matière dç.la foudre étoit la même que-
celle de l’éleftricité. Cet article eft deftiné à rapporter les
obfervations que M. Franklin a faites fur ce fujet,Jes confé-
qucnccs qu’il en tire, 8c les expériences qu’il a imaginées pour
les prouver. i°. Rapport entre le zig-zag de l’éclair 8c l’étincelle
élcftrique, quand on la tire d’un corps irrégulier, avec
un corps irrégulier, ou à travers un cfpace dans lequel les
conducteurs lont difpofés d’une façon irrégulière. Suppl. III.
97. a. 2°, La foudre frappe les objets les plus élevés , les
plus pointus, de même que les corps pointus pouffent 8c attirent
le fluide éleétrique , plutôt que ceux qui font terminés
par des furfaces planes. 30. La foudre fuit toujours le meilleur
conducteur 8c le plus à fa portée : le fluide éleétrique en
fait de même dans la décharge de la bouteille de Leyde. 4». La
foudre 8c la maticre p i » ont la propriété de mettre le
fou. 50. La foudre fond quelquefois les métaux, ü n fait la
Tome, I,
mémo chofe avec l’élcétricité. Différentes expériences fur les
fufions opérées par le feu éleétrique. Ibid. b. Exameri de certaines
fufions froides que Von dit avoir été produites par la
foudre, celle d’une lame d’épéc dans fon tourrcaii.,6°. La
fondre déchire certains corps ; l’élcftricité en fait de même.
7 0. La foudre 6c la commotion éleétrique ont caufé l’aveuglement.
8°. On rapporte que la foudre emporta un jour de
la peinture qui couvroit une moulure dorée d’un panneau de
menuiferie, fans avoir endommagé le refte de la peinture ;
M. Franklin a imité ce fait. 90. La foudre tue les animaux ;
on a aufli tué des animaux en. leur donnant la commotion;
Ibid. a. x°. La foüdre a ôté à dçs aimans leur vertu, 8c ren-
verfé leurs pôles ; M. Franklin a imité ce phénomène. Hif-
toirc de l’invention des conduéleurs élevés fur des tours -, pour
attirer la matière éleétrique contenue dans les nuages. Invention
des cerfs-volans électriques. Par ces expériences, fc phy-
ficicn Anglois démontra de la maniéré la plus romplctte ,
l’identité ae la matière éleétrique 8c de celle qui odeafionne
la foudre, l’éclair 8c le tonnerre. Ibid: b. Scs recherches,fur
la formation du tonnerre. Dans la fuite des obfervations qu’il
•fit à ce fujet, il trouva les nuages plus foUvcnt éleétrifés négativement
que pofitivement ; enforte , dit - i l , que dans les
coups de foudre, c’c'ft la terre qui frappe les nuages, 8c non •
les nuages qui frappent la terre. Hypothcfe par laquelle il
tâche d expliquer la caufe de cette élcétricité négative des
nuages. Ibid. 99. a , b. Expérience qui prouve qu’un corps dans
différentes circonflanccs de dilatation 8c de contraétion, eft
capable de recevoir 8c de retenir plus ou moins de fluide
éleétrique fur fa furfàce. Ibid. 100. a. Autres conjeétures que
préfente M. V ilck e, fur la caufe de l’éleétricité des nuages.
Ibid. b. Travaux du P. Beccaria fur le même fujet. Appareil
d’expériences qu’il a employé. Ibid. l o i . b. Ses obfervations
fur la formation des nuages orageqx, ibid. 102. a. 6c fur l’électricité
de ces nuages au moyen ae fon appareil. Explication
que ce phyficien donne de ces phénomènes. Ibid. b. Selon
lu i, les nuages fervent de Conduétcffr, pour voiturer le fluide
éleétrique'des endroits de la terre qui en font furchargés, à
ceux qui en font épuifés. Il a vu dans un tems très-calme de
la poufliere' 8c d’autres corps légers emportés dans l’a ir , 8c
même aller quelquefois contre le vent : explication de ce phénomène.
Speétacle à-peu-près fcmblable, mais accompagné
de plus de circonftances remarquables, dont M. Vilcke a été
témoin. Ibid. 193. b. Démonftration de la manière dont les v;*
peurs font élevées pour former les nuages orageux. Ibid. b. L’expérience
8c l’obfervation démontrent que la foudre part quelquefois
de la terre pour frapper les nuages. Conféquencc que
1 auteur en tire fur la manière d’aflùjcttir les conduéteurs à la
terre, 8c de les y enfoncer. De la perte d’équilibre de matière
éleétrique dans les entrailles de la terre. Caufe du bruit de'
la foudre. Ibid. 104. a. Explication que donne M. Franklin
des effets de la foudre tombée fur le clocher de la ville de
Newbourg dans la nouvelle Angleterre. Ibid. b. La rapidité
du mouvement de la matière éleétrique, eft la caufe de la
chaleur qu’elle produit dans les corps , 8c de leur embra-
fement. Explication de quelques phénomènes qu’on remarque
fur les corps humains frappés de la foudre. Ouvrages
où l'on trouve la relation de la mort de M. Richman,
qui fut tué par un coup qui partit de fon appareil. Singuliers
effets du tonnerre fur quelques liqueurs. Ibid. 103. a. Pourquoi
il tonne fouvent en certains pa ys, en d’autres rarement, 8c
en quelques autres jamais. Obfervation fur la méthode de
détourner les orages par le fon des cloches. Ibid. b.
Foudre ; caufe qui la produit. X I. 345 .a . Explication de fes
1 effets. Ibid.b. Conduéteurs de la foudre. Suppl. i l . 540. <1, b.
Oc. Pourquoi certaines régions font plus fouvent frappées de
la foudre que d’autres. 541. a. D e l’état des poumons de ceux
qui ont été tués de la foudre. Suppl. IV. 618. b.
Foudre, comment il eft poffible qu’elle tombe en pierre.
XI. 543. b.
Fo u d r e , (Médec. A n a t.) Recherches des caufes de la
mort de ceux que la foudre a tués, fans qii’on ait trouvé
en eux aucune trace de ce qui a pu leur ôter la vie. Exemple j
raconté par M. Scheuchzcr qui lemble prouver que la feule
frayeur caufée par la foudre , peut donner la mort. Obfervations
qui fcmblent montrer que la vapeur du foufre ou la
perte de l’éleétricité- de l’air par la foudre, peut aufli ôter
la vie. Autres cas qui nous apprennent que les hommes
peuvent mourir de frayeur, ou qu’elle peut les réduire à
l’extrémité. Phénomènes étranges que la fondre opere quelquefois
fur le corps de ceux qu’elle fait périr. VII. 214. b.
Foudre ; caufe de la fuffocation par la foudre. VII. 520. a.
Rapport d’un chirurgien concernant un corps mort de la
foudre. XIII. 806. a.
Foudre , ( Pierres de ) Ce que M. Lémery penfe de ces
pierres. Opinion plus'raifonnable. VII. 214.-a.
Foudre , (M y th o l.) dard enflammé dont les poëres ont
armé Jupiter, rréfent de la foudre que ce dieu reçut de Célus.
Les cyclopes fabricateurs de la foudre : vers de Virgile fur
ce iiijcc« Stace eft le feul qui ait donné la foudre à Junon.
/ v K K K K k k k k l^