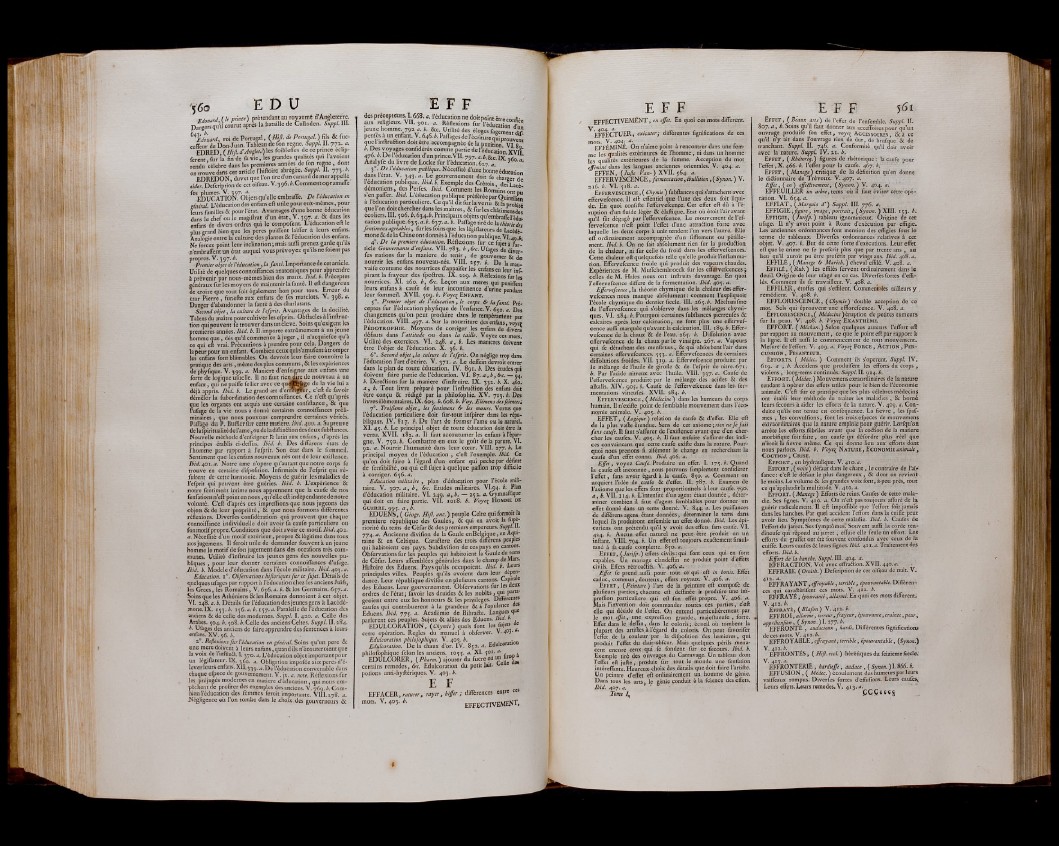
'5 Co E D U
TJiuiri (h prince) prétendant au royaiimt d’Angleterre.
Dangers qu’ il courut aprè! la bataille de Cullodcn. Suffi. 111.
W Ê s Ê I - roi de Portugal s W - * ) fils & fuccefieur
de Don-Juin. Tableau de (on renne,.Suffi II. 7 « . «.
EDRED ( »/!. tAndct.) les foiblefles de ce prince éclip-
ferent, fur la findc fa vie, les grandes qualités qui l'avoicnt
rendu célébré dans les premières années de fon renne, dont
on trouve dans cet artiefe l’hiftoire abrégée. Suffi. II, 773.*.
EDREDON duvet que l’on tire d’un canard de mer appellé
eider. Defcrlption de cet oifeau. V. 3 96. b. Comment opramaffe
^CSE?)U(iATI0^^01;jets qu’elle embraffe. De tidjicâiion en
cintrai L’éducation des enfanseft utile pour eux-mémes, pour
leurs familles & pour l’état. Avantages d’une bonne éducation
dans le chef ou le magiftrat d'un état, V . 397. a. 8c dans les
enfans de divers ordres qui le compofent. L’éducation eft le
plus grand bien que les peres puiflent laiffer à leurs enfans.
Analogie entre la culture des plantes & l’éducation des enfans.
Ne forcez point leur inclination ; mais auffi prenez garde qu ils
n’embraffentun état auquel vous prévoyez qu’ils ne foient pas
propres. V. 397. b. .1
Premier objet de réducation, la fanté. Importance de cet article.
Utilité de quelques connoiffances anatomiques pour éprendre
à prévenir par nous-mêmes bien des maux.Ibid. b. Préceptes
généraux fur les moyens de maintenir la fante. 11 eft dangereux
de croire que tout foit également bon pour tous. Erreur du
tzar Pierre , funefte aux enfans de fes matelots. V. 398. a.
Danger d’abandonner la fanté à des charlatans.
Second objet, la culture de refont. Avantages de la docilité.
Talens du maître pour cultiver les efprits. Obftacles à 1 inftruc-
tibri qui peuvent le trouver dans un èleve. Soins qu’exigent les
premières années. Ibid. b. Il ¡importe extrêmement un jeune
nomme que, dès qu’il commence à juger, il n’acquiefce qu’à
ce qui eft vrai. Précautions à prendre pour cela. Dangers de
la peur pour un enfant. Combien ceux auis’amufcntàtromper
les enfans font blâmables. On devroit leur faire connoîtrc la
pratique des arts, même des plus communs, & les expériences
dephyfique. V. 399. a. Maniéré d’enfeigner aux enfans une
forte de logique ufuelle. 11 ne faut rieiyu-e de nouveau à un
enfant, qui nepuific fe lier avec ce quJRûgc de la vie lui a
déjà appris. Ibid. b. Le grand art d cnlSPer, c’eft de favoir
démêler la fubordimrion des connoiffances. Ce n’eft qu’après
que les organes ont acquis une certaine coniiftance, 8c que
rufage de la vie nous a donné certaines connoiffances préliminaires
, que nous pouvons comprendre certaines vérités.
Pairage du P. Buffierfur cette matière. Ibid. 400. a. Sa preuve
de la fpiritualité de l’ame, ou de la difti nélion des deux fubftances.
Nouvelle méthode d’enfeigner lé latin aux enfans, d’après les
principes établis ci-deffus. Ibid. b. Des différens états de
l’homme par rapport à l’cfprit. Son état dans le' fommeil.
Sentiment que les enfans nouveaux nés ont de leur cxiftcnce.
Ibid. 401. a. Notre âme n’opere qu’autant que notre corps fe
trouve en certaine difjxofition. Infirmités de l’efprit qui ré-
fultent de cette harmonie. Moyens de guérir les maladies de
l'efprit qui peuvent être guéries. Ibid. b. L’expérience 8c
notre fentiment intime nous apprennent que la caufe de nos
fenfadons n’eft point en nous, qu’elle eft indépendante de notre
volonté. C’eft d’après ces impreflions que nous jugeons des
objets 8c de leur propriété, 8c que nous formons différentes
réflexions. Diverles confidérations qui prouvent que chaque
connoiffance individuelle doit avoir fa caufe particulière ou-
fon motif propre. Conditions que doit avoir ce motif Ibid. 402.
a. Néceffité d’un motif extérieur, propre & légitime dans tous,
nos jugemens. Il feroit utile de demander fouvent à un jeune
homme le motif de fon jugementdans des occafions très communes.
Utilité d’inftruire les jeunes gens des nouvelles publiques
, pour leur donner certaines connoiffances d’ufage.
Ibid. b. Modelé d’éducation dans l’école militaire. Ibid. 403. a.
Education. i°. Obfervations hifloriques fur ce fujet. Détails de
quelques ufages par rapport à l’éducation chez les anciens Juifs,
les Grecs, les Romains, V. 656. a. b. 8c les Germains. 657. a.
Soins que les Athéniens 8c les Romains donnoient à cet objet.
VI. 248. a.b. Détails fur l’éducation des jeunes gens à Lacédé-
mone. IX. 133. b. 156. a. b. 157. a. Paralclle de réducation des
anciens 8c dé celle des modernes. Suppl. I. 420. a. Celle des
Arabes. 504. b. 508. ¿.Celle des anciens Celtes. Suppl. II. 284.
b. Ufages des anciens de faire apprendre des fcntcnces à leurs
enfans. XV. 56. b.
2°. Réflexions fur Téducation en général. Soins qu’un pere 8c
une mere doivent à leurs enfans,quand ils n’écouteroientque
la voix de 1 inftinQ. L 270. a. L’éducation objet important pour
un légiflateur. IX. 360. a. Obligation impofée aux peres d’é-
leverleurs enfans. XII. 339. a. De l’éducation convenable dans
chaque efpece de gouvernement. V. jx. a. note. Réflexions fur
les préjugés modernes en matière d’éducation, qui nous empêchent
de profiter des exemples des anciens. V. 769. b. Combien
l’éducation des femmes feroit importante. VIII. 278. a.
Négligence où l’on tombe dans le choix des gouverneurs 8c
E F F
jeune homme. 79» a. b. Sic. Utilité des ¿l<»cs faeemm, jv?
penftsàunenfam.y^.i.Paffagesdel’é e r i .u t e i lp , "^ ;
quel inftruétion doit être accompagnée de la punition VI «
comme partie de l’éducation XVI?'
476. b. De 1 éducation d un prince. VII. 707. a. b àtc. IY -
Analyfe du livre de Locke fur l’éducation. 627. a ‘
I ï ° \P e ÿÊÊÊâPublique. Néceflité d’une bonne éducation
dans 1 état. V. 343. a. Le gouvernement doit fc chareer A*
1 éducation publique. Ibid. b. Exemple des Crétois des Lacé
démoniens, des Perfes. Ibid. Comment les Romains ont nu
s’en paffer. Ibid. L’éducation publique préférée par Quintiben
à l’éducation particulière. Ce qu’il dit fur la vertu 8cla probité
que l’on doit chercher dans les maîtres, 8c fur les châtimensde*
écoliers. III. 306. ¿.634.A Principaux objets qu’embraffel’édu.
cation publique. 6 3 3. a. b. 637. a. b. PafTage tiréde la théorie des
fentiminsagréables, furies foins que les légiflatcurs de Lacédé-
mone 8c de la Chine ont donnés àl’éducation publique. VI. 40 g
40. De la première éducation. Réflexions air ce fujet à l’article
Gouvernante d’enfans. VII. 783. b ,&c. Ufages de diver-
fes nations fur la maniéré de tenir, de gouverner & dé
nourrir les enfans nouveau-nés. VIII. 257. b. De la mau«
vaife coutume des nourrices d’appaifer les enfans en leur infl
pirant la frayeur des fpcélres. IX. 229. b. Réflexions fur les
nourrices. XI. 260. b, &c. Leçon aux meres qui puniffent
leurs enfims à caufe de leur incontinence d’urine pendant
leur fommeil. XVII. 309. b. Voyc{ E n f a n t .
30. Premier objet de l'éducation, le corps & la fanté. Préceptes
fur l’éducation phyfique de l’enfance. V. 632. a. Des
changemens qu’on peut produire dans le tempérament par
l’éducation. VIII. 407. a. Sur la nourriture des enfans, voyer
P é d o t r o p h i e . Moyens de corriger les enfans de divers
défauts dans l ’attitude ou dans la taille. Voyez ces mots.
Utilité des exercices. VI. 248. a , b. Les manières doivent
être l’objet de l’éducation. X. 36. b.
. 6°. Second objet, la culture de l ’efprit. On néglige trop dans
l’éducation l’art d’écrire. V. 371. a. Le defTein devroit entrer
dans le plan de toute éducation. IV. 891. b. Des études qui
doivent faire partie de l’éducation. VL 87. a , b,&c. *—94.
b. Direélions fur la maniéré d’inftruire. IX. 332. b. X. 460.
a , b. Tout livre préparé pour l’inftruétion des enfans doit
être conçu 8c rédigé par la • • • - • • lúe. XV.* 713. b. —
Des
livres élémentaires. IX. 003. b.6o$.b. Voy. Elémens dés feitnets'.
70. Troifieme objet, les fentimens 6* les meeurs. Vertus que
l’éducation particulière doit fur-tout infpirer dans les républiques.
IV. 817. b. De l’art de former l’ame ou le naturel.
XI. 43. b. Le principal objet de toute éducation doit être la
vertu. XVII. 182. a. Il faut accoutumer les enfans à l’épargne.
V. 730. b. Combattre en eux le goût de la parure. VI.
92. a. Nourrir l’humanité dans leur coeur. VIII. 277. b. Le
principal moyen de l’éducation , c’eft l’exemple. Ibid. Ce
qu’on doit faire à l’égard d’un enfant qui peche par défaut
de fcnfibilfté, ou qui eft fujet à quelque paflion trop difficile
à corriger. 636. a.
Education militaire , plan d’éducation pour l’école militaire.
V. 307. a , b, &c. Etudes militaires. VI.94. b. Plan
d’éducation militaire. VI. 249. a, b. — 232. a. Gymnaflique
qui doit en faire partie. VII. 1018. b. Voyc^ Homme de
GUERRE. 993. a , b. > i
EDUENS, ( Géogr. ffifl. anc. ) peuple Celte qui fonnoit la
première république des Gaules, 8c qui en avoit la fupé-
riorité du tems de Céfar 8c des premiers empereurs. Suppl- II.
774. a. Ancienne divifion de la Gaule en Belgique, en Aquitaine
8c en Celtique. Caraftere des trois différens peuples
qui habitoient ces pays. Subdivifion de ces pays en cantons,
ôbfervations fur les peuples qui habitoient la Gaule du tems
de Céfar. Leurs aftcmblécs générales dans le champ de Mars.
Hiftoire des Eduens. Pays qu’ils occupoient. Ibid. b. Leurs
principales villes. Peuples qu’ils avoient dans leur dépendance.
Leur république divifee en plufieurs cantons. Capitale
des Eduens. Leur gouvernement. Obfervations fur les deux
ordres de l’état; favoir les druides 8c les nobles, qui parta*
geoient entre eux les honneurs 8c les privilèges. Différentes
caufes qui contribuèrent à la grandeur 8c à l’opulence des
Eduens. Ibid. 773. a. Académie de Bibra&e. Langues¡que
parlèrent ces peuples. Sujets 8c alliés des Eduens. Ibid. b.
EDULCORATION, ( Chymie) quels font les fujets ac
cette opération. Réglés du manuel à obferver. V. 4°3*
Edulcoration philoJ'ophique. V. 403. b. .
Edulcoration. De la chaux d’or. IV. 832. a. Edulcora
philofophique félon les anciens. 1033. a. XI. $oi» a- . ,
EDULCORER, ( Pharm. ) ajouter du fucre ou un üroj^a
certains remèdes, &c. Edulcoration du petit lut. Ueu
potions anti-hyftériques. V. 403. b.
E F
EFFACER, raturer, raya, biffa ; diflïrences entre ces
mots. V. 403. b. EFFECTIVEMENT,
E F F E F F JÓI
EFFECTIVEMENT, en effet. En quoi ces mots différent.
EFFECTUER, exécuter; différentes fignifications de ces
mots. V. 404. a. _ '
EFFÉMINÉ. On n aime point a rencontrer dans une femme
les qualités extérieures de l’homme , ni dans un homme
les qualités extérieures de la femme. Acception du mot
efféminé dans les langues anciennes orientales. V. 404. a.
EFFEN, (Jufle Van-) XVII. 364. a.
EFFERVESCENCE, fermentation, ébullition, ( Synon. ) V.
aió. b. VI. 318. a.
E f f e r v e s c e n c e , ( Chymie ) fubftances qui s’attachent avec
effcrvefcence. Il eft effcndel que l’une des deux foit liquide.
En quoi confifte l’effervefcence. Cet effet eft dû à l’éruption
a’un fluide léger 8c élaftique. Etat où étoit l’air avant
?iu’il fût dégagé par Peffervefccnce. Le mouvement de l’ef-
ervefcence n’eft point l’effet d’une attra&ion forte avec
laquelle les deux corps à unir tendent l’un vers l’autre. Elle
eft ordinairement accompagnée d’un fifflement ou pétillement.
Ibid. b. On ne fait abfolument rien fur la prodüftion
de la chaleur, ni fur celle du froid dans les effervefcences.
Cette chaleur eft quelquefois telle qu’elle produit l’inflammation.
Effcrvefcence froide qui produit des vapeurs chaudes.
Expériences de M. Muffchembroeck fur les cffêfrvefcences ;
celles de M. Haies nous ont inftruits davantage. En quoi
l’effervefcence différé de la fermentation. Ibid. 403. a.
Effcrvefcence, la théorie chymique de la chaleur des effervefcences
nous manque abfolument : comment l’expliquoit
l ’école chymique du dernier fiecle. III. .263. ¿. Mécnanifme
de l’effervefcencc. qui s’obferve dans les mélanges chymi-
ques. VI. 284. b. Pourquoi certaines fubftances pierreufes 8c
calcaires après leur calcination, ne font plus une effervef-
cence auffi marquée qu’avant la calcination. III. 189. b. Effer-
vcfcence de la Üiaux 8c de l’eau. 263. b. Diffolution avec
effcrvefcence de la chaux par le vinaigre. 267. a. Vapeurs
qui fc détachent des menftrues, 8c qui abforbent l’air dans
certaines effervefcences. 333. a. Effervefcences de certaines
diffolutions froides. VII. 319. a. Effervefcence produite par
le mélange de l’huile de girofle 8c de l’efprit de nitre. 671.
b. Par l’acide nitteux avec l’huile. VIII. 337. a. Caufe de
reffervefccnce. produite par le mélange des acides 8c des
alkalis. XIV. 903. ¿. Caufe de l’effervefcence dans les» fermentations
vineufes. XVII. 284. b.
E f f e r v e s c e n c e , (Médecine V dans les humeurs du corps
humain. Il n’exifte point de fembluble mouvement dans l'économie
animale. V. 403. b.
EFFET, ( Logique) relation de caufe 8c d’effet. Elle eft
de la plus vafte étendue. Sens de cet axiome ; rien ne fe fait
fans caufe. Il faut s’affurcr de l’exiftence avant que d’en chercher
les caufes. V. 403. b. Il faut enfuite s’aflurcr des indices
convaincans que cette caufe exifte dans la nature. Pourquoi
nous prenons fi aifément le change en recherchant la
caufe d’un effet connu. Ibid. 406. a.
Effet, voyez Caufe. Produire un effet. I. 173. b. Quand
la caufe eft inconnue, nous pouvons fimplement confidérer
l’effet, fans avoir égard à la caufe. 830. a. Comment on
acquiert l’idée de. caufe 8c d’effet. IL 787. b. Examen de
l’axiome que les effets font proportionhels à leur caufe. 790.
a, b. VII. ï 14. b. L’intenfité d’un agent étant donnée, déterminer
combien il faut d’agens femblables pour donner un
effet donné dans un tems donné. -V. 844. a. Les puiffances
de différens agens étant données, ■ déterminer le tems dans
lequel ils produiront enfemble un effet donné. Ibid. Les épicuriens
ont prétendu qu’il y avoit des effets fans caufe. VI.
424. b. Aucun effet naturel ne peut être produit en un
inftant. VIII. 794. b. Un effet eft toujours exactement fimul-
tané à fa caufe complettc. 830. 0.
E f f e t , (Jurifp. ) effets civils: qui font ceux qui en font
capables. Un mariage clandeftîn ne produit point d’effets
civils. Effets rétroaaifs. V. 406a a. ‘ ,
Effet fe prend auffi pour tout ce qui eft in bonis. Effet
caduc, commun, douteux, effets royaux. V. 406. a.
E f f e t , ( Peinture) l’art de la peinture eft compofé de
plufieurs parties ; chacune eft deftinée à produire une im-
Kreffion particulière qui eft fon effet propre. V., 406. a.
lais l’invention'doit commander toutes ces parties, c’eft
elle qui décide de l’effet. On entend particulièrement par
le mot effet, une expreffion grande, majeftueufe , forte.
Effet dans le deffin, dans le coloris;, écueil où tombent la
plupart des artiftes.à> l’égard du. coloris. .On peut fiivorifer
[’effet de la couleur par la difpofition des. lumières, qui
produit l’effet du clair-obfcur. Mais quelques, périls menacent
encore ceux qui, fe fondent fur ce fecours. Ibid. b.
Exemple tiré des ouvrages du Carravage. Un tableau dont
l’effet eft juftè, produit fur tout le monde une fenfation
intéreffante. Heureux choix des détails que doit faire l’artifte.
Un peintre d’effet eft ordinairement un homme de génie.
Dans tous les arts, le génie conduit à la fciencc des effets.
Ibid. 407. a.
Tome
E f f e t , (Beaux an,) do l’effet de l’enfcmble. Suppl. II.
807.a, b. Soins qu’il faut donner aux acccffoircspour qu’un
ouvrage produife fon effet, voye^ A c c e s s o ir e s , 8c à ce
qu’il n’y ait dans l’ouvrage rien de dur, de brufque'8c de
tranchant. Suppl. II. 740. a. Conformité qu’il ¿oit avoir
avec la nature. Suppl. IV. 21. b.
E f f e t , ( Rhétonq.) figures de rhétorique: la caufe pour
l’effet, X. 466. b. l’effet pour la caufe. 467. b:
E f f e t , (Manège) critique de la définition qu’en donne
le diâionhaire de Trévoux. V. 407. a.
Effet, (en) effeflivement, ( Synon. ) V. 404. a.
EFFEUILLER un arbre, tems où il faut éviter cette opération.
VI. 634. a.
EFFIAT, ( Marquis d’ ) Suppl.. III. 776. a.
EFFIGIE, fleure , image, portrait, ( Synon. ) XIII. IC3. b.
E f f i g i e , ( Jurifp. ) tableau ignominieux. Origine ae cet
ufage. Il n’y avoit point à Rome d'exécution par effigie.
Les anciennes ordonnances font mention des effigies fous le
terme de tableaux. Diverfes ordonnances relatives à cet
objet. V. 407. b. But de cette forte d’exécutions. Leur effet
eft que le crime ne fe preferit plus que par trente ans , au
lieu qu’il auroit pu être preferit par vingt ans. Ibid. 408. a.
EFFILÉ, ( Manège & Maréch. ) cheval effilé. V. 408. a.
E f f i l é , ( Rub. ) les effilés fervent ordinairement dans le
deuil. Origine de leur ufagé en ce cas. Diverfes fortes d’effilés.
Comment ils fe travaillent. V. 408. a.
EFFILER, étoffes qui s’effilent. Commentâtes tailleurs y ,
remédient. V. 408. b.
EFFLORESCENCE, ( Chymie) double acception, de ce
mot. Sels qui éprouvenr une effiorefcence. V. 408. a.
E f f l o r e s c e n c e , ( Médecine)éruption de petites tumeurs
fur la peau. 408. b. Voyt{ E x a n th èm e .
EFFORT. ( Méchan. ) Selon quelques auteurs l’effort eft
par rapport au mouvement, ce que le point eft par rapport à
la ligne. Il eft auffi le commencement de toqt mouvement.
Mefurfi'de l’effort. V. 409. a. Voye\ F o r c e , A c t i o n , P e r c
u s s io n , P e s a n t e u r .
E f f o r t s . ( Médec. ) Comment ils s’opèrent. Suppl. IV.
619. a , b. Àccidens que produifént les efforts du corps,
violens, long-tems continues. Suppl. II. 914^.
E f f o r t . (Médec.) Mouvemensexraordinaires de la nature
tendant à opérer des effets utiles pour le bien de l’économie
animale. C’eft fur ce principe que les plus célébrés médecin^
ont établi leur méthode de traiter les maladies, & borné
leurs fecours à aider les efforts de la nature. V. 409. a. Conduite
qu’ils ont tenue en conféquence. La fievre , les fpaf-
mes , les convulfions, font les trois.efpeces de mouvemens
extraordinaires que la nature emploie pour guérir. Lorfqu’on
arrête les efforts fébriles avant que la coihon de la matière
morbifique foit faite, on caufe un défordre plus réel que
n’étoit la fievre même. Ce qui donne lieu aux efforts dont
nous parlons. Ibid. b. Voye^ N a t u r e , E c o n om ìe animale,
C o c t i o n , C r is e .
E f f o r t , en hydraulique. V . 410.a.
E f f o r t , ( voix) défaut dans le chant, le contraire de l’aif'
fance: c’eft le défaut le plus dangereux, & dont on revient,
le moins. Le volume & les grandes voix font, à-peu près, tout
ce qu’applaudit la multitude. V. 4iô.’<*.
E f f o r t . ( Manège ) Efforts de reins. Caufes de cette maladie.
Ses fignes. V. 4x0. a. On n’eft pas toujours affuré de la
guérir radicalement. Il eft impoffibleque l’effort fôiiJamais
dans les hanches. Par quel accident l’eflort dans la cuifle peut
avoir lieu. Symptômes de cette maladie. Ibid. b. Caufes de
l’effort du jarret. Ses fymptôi'nesT'Souvent auffi la corde ten-
dineufe qui répond au jarret, effuie elle feule Un effort. Les
efforts du graffet ont été fouvent confondus avec ceux de la
cuifle. Leurs caufes 8t leurs fignes. Ibid. 41 i.a. Traitement des
efforts. Ibid. b.
Effort de la hanche. Suppl. III. 4°4- a-
EFFRACTION. Vol avec effraftion. XVII. 440. a.
EFFRAIE. ( Orni th. ) Defcription de cet oifeau de nuit. V ;
^ EFFRAYANT ¡ effroyable, terrible , épouvantable. Différences
qui caraélérifent ces mots. V. 412. b.
EFFRAYÉ ; épouvanté, allarme. En quoi ces mots différent.'
V. 412. b.
E f f r a y é , ( Blafon ) V. 412. ¿.
EFFROI, allarme, terreur , frayeur, épouvante, crainte ,peur ',
appréhenfton, (Synon.) I. 277. b. _
EFFRONTÉ , audacieux, hardi. Différentes fignificadons
de ces mots. V. 412. b.
EFFROYABLE, effrayant ; terrible, épouvantable, (Synon.)
Y.Aii.b.
EFFRONTÉS, ( Hift. eccl. ) hérétiques du feizieme fiecle«
EFFRONTERIE, hardieffe, audace , ( Synon. ) 1. 866. b.
EFFUSION, ( Médec. ) écoulement des humeurs par leurs
vaiffeaux rompus. Diverles fortes d’effufions. Leurs caufes*
Leurs effets. Leurs remedes. V. 413. a.
Ç C Ç c c c §