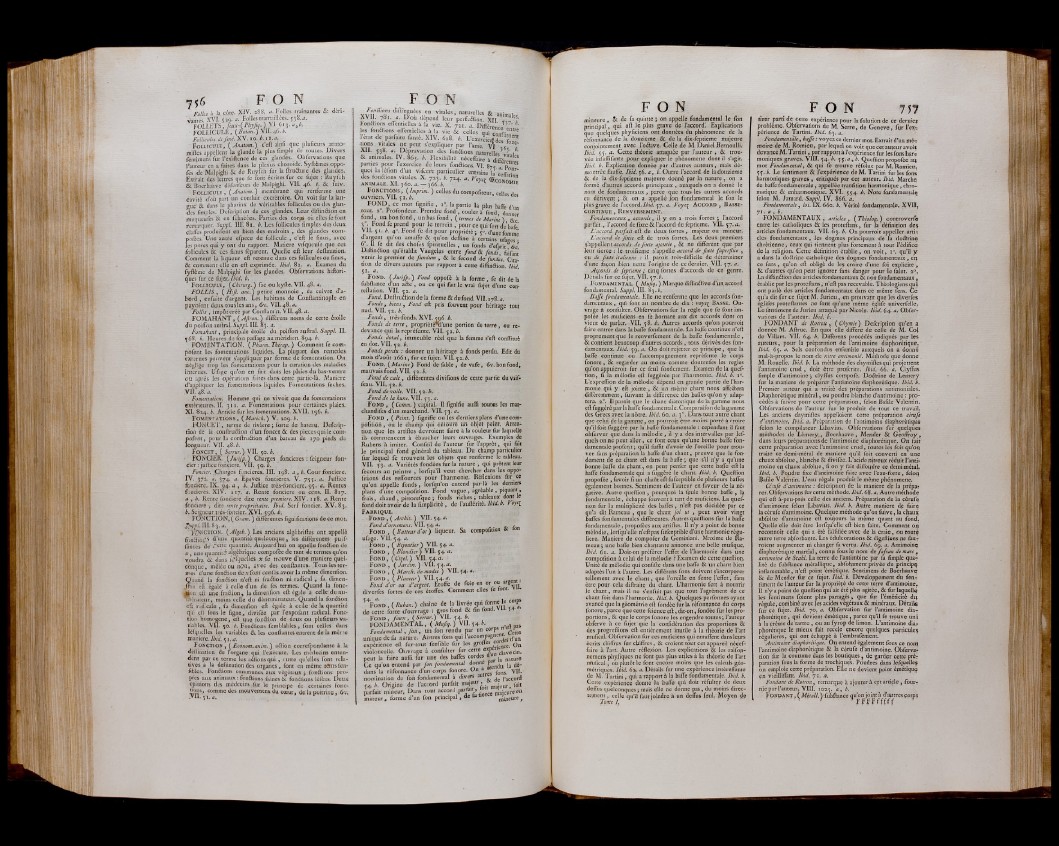
756 F O N
Folles h la côte. XIV. 288. a. Folles traînantes & déri-
'«mes. XVi: î 2 0 . Î 38;'"-
FOLLETS ,f e u x - ( P h y h - ) VI 613. « , i .
FOLLICULE, (M iu u .) VII. 46. i.
Follicule* de {tnt. XV. 10. i. J
FOU.ICULE, ( Anumn. ) c’eft ainfi que plufieurs jnato-
miftes appellent la glande la plus fuuple de toutes. Divers
fentimens fur l’exiftence de ces glandes. Onfervattons que
l’auteur en a faites dans le plexus choroïde, Sylldmcs oppo-
lës de Malpighi & de Ruyfch fur la flruilure des glandes.
Extrait des lettres que fe font écrites fur ce fujet : Ruyfch
& Boerhaitve défenfeurs de Malpighi. V il. 46. b. Si iuiv.
Follicule , ( Anaeom. ) membrane qui renferme une
cavité d’où part un conduit excrétoire. On voit fur la langue'
& dans le pliarinx de véritables follicules ou des glandes
fimples. Defcription de ces glandes. Leur diftinâion en
muqueufes 8c en fébacées. Parties des corps pu elles fe font
remarquer. Suopl. III. 81. b. Les follicules fimples des deux
dalles produilent en bien des endroits , des glandes composes.
Une autre efpece de follicule , c’cft le finus, avec
les pores qui y ont du rapport. Matière vifqueufc que ces
follicules oc ces finus féparent. Quelle eft leur deftination.
Comment la liqueur eft retenue dans ces follicules ou finus,
8c comment elle en eft exprimée. Ibid. 82. a. Examen du
fyftême de Malpighi fur les glandes. Obfervations hiftori-
qués fur ce fujet. Ibid. b.
F o llicule , ( Chirurg. ) fac ou kyfte. V IL 48. a.
F O L L I S , ( Htfl. anc.) petite monnoie , de cuivre d’abord
, en fui te d’argent. Les habitans de Conftantinoplc en
payoient deux tous les ans, £*c. VII. 48. a.
Follis , impôt créé par Conftant'n. VII. 48. a.
FOM AH AN T , ( Aftron. ) différens noms de cette étoile
du poilTonnuftral. Suppl. III. 83. a.
Fomàknnt, principale étoile du poiffon auftral. Suppl. II.
568. b. Heures de Ion paliage au méridien. 894. b.
FOMENTATION. ( Pbarm.Thérap. ) Comment fe com-
pofent les fomentations liquides. La plupart des reinedes
externes peuvent s’appliquer par forme de fomentation. On
néglige trop les fomentations pour la curation des maladies
internes. Ufijge qu'on en fait dans les plaies du bas-ventre
ou après les opérations faites dans cette parti,c-là. Maniéré
d'appliquer les fomentations liquides. Fomentations feches.
VII. 48. à.
. Fomentation'. Homme qui ne vivoit que de fomentations
extérieures. IL 311. a. Fomentations pour certaines plaies.
XI. 824. b. Article fur les fomentations. XVII. 196. b.
F om en ta t io n s , ( Maréch. ) V . 209. b.
FONCE T , terme dé riviere ; forte de bateau. Defcription
de la conftruélion d’un foncet & des pièces qui le comÎlofent,
pour la conftruâion d’un bateau de 170 pieds de
É 10
Ongucur. VII. 48. b.
Fon ce t , ( Serrur.) VII. 30.b.
FONCIER. (Ju r ijp .) Charges foncières : feigneur foncier
: juftice foncière. VII. 50. b.
Foncier. Charges foncières. III. 198. a , b. Cour foncière.
IV. 372. à. 374. a. Epaves foncières. V . 753. a. Juftice
foncière. IX. 94. a , b. Juftice très-foncicre. 93. a. Rentes
foncières. X lV . 117. a. Rente foncière ou cens. II. 817.
a , b. Rente foncière dite rente première. X lV . 118. a. Rente
foncière-j dite rente propriétaire. Ibid. Serf foncier. X V . 83.
b. Sejgneurjrès-foncier. XVI. 396. b.
FONCTION, ( Gram. ) différentes figuifications de ce mot.
£*ppl. III. 83. a.
y£NCT!ON. ( Algeb. ) Les anciens algébriftes ont appetlé
fonâiot.'s d’une quantité quelconque, les différentes puif-
fances de quantité. Aujourd hui on appelle fonélion de
x , une quantité algébrique compofée de tant de termes qu’on
voudra 6c dans lé*fijuelles x fc trouve d’une maniéré quelconque,
méléeou non, avec des confiantes. Tous les termes
d’une fonélion de x font oenfés avoir la même dimenfion.
Quand la fonélion n’eft ni fraélion ni radical, fa- dimen-
M m eft égalé à celle d’un de fes termes. Quand la fonct
io n eft une fraélion, la dimenfion eft égale à celle du numérateur,,
moins celle du dénominateur. Quand la fonélion
Cft radicale , fa dimenfion eft égale à celle de la quantité
qui eft fous le figne., divifée par l’expofant radical. Fonction
homogène, eft une. fonélion de deux ou plufieurs variables.
V il. 30. b. Fondions femblables, font celles dans
lëfquelles les variables 8c les conftantcsentrent de là mène
maniéré. Ibid, 31. a.
F o n c t io n , (Econom.anim.) aélion correfpondantc à la
deftination de 1 organe qui l'exécute. Les médecins entendent
par ce terme les actions q u i , 1 utre qu’elles font relatives
à la deftination des organes, font en même tems fen-
fibles. Fondions communes aux végétaux ; fondions propres
aux animaux : fondions faines 6c fondions léfées. Deux
opinions des médecins fur le principe de certaines fonc-.
»jons, comme des mouvemens du coeur, de la poitrine, Src.
.»II. 3 1 .a.
F O N
l’état de parfaite fanté. X IV . ¿28. b. L’c x e S e fd « '« S
nous vitales ne peut s’expliquer par l’ame. VI S S ®
X ll. 338. a. Dépravation des fondions naturelle t
8c animales. IV . 063. b. Flexibilité néceffaire à diffère *
parties pour l’exercice de leurs fondions. VI. 87? J p ‘
quoi la léfion d’un vifeeVe particulier entraîne la c ~ - h
des fondions vitales. X. 723. b. 724. a. Foyer
ANIMALE. XI. 360. a. — 366. b.
ceffarion
F o n c t io n s , ( Imprim. ) celles ducompofiteur, celles de«
ouvriers. V i l . 31. b.
FON0Dri C? T \ nifie,’ l$ laJPartie la Plus baffe d’un
tout. 2 . Profondeur. Prendre fond, couler à fond, donner
tond, un bon fond, un bas fond, (termes de Marine ) & c
2“. Fond fc prend pour le terrein , pour ce qui fert de b a t
VII. 5 1 .* . f .F o n d led it pour propriété; 5«. d'une fourme
d argent au ou amafle & qu on défline i ceriains ulàecs •
«”• H fe oit des chofes fpirituciles, un fonds d'efprii {■c
Diftinçtion qu’établit Vaugelas entre fond Si fonds fa’ifant
venir le premier de firndnm , Si le fécond de fundut. Cita-
non de divers auteurs par rapport à cette diltinflion. Ibid
51. et.
F o n d . ( Jurifp. ) Fond oppofé à la forme, fe dit de la
fubltance d un a f le , ou ce qui fait le vrai fujet d'une con-
teftation. VII. 32. a.
Fond. Deftruélion de la forme 8c du fond. VIL 178. a.
Fonds, biens, Fond eft pris fouvenr pour héritage tout
nud. VII. 32. b.
Fonds , très-fonds. XVI. 396 b.
Fonds de terre, propriéré*tTune portion de terre, ou redevance
qui la repréfente. VII. 32. b.
Fonds d otal, immeuble réel que la femme s’eft conftitué
en dot. VII. 32. b.
Fonds perdu : donner un héritage à fonds perdu. Edit du
mois d’août 1661, fur ce fujet. VIL 32. b.
F o n d . ( Marine) Fond de fable , de v a fe , 6>c. bon fond,
mauvais fond. V II. 52. b.
Fond de c a le , différentes divifions de cette partie du vaif-
feau. VII.. 32. b.
F on d de voile. VII. 3 a. b.
Fond de la hune. V II. 33. a.
F o n d , ( Comm. ) capital. Il fignifie anilx toutes les mai-
chandifes d’un marchand. VII. 33. a.
F o n d , ( Peint. ) fignifie ou les derniers plans d’une com-
pofition, ou le champ qui entoure un objet peint. Attention
que’ les artiftes devraient faire à la couleur fur laquelle
ils commencent à ébaucher leurs ouvrages. Exemples de
Rubens à imiter. Confeil de l’auteur fur l’apprêt, qui fait
le principal fond général du tableau. Du champ particulier
fur lequel fe trouvent les objets que renferme le tableau.
VII. 53. a. Variétés fondées fur la nature, qui prêtent leur
fecours ail peintre , lorfqu’il veut chercher dans les oppo-
fitions des reffources pour l’harmonie. Réflexions fur cè
qu’on appelle fonds, lorfou’on entend par-là les derniers
plans d’une compofition. Fond vague, agréable, piquant,
frais, chaud , pittorefque ; fonds riches i tableaux dont le
fond doit avoir de la fimplicité, de l’auftérité. Ibid. b. Voy*l
F a b r iq u e .
F o n d , ( Archit. ) VII. 34. a.
Fond d'ornemens. VII. 3 4- ° . - , <• _
F o n d , (B a tteu rd ’o r ) liqueur. Sa compofition * »on
ufage. VII. 34. a.
F o n d , ( B ijou tier ) V IL 34. a.
F o n d , ( Blondier) VII. 34. a.
F o n d , ( Cirel.% VII. 34. a.
F o n d , ( Jardin. ) VII. 5 4 . a.
F o n d , ( March. dé modés ) VII. 3 4 . a.
F o n d , (P la n eu r ) V I I .34. a.
Fond d ’or ou d'argent. Etoffe de foie en or ou a g
diverfes fortes de ces étoffes. Comment elles fc font. j g |
’ 4 F ü n d , (R u b un .) chaîne de la j É ÿ W P M * ; “ rPs
de cette forte d’ouvrage : gros fond S i fin fond. VU. (4.
F o n d , f a u x , ( Serrur.) VII. 34. b.
FO N D AM EN T A L , {M u ß , . ) 'V I L 54-i- ,
Fondamental, f o n , un fon rendu par un corps n
unique de fa nature. Autres fons qui l’accompagnen .
expérience eft fur-tout fenfible fur les grofles c Qn
violoncelle. Ouvrage à confulter fur cette exp cjavecin>
peut la faire aufli for une des baffes cordes A ^ naturC
Ce qu’on entend par fon fondamental donne F j u ja
dans la réfonnancc d’un corps fonore. On y n .
nomination de fon fondamental à divers an jtacc0rd
54. b. Origine de l’accord parfait majeuir, jeur, fq«
parfait mineur. Dans tout accord .¡»rta1 » . majcure eu
mineur, forme d’un fon principal, <*e .mineure,
F O N F O N 757
mineure , 8c de fa quinte ; on appelle fondamental le fon
principal, qui eft le plus grave de l’accord.' Explications
que quelques phyficiens ont données du phénomène de la
réfonnance de la douzième 8c de la dix-feptieme majeure
conjointement. avec l’oâavç. Celle de M. Daniel Bçrnoullb
Ibid. 55. a. Cette théorie attaquée par l’auteur , 8c trouvée
infuflifante pour expliquer le phénomène dont il s’agit.
Ibid. b. Explication donnée par d’autres auteurs, mais démontrée
fauffe. Ibid. 36. a , b. Outre l’accord de la douzième
8c de la dix-feptieme majeure donné par la nature, on a
formé d’autres accords principaux, auxquels on a donné le
nom de fondamentaux, parce que tous les autres accords
eu dérivent ; 8c on a appelle l’on fondamental le fon le
plus grave de l’accord. Ibid. 37. a. Voye£ ACCORD , B asse-
continue , Renversement.
Fondamentaux, accords, il y en a trois fortes ; l’accord
parfait., l’accord d e fixte& l’accord de fepticme. VII. 37.a.
L ’accord parfait eft de deux fortes, majeur ou mineur.
L ’accord de Jixte eft de trois fortes.. Les deux premiers
s’appellent accords de fix te ajoutée, 8c ne différent que par
leur tierce : le troificnie s’appelle accord de fix te fuperfiue ,
ou de fix te italienne : il parait très-difficile de déterminer
d’une façon bien nette l’origine de ce dernier. VII. 37. a.
Accords de feptieme ; cinq fortes d’accords de ce genre.
Détails fur ce fujet. VII. 37. b.
Fondamental. ( Mufiq. ) Marque diftinâive d’un, accord
fondamental. Suppl. III. 83.b,
Bajfe fondamentale. Elle ne renferme que les accords fondamentaux
, qui font ail nombre de dix : voye[ Basse. Ouvrage
à confulter. Obfervations fur la réglé que fe font im-
pofee les muficiens en fe bornant aux dix accords dont on
vient de parier. VII, 38. b. Autres accords qu’on pourrait
faire entrer dans la baffe fondamentale. La baffe continue n’eft
proprement que le renverfement de la baffe fondamentale ,
8ccontient beaucoup d’autres accords, tous dérivés des fondamentaux.
Ibid. 39, a. On doit rejetter ce principe, que la
baffe continue ou l'accompagnement repréfente le corps
fonore, 8c regarder au moins comme douteufes les réglés
qu’on appuierait fur ce feul fondement. Examen de la quef-
tion, fi la mélodie eft fuggérée par l’harmonie. Ibid. b. i°.
L ’cxpreflion de la mélodie dépend en grande partie de l'harmonie
qui y eft jointe, 8c un même chant nous affeétera
différemment, fuivant la différence des baffes qu’on y adaptera.
2°:. Il paraît que le chant diatonique de la gamme nous
cftfuggéré par la baffe fondamentale. Coniparaifon de la gamme
des (jrccsavec la nôtre. Ibid. 60. a. 3". Dans tout autre chant
que celui de la gamme, on pourrait être moins porté à croire
qu’il foit fuggére par la baffe fondamentale : cependant il faut
obferver que dans la mélodie, il y a des intervalles par lefi
quels on ne peut aller, ce font ceux qu’une bonne baffe fondamentale
proferit ; qu’il fuffit d’avoir de l’oreille pour trouver
fans préparation la baffe d’un chant, preuve que le fondement
de ce chant eft dans la baffe ; que s’il n’y a qu’une
bonne baffe du çhant, on peut penfer que cette baffe eft la
baffe fondamentale qui a fuggére le chant. Ibid. b. Qucftion
propofée, favoir fi un chaàt eft fufccptible de plufieurs baffes
également bonnes. Sentiment de l'auteur en faveur de la nés
gative. Autre queftion, pourquoi la foule bonne baffe , la
fondamentale, échappe fouvent à tant de muficiens. La question
fur la multiplicité des baffes, n’eft pas décidée par ce
qu’a dit Rameau , que le chant fo l ut , peut avoir vingt
baffes fondamentales différentes. Autres queftions fur la baffe
fondamentale, propofées aux artiftes, Il n’y a point de bonne
mélodie, lorfqu’elle n’eft pas fufceptiblc d’unç harmonie régulière.
Mapiere de compofer de Geminiani. Maxime de Rameau
; une baffe bien chantante annonce une belle mufique,
Ibid. C i . a. Doit-on préférer l’effet de l’harmonie dans une
compofition à celui de la mélodie ? Examen de cette queftioij.
Unité de mélodie qui confifte dans une baffe 8c un chant bien
adaptés l’un à l’autre. Les différens fons doivent s’incorporer
tellement avec le chant, que l’oreille en fente j’effet, fans
être pour cela diftraitç du chant. L’harmonie fert à nourrir
le chant, mais il ne s’enfuit pas que tout l’agrément de ce
chant foit dans l’harmonie. Ibid. b. Quelques perfonnes ayant
avancé que la géométrie eft fondée fur la réfonnance du corps
fonore, parce que cette fcicnce e ft, dit-on, fondée fur les proportions
, 8c que le eprps fonore les engendre toutes ; l'auteur
obferve à ce fujet que la considération des proportions 8c
des progreftions eft entièrement inutile à la théorie de l’art
mufical. Obfcrvation fur ces muficiens qui emaffent dans leurs
écrits chiffrps fur chiffres, 8c croient tout cet appareil néceffaire
à l’art. Autre réflexion. Les explications 6ç les raifop-
nemens phyfiques ne font pas plus utjles à la théorie de l’art
nftifical, ou plutôt le font encore moins que les calculs gé.o-
métriques. /è/d. 62. a. Détails fur une expérience »ntéreffante
de M. Tartini, qui a rapport à la baffe fondamentale. Ibid. b.
Cette expérience donne la baffe qui doit réfultçr de deux
deffus quelconques ; mais elle ne donne pas, du moins directement
, celle qu’il faut joindre à un deffus feul, Moyen ¿le
fonte I .
tirer parti de cette expérience pour la folution de ce dernie|:
problème. Obfervations de M. Serre, de Gençvc, fur Vçx-i
périence de Tartini. Ibid. 63. a.
Fondamentale, baffe : voyez ce dernier mot. Extrait d’un mémoire
de M. Romicu, par lequel on voit que cet auteur avoit
devancé M. Tartini, par rapport à l’expérience fur les fons bar?
moniques graves. VIII. 34. b. 33.a , b. Qucftion propofée au
mot Fondamental, 8c qui fe trouve réfoluc par M. Romicu,
35. b. Le fentiment 8c l’expérience de M. Tartini fur les fons
harmoniques graves , critiqués par cet auteur. Ibid. Marche
de baffe fondamentale, appelléc tranficion harmonique, chromatique
8c enharmonique. XVI. 3 34. b. Note fondamental;
félon M. Jamard. Suppl, IV. B66, a,
Fondamentale, loi. IX. 660. b. Vérité fondamentale. XVII,
71. a , b.
FONDAMENTAUX , articles , ( Thcolog. ) controverfe
entre les catholiques 8c les proteftans, fur Ta définition de$
articles fondamentaux. VII. 63. b. On pourrait appeller artii
des fondamentaux, les dogmes principaux de la doétrine
chrétienne, ceux qui tiennent plus fortement à tout l’édifice
de la religion. Cette définition établie, on v o it , 1 °. qu’il y
a dans la doârinc catholique des dogmes fondamentaux, crç
ce fens, qu'on eft obligé de les croire d’une foi explicite ,
8c d’autres qu’on peut ignorer fans danger pour le falut. 20,
La diftinéfion des articles fondamentaux 8c npn fondamentaux,
établie par les proteftans, n’eft pas recevable. Théologiens qui
ont parlé des articles fondamentaux dans ce même lens. Ce
qu’a dit fur ce fujet;M. Jurieu, en prouvant que les diverfes
églifes proteftantes ne font qu’une même églife univerfelle.
Le fentiment de Jurieu attaqué par Nicole. Ibid. 64. a. Obfervations
de l’auteur. Ibid, b.
FON D AN T de Rotrou , ( Chymie ) Defcription qu’en a
donnée M. Aftruc. En quoi elle différé de celle de M. Col
de Villars. VII. 64. b, Différens procédés indiqués par les
auteurs, pour la préparation de l’antimoine diaphorétique, '
Ibid. 63. a. Sels confondus enfemble auxquels on a donné
mal-à-propos le nom de nitre antimonié. Méthode que donne ,
M. Rouelle. Ibid. b. La méthode des chymiftcs qui projettent
l’antimoine çrud , doit être proferite. Ibid, 66. a. Clyffus
fimple d’antimoine ; clyffus compofé. Doélrine de Lemcry
fur la maniéré de préparer l’antimoine diaphorétique. Ibid. b.
Premier auteur qui a traité des préparations antimoniales.
Diaphorétique minéral, ou poudre blanche d’antimoine : procédés
à fuivre pour cette préparation, félon Bafilc Valentin.
Obfervations de l’auteur fur le produit de tout ce travail.
Les anciens chymiftcs appeUoient cette préparation cérufe
d'antimoine. Ibid. a. Préparation de l’antimoine diaphorétique
félon le compilateur Libavius. Obfervations fur quelques
méthodes de Lémery„, Bocrhnave, Mendcr 8c Geoffroy,
dans leurs préparations de l’antimoine diaphorétique. On fait
cette préparation avec l’antimoine crud, toutes les fois qu’or)
traite ce demi-métal de maniéré qu’il foit converti en une
chaux abfolue, blanche 8c divifée. L’acide nitreux réduit l’antimoine
en chaux abfolue, fi on y fait diffoqdre ce demi-métal.
Ibid, b. Poudre fixe d’antimoine faite avec l’eau-fortc , félon
Çafile Valentin. L’eau régale produit le mépie phépomene.
Cérufe d ’antimoine : description de la maniéré de la prépa?
rer. Obfervations fur cette méthode. Ibid. 68. a. Autre méthode
qui eft à-peu-prés celle des anciens. Préparation de la cérufe
d’antimoine félon Libavius. Ibid. b. Autre maniéré de faire
la cérufe d’antimoine. Quelque méthode qu’on fuive, la chaux
abfolue d’antimoine clt toujours la même quant au fond.
Quelle elle doit être lorfqu’elle eft bieq faite. Comment on
reconnoît celle qui a été falfifiée avec de la craie, ou toute
autre terre abforbapte. Les édulcorations 8c dieeftiens ne fau-
roient augmenter ni changer fa vertu. Ibid. 69. a. Antimoinq
diaphorétique martjal, connu fous fo nom de fafran de mars „
antimoine de Stahl. La terre de l’antimbipe par fa fimple qua?
Jité de fubftance métallique, abfohimcnr privée du principe
inflammable, n’eft point 'émétique, Scntimens de Bocrhaave
8c de Mendcr fur ce fujet. Ibid. b. Développement du fentiment
de l’auteur fur la propriété de cette terre d’antimoine.
Il n’y a point de queftion qui ait été plus agitée, 8c fur laquelle
les fentimens foient plus partagés, que fqr l’cméticité di)
régule, combiné avec |c$ acides végétaux 8c minéraux. Pétailè
fur cè fujet. Ibid. 70. a. Obfervation fur l’antimoine diaphorétique
, qui devient émétique. parce qu’il fe trouve uni
à la çrême de tartre, ou au fyrop de limon. L’antimoine diar
phorétique le mieux fait receje encore quelques pafticulcç
régulières, qui ont échappé à l’embrafement.
Antimoine diaphorétique. Oi) entend également fous ce non)
l’antimpine diaphorétique 8c la cérufe a’àntimoine. Obfervation
fur la coutume dans les boutiques 7 de garder cette pré?
paration fous la forme de trochiques. Poudres dans lesquelles
on emploie cette préparation. Elle ne .devient point ¿piétiqué
çn vieilli liant. Ibid. 71. a.
Fondant de Rotrou, remarque à ajouter à ctet ard flc, four?
nie par l’auteur, VIII. 1023. a , b.
F o n d a n t , (M ita ll. Vfubftance qu’on joint à d'autres corps