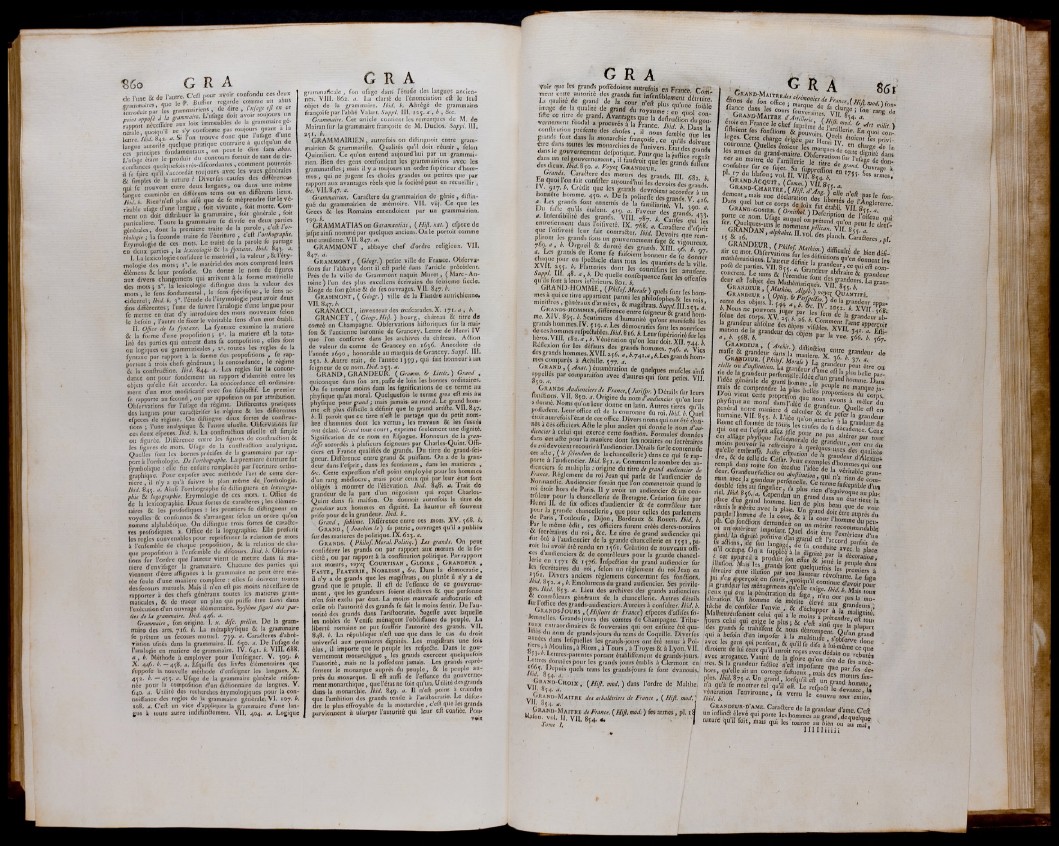
’SGo G R A G R A
I I . . « , An P liu re . C 'c il pour «voir confondu ces deux
d e 1 une oc * ' ,p ütijlicr regarde comme un «bu»
OE S g 'n m m e S » , d é d ir e , t ' # f f l - «
“ S | U ïam m a in . L’ufage don avoir toujours un
n p p o n ncccffalre aux loix immuable» de la grammaire gé-
mírale quoiqu'il ne s’y conforme pas toujours quant 4 la
lotirc ’/¿i/. 8-t». «.SI fon trouve donc que l ufcgc dune,
langue autorife quelque pratique contraire a quefou un de
ce» principe» fondamentaux, on peut le dire fan. «fer.
f ’ufava ¿tant le produit du concours fortuit de tant de cir-
confiances quelquefois trè*-difcordantcs » comment pourroit-
il fc faire qu’il s’accordât toujours avec les yucs génôralcs
8c finipics de la nature i Divcrfe» caufcs des différence«
nui fc trouvent entre deux langues, ou dans une même
laneuc examinée en différons teins ou en différons lieux.
Jbtd b. Rien'n’eft plus aifé que de fc méprendre fur le v é ritable
ufage d’une langue, foit vivante , foit morte. Corn-
nient on doit diftribucr la grammaire, foit générale , loit
particulière. T oute la grammaire fc divife en deux parties
générales, dont la première traite de la parole, c cft l or-
tholorn : la féconde traite de l’écriture , cÆ l orthographe.
Etymologie de ces mots. Le traité de la paro c fc partage
en deux parties , la lexicologie 8c la fynta xe. Ibid. »43;
i . La lexicologie confidcre Te matériel, la valeur , ot 1 é ty mologie
des mots; i \ le matériel des mots comprend leurs
élémens 8c leur profodic. O n donne le nom de figure*
aux divers changemcns qui arrivent Ji la forme matérielle
de* mots ; %\ la lexicologie diftinguc dans la valeur des
mots le fens fondamental, le fens fpécinquc, le fens accidentel
; ibid. b. f . l’étude de l’étymologie peut avoir deux
Üns différentes ; l'une de fuivre l’analogie d une langue pour
f c mettre en état d’y introduire des mots nouveaux félon
le befoifl l’autre de fixer le véritable fens d’un mot établi.
II. Office de la fynta xe. La fyntaxe examine la matière
& la forme d’une propofition ; i" . la matière eft la totalité
des parties qui entrent dans fa compofition, elles font
ou logiques ou grammaticales , a", routes les regles de la
fyntaxe par rapport <t la forme des propqfitions , fc rapportent
«i trois chefs généraux ; la concordance, le régime
8c la conftru&ion. Ibid. 844. a. Le# règles^ fur la concordance
ont pour fondement un rapport d identité entre les
objets qu’elle fait accorder. La concordance cft ordinaire-
ment dun mot modificatlf avec Ion fubjcélif. Le premier
le rapporte au fécond, ou par appofuion ou par attribution.
Obfervation» fur l’ufage du régime. Différente» pratique» |
de» langue» pour caraétérifer le régime 8c le» différente»
efpccc» de régime. On diftinguc deux forte» de conftruc-
tion» ; l’une analytique 8c l’autre ufucllc. Obfervation» fur
ce» deux cfpcce». Ibid. b. La conftruflion ufuelle cft ftmple
ou figurée. Différence entre les figure» de conflruéilon 8c
les figure» de mon. Ufage de la conflritélion analytique.
Quelle» font le» borne» préclfe» de la grammaire par rap-'
port 1 l’orrhologic. D e lorlhographc. La première écriture fut
fymboliqtie : elle fur enfuite remplacée par l’écriture orthographique.
Pour expofer avec méthode 1 art de cette dernière
il n’y a qii’é fuivre le plan même de l’ortltologlc.
Ibid. iif.ji a. Ainfi l’orthographe fe diftlngttcra en lexicopra-
p/ùe 6c logographie. Etymologie de ces mot*, i. Office de
de la lexicographie. Deux forte» de caraétcre» ; le» clémcn- .
rairc» 8c le» profodique» : le» premier» fe diftingnenr en
voyelle» 8c confonne» 8c »’arrangent félon un ordre qu on
nomme alphabétique. On diftinguc trois forte» de caraélc-
re# profoaiqtics. ». Office de 1» logographie. Elle prefcrit
le» règles convenables pour repréfemer la relation de mots
k l’cnTcmblc de chaque propofition, 8c la relation-de chaque
propofition li l’enfcmblc du difeour*. Ibid. b. Observations
fur l’ordre que l’auteur vient de mettre dans fa maniere
d’envifager la grammaire. Chacune des parties qui
viennent d’étre affignées k la grammaire ne peut être traitée
feule d’une maniere complete : elles fc^ doivent toutes
des fccours mutuels. Mai» il n’en cft pas moins néccfïairc de
rapporter k des chefs généraux toutes les matières jgram-
maticalcs, 8c de tracer un plan qui puiffe être fuivi dans
l’exécution d’un ouvrage élémentaire. Syjlérne figuré des parties
de la grammaire. Ibid. 446. a . Pi 1
Grammaire, fon origíne. 1. x . dife. prélim. D e la grammaire
des arts. 7 1 6. b. La métaphyfique 6c la grammaire
fc prêtent un fccours mutuel. 739* a- Caraélcre* d’abréviation
ufités dans la grammaire. II. 650. a. D e rujage do
l’analogie en matière de grammaire. IV .6 4 1 . b. V I I I . 088.
a , b. Méthode à employer pour l'cnfcigncr. V . 309. b.
X . 446. b. — 458. a. Efquiffe des livres élémentaires que
ftippofc la nouvelle méthode d'enfeigner les langues. X.
4<». b. — 455. a. Üfage de la grammaire générale rationnée
pour la compofition d'un diélionnairc de langues. V .
640, a. Utilité des recherche* étymologique* pour la con-
noiffancc des regles de la grammaire générale. V I . 107. b,
108. a. C c f t un v ice d'appliquer la grammaire d'une langue
k toute autre íiidíftínélcmem. V U . 404. a . Logique
grammaticale, fon ufage dans l'étude des langues anciennes
. VIII. 86». a. La clarté du l’énonciation cft le fc'ul
objet de la grammaire. Ibid. b. Abrégé de grammaire»
françoifepar l’abbé Valart. SuppL III. ta ç . //, b , 0cc.
Grammaire. C e t article contient les remarque* de M. de
Mairan fur la grammaire françoife de M. Duclo». Suppl, III.
» 5 1 . b.
G R AM M A IR IE N , autrefois on diftinguoit entre grammairien
8c grammatifte. Qualités qu’il doit réunir , félon
Quintilicn. C e qu’on entend aujourd’hui par un grammairien.
Bien des gens confondent le» grammairien» avec les
grammatifte» ; mais il v a toujours un ordre fupéricur d’hommes
, qui ne jugent les choies grandes ou petite» que par
rapport aux avantage» réels que la fociété peut en recueillir,
V II. 847. <*.
Grammairien. Caraélcre du grammairien de g én ie , diftin-
gué du grammairien de mémoire. V I I . viij. C e que les
Grecs 8c les Romains entendoient par un grammairien.
599, b. ' % . g
G R AM M A T IA S ou Garamantias, ( H ijl. nat. ) cfpcce de
jafpe ainfi nommé par quelques ancien». On le portoit comme
une amulette. V i l . 847. a.
G R AM M O N T , abbaye ch e f d’ordre religieux. V I I .
847. a.
G r a m m o n t , (G lo g r .) petite ville de France. Obfcrva-
tions fur l’abbaye dont il cft parlé dans l’article précédent.
Près de la v ille de Grammont naquit M u re t, ÇM a rc -A n toine)
l’un des plu» excellons écrivain* du fcizicmc ficcle.
Eloge de fon génie 8c de fc* ouvrages. V U . 847. b.
G r a m m o n t , ( Géogr,. ) v ille de la Flandre autrichienne.
V II. 847. é.
G R A N A C C I , inventeur des mafearades. X . t y i . a , b.
G R A N C E Y , ( G io g r .H ifl. ) b ou rg , château 8c titre de
comté en Champagne. Obfervation» hiftoriques fur la mai-
fon 8c l’ancienne baronnie de Grancey. Lettre de Henri IV
que l’on cortfcrve dans les archives du château. A ilion
de valeur du comte de Grancey en 1636. Anecdote do
l'année 16 9 0 , honorable au marquis de Grancey. Suppl. III.
»3». b. Autre tra it, de l’année 135,9, qui fait honneur à tm
feigneur de ce nom. Ibid. »53. a.
G R A N D , G R AN D EU R . ( Gramm. & L itlir») Grand ,
quiconque dans fon art,paffe de loin les bornes ordinaires.
On fe trompe moins dans les lignifications de ce terme au
phyfique qu au moral. Quelquefois le terme gros eft mis âu
phyfique pour grand j mais jamais» au moral. L e grand homme
cft plus difficile k définir que le grand artifte. V I I . 847.
b. Il paroit que c e titre n’eft le partage que du petit nombre
d’hommes dont les v e r tu s , les travaux 8c les fuccês
ont éclaté. Grand tout co u r t , exprime feulement une dignité.
Signification de ce nom en Efjiagoc. Honneur» de la pran-
dcjjc accordé» k pluficur» feigneurs par Charlcs-Quint. Officiers
en France qualifiés de grands. D u titre de grand-fei-
gneur. Différence entre grand 8c puiffant. On a de la grandeur
dans l’e fprit, dans les fentimen*, dans les manières „
6>c. Cette expreflion n’eft point employée pour les hommes
d’un rang médiocre, mai» pour ceux qui par leur état font
obligés à montrer de l’élévation. Ibid. 848. a. Trait do
grandeur de la part d’un négociant qui reçut Charlcs-
Qu int dans fa maifon. On donnoit autrefois le titre do
grandeur aux hommes en dignité. La hauteur eft fouvent-
prife pour de la grandeur. Ibid. b..
Grand 9 /M m e . Différence entre ces mots. X V . 568. h.
G r a n d , ( Joaehim le ) fa pa trie, ouvrages qu’il a publié»
fur des matières de politique. IX. 6%3. a.
G r a n d s . ( P h i lof. Moral. Politiq . ) L e s grands. On peut
confidérer les grands ou par rapport aux moeurs de la fociété
, ou par rapport k la conftitution politique. Par rapport
aux moeurs, voye[ C o ü r t i s a n , G l o ir k , G r a n d ï ü r *
F a s t e , F l a t e r i e , N o b l e s s e , & c . Dans la démocratie,
il n’y a de grands que les magiftrats, ou plutôt il n’y a de
grand que le peuple. Il cft de l’cffcncc de ce gouvernement
, que les grandeurs foient éleflives 8c que perfonne
n’en foit exclu par état. La moins mauvaife ariftocratic eft:
celle ob l’autorité des grands fe fait le moins femir. D e l’autorité
des grand* dans l’ariftocratic. Sageffe avec laquelle
les nobles de Vcnifc ménagent l’obéiffancc du peuple. La
liberté romaine ne put fouffrir l’autorité des grands. V I I .
848. b. La république n’eft une que dans le cas du droit
iiniverfel aux premières dignité». Le* magiftrats une foi»
élus , il importe que le peuple les rcfpcéle. Dans le gouvernement
monarchique , les grands exercent quelquefois
l’autorité, mais ne Ja poffedent jamais. Les grand» repré-
fentent le monarque auprès du peu ple, 8c le peuple auprès
du monarque. Il eft auffi de rcfience du gouvernement
monarchique, que l’état ne foit qu’un. Utilité de» grands
dans-la monarchie. Ibid. 849. a. Il n’eft point «1 craindre
que l’ambition des grands tende ?t l’ariftocratio. Le déforme
le plu» effroyable de la monarchie, c’cft que les grands
parviennent à ufurper l’autorité qui leur eit confiée. Pou*
v o it
G R A
y o ir que les grand, poffédolem autrefois en F rm e t C n n ,
¡.nage de la nu allii de grand du royaume : en T o i con°
fine ce titre de grand. A v a n ta g e u j a Â. * . con
vernemenr féodal a procuré» é la I ran e c e °,11'
confilrufiou préfenre d e . ch ofe, , n s l l I f P
grand» font dan. la monarchie francolfc , ce T » S i
éirc dan» toutes le» monarchies de l'univers EnV L T ?
dan» le gouvernement defpotlque. Pour que'la S f l ! « 8 * î
dan, un tel gouvernement. Il L d T t q u e T e e » " T r T Î
de» dieu*. ¡ S i i . 850. a . V „ y \ G u a n d e u b 8 f,,if<:nl:
(yrands. Caraélcre de» moeurs des grand» III d» , 1
IV s .V f auiûtlrcl’hiii le» devoir, de» grand»
, ■ V 7 ' f : ï ue les grand» devroicnr accorder i un
honnête homme. 4 ,0 . „ . D e la poü.cffc de» grandi V a fi
n , U r i F ' ln< V / ' icnncm‘s 1 la D u fane qu'ils étalent, a i i j . a. Fafvameuilri arditeé.. V I . sôo .
a. Infcnfdfilité des grantls. VIII vK-r / r / ,‘111-
entretiennent dan. S v c l l x !
que l'oifiveté leur fait eontraéler. Ibid. rempliront
les grand» o u i un gouvernement fage & vigoureux
7 f i9 .1 t , b. Orgueil tk dureté de» grand» X III o l * T
a. L e , grand, de Rome fc faifo ieit honne îr de T d o Æ
! » «n f tc â a ç le dan» tou, le» quartier, de la v i l e
W l i t À ' . T » ” S i S P ? “ «®n s le , amufent.
bupvl. AU. 48. a yb D e quelle confétiucncc font les «ffen f^
qu ils font k leurs inférieurs. 801 b « » " « o i t e n K i
G R A N D -H O M M E ( P U h f .M o r a l . ) q „ c |, font |cshoffl.
m e . i qui ce titre appartient parmi le , ph1lofophei& le, Æ
miniftres, généraux d’armée», & m a g i r t r a t » . S . l l * / , /
GKANDs.HOMHES.différeneeentrlfelgnimÆgrandhom:
T ' i l é. Scniimcn» d'humanité qu’ont manifeilé le»
grand» homme».IV, t in a .Le» démocratie» font le»nonrrlco,
h to “ VH I v f W Leur fupérionté f „ r i
Réflexion fur l e , défaut,‘'d c ,11' ^ K o m m a 7 ^ " * ^
' , „ S { Î S | (^ « "O i iium é r a t io n de quelque» mufde» ainfi
appcllé» par comparaifon avec d autres qui font petit*. V II.
) Détail, fur leur,
l ,ù / h 8t,0, 0 r l? ,n'd u nom d auditneier qu’on leur
i S p Noms qu on leur donne en latin. Autre» titre» qu'il»
p détient. Leur office cft de ta couronne du roi. Ibid. b. O u c l
ctoit.autrefois! état de cet office. D ivers nom» qui ont été don-
né» a c e , officier,. A i le le plu, ancien qui donne le nom d'au-
du n e ,.r h celui qui exerce cette fonéüon. Formule» donnée,
flans cet acte pour la manière dont les notaires ou fccrétaircs
(lu roidévoient recourir* raudicncicr. Détails furie contenu de
cet ac te, ( le fdiendum de la chancellerie) dans ce qui f c rappor
te k 1 audicncier. I b id .S e t .a . Comment le nombre des au-
dicncicr* fe multiplia ; origine du titre de grand audieneier de
t rance. Règlement du roi Jean qui parle de l’audicncicr de
Normandie. Audicncier forain que l’on commcttoit quand le
G R A 8 f i t
' G r a KO-Ma iTReA , a •
fé in cT f H 0flicci
GGibiaanÎoÏ ’Mm Ia“i t rSe m Çg'W/ Æmin mc» &VÆI I II ITI “■n S •<«
¿toit en France le chef fiiprêm^ mllii. )
fiftoientre, fonflion, & LuZk, o a T ' En S
foge». Cette charge érigée par Henri i v cn t *M Pr iv>-
couronne. Quelle,6 é,olc,„ le , marmi T ’ cn
le» arme» tÏÏi gtand-maitrc. Obfervation, <la"J
ner au maître de l’artillerie le S e dè t ' «k don-
confulter fur ce fujer. Sa fimi.rc/fio„ V - * 9 uvrV i
p l .17 du blafon; vol. II. V l f s< o k 7i5 ' Scs arme»,
G ra n d -A c q u it , (C om , ) v ï ï t e „
.l_L’ RA«D-CHAUTn,E, (////?. T c lfo n’ntl n r r
r-ü an s o-quel mal,but
Sâsgssiftffe: une déclaration do,Ybcrté, d f l ' T ° fon' G r a n d -g o
porte ce nom.
nir c c mq®O b fo rV L fo n Ì Ìù ^ T d t ì^ “ '''^ dc Wcn défi-
mathématiden». L ’auteur définit la « S * ®" 1 donnc”t
pofé de partie». V II. 8<e „ G i , . l î î >cc |U! eft coni-
concrete. Le tem» & f’L n T c fonfd« “ * ra"dcur
dcu rc ftl objet de» Mathématique»
G r a n d e u r , (M a t /u S v
G r a n d e u r , (Ornlq. % •pirÈa^-0 , SUA!'T,TÎ-
,J" ‘e de» objet». 1. 544. a , b / l c I V 8™"dcnr appa.
é. Nou» ne pouvon» juger par fc» fo’„ , P ’i V l , ‘
follie de» corn,. XV . a i fi,Pî6 Ï » f f e “ e la grandeur ah-
la grandeur atfolue de, objets^'vifèfcT' X V 1 1 “™ W & M
É l i ! » d« objet» par fc ^iJÎ" & J f e
- uu ivi svun parie uc lauaicncier de
!c
roi croit hors de Paris. Il y avoit un audieneier 6c un contrôleur
pour la chancellerie dc Bretagne. Création faite par
Henri II. dc fix offices d’audiencicr 8c dc contrôleur tant
pour la grande chancellerie, que pour celles des parlcmcns
fle I a n s , F o iilo u fc , D ijo n , Bordeaux 8c Rouen. Ibid. b.
Far le môme é d it , ces officiers furent créés clcrcs-notaircs
/ feerétaires du roi > 8cc. Le titre dc grand audicncier qui
«ut oté k l’audicncier de la grande chancellerie en i ç ç t ,pa-
«oit lui avoir été rendu en 1561. Création dc nouveaux offices
d audicncicrs 8c dc contrôleurs pour la grande chanccl-
jerie en t^ y x Sc 1376. ïnfpcélipn du grand audicncier fur
le» fccrétaircs du r o i , félon un règlement du roi Jcap en
/ r / o rs anc,cns «églcmcns concernant fes fondions.
ibid. 2 . a , 1, Emolumensdu grand audicncier. Scs privilc-
gcs. Ibid, 853. a. Lieu des archives des grands audicncier*
« contrôleurs généraux dc la chancellerie, Autres détails
•un office des grands-audiencicrs. Auteurs à con(u\tcr. Ibid. b.
G r a n d s J o u r s , (H iflotr c de France) cfpcccs d’afiifes fo-
cuinclrei/. Grands-jours des comtes dc Champagne. Tribu-
yj.‘!x cxtraqrdinairé» 8c fouverains qui ont enfuite été qua-
11 ? «u nom dc grands-jours du teins de Coquille. Divcrfcs
née» tlsins Icfquclles les grands-jours ont été tenus k Poi-
er s» a M oulins,â R iom ,f iT o u r s , k T r v y e$ 6 c k L y on .V I I .
J } ‘ b. Lcttrcs-patentcs portant établiflemeut dc grands-jours.
•«res d o n n é e^ 0^ les grands jours établis k Clcrmont cm
//¿d ‘ 8 11,19 tcmÿ ^CS griin(W 0l,rs fc font évanouis.
G r a n d -C h o ïx , ( / / i f . m o d .) dans l ’ordre dc Malthc,
• 0 5 4. a.
G r a n d -M a î t r e des arbalétriers de France , ( H ifl. mod.1
854- a. j
G r a n d -M a î t r e de France. CHifl.mod. ) fes armes, pl. xq
«mon. vol. II. V II, 854. * ^ • I
Tome It •
maffe « f f e l t t ' Ù mtn i"oe °X d e
Uc do fc grandeur p c r fc n S fc ld -r ''’' Cft « H É p ”“
Hdéo générale de
mais de comprendre 1« plus îwi fe ÇCI,P|C !K manque m-
Dou vient cette propei/£n que H o f f l S S du CorP»*
phyfique au moral dansl’idée de eraLl- rv m4lor «■“
général noire maniere di calculer & ,1 'r ^ l l4llc eft cn
humaine. V II. 8 5 5 . » S i i „ ““ pefcrla grandeur
Rome eft formée dc loin, fc caufe» de fc Jée“ f “ ndci'r dc
qui oui eu l’efnrit affex jifte „„„l ì . lj “«adcnce. Ceux
coi alliage phyllque l’idédmniale de J w A par ,0" r
moin» pouvoir la refirclntc b ni J r ’ om c n ' é t
qu’elle'embraffe. W H
dre, & do celle de Céfcr5eux T c ,nT f ,N ,rd ^ ,™ '’c
rempli dan, loatc fon é,orino S T d f f c ont
deur. Grandeur faélice ou oinKtuüan „f,i .vdr.“ablc I f l
mun avec la gmndeur p e r lm cU e c l T "? r Cn dc co ">-
doubld foi, au fing„liePr , 1 d'un
riti, ib id 8 .6 . % Cencndan un „ 1 , i[P "V0ilue au pluplace
d'un grand homme. lien 5c p h T b i '" 1 !'ent h
ràim» le m&'ie avec fc plaie. Un £ , ? 1 “ ! ‘Iuc de voir,
pçuplc lliomme dc fc cour, & ft f : S a p É ' 5? auN » d t i
pk. Ces fonéfion» demandeit ou un mérite î - d l ,Pc " -
01 un extérieur impofant. Duel doit é B S!t0” Iinan<wbld
Rfind, La dignité pofitivc d’an grand e ftl ü CX!éricui' d’un
ft» aélioh», tic fon l a n g a g T | . fc ‘ „ T ccord ® do
ri'Il occupe. On a fupSlH à la Î L T " ,!,vec la Ph c °
f cet appareil a produit ton 'effet tv *;Pai 1 décoration,
illufion. Mais le» grandi font tmefon r , P°uple dan»
¿fruire cette ill„fi„g„ f B g g 5 premier, |
lut SCO spperçoit en fo u rh t quoiqu'il continue W1» ' S fi0
k grandeur le, ménagemen» qu’elle exige Û fd Î m '- 'P° ' ’ r
ceux qu! ont fc.pénétratlon du f ig e , 8'cn T , 1 '*
(¡¿ration. U n homme de mérite ¿lev/- 1 ? mo"
dche de confolcr l’envie , & d’é c t p l , “ i* 1 g™ ÎC":*P
Malhcureufcment celui qui a le moin,^b p r i te n d r e ^ " .
jours celui qui exige le plus; 8c c’eft ainfi ane l i
1des grands fc trahiffcnt 8c nous détromnîn/1 A » P,uPart
qui a befoin d’en impof.r
avec le» gens.qu. penfent, & qu’il fe dife J hitmême „ S
dtroicnt de lui ceux qu’il aurolt reçus avec d é d a ln T Î q ,8
avec arrogance. Vanné dc fc gloire qu’on tire dc T T '
■rc». Si la grandeur faélice n’eft Impofante que par îe, ,|
hpr», qu’elle ait un cortcge faftucux , mai, l l r . r
pe». 1 d .8 7 1 a. V n grand, lorfqu’il cft“ „^S Z T * H
na qu i fe montrer tel qu’il eft. Le rcfpcfÆ ?l P i*P
vénération l’environne, fa vertu f c T , , t / ¿ y i ' ’ lu lc couvre tout entier.
Grandeur-D’ame. Caraélcre de fc grandeur d W r - . t i
n S t f e f f e x gl" p0rtC. *cs l,ommcs au grand, dc quelque naturi quii foit, mats qui les tourne au bien ou au mal iniIIÜU a