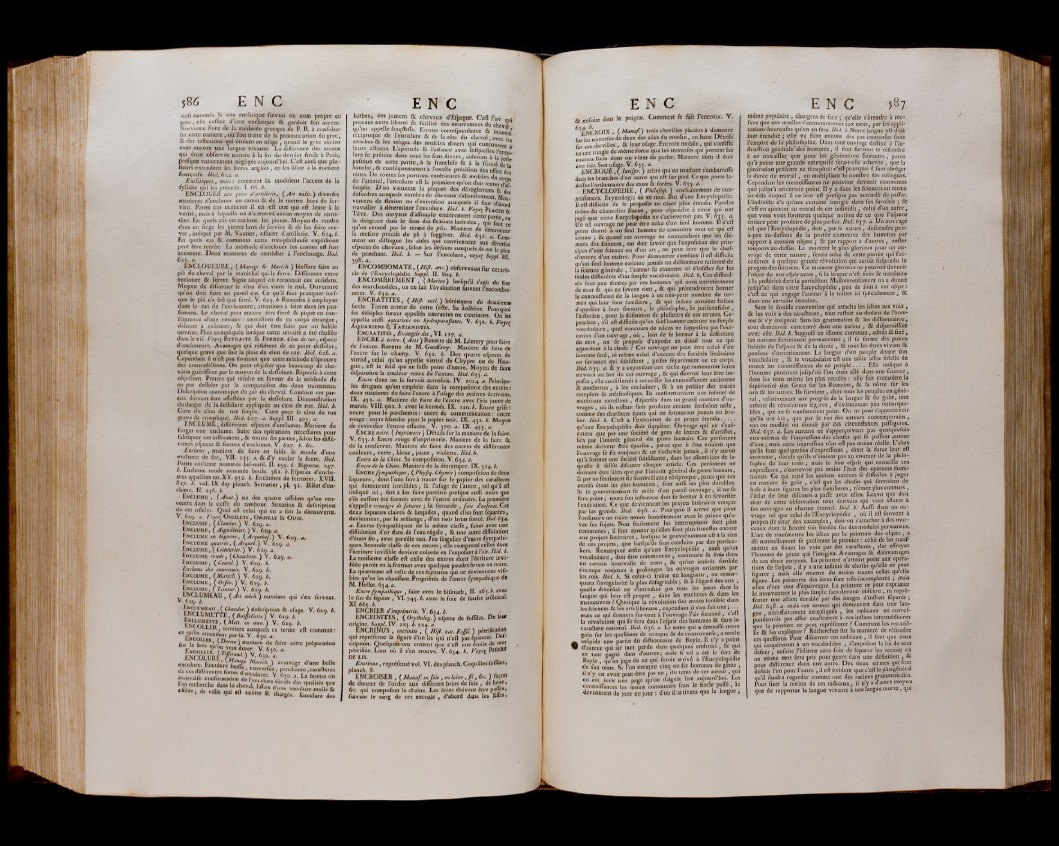
E N C E N C
ahifi nommés. Si une enclitique fui voit un nom propre en
grec, die ceffoir d’étre enclitique 8c gardoit fon accent.
Neuvième livre de la méthode grecque de P. R, à conftilter
fur cette matière, où l’on traite de la prononciation du grec,
8c des indexions qui étoient en ufage, quand le grec ancien
étqit encore une langue vivante. La différence de» accent
qui ¿toit obfcrvée encore à la fin du dernier fieele à Paris,
prefqoe entièrement négligée aujourd’hui, C’eft ainfi que plu-
licurs entendent les livres anglois, en les iifant à la maniere
françoife, Ibid, ¿24, a.
Enclitiquet, mots : comment ils modifient l'accent de la
fyllabe qui les précédé, I- 66. b,
ENCLOUER une pièce d'artillerie, [Art milit.) diverfes
manieres d'encloucr un canon & de le mettre hors de fer-
vice, Parmi ces manieres il en eft une qui eft lente à la
vérité, mais à laquelle on n’a trouvé aucun moyen de remédier,
En quels cas on eue loue les pièces. Moyen de rendre
dans un uege les pièces hors de fervice & de les faire crever,
indique par M, Vuutier, officier d'artillerie. V, 624. b.
En quels cas & comment cette trés-périlleufe expédition
peut être tentée. La méthode d’enclouer les canons eft fort
ancienne. Deux manieres de remédier à l’enclouage. Ibid.
CiK. a.
ENCLOUEURE, ( Manege 6 Maréch.) bleffiire faite au
pié du cheval par le maréchal qui le ferre. Différence entre
enclouer tic ferrer. Signe auquel oh reconnoit ces accidens.
Moyen de difeerner le clou d’où vient le mal. Ouverture
qu’on doit faire en pareil cas. Ce qu'il faut pratiquer lorf- 3ue le pié n'a été qué ferré, V, 625. b. Remedes â employer
ans le cas de l'encloueure ; attendons à faire dans les pan-
femens. Le cheval peut encore être ferré 6c piqué en con-
fêquence d’une retraite : extradion de ce corps étranger,
délicate à exécuter, 6c qui doit être faite par un habile
ouvrier. Plaie compliquée iorfque cette retraité a été cliaffée
dans le vif Voyt[ R e t r a i t e oc F e r r e r , Clou de rue, efpecc
d’encloueure. Avantages qui réfultent de ne point dcfïoler,
quelque grave que foit la plaie du clou de rue, Ibid. 616. a.
Cependant il n'eft pas douteux que cette méthode n'éprouve
des contradictions, On peut objeéter que beaucoup de chevaux
guériffenr par le moyen de la defiolurc, Réponfe k cette
ohjeélion. Preuve qui réfulte en faveur de la méthode de
ne pas deffoler par la comparaifon des deux traitemens.
Defcription anatomique du pié du cheval. Combien ces parces
doivent être affeétées par la deffolure. Démonstration
du danger de la deffolure appliquée au clou de rue, Ibid. b.
Cure du clou de rue fimple. Cure pour le clou de rue
grave 6c compliqué, Ibid. 027, a. Suppl. III, 405, a.
ENCLUMÉ, différentes efpeces d’enclumes. Maniere de
forger une enclume. Suite des opérations néceffaires pour
fabriquer cet infiniment, 6c toutes fes parties, félon les différentes
efpeces 6c formes d'enclumes, V. ¿27. b. (te.
Enclume , maniere de faire en fable le moule d’une
enclume de fer, VIL ih , a. 6c d’y couler la fonte. Ibid.
Petite enclume nommée hd-outij, II. 199, b. Bigorne. 247.
E Enclume ronde nommée boule. 361. E Efpeces d'enclumes
appellée* tas, XV. 93a. b. Enclumes de ferrurier. XVII.
027, E vol. IX dep plancli. Serrurier, pL <1. Billot d'enclume.
II, 216. b.
E n c lum e , ( A n a l,) un des quatre offelets qu’on rencontre
dans la caiffe ou tambour. Situation 6c aeferiprion
de cet ofleler. Quel eft celui qui en a fait la découverte.
V, 629, a. Voyez O s s e l e t s , O r e i l l e 6c O u ïe .
E n c lum e , ( Cloutier,) V, 6 2 9 .a.
E n c lum e , ( AiguilUtier,) V . 629, a.
ENCLUME en bigorne, ( Arquebuf.) V. 629, a.
ENCLUME quarrie, ( Arqueo. ) V , 629, a.
E n c lum e , ( Ceintuner, ) V. 6 2 9 ,4 ,
E n c lum e ronde, (Chaudron. ) V. 629. a.
E n c lum e . ( Coutel,) V, 629. E
Enclume de» couvreurs. V. 629. E
E n c lum e , (Maréch.) V. 629. E
E n c lum e , f Orfiv. ) V. 629. E
E n c lum e , ÇTe///tur.') V, 629, E
EN C LU ME AU , ( Art midi.) ouvriers qui s’en fervent,
V, 629, b.
defcription 6c ufage. V. 629. E
ENCLUMETTE, ( BoijellerieY V. 629, E
EÑCOLÍ.™ ' ( :"■ ” ) V ' a M ee flu'iu » V ouvr^cr* auxquels ce terme eft commun 1
à ï c o endent Pir'ü ' V-, 630, 4.
fur le uniere de faire cette préparation
ENCOLURE .CM a t i i to ? ? \ a' I , „
encolure. Encoluref i f í i‘''S" !i S<! 'lu n e , ,elle
de ces différentes fortes L ’n S K t V K T ’ Î,“ “
inauvaife conformation de l’eneolure ÁÚa» \ f f
»'on recherche dans le cheval! Æ Æ Î . f l f ps * «»? | «# ■ ! I M H H
barbes, des jumen? 6c chevaux d’Efpagne. Ceft l’art
procure cette liberté 6c facilité des inouvemens du cheval
quon appelle foujdfeffe. Etroite correfpondance &
reciproque de 1 encolure 6c de la tète du cheval,avec u
attaches 6c les ufage* des mufcles divers qui concourent1
leurs aéltons. Lajuitude 6c l’aiiânce avec lefquelles l’encn
Jure fe prêtera dans tous les fens divers, aideront k la î.,/i^
pohrion de cette partie,à la franchife 6c à la ffiretédei»
bouche, 6c conféqucmment à l’exaéle précifion des effets d2
rênes. De toutes les portions extérieures 6c mobiles du com.
de 1 animal, l’encolure eft la première qu’on doit tenter d’ar
foupllr. D’où viennent la plupart des déréglemens & ¡Il
défordres auxquels nombre de chevaux s’abandonnent Mou
vemens de flexion ou d’extenfion auxquels il faut d’abord
travailler à déterminer l’encolure. Ibid. b. Voye{ Pla ce r fie
T ê te . Des moyens d’affouplir entièrement cette partie en
la dirigeant dans le fens des flexions latérales. qui (0nt ce
qu’on entend par le terme de plis. Maniere de déterminé
la meftire précife du pli à fuggérer. Ibid. 6 p . a ç om
ment on diftingue les aides qui conviennent aux diverfes
efpeces de chevaux, félon les défauts auxquels ils ont le nhis
de penchant. Ibid. b. — Sur l’encolure, voyez Suppl. [IL
398.4, « f '
ENCOMBOMATE, (fUift. anc.) obfervation fur cet árdele
de l’Encyclopédie. Suppl. II. 804, E
ENCOMBREMENT , ( Marine) lorfqu’il s’agit du fret
des marchandifes, on en fait l’évaluation íuivant Pcncombre-
ment. V. 632.4.
ENCRAflTES, ( Hiß. eccl.) hérétiques du deuxiem»
ailtCur dc cette Sa doârine. Pourquoi
les difciples furent appellés encratites ou continens. On les
ajipella auffi aquariens ou hydroparañatet. V. 632. E Voyez
A q u a r ien « 6f T a t ia n is t e s . j v
E n c r a t i t e s , Evangile des, VI. 117. 4.
ENCRE à écrire. ( Arts ) Recette de M. Lémery pour faire
de 1 encre. Recette de M. Geoffroy. Maniere de faire de
l’encre fur le champ. V. 632. b. Des quatre efpeces de
vitriol, celui qu’on appelle vitriol de Chypre ou de Hongrie
, eft le feul qui ne faffe point d’encre. Moyen de faire
difparoftre la couleur noire de l’encre. Ibid. 633.4.
Encre dont on fe fervoit autrefois. IV. *024. 4 , Principales
drogues qu’on emploie dans la ccmpofltion des encres:
deux manieres de faire l’encre à l’ufage des maîtres écrivains.
IX. 43 a. 4 . Maniere de faire de l’encre avec l’iris jaune de
marais. VIII.902. E avec le kermès. IX. 120.E Encre grife:
encre pour le parchemin : encre de communication : encre
rouge ; encre blanche pour le papier noir. IX. 432. E Moyen
de revivifier l’encre effacée. V. 370. 4. IX. 433. 4 .
E n c re noire. ( Imprimerie) Détails fur la maniere de la faire.
V, 633, E Encre rouge d’imprimerie. Maniere de la faire 6c
de la conferver. Maniere de faire des encres de différentes
couleurs, verte, bleue, jaune, violette. Ibid. b.
Encre de la Chine. Sa compontion. V. 634.4.
Encre de la Chine. Maniere de la détremper. IX. 314. E
E n c r e fympathique, ( Phyfiq, Chymie ) compofition de deux
liqueurs , dont l’une fert à tracer lur le papier des caradures
«pii demeurent invifibles ; 6c l’ufage de 1 autre, tel qu’il eft
indiqué ic i, fert à les faire paraître prefque auffi noirs que
s’ils euffent été formés avec de l’encre ordinaire. La première
s’appelle vinaigre de faturne ; la fécondé , foie darjenic. Ces
deux liqueurs claires 6c limpides, quand elles font réparées,
deviennent, par le mélange, d’un noir brun foncé. Ibid. 634.
4 . Encres fympatbiques de la même ciaffe, faites avec une
diffolution d’or dans de l’eau régale , 6c une autre diffolution
d’étain fin, avec pareille eau. Jeu fingulier d’eocre fympathi-
ques,Seconde ciaffe de ces encres; efie comprend celles donc
récriture invifible devient colorée en l'expolant à l’air. Ibid. b.
La troifteme ciaffe eft celle des encres dont l’écriture invi-
fible paraît en la frottant avec quelque poudre brune ou noire.
La quatrième eft celle de ces écriture* qui ne deviennent vifi*
bles qu’en les chauffant. Propriétés de 1 encre fympathique de
M.Hcllot.634.4.
Encre fympathique , faite avec le bifmuth, IL *63. E avec
le fuc de figuier , VI. 743. E avec le foie de foufre arfénical.
X I , 66 k. E
ENCRIER d’imprimerie. V. 634. E
ENCRINITES, ( Oryflolog. j cfpece de foffiles. De leur
origine. Suppl, IV. 223, E 224. a.
ENCRINUS , encrinite , ( Hifl. nat. Fojftl. ) pétrification
qui repréfente la figure d’un lis qui n’eft pas épanoui. Defcription.
Quelques-uns croient que c'eft une étoile de mer
pétrifiée, Lieu où il s'en trouve. V. ¿34. E Voye[ PiERk*
de us,
Encrinus, repréfenté vol. VI. des planch. Coquilles foffiles,
plsneli. 8.
ENCROISER, ( Manuf. en Joie, en laine , f i l, 6c. ) façon
de donner de l'ordre aux différons brins de foie , de laine,
6c. qui compofent la chaîne. Les brins doivent être paffes»
fulvant le rang de cet incroix , d'abord dah* les bues»
E N C E N C
6c enfuite dans le peigne. Comment fe fait Vetierolx. V.
^ENCROIX , (Manu/.) trois chevilles placées i demeure
fur les traverfes de deux des ailes du moulin, en haut. Détails
fur ces chevilles , 6c leur ufage. Encroix mobile, qui confifte
en une tringle de même force que les traverfes qui portent les
îi,croix fixes dont on vient de parler. Manière dont il doit
être fait. Son ufage. V. 63<.a. . . .
ENCROUE, ( Jurifpr. ) arbre qui en tombant s embarraffe
dans les branches d’un autre qui eft fur pied, Ce que porte lâ-
deffusl’ordonnance des eaux & forêts, v. 6 p . a.
ENCYCLOPÉDIE, (Philo/op.) enchaînement de con-
noiffances. Etymologie de ce mot. But d’une Encyclopédie.
B eft difficile de fe propofer un objet plus étendu. Paroles
tirées du chancelier Bacon , pour répondre à ceux qui ont
jugé que cette Encyclopédie ne s’achevcroit pas. V . 035. a.
Un tel ouvrage ne peut être celui d’un feul homme. Il n’eft
point donné a‘ un leul homme de connoitro tout ce qui eft
connu ; 6c quand cet ouvrage ne comiendroit que les élé-
mens des fciences, on doit lavoir que l’exnofition des principes
d’une fcience ou d’un art, ne peut être que le chcf-
d’amvre d’un maître. Pour démontrer combien il eft difficile
qu’un feul homme exécute jamais un diélionnaire raifonnéde
la fcience générale , l’auteur fe contente ici d’infifter fur les
feules difficultés d’un fimple vocabulaire. Ibid. b. Ces difficultés
four peu fendes par ces hommes qifi nous entretiennent
de tout oc qui ne favent rien , & qui prétendroient borner
la connoiffance de la langue ir un très-petit nombre de termes
qui leur font familiers , 6c qui même auroient befoin
d'appeller à leur fecours , le plülofophe, le jurifconfuhc ,
fhiftoricn, pour lu définition de plufieurs de ces termes. Cependant
, s’il eft difficile qu’un feul homme exécute un fimple
vocabulaire, quel concours de talens ne fùppoférà pas l’exécution
d'un ouvrage, où , loin de fe borner à la définition
du mot-, on fe propofe d’expofer en détail tout ce qui
appartient U la chofe r Cet ouvrage ne peut être celui d’un
homme feul, ni même celui d'aucune des fociétés littéraires
ou favantes gui fubfiftcnt , prifes féparément ou en corps.
Ibid. 6m. a. 11 y a cependant une tâche qui ramencroit leurs
travaux au but de cet ouvrage , 8c qui devroir leur être iin-
pofée ; elle confifteroit à recueillir les conuoiffances anciennes
6c modernes , à les enchaîner, 8c à en publier des traités
complets 6c méthodiques. Ils renfermeroient une infinité de
matériaux exccllcns, difperfés dans un grand nombre d’ouvrages
, où ils reftent fans produire aucune fenfation utile ,
comme des charbons épars qui ne formeront jamais un brafier.
Ibid. b. C’eft à 1 exécution de ce projet étendu........
qu’une Encyclopédie doit fuppléer. Ouvrage qui ne s’exécutera
que par une Ibciété de gens de lettres 6c d’artiftes,
liés par l'intérêt général du genre humain. Ces perfonnes
même doivent être éparfes , parce que fi l’on youloit que
l’ouvrage fe fît toujours 6c ne s'achevât jamais, il n y aurott
qu’à former une fociété lubfiftantc, dans les affemblécs de laquelle
il fallût difeuter chaque article. Ces perfonnes ne
doivent être liées que par l’intérêt général du genre humain,
6c par un feutiment de bienveillance réciproque, parce que ces
motifs étant les plus honnêtes, font auffi les plus durables.
Si le gouvernement fe mêle d’un pareil ouvrage, il ne fe
fera point ; toute fon influence doit fe borner à en favortfer
l'exécution. Ce que deviennent les projets littéraires conçus
par les grand*. Ibid. 636. a. Pourquoi il arrive que pour
l'ordinaire on traite moins honnêtement avec le prince qu a-
vcc fes fi,jets. Non feulement les interruptions font plus
communes ; il faut ajouter qu’elles font plus funeftes encore
aux projets littéraires, Iorfque le gouvernement cil à la tête
de ces projets, que lorfqu’ils font conduits par des particuliers.
Remarquez enfin qu’une Encyclopédie , ainfi qu un
vocabulaire, doit être commencée , continuée 8c bnie dans
un certain intervalle de teins, 8c qu’un intérêt »croule
s'occupe toujours à prolonger les ouvrages ordonnés par
les rois. Ibid. b. Si celui-ci traîne en longueur, 011 remarquera
l'irrégularité la plus défagréablc ; 6c a l'égard des arts ,
quelle diverfité ne s introduit pas tous les jours dans la
langue qui leur eft propre , dans les machines 8c■ dàns' les
manoeuvres ? Quoique la révolution foit moins fenfible dans
les fciences 6c les arts libéraux, cependant il s’en fait une ; . . .
mais ce qui donnera fur-tout à l’ouvrage l’air furanné , c eft
la révolution qui fe fera dans l'efprit des hommes 8c dans le
caraélore national. Ibid. 636. a. Le tems qui a émouffé notre
goût fur les queftions de critique 8c de controverfe, a rendu
A fnlipide une partie du diélionnaire de Bayle. Il n'y a point
“ d’auteur qui ait tant perdu dans quelques endroits, 8c qui
ait tant gagné dans d’autres ; mais fi tel a été le fort de
Bayle , qu'on juge de ce qui feroit arrivé à l’Encyclopédie
de fon tems. Si l’on excepte cinq ou fix hommes de génie ,
11 n’y on avoit peut-être pas un , du tems de cet auteur, qui
en eût écrit une page qu’on daignât lire aujoiird hui. Les
connoiffance? les moins communes fous le lieclc pailc, le
deviennent de jour en jour : d’où il arrivera que la langue,
même populaire, changera d e face ; qu’elle s’étendra h me-
fure que nos oreilles s’accoutumeront aux mots, par les applications
heureufes qu’on en fera, Ibid. b. Notre langue eft déjà
fort étendue ; elle va faire encore des pas immenfes fous ,
l’empire de la plülofoplue. Dans tout ouvrage deftiné à l’in-
ftrucnotr générale'des hommes, il faut fur-tout fe réfoudre
à ne travaille^ que pour les générations fuivantes, parce
qu’à peine une grande entreprile fera-t-elle achevée , que la
génération prélente ne fera plus: c’eft'pourquoi il faut abréger
la durée du travail, en multipliant le nombre des collègues.
Cependant les connoiffances ne' peuvent devenir communes
que jufqu'à un certain point. Il y a dans Jes fcience* un terme
au-delà duquel il ne leur eft prefque pas accordé de paffer.
L’individu n’a qu’une certaine énergie dans fes facultés ; &
c’eft en ajoutant au travail de cet inaividu . celui d’un autre,
que vous vous formerez quelque notion de ce que l’efpecc
entière peut produire de plus parfait. Ibid. 637. a. Un ouvrage
tel que l’Encyclopédie, doit, par fa nature, defeendre peu-
à-peu au-deffous de la portée commune des hommes par
rapport à certains objets ; 8c par rapport à d’autres, relier
toujours au-deffus. Le moment le plus glorieux pour un ouvrage
de certe nature, feroit celui de cette portée qui fuc-
céderoit à quelque grande révolution qui auroit fufpcndu le
progrès des iciences. Ce moment glorieux nepourroirdevenir
l’objet de nos efpérances , fi la langue n’eft fixée 8c trabfmile
à la poftériré dans fa perfection, Malheiireufcmcnt on a donné
jufqu’ici dans cette Encyclopédie , peu de foin à cet objet :
c’elt ce qui engage l'auteur à le traiter ici fpécialcmcnt, 6c
dans une certaine étendue.
Sans la double convention qui attacha les idées aux voix,
8c les voix à des caraéteres, tout reftoit au-dedans de l’homme
8c s’y éreignoir. Sans les grammaires 8c les dictionnaires,
tout demeuroit concentré dans une nation , 8c dilparoiffoit
avec elle. Ibid. b. Suppofé un idiome commun, admis 6c fixé,
1 les notions deviennent permanentes ; il Ce forme des points
habités de l'cfpace 8c de la durée , 8c tous les êtres vîvans 6c
penfans s'entretiennent. La langue d’un peuple donne fon
vocabulaire , 8c le vocabulaire eft une table affez fidclle de
toutes les connoiffances de ce peuple. . . . Elle indique à
l'homme pénétrant jufqu’où l’on étoit allé dans une fcience,
dans les tems même les plus reculés : clic fait connoitre la
fupérioriré des Grecs fur les Romains, 8c la nôtre fur les
uns 8c les autres. Ils furvient, chez tous les peuples en général
, relativement aux progrès d‘e la langue oc du goût, une
infinité de révolutions légères, d'èvénemens peu remarquables
, qui ne fe tranfinettent point. On ne peut s’apperccyoir
qu'ils ont été , que par le ton des auteurs contemporains,
ton ou modifié ou donné par ces circonftances paffagercs.
Ibid. 637. 4. Les auteurs ne s’appercoivent pas quelquefois
eux-mêmes de l’impreffion des choies qui fe panent autour
d'eux ; mais cette imprelfion n'en eft pas moins réelle. L’abus
qu’ils font quelquefois d'expreffions , dont la force leur eft
inconnue, décele qu’ils n’étoient pas au courant de la philo-
fophie de leur tems ; mats le bon efprit qui recueille ces
expreffions, n’entrevoit pas moins l’état des opinions dominantes.
Ce qui rend les anciens auteurs fi difficiles à juger
en matière de goût , c'eft que les chofcs qui fervoient de
bafe à leurs figures les plus familières, n’étant plus connues,
l’éclar de leur difeours a paffé avec elles. Leçon que doit
tirer de cette obfervation tout écrivain qui veut affurcr à
fes ouvrages un charme éternel. Ibid. b. Auffi dans un ouvrage
tel que celui de l’Encyclopédie , où il eft fouvent à
propos de citer des exemples, doit-on s’attacher à des morceaux
dont la beauté foit fondée fur des modèles permaneiis.
L’art de tranfinettre les idées par la peinture des objets, a
dû naturellement fe préfenter le premier : celui de les rranf-
mettre en fixant les voix par des caraéleres, dut effrayer
l’homme de génie qui l’imagina. Avantages 8c défavamages
de ces deux moyens. La peinture n’atteint point aux opérations
de l'efprit, il y a une infinité de chofes qu’cl c ne peut
figurer ; mais elle montre du moins toutes celles qu elle
faure. Les peintures des êtres font trés-incomplettes ; niais
elles n’ont rien d'équivoque. La peinture ne peut exprimer
le mouvement le plus fimple fans devenir obfcure , m repré-
feiuer une aétion durable par des images d'inftans Icparês ;
Ibid. 638. 4. mais ces termes gui demeurent dans une langue
, néceffairement inexpliqués , les radicaux ne corref-
pondent-ils pas affez exactement à ces inftans intermédiaires
nue la peinture ne peuj repréfenter ? Comment les recueillir
8c le* expliquer ? Recherches fur la maniéré de réfoudre
ces queftions. rour difeerner ces radicaux , il faut que ceux
qui coopéreront à un vocabulaire , s'impofent la loi de tout
Jéfinir ; enfuite l’éditeur aura foin de (épurer le* termes où
un même mot fera pris pour genre dans une définition , 8c
pour différence dans une autre. Des deux termes qui font
définis l'un pour l’autre , il eft évident que c’eft le plus général
qu'il faudra regarder comme une des racines grammaticale*.
Pour fixer la notion de ces radicaux, il n'y a d'autre moyen
que de rapporter U langue vivante à une langue morte, qui