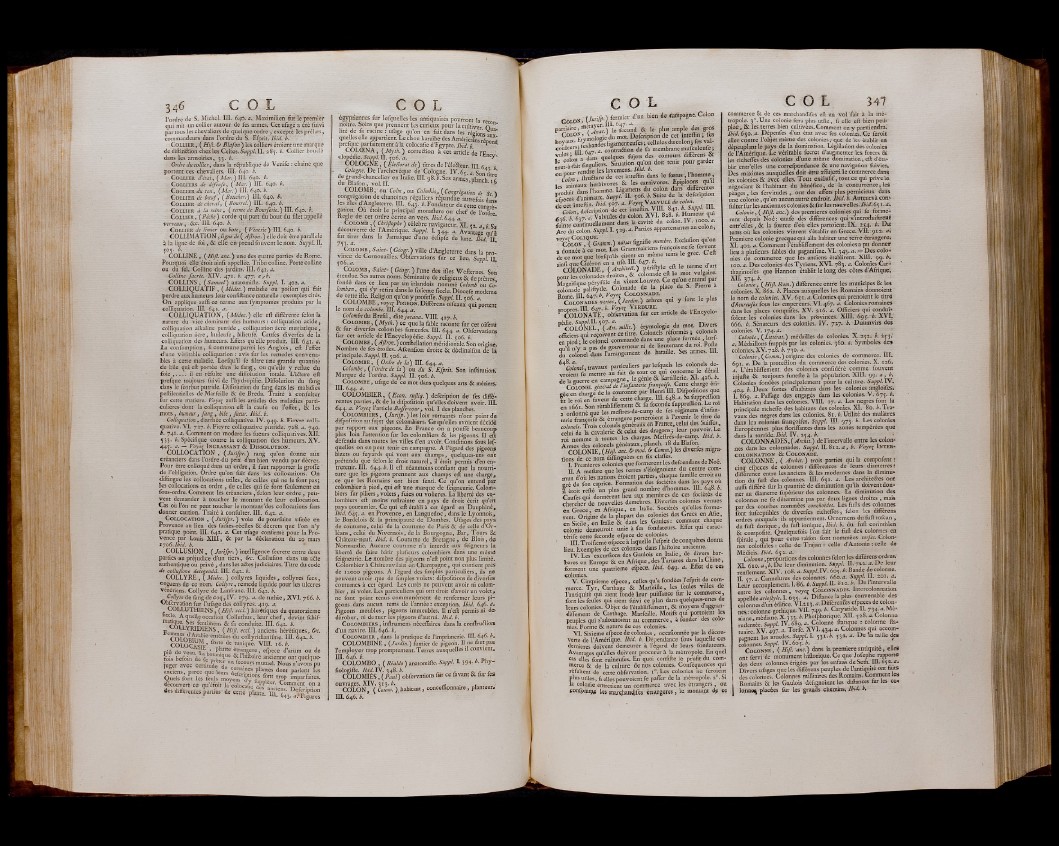
COL COL l ’ordre de S. Michel. III. 640. a. Maximilien fut lé premier
<jui mit un collier autour de fes armes. Cet ufage a été fuivi
par tous les chevaliers de quelque ordre, excepté.'lës prélats,
commandeurs dans l’ordre du S. Efprit. Ibid.b.
C ollier , ( Hiß. & Blafon ) les colliers étoient une marque
de diftinétion chez les Celtes. Suppl. II. 285. b. Collier bouclé
dans les armoiries, 33. b.
Ordre du collier, dans la république de Veniiè : chaîne que
portent ces chevaliers. III. 640. b.
C ollier ¿Tétai, ( Mar. ) III. ,640. b.
C olliers de défenfe, ( Mar. ) III. 640. b.
C ollier du ton, (Mar:) -III. 640. b.
C ollier de boeuf, (Boucher.) III. 640. b.
- COLLIER de cheval, ( Bourrel. ) III. 640. b.
COLLIER à-la reine, ( terme de Bourferie.) III. 640. b.
: C ollier , (Pêche) corde qui part du bout du filet appellé
verveux, 8cc. III. 640. b. "
COLLIER de limier ou bote, ( Vénerie) TH. 640. b.
COLLIMATION, ligne de ( Aßron. ) elle doit être parallele
b la ligne de foi, & elle en prend foùvent le nom. Suppl. II.
5°& L L IN E , (Hiß. anc. ) une des quatre parties de Rome.
Pourquoi elle étoit ainfi appellée. Tribu colline. Porte colline
ou du fel: "Colline des jardins. III. 641. a.
-Colline• facrée. XIV. 471. b. 477. ay-b.
COLLINS, (Samuel) anätomifte. Suppl. I. 402. a.
COULIQUATIF, (Médec.) maladie ou poifon qui fait
perdre aux humeurs leur confiftance naturelle : exemples cités.'
On applique aufîi ce terme aux iymptomes produits par la
colliquàrion. III.'641. a.
COLLIQUATION, (Médec.) elle eft différente félon la
nature du vice dominant des humeurs : colliquàrion acide,
colliquàrion alkaline putride , colliquàrion âcre irmriarique,
colliquàrion âcre, huileufe, bilieufe. Caufes diverfes de la
colliquàrion des humeurs. Effets qu’elle produit. III. 641. a.
La confomption, fi commune parmi les Anglois, eil l’effet
d’une véritable colliquàrion : avis fur les remedes convenables
à cette maladie. Lorfqu’il fe filtre une grande quantité
de bile qui eil portée dans le fang, ou qu’elle y renue du
foie , . . . . il eu réfulte une diffolurion totale. L’iétere eil
prefque toujours fuivi de l’hydropifie. Diffolurion du fang
clans le fcorbut putride. Diffolurion du fang dans les maladies
peililenrielles de Marfeille & de Breda. Traité à confulter
iur cette matière. Voye{ auiîiles articles des maladies particulières
dont la colliquàrion eft la caufe ou l’effet, 8c les
mots , humeur, fang, bile , fueur. Ibid. b.
Colliquation, diarrhée colliquarive. IV. 949. b. Fievre colli-
quarive. VI. 727. b. Fieyre colliquative putride. 728. a. 740.
b. 741 .a. Comment on modere les Tueurs colliquatives. XII.
533. b. Spécifique contre la colliquation des humeurs. XV.
445. a. — Voyez ÏNCRASSANT & DISSOLUTION.
COLLOCATION , (Jurifpr.) rang qu’on donne aux
créanciers dans l’ordre -du prix' d’un bien vendu par décret.
Pour être colloqué dans un ordre, il faut rapporter la groffe 1
de l’obligation. Ordre qu’on fuit dans les collocations. On
diftingue les collocations utiles, de celles qui ne le font pas;
les collocations en ordre , de celles qui fe font feulement en
fous-ordre. Comment les créanciers, félon leur ordre, peuvent
demander à toucher le montant de leur collocation.
Cas où l’on ne peut toucher le montant’des collocations fans
donner caution. Traité à confulter. III. 642. a.
C ollocation , ( Jùrifpr. ) voie de pourfuite ufitée en
Provence au lieu des faifies-réelles & décrets que l’on n’y
pratique point. III. 642.- a. Cet ufage confirmé pour la Provence
par Louis XIU, 8c par la déclaration du 20 mars
2706. Ibid. b.
COLLUSION , ( Jurifpr. ) intelligence fecretc entre deux
parties -au préjudice d’un tiers, &c. Collufion dans un aéle
authentique ou privé, dans les ailes judiciaires. Titre du code
de collufione detegendâ. III. 642. b.
COLLYRE, ( Médec. ) collyres liquides, collyres fecs,
onguens de ce nom. Collyre , remede liquide pour les ulcérés
vénériens. Collyre de Lanfranc.IH. 642. b.
Collyre-Ae fang de coq, IV! 179. a. de tuthie, XVI. y66. b.
Obfervation fur l’ufage des. collyres. 419. a.
COLLUTHIENS, (Hiß. tccl.) hérétiques du quatorzième
. . A quelle occafion Colluthus, leur chef, devint fchif-
mauque Ses fentimens & fa conduite. III. 642. b.
> (Hifl. eccl. ) anciens hérétiques, &c.
COïcm™™«*6 ^.nt es du collyridianifme. III. 642. b.
coloS ’ fT de H B vin. É
nié de venu t u’ P*.ante ®trangere, efpece d’arum ou de
fois befoin de f e S ä “ ancienne ont quelqueiueer
avec Certitude I a.ou^s -mutuel . »Nou s n’avons pu Ëm fe Quels font les feuls moyens W m Ë i ' Û ,raI)lr&tes-
découvert ce qu’étoit la colocaue de? t • a
d « différentes parties de cette phinte. f f iT ^ P ^ T g S e s I
égyptiennes ftif lefqùelles les antiquaires pourront la reen
rioître. Soins que prennent les curieux pour la cultiver Oi
lité de fa racine : ufage qu’on en fait dans les régionsai
quelles elle appartient. Le chou karaïbe des Américains rénn à
prefque parfaitement à la colocafte d’Egypte. Ibid. b.
COLCENA, (Myth. ) correélion à cet article de •
clonédie. SuddI. Ù. fg 6:à. 1 Ency '
COLOGNE, (EleElorat de) titres de l’éleïleur. III. 6at h
Cologni. De l’archevêque de Cologne. IV. 6? a ‘
d u f e t t v o u ï
COLOMB, ou Colm, ou Çolmkis .(Congrégation de St \
çonnégation de chanoines réguliers répandue autrefois dans
les illesd Angleterre. III., 643. b. Fondateur de cette coneré!
gatton. Ou étoit le principal monaftere ou chef de l’ordre
Réglé de cet ordre écrite en vers. Ibid. 644. a.
- C o lom b , ( Chriftophe ) célébré navigateur. XI. e2.a ¿Sa
découverte de l'Amérique. Suppl. 1.344. g Avantagé’ '
lut tirer dans la Jamaïque d’une éclipfe de lune Ibid II
753.-4. *
.C o lom b, Saint-(Géogr.) ville d’Angleterre dans la province:
de Cornouailles. Obfervations fur ce lieu. Suppl U
ço6. a. " " S
C o lom b, Saint- ( Gioir. ) l’une des ¡lies Wefternes. Son
étendue. Ses autres noms. Séminaire de religieux & de prêtres'
fondé dans ce lieu, par un irlandois nommé Colomb bu Co-
lombnn, qui s y retira dans le fixieme fiede. Diocefe moderne
de cette îfle. Religion mi’on y profeffe. Suppl. II. ç06. a.
COLOMBE, voyez Pigeon. Différens oifeaux qui portent
le nom de colombe. III. 644. a.
Colombe du Brefil, dite jacana. VIIL 427. b.
C olombe , (Myth.) ce que la fable raconte fur cet oifeaii
& fur diverfes colombes fameufes. III. 644. a. Obfervations
fur cet article dé l’Encyclopédie. Suppl. II. 506. b.
C olom be, (Aftron.) conftellation méridionale.Son origine«
Nombre de fes étoiles. Afcenfion droite & déclinaifon de la
principale. Suppl. II. 506! a.
C olombe , ( Ordre de la ) III. 644. a.
Colombe, (l'ordrede la) ou du S. Efprit. Son inftitutiori.'
Marque de l’ordre. Suppl. II. 506. b.
C olombe , ufage de ce mot dans quelques arts & métiers.'
III. 644. a.
COLOMBIER, ( Econ. ruftiq. ) deferiprion de les différentes
parties , & de la diipofition qu’elles doivent avoir. IIL
644. a. Voye[ l’article Bajje-cour, vol, I des planches.
C olom biers , (Juri/p.) les loix romaines n’ont point de
difpofirion au fujet des colombiers. Ce qu’elles avôient décidé
par rapport aux pigeons. En France on a pouffé beaucoujp
plus loin l’attention fur les colombiers & les pigeons. Il eft
défendu dans toutes les villes d’en avoir. Conditions fous lesquelles
on en peut tenir en campagne. A l’égard des pigeons
bizets .ou fuyards qui vont aux champs, quelques-uns ont
prétendu que félon le droit naturel, il étoit permis d’en entretenir.
III. 644. b. Il eft néanmoins confiant que la nourriture
que les pigeons prennent aux- champs eft une charge,
ce que les Romains ont bien fenti. Ce qu’on entend par
colombier à pied, qui eft une marque de feigneurie. Colombiers
îùr piliers, volets, fuies ou volieres. La liberté des colombiers
eft moins reftrainte en pays de droit écrit qu’en
pays coutumier. Ce qui eft établi à cet égard en Dauphiné,
Ibid. 645. a. en Provence, en Languedoc, dans le Lyonnois.,
le Boçdelois & la principauté de Dombes. Ufages des pays
de coutume, celui de la coutume de Paris & de celle a’Or-
léans, celui du Nivernois, de la Bourgogne, Bar, Tours &
Château-neuf. Ibid. b. Coutume de Bretagne, de Blois, de .
Normandie. Aucune coutume n’a interdit aux feigneurs la
liberté de faire bâtir pluficurs colombiers dans une mêmd
feigneurie. Le nombre des pigeons n’eft point non plus limité.
Colombier à Châteauvilain en Champagne, qui contient près
de 12000 pigeons. A l’égard des fimples particuliers, ils ne
peuvent avoir que de fimples volets: difpofitions de diverfes
coutumes à cet égard. Les curés ne peuvent avoir ni colombier
, ni volet. Les particuliers qui ont droit d’avoir un volet,
ne font point tenus communément de renfermer leurs pigeons
dans aucun tems de l’année : exception. Ibid. 646. a.
Pigeons meubles, pigeons immeubles. Il n’eft permis ni de-
dérobçr, ni de tuer les pigeons d’autrui. Ibid. b.
C olombiers , inftrumens néeeffaires dans là conftruélion
d’un navire. III. 646. b. >
C o lom b ie r , dans la pratique de l’imprimerie. III. 646. K
COLOMBINE, (Jardin.) fumier de pigeon. Il ne faut pas
l’employer trop promptement. Terres auxquelles il convient,
in . 640. b. 5 .. »
COLOMBO, (Réaldo) anatomifte.Suppl. 1. 394. Phy-
fiologifte. Ibid.W. 348. b. o r r
COLOMIÉS, (Paul) obfervations fur ce favant & fur fes
0UVCr& M V ( 1 2 m.), habitaat, «nceffionnaire, planteur.
1DL 646. b.
COL CôLPH. ( .M M fermieriun bien Je ¿BÜpagne. Colon
parùaire, n tW “ - .Uje6^.7con(1 & le p]1B ample des gros
°FArmoloeie du mot. Defcripdon dé cet mtelbn ; fes
boyaux. E f f J P ligamenteufes ; cellules du colon; fes val-
“ f i îl t o a. contraction de fa membrane mufculeufe; ,
ï L . L ctats quelques fujets des contours di®rens &
SCr à 6fitt ftsngupUefs s. Sittuatsion tqul’on. do it tenir pour garder j ie m w è . 1 «aux herbivores & les carnivores. Epiploons quil
les an,m*“ rhomme. Ligamens du colon dans différentes
£ ‘ceM ^ S u rP\ , o 6 . i . S u iK i ^ ^ n o n
M l B du iolon. XVI 8a8 i. Humeur qut
fuinte continuellement dans la cavité du colon. IV. 1000. U.
Are du colon. SuppL I. W - P“ “ “ appartenantes au colon.
! T Gramm.) ftgnifie mtmbn. Exclufion qu'on
a donnée à ce mot. U s Grammairiens françois nejfe fervent 3e ce mot que lorfqu’ils citent en même tems le grec. Ceft
amC^LONADE,eI(!<reéiKÎI.) périftyle eft le terme dart
nour les colonades droites, & colonade eft le mot vulgaire,
ïriattniiique pêryftile du vieux Louvre. Ce qu on entend par
colomide palftlyde. Colonade de la place de S. Pierre à
î “ y fom 1 p'us
ardde de 1'Encydo-
^ C O lS& E L ,’ ^ « . milit.) étymologie du mot. Divers
officiers qui reçoivent ce titre. Colonels réformés ; colonels
en pied ;^e colonel commande dans ime place fermée, lorf-
qu’ft n’y a pas de gouverneur ni de lieutenant du roi. Pofte
du colonel dans l'Srangement de bataüle. Ses armes. UI.
64Cobnd, travaux particuüers parlefquels les colonels de-
vroient fe mettre au fait de tout ce qui concerne le détad
de la guerre en campagne, legéme&WuUene. XI-4^6. t-
COLONEL (inirai de l'infantene ^nfoift. Cette charge érigée
en charge de la couronne par Henri III. Difcofmons que
I t le roi en faveur de cette charee. 11L 648.0. Safuppreflîon
en 1661 Son rétabliflement & fa fécondé fuppreflion. Le roi
a ordonné que les meftres-de-camp de fes regimens d .nfen-
teriefrançoife & étrangère porteroient à 1 avenir le utre de
colonel,. Trois colonels généraux en France, celui des SiufTes
celui de la cavalerie & celui des dragons ; leur pouvoir Le
roi nomme à toutes les charges. Meftres-dmçamp. tttd. b.
Armes des colonels généraux, planch. 18 du Blafon.
COLONIE, (Hifi. anc. 6* mod. & Comm.) les diverfes migrations
de ce nom diftinguées en fix claffes.
I. Premières colonies que formèrent les defeendans de Noé.
II. A mefure que les terres s’éloignoient du centre commun
d’où les nations étoient parties, chaque famille erroitau
«ré de fon caprice. Formation des fociétés dans 1« pays ou
Ü étoit refté un plus grand nombre d hommes. ¡ ¡ g i g M
Caufes qui donnèrent heu aux membres de ces fociétés de
chercher de nouveUes demelires. Diverfes colonies venues
en Grece, en Afrique, en Italie.' Sociétés quelles forme
rent Origine de la plupart des colonies des Grecs en Afie,
en Sicile, en Italie & dans les GauleS: comment chaque
colonie demeuroit unie à fes fondateurs. Effet qui carac-
térife cette fécondé efpece de colonies. . ,
III. Troifieme efpece à laquelle l efprit de conquêtes donna
lieu. Exemples de ces colonies dans Thiftoire ancienne.
IV. Les excurfions des Gaulois en Italie , de divers bar
bares en Europe & en Afrique, des Tar tares dans la Chine,
forment une quatrième efpece. Ibid. 649. a. bitet de ces
colonies. j
V. Cinquième efpece, celles qu’a fondées 1 efpnt de commerce.
T y r , Carthaee & Marleille, les feules villes de
l ’antiquité qui aient fondé leur puiffance fur le commerce,
font les feules qui aient fuivi ce plan dans quelques-unes de
leurs colonies. Objet de l’établiffement, & moyens d’aggran-
diffement de Carthage. Marfeille. Motifs qui portoient les
peuples qui s’adonnoient au commerce, à fonder des colonies.
Forme & nature de ces colonies.
VI. Sixième efpece de colonies, occafionnée par la découverte
de l’Amérique. Ibid. b. Dépendance fous laquelle ces
dernieres doivent demeurer à l’égard de leurs fondateurs.
Avantages qu’elles doivent procurer à la métropole. En quel
cas elles font ruineufes. En quoi confifte le profit du commerce
& de la culture de nos colonies. Conféquences qui
réfultent de cette obfervation. x°. Les colonies ne feroient
plus utiles, fi elles pouvoient fe paffer de la métropole. 20. Si
la colonie entretient un commerce avec les étrangers , ou
COL 347
Commerce 8c de ces marchandifes eft un vol fait à la métropole.
30. Une colonie fera plus utile, fi .elle eft bien pcü*
pjée , & les;terres bien cultivées. Gomment on y parviendrai
Ibid. tiço. a. Dépenfes d’un état avec fes colonies.'Ge feroit
allée contre l’objet même des colonies y* que de les établir ert
dépeuplant le p^s de la domination. Légiilation des colonies
de l’Amérique. Le.véritable fecret d’augmenter les forces 8s
les richeffes des colonies. d’une , même domination j eft d’établir
entr’elles une correfpondance 8c une navigation fuivies*
Des maximes auxquelles doit être affujettile coramerce.dans
les colonies 8c avec elles. Tout exclufif, tout ce qui prive le
négociant 8cl’habitant du bénéfice, de ¡la concurrence,les
péages, les fervitudes ont des effets plus pernicieux dans
une colonie, qu’en aucun autre endroit. Ibid. b. Auteurs à con*
fulter fur les anciennes colonies 8c.fur les nouvelles.7éid. 651 .a.
Colonie, (Hiß. anc.) des premières colonies-qui iè formèrent
depuis Noé: caufe des différences qui-s’introduifirenè
entr’elles, 8c la fource d?où elles partoient.-IX.. 2x4. b. Dii
tems où les colonies vinrent s’établir en Grece. VII. 912. ai.
Premiere colonie grecque qui alla habiter une terre étrangère*
XI. 402. a. Comment l’établiffement des colonies a pu donner
lieu à plufieurs fables!du paganifme. VI. 343. a. — Des cola»
nies de commerce que les . anciens établirent. XIII. 994 é*
100. a. Des colonies des Tyriens. XVI. 783. a. Colonies Car*
thaginoifes que Hannon établit le long des côtes d’Afrique*
XIL 374. b. e . •
Colonie, (Hiß. Rom.) différence entre les mumeipes 8c les
colonies. X. 862. b. Places auxquelles les Romains donnoient
le nom de colonies. XV. 651.4. Colonies qui prenoient le titré
d'heureu fes fous les empereurs.. VI. 467. a. Colonies, romaines
dans les places conquifes. XV. 216. a. Officiers qui condui*
foient les colonies dans les prbvinces. XIU. 695-. -A XVI.'
666. ¿..Sénateurs des colonies. IV. 727. b. Duiimvirs des
colonies. V. 174. a. \ ■
■ Colonie, (Littéral.) médailles de colonies; X. 252. b. ¿53.'
a. Médaillons frappés par lès colonies. 360. a. Symboles des
colonies. XV. 728. b. 730. a.
Colonie, ( Comm.) origine des colonies de commerce. III.
691. 4. De la protection du commerce des colonies. X. 126*
4. L’établiffement des colonies confidéré comme fouvent
injufte 8c toujours funefte à la population. XIII» 99»' a , ¿»
Colonies fondées principalement pour la culture. Suppl. IV*
404. b. Deux fortes d’nabitans dans les colonies àngloifes*
I. 869. 4. Paffage des engagés dans les colonies. V. 675. b.
Habitation dans les colonies. VIII. 17. a. Les negres font là
principale richeffe des habitans des colonies. XI. 80. b. Travaux
des negres dans lés colonies» 81. ¿.Utilité des mulâtres
dans les colonies françoifes. Suppl. III. 973. b. Les colonies
Européennes plus floriffantes dans les zones tempérées que
dans la torride. Ibid. IV. 254. b. •
C O L O N N A D E S , d e l’intervalle entre les colon*
nés dans les colonnades. Suppl. II. 8 12.4, b. Voyc{ I n t e r *
COLONNAT ION 8c COLONADE.
COLONNE, ( Archit.) trois parties qui la compöfent i
cinq efpeces de colonnes : différences de leurs diamètres t
différence entre les anciens 8c les modernes dans la diminu*
tion du fiift des colonnes. III. 651. a. Les architeôes ont
auffi différé fur la quantité de diminution qu’ils doivent don*
ner au diametre fupérieur des colonnes. La diminution des
colonnes ne fe détermine pas par deux lignes droites, mais
par des courbes nommées conchoîdes. Les fufts des colonnes
font iufceptibles de diverfes richeffes, félon les différens
ordres auxquels ils appartiennent. Ornemens du fuft tofean ,
dufuft dorique, du tuft ionique, Ibid. b. du fùft corinthien
8c compofite. Quelquefois l’on fait le fuft des. colonnes en
fpirale, qui pour cette raifon font nommées torfes. Colonnes
coloffales : celle de Trajan : ceüe d’Antonin : celle de
Médicis. Ibid. 652.4. . _ ,
Colonne, proportions des colonnes félon les difterensordres»
XI 610.4,¿.De leur diminution. Sàppl. 11.722. a. De leur
renflement. XIV. 108.4. Suppl. IV. 605. b: Bande de colonne.
II. <7.4. Cannelures des colonnes. 660.4. Suppl. il. 201» a.
Leur accouplement. 1. 86. b. Suppl. U. Sie. b De 1 intervalle
entre les colonnes, voyeç C o l o n n a d e s . Intercolonnation
appelléearcoftyle.1. 631. | Diftancela pte Convenable■ des
colonnes d’un édifice. VI.ar3. a. Différentes; efpeces de colonnes:
colonne gothique. VII. 749/ b- Cerymio. 11.734.0 Mé-
niane,médiane. X. 333. b. Phofphonque. XII. 318.0. Colonne
rudemée. Suppl. IV- 689. o. Colonne ftatique : colonne fta-
tualre. XV. 497- “■ Torfe' ,X,VI' 434- Colonnes qut accom*
pagnent les arcades. Suppl. I. 531. b. 331. 4. De la taille des
colonnes. Suppl. IV. 603. b. ■ . ; . . , .,
C o l o n n e , (Hiß. anc.) dans la première antiquité, elles
ont fervi’de monument hiftorique. Ce que Jofephe rapporte
des deux colonnes érigées par les enfirns de Seth. M . 652. 4»
Divers ufages que les différens peuples de l’antiquité ont faits
des colortnes. Colonnes militaires des Romains. Comment les
1 Romains 8c les Gaulois défignoient les diftances fur les cot