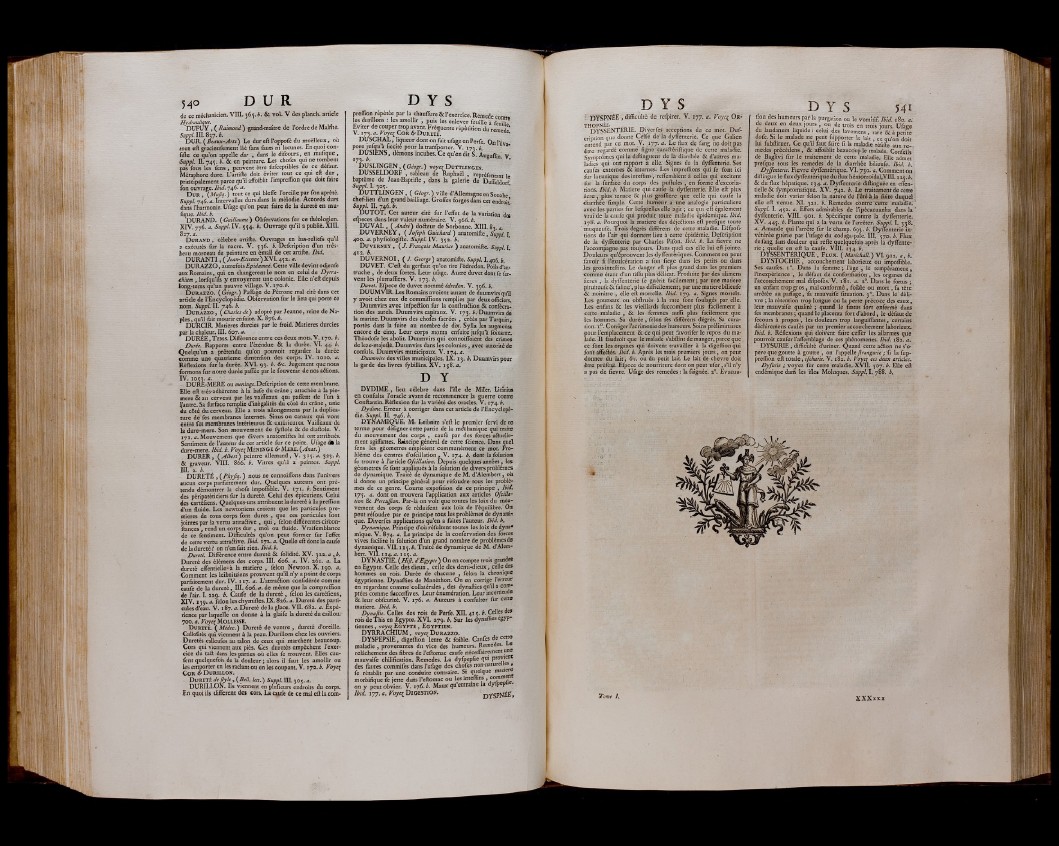
540 D U R D Y S
de ce méchamcien. VIIL 365. b. & v o l . V des planch. article
^Dü pJ y , ( Raimond) grand-maître de l’ordre de Malrhe.
Suppl. III. 837. b. _ %
DUR. ( Beaux-Arts) Le dur eft l’oppofé du moelleux, ou
tout eft gracicufement lié fans fauts ni lacunes. En quoi con-
fifte ce qu’on appelle dur , dans le difcours, en mufique,
Suppl. D. 745. b. & en peinture. Les chofes qui ne tombent
pas fous les fens, peuvent être fùfceptiblcs de ce défaut.
Métaphore dure. L’artifte doit éviter tout ce qui eft dur ,
principalement parce qu’il affoiblit l’impreffion que doit faire
fon ouvrage, lbid. 746. a.
D u r , (Mufiq. ) tout ce qui bleffe 1 oreille par fon aprête.
Suppl. 746. a. Intervalles durs .dans la mélodie. Accords durs
dans l’harmonie. Ufage qu’on peut faire de la dureté en mufique.
lbid. b. ■ , , , .
DURAND. ( Guillaume ) Obfervations fur ce théologien.
XIV. 776. a. Suppl. IV. 5 54. b. Ouvrage qu’il a publié. XIII.
827. a.
D u r a n d , célébré artifte. Ouvrages en bas-reliefs qu il
a exécutés fur la nacre. V. 536. ¿.Defeription d’un très-
beau morceau de peinture en émail de cet artifte. Ibid.
DURANTI, ( Jean-Etienne) XVI. 45 2. a.
DURAZZO, autrefois Epidamné. Cette ville devint odieufe
aux Romains, qui en changèrent le nom en celui de Dyrra-
chium , lorsqu'ils y envoyèrent une colonie. Elle n’eft depuis
iong-tems qu’un pauvre village. V. 170. b.
D u r a z z o . {Géogr.) Paffage de Pétrone mal cité dans cet
article de l’Encyclopédie. Observation fur le lieu qui porte ce
nom. Suppl. II. 740. b.
D u ra z z o , {Charles de) adopté par Jeanne, reine de Na-
ples, qu’il fait mourir enfuite. X 876. b.
DURCIR. Matières durcies par le froid.' Matières durcies
par la chaleur. III. 607. a.
DURÉE, Tems. Différence entre ces deux mots. V. 170. b.
. Durée. Rapports entre l’étendue & la durée. VI. 44. b.
Quelqu’un a prétendu qu’on pouvoit regarder la durée
comme une quatrième dimenfion des corps. IV. 1010. a.
Réflexions fur la durée. XVI. 93. b. &c. Jugement que nous
formons fur notre durée paffée par le fouvenir de nos aâions.
IV. 1053. a.
■ DURE-MERE ou méningé. Defeription de cette membrane.
Elle eft très-adhérente à la bafe du crâne ; attachée à la pie-
mere & au cerveau par les vaiffeaux qui paffent de l’un à
Vautre.Sa Surface remplie d’inégalités du côté du crâne, unie
du côté du cerveau. Elle a trois allongemens par la duplicature
de fes membranes internes. Sinus ou canaux qui vont
entre fes membranes intérieures & extérieures. Vaifleaux de
la dure-mere. Son mouvement de fyftole & de diaftole. V.
171. a. Mouvemens que divers anatomiftes lui ont attribués.
Sentiment de l’auteur de cet article fur ce point. Ufage d i la
dure-mere. lbid. b. Voye{ M é n in g e & M e r e . {Anat.)
DURER, {Albert) peintre allemand, V. 315.a. 323.b.
& graveur. VIII. 866. b. Vitres qu’il a peintes. Suppl.
III. 2. b.
DURETÉ, ( Phyfiq. ) nous ne connoiffons dans l’univers
aucun corps parfaitement dur. Quelques auteurs ont prétendu
démontrer la chofe impoflibie. V. 171. ¿. Sentiment
des péripatéticiens fur la dureté. Celui des épicuriens. Celui
des cartefiens. Quelques-uns attribuent la dureté à la prefîion
d’un fluide. Les newtoniens croient que les particules premières
de tous corps font dures , que ces Jparticules font
jointes par la vertu attraâive , qui, félon différentes cir'con-
ftançes, rend un corps dur , mol ou fluide. Vraifemblance
de ce fentiment. Difficultés qu’on peut former fur l’effet
de cette vertu attraâive. lbid. 172. a. Quelle eft donc la caufe
de la dureté ? on n’en fait rien. lbid. b.
Dureté. Différence entre dureté & folidité. XV. 322. a , b.
Dureté des élémens des corps. III. 606. a. IV. 261. a. La
dureté effentielle*-à la matière , félon Newton. X. 190. a.
Comment les leibnitziens prouvent qu’il n’y apoint de corps
parfaitement dur. IV. 117. a. L’attraétion confidérée comme
caufe de la dureté, EU. 606. a. de même que la compreffion
de l’air. I. 229. b. Caufe de la dureté , félon les cartéfiens,
XTV. 139. a. félon les chymiftes. IX 826. a. Dureté des particules
d’eau. V. 187. a. Dureté de la glace. VII. 682. a. Expérience
par laquelle on donne à la glaife la dureté du caillou.-
700. a. Voye{ MOLLESSE.
D u re té . {Médec.) Dureté de ventre , dureté d’oreille.
Callofitès qui viennent à la peau. Durillons chez les ouvriers.
Duretés catieufes au talon de ceux qui marchent beaucoup.
Cors qui viennent aux piés. Ces duretés empêchent l’exercice
du taft dans les parties où elles fe trouvent. Elles cau-
fent quelquefois de la douleur ; alors il faut les amollir ou
les emporter en les raclant ou en les coupant. V. 172. b. Voye^
C o r g* D u r i llo n .
Dureté de flyle, ( Bell. lett. ) Suppl. m. 30c. a.
DURILLON. Ils viennent en plufieurs endroits du corps.
En quoi Us différent des cors. La caufe de ce mal eft la coinpreffion
repetèe par U chauffore & l’exercice. Remedc COntr.
les durillons : les amollir , puis les enlever feuille à feuilu
Eviter de couper trop avant. Fréqueute répétition du remedt
V. 173. a. Voye[ C o r & D u r e t e . *
DUSCHAL, liqueur dont on fait ufag_e enPerfe. On l’éva
pore jufau’à ficcité pour la tranfporter. V. 173. ¿.
DUSIENS, démons incubes. Ce qu’en dit S. Âuguflin. V
1)USLINGEN, { Géogr. ) voyez D u t t l in g e n
DUSSELDORF , tableau de Raphaël , repréfentant le
baptême de Jean-Baptifte, dans la galerie de Duffeldorf
S u t Î l ïN G E N , ( Géogr.) ville d’Allemagne en Souabe
chef-lieu d’un grand bailliage. Grofles forges dans cet endroit
Suppl. II. 746. b.
DUTOT. Cet auteur cité fur l’effet de la variation des
efpeces dans leur valeur numéraire. V. 966. b.
DU V A L, (André) doétcur de Sorbonne. XIII. 83, a.
DUVERNEY, ( Jofeph Guichard ) anatomifte, Suppl. L
400. a. phyfiologifte. Suppl. IV. 352. b.
D u v e r n e y , (/ . François Maurice ) anatomifte. Suppl. L
412. b.
DUVERNOI, ( J. George) anatomifte. Suppl. 1. 406,
DUVET. C’eft du gerfaut qu’on tire l’édreaon. Poils d’autruche
, de deux fortes. Leur ufage. Autre duvet dont fe fervent
les plumaffiers. V. 173. b.
Duvet. Efpece de duvet nommé édredon. V. 396. b.
DUUMVIR. Les Romains avoient autant de duumvirs'qu’ft
y avoit chez eux de commiffions remplies par deux officiers.
Duumvirs avec infpeétion fur la conftruâion & confieration
des autels. Duumvirs capitaux. V. 173. ¿. Duumvirs de
la marine. Duumvirs des choies facrées , créés par Tarquin,
portés dans la fuite au nombre de dix. Sylla les augmenta
encore de cinq. Leur corps monta enfuite jufqu’à foixanre.
Théodofe les abolit. Duumvirs qui connoiffoiént des crimes
de leze-majefté. Duumvirs dans les colonies, avec autorité de
confuls. Duumvirs municipaux. V. 174. a.
Duumvirs des villes municipales. IX 13. b. Duumvirs pour
la garde des livres fybillins. XV. 138. a.
D Y
DYDIME, lien célébré dans l’ifle de Miler. Licinim
en confulta l’oracle avant de recommencer la guerre contre
Conftantin. Réflexion fur la variété des oracles. V. 174. b.
Dydirnc. Erreur à corriger dans cet article de l’Encyclopédie.
Suppl. II. 746. b.
DYNAMIQUE. M. Leibnitz s’eft le premier fervi de ce
terme pour défigner cette partie de la mebhanique qui traite
du mouvement des corps , caufé par des forces aâuelle-
ment agiffantes. RuLncipe général de cette fcience. Dans quel
fens les géomètres emploient communément ce mot. Problème
des centres d’ofcillation, V. 174. b. dont la folutioa
fe trouve à l’article Ofcillation. Depuis quelques années, les
géomètres fe font appliqués à la folution de divers problèmes
de dynamique. Traité de dynamique de M. d’Alembert, où
il donne un principe général pour réfoudre tous les problèmes
de ce genre. Courte expofition de ce principe , lbid.
175. a. dont on trouvera l’application aux articles Ofcillation
& Percujfton. Par-là on voit que toutes les loix du mouvement
des corps fe réduifent aux loix de l’équilibre.1 On
peut réfoudre par ce principe tous les problèmes de dynami-.
que. Diverfes applications qu’en a faites l’auteur, lbid. b.
Dynamique. Principe d’où réfultent toutes les loix de dyna*
mique. V. 874. a. Le principe de la confervation des forces
vives facilite la folution d’un grand nombre de problèmes de
dynamique. VII. nq.b. Traité de dynamique de M. d’Alembert.
VII. 114. a. 115. a.
DYNASTIE. {Hift. d’Egypte") On en compte trois grandes
en Egypte. Celle des dieux, celle des demi-dieux, celle des
hommes ou rois. Durée de chacune , félon la chronique
égyptienne. Dynafties de Manéthon. On en corrige l’erreur
en regardant comme collatérales , des dynafties qu’ila comptées
comme fucceifives. Leur énumération. Leur incertitude
& leur obfcurité. V. 176. a. Auteurs à confulter fur cette
matière, lbid. b.
Dynaftie. Celles des rois de Perfe. XIL 415. b. Celles des
rois de This en Egypte. XVI. 279. b. Sur les dynafties égyp*
tiennes, voyez E g y p t e , E g y p t ie n .
DYRRACHIUM, voyez DURAZZO.
DYSPEPSIE, digeffion lente & foible. Canfes de cette
maladie, provenantes du vice des humeurs. Remèdes,
relâchement des fibres del’eftomac caufe néceffairementun
mauvaife chilification. Remedes. La dyfpepfie qui PT0Y}
des fautes commifes dans l’ufagc des chofes non-naturel »
fe rétablit par une conduite contraire. Si quelque m*a
morbifique fe jette dans l’eftomac ou les inteftins -
on y peut obvier. V. 176. b. Maux qu’entraîne la dyfpepüe.
Ibid. 177. a. Voyei D i g e s t io n . DYSPNÉE»
D Y S
- DYSPNÉE, difficulté de refpirer. V. 177. a. Voye{ O r -
THj)YSSENTERIE. Diverfes acceptions de ce mot. Defeription
que donne Celfé de’ la dysenterie. Ce que Galien
entend par ce mot. V. 177. a. Le flux de fang ne doit pas
être regardé comme figne 'çaràftériftique de cette maladie.
Symptômes qui la diftinguent de là diarrhée & d’autres maladies
qui ont rapport à elle. Signes de la dyffenterie. Ses
caufes externes oc internes: Les impreffions qui fe font ici
fur la tunique des inteftins', reffemblent à celles qui excitent
• fur la furface du corps des puftules, en forme d’excoriations.
Ibid. b. Matière qui caufe la dyffenterie. Elle eft plus
âcre y.plus'tenace & plus groffière que celle qui caufe la
diarrhée fimple. Cette humeur a une analogie particulière
avec les parties fur iefquel les elle agit; ce qui eft également
vrai'de la caufe qui produit toute maladie épidémique, lbid.
178. a. Pourquoi la matière des déjeétions eft prefque toute
0 muqueufe. Trois degrés différens de cette maladie. Difpofi-
tions de l’air qui donnent lieu à cette épidémie. Defeription
de la dyffenterie par Charles Pifori. Ibid. b. La fievre ne
l’accompagne-pas toujours. Dans quel cas elle lui eft jointe.
Douleurs qu’éprouvent les dyffenteriques. Comment on peut
favoir fi .l’éxulcération a fon fiege dans les petits ou dans
les gros inteftins. Le danger eft plus grand dans les premiers
commè étant d’un tiffu plus délicat. Produite far des alimens
âcres , la dyffenterie fe guérit facilement ; par une matière
pituiteufe 8c faline', plus difficilement; par une matière bilieufe
Oc noirâtre , elle eu mortelle. Ibid. 179. a. Signes mortels.
Les goutteux ou obftrués à la rate font foulagés par elle.
Les enfàns & les vieillards fuccombent plus facilement à
cette. maladie , & les femmes auffi plus facilement que
les hommes. Sa durée, félon fes différens dégrés. Sa curation.
i°. Corriger l’acrimonie des humeurs. Soins préliminaires
pour, l’emplacement & ce qui peut favorifer le repos du malade.
U faudroit que le malade s’abftint de manger, parce que
ce font les organes qui doivent travailler à la digeftion qui
font affeâés. lbid. b. Après les trois-premiers jours, on peut
donner du lait', bc. ou du petit lait. Le lait de chevre doit
être préféré. Efpece de nourriture dont on peut ufer, s’il n’y
a pas de fievre. Ufage des remedes.: la faignée. 20. Evacua-
D Y S 541
| tion des humeurs pafla purgation ou le vomitif, lbid. 180. P
de deux en deux jours , ou de trois en trois jours. Ufage
du laudanum liquide : celui des lavemens , rare & à petite
dofe. Si le malade ne peut fiipporter le lait, ce qu’on doit
lui fubftituer. Ce qu’il faut faire fi la maladie réfifte aux remèdes
précédehs, 8c affoiblit beaucoup le malade. Confeils
de Baglivi fur le traitement de cette maladie. Elle admet
prefque tous les remedes de la diarrhée bilieufe. lbid, b.
Dyffenterie. Fievre dyffentérique. VI. 730. «. Comment ou
diftingue le flux dyffentérique du flux hémorroïdal,VIIL 12«.¿.
& du flux hépatique. 134. a. Dyffenterie diftinguée en effen-
tielle & fymptomatique. XV. 742. b. Le traitement de cette
maladie doit varier lelon la nature'de l’été à la fuite duquel
elle eft venue. XI. 321. b: Remedes contre'Cette maladie:
Suppl. I. 452. a. Effets admirables de l’ipécacuanha dans la
dyilenterie. VIIL 901. b. Spécifique contré la dyffenterie.
XV. 445. b. Plante qui a la vertu dè l’arrêter. Suppl. I. 338.
a. Amande qui l’arrête fur le champ. 693. b. Dyflenterie invétérée
guérie par l’ufage du codaga-palc. III, 570. b. Flux
de fang lans douleur qui refte quelquefois après là dyffente- '
rie; quelle en eft la caufe. VÏII. 134. ¿. .
DYSSENTÉRIQUE, F l u x . {Maréchall.) VI. 912. a, b.
DYSTOCHIE, accouchement laborieux où impoflibie.
Ses caufes. i°. Dans la femme; l’âge , le tempérament,
l’inexpérience , le défaut de confonhation, les organes de
l’accouchement mal difjmfés. V. 181. a. 20. Dans le foetus;
un enfant trop gros, mal conformé, foible ou mort, fa tête1
arrêtée au paffage, fa mauvaife fituation. 30. Dans le délivre
; la rétention trop longue ou la perte précoce des eaux,
leur mauvaife qualité ; quand le foetus fort enfermé dans
fes membranes ; quand le placenta fort d’abord, le défaut de
fecours à propos, les douleurs trop languiffantes, certains
déchiremens caufés par un premier accouchement laborieux.
Ibid. b. Réflexions qui doivent faire ceffer les allarmes que
pourroit caufer l’affemblage de ces phénomènes. Ibid. 182. a.
DYSURIE, difficulté d’uriner. Quand cette aétion rie s’opère
que goutte à goutte , on l’appelle flranguiie ,*:fi la fup-
preffion eft totale, ifchurie. V. 182. b. Voyez ces deux articles.
Dy furie ; voyez fur cette maladie^XVlI. 507. b. Elle eft
endémique dam les ifles Moluques. Suppl. I. 708. b.